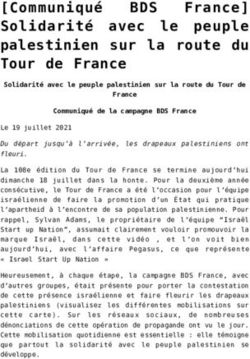" Me fui quedando " : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Artículo de investigación
Recibido: 15 de mayo de 2020. Aprobado: 18 de julio de 2020.
DOI: 10.17151/rasv.2021.23.1.7
« Me fui quedando » : le provisoire durable
des étudiants colombiens à Paris
“Me fui quedando”: la estadía temporal-duradera de estudiantes colombianos en París
“Me fui quedando”: the temporary-prolonged stay of Colombian students in Paris
Résumé Marcia Carolina
Cet article porte sur la migration étudiante de Ardila Sierra
Colombiens à Paris. L’objectif est de reflechir sur Doctora en Estudios Urbanos
les processus à travers lesquels une ville considérée de l’EHESS, profesora de la
comme un lieu de transit est devenue une ville de Universidad Pedagógica y
résidence à plus long terme. L’etude repose sur une Tecnológica de Colombia,
enquête ethnographique multi située realisée en UPTC. Investigadora grupos
France et en Colombie. Le texte se divise en trois Hisula (UPTC, Tunja) e
sections : la première explique le double caracter IRIS (EHESS, Paris). Tunja,
transitoire des étudiants migrants, la deuxième Boyacá, Colombia.
explore le contexte de départ, et la troisième
analyse les conditions d’existence des étudiants marcia.ardila@uptc.edu.co
colombiens non boursiers en France. On conlue ORCID: 0000-0001-8722-5496
que pour comprendre les réorientations du projet Google Scholar
des étudiants et l’allongement de leurs séjours à
Paris, il faut étudier parallèlement le contexte de
départ et celui d’arrivée, tant au niveau individuel
qu’au niveau social et transnational.
Mots-clés : migration colombienne;
étudiants étrangers; étudiants
travailleurs; provisoire-durable.
Cómo citar este artículo:
Ardila-Sierra, M. C. (2021). « Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris.
Revista de Antropología y Sociología: Virajes, 23(1), 155-178. https://doi.org/10.17151/rasv.2021.23.1.7
ISSN 0123-4471 (Impreso) ISSN 2462-9782 (En línea) | 155 |Marcia Carolina Ardila Sierra
Resumen
Este artículo aborda la migración de estudiantes colombianos en París.
El objetivo es reflexionar sobre los procesos a través de los cuales una ciudad de
estadía temporal deviene un lugar de residencia prolongada. La investigación
se apoya en una etnografía multisituada y entrevistas en profundidad realizadas
en Francia y en Colombia. El texto se divide en tres secciones: la primera explica
el doble carácter de transitoriedad de los estudiantes migrantes, la segunda
explora el contexto de partida, y la tercera analiza las condiciones de vida de
estudiantes colombianos sin beca en Francia. Se concluye que para comprender
las reorientaciones del proyecto de los/las estudiantes y el alargamiento de sus
estadías en París, es necesario atender de manera paralela el contexto de origen
y el de llegada, tanto a nivel individual como a nivel social y transnacional.
Palabras clave: migración colombiana; estudiantes extranjeros; estudiantes
trabajadores.
Abstract
This article addresses the migration of Colombian students in Paris.
The objective is to reflect about the processes through which a temporary-
stay city becomes a place of prolonged residence. The research is based in
a multi-sited ethnography and in-depth interviews conducted in France and
Colombia. The text is divided into three sections: The first section explains the
dual nature of transience of migrant students; the second section explores the
context of departure; and the third section analyses the living conditions of
Colombian students without scholarships in France. It is concluded that in order
to understand the reorientation of the students’ project and the lengthening
of their stay in Paris, it is necessary to address the context of origin and arrival in
parallel, both at an individual and at a social and transnational level.
Keywords: Colombian migration, foreign students, working students.
D
ans cet article nous anlaysons la « migration étudiante » de
Colombiens et Colombiennes à Paris, qui selon Andrea Rea et
Frank Caestecker (2012) se caractérise par des établissements
durables dans le pays d’accueil1: elle a lieu lorsqu’ « un projet de courte durée
1
Les auteurs différencient la migration étudiante de deux autres types de carrières chez les étudiants
étrangers. La «mobilité étudiante» est de courte durée et est encadrée par un programme d’échange ou
par une bourse. En raison de sa durée, les étudiants ne tissent pas de liens forts dans le pays d’accueil et
l’installation est rarement envisagée. Et la «migralité», terme emprunté par les auteurs à Coulibay-Tandian,
fait référence à une situation d’entre deux, entre migration et mobilité.
| 156 | RASV. Vol. 23, n.º 1, ene.-jun. 2021. pp. 155-178« Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
se métamorphose dans le temps en un projet de longue durée » (p. 251).
Nous nous concentrons sur des projets d’étudiants dont le séjour en
France est présumé temporaire et qui, après différentes vicissitudes, se
muent en installations prolongées, perdant même de vue un possible
retour en Colombie.
Avec Abdelmalek Sayad (1999), nous nous interrogeons sur le
sentiment de provisoire durable dans la migration, c’est-à-dire sur la
contradiction temporelle vécue par l’individu lorsqu’il se sent engagé dans
une condition qui peut durer, alors qu’il continue à vivre comme si son
émigration n’était que passagère. Cette condition, selon le sociologue
algérien, influence les pratiques et les perceptions du monde social et
politique des immigrants et, bien évidemment, affecte leur représentation
de la temporalité. A partir de ce caractère provisoire, nous analysons
les réorientations du projet des étudiants à Paris, à la fois grâce à la
consolidation d’un savoir-faire de la ville d’immigration, que du fait de
nouvelles configurations familiales, sociales et politiques survenues en
Colombie – autrement dit, du fait d’évènements résultant des intentions
de l’individu que de ceux qui lui échappent.
Actuellement, les étudiants colombiens sont le second groupe
d’Amérique Latine en France après les Brésiliens, et avant les Mexicains
(Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et
de la recherche, 2019). Bien que les ressortissants colombiens ne
représentent qu’une faible proportion des étudiants étrangers en France,
majoritairement originaires de l’Afrique francophone2, le pays est l’une
des premières destinations de ces jeunes pour continuer leurs études.
Les cas qui nourrissent nos analyses sont ceux de Colombiens
arrivés à Paris pour suivre des formations de troisième cycle, entre la fin
des années 1970 et le début des années 2000. Il s’agit de cinq hommes
et de cinq femmes, originaires de Bogotá et de Cali. Nous les avons
interviewés au moins deux fois, entre 2009 et 2016, et parfois nous
avons pu les rencontrer en Colombie et en France, ce qui a apporté une
profondeur temporaire aux analyses, nécessaire pour penser en termes
de projets migratoires. Ils sont toutes et tous partis en France par leurs
propres moyens, sans aucune bourse ou financement institutionnel,
ce qui est une caractéristique importante, car ils avaient une certaine
2
Selon le Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche (2019) «plus d’un
étudiant international sur deux est africain. Les continents les plus représentés sont ensuite l’Europe (19,4%),
l’Asie (19,1%) et l’Amérique (8,5%)».
| 157 |Marcia Carolina Ardila Sierra
liberté quant à la durée du séjour et pour continuer ou arrêter
leurs études.3
Ces hommes et femmes n’étaient plus des étudiants lorsque nous
les avons rencontrés, ce qui apporte un éclairage nouveau au sujet des
migrations étudiantes, puisque la plupart des enquêtes dans le domaine
portent sur les étudiants actifs, ou sur ceux qui viennent juste de quitter
leur statut d’étudiant. Le fait de parler de ces expériences avec le recul
du temps, permet d’identifier les bifurcations ou les ruptures associées
au passage d’un projet étudiant à une installation sur le sol français, et les
effets de ce choix sur le parcours migratoire de chacun et chacune. Si les
données statistiques concernant les étudiants étrangers qui s’installent à
la suite de leurs spécialisations ne sont pas d’un accès facile (Pinto, 2015),
on peut en dire autant de leurs trajectoires migratoires plusieurs années
après leur passage par les institutions éducatives françaises.
L’article se divise en trois sections. La première explique le double
caracter transitoire des étudiants migrants, la deuxième explore le
contexte de départ en Colombie, et la troisième analyse les conditions
d’existence des étudiants colombiens à Paris et l’allongement de leur
séjour en France.
Etre étudiant et immigrant : un double caractère transitoire
Les trajectoires des étudiants colombiens à Paris sont traversées par
un double état de « transitoire » : d’abord par leur condition d’étudiants,
et ensuite par leur statut d’étrangers de passage en France. La question de
l’élasticité temporaire et du caractère transitoire implicite de la condition
d’étudiant a été soulignée par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron
(1964) dans Les héritiers. Dans la parenthèse créée par les études, l’étudiant
échappe aux rythmes et aux horaires de la société globale ; ses actions dans
le présent prennent sens en fonction de l’avenir professionnel auquel il se
prépare. Ainsi, affirment les auteurs, « l’étudiant n’a pas et ne saurait avoir
d’autre tâche que de travailler à sa propre disparition en tant qu’étudiant.
Ce qui supposerait qu’il s’assume en tant qu’étudiant et en tant qu’étudiant
provisoire » (pp. 84-85).
Quant aux étudiants étrangers qui s’installent en France, nous
considérons que leur migration s’inscrit dans les dynamiques de la
3
Les analyses présentées ici s’inscrivent dans une recherche doctorale, soutenue en 2019 à l’EHESS, intitulée
Les paysages de la migration colombienne à Paris : Espaces traversés, espaces d’attente, espaces habités
(Ardila, 2019). L’enquête s’est d’éroulée à la fois à Paris et dans des régions colombiennes d’émigration vers
la France comme Bogotá, Risaralda (Santuario et Dosquebradas) et le nord du Valle du Cauca (Cartago).
| 158 | RASV. Vol. 23, n.º 1, ene.-jun. 2021. pp. 155-178« Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
migration de transit, conçue comme un projet de courte durée, le retour
en Colombie étant au cœur de ces projets avant le départ, et durant
l’immigration. Parfois l’idée de rentrer s’efface avec le temps, d’autres fois
elle reste présente, même après plusieurs années de résidence à Paris.
Nous divergeons en ce sens des études sur la migration colombienne qui
excluent la population étudiante :
On ne considère pas comme des migrations les déplacements
touristiques, les voyages d’affaires ou d’études, étant donné
leur caractère transitoire et parce qu’ils n’impliquent pas de
réorganisations vitales ; ils ne supposent pas un changement
d’environnement politique-administratif, et n’entraînent pas
l’interruption d’activités précédentes. (Blanco cité par Puyana,
Micolta, et Palacio, 2013, p. 18)4
Cette considération peut être faite dans d’autres pays d’accueil où
le travail salarié des étudiants est interdit par la loi, ou bien lorsque les
étudiants bénéficient davantage de financements institutionnels, ou dans
le cas précis de mobilité étudiante telle qu’elle est comprise par Rea et
Caestecker. À notre avis, elle n’est pas valable dans le cas qui nous occupe.
En premier lieu parce que contrairement au paragraphe cité ci-dessus, au
long du séjour en France, les étudiants vivent des transformations vitales
qui s’accompagnent de nouvelles configurations identitaires. L’expérience
internationale change les perceptions du monde et les relations avec le
pays d’origine (Agulhon & de Brito, 2009) et entraîne des transformations
importantes, susceptibles de mettre en cause les projets initiaux et les
représentations des jeunes étudiants (Ennafaa & Paivandi, 2008).
Elle ne nous paraît pas adaptée en second lieu, parce que le voyage
éducatif est animé par des intérêts sociaux et culturels, différents
des ambitions purement académiques. Connaître d’autres cultures,
faire l’expérience de vivre en dehors du pays, acquérir une certaine
indépendance familiale, prendre de la distance avec certains espaces et
routines sont autant d’arguments également importants dans le projet
de départ. Certes, la migration des étudiants présente des différences
importantes avec la migration ordinaire : par les origines sociales des
intéressés, leur niveau de scolarité, par sa finalité, parce que la durée, en
principe, est déterminée par le diplôme visé, par le positionnement de
chacun face aux institutions françaises.
4
Traduit de l’espagnol par nos soins.
| 159 |Marcia Carolina Ardila Sierra
La mention « étudiant autorisé à travailler à titre accessoire » sur
le titre de séjour, contient la liminalité de deux statuts entre lesquels son
porteur se partage : celui de l’étudiant et celui du travailleur migrant.
L’extrait d’entretien suivant nuance bien cette reflexion :
Je pense que nous [les étudiants] avons construit une nouvelle
catégorie. Parce que nous, nous ne sommes pas venus pour obtenir
de l’argent, mais pour nous confronter à cette société, afin de pouvoir
faire nos études supérieures. Et en ce cas, nous nous trouvons dans
une situation économique très compliquée. Nous sommes obligés
d’aborder le monde du travail à partir du monde académique.
Nous n’avons pas de bourse, nous devons travailler tous les jours,
nous devons faire notre recherche pendant que nous travaillons.
Lorsque nous parlons de l’immigration, nous ne parlons pas des
autres, nous parlons de nous-mêmes. [Homme originaire de Bogotá.
Arrivé en France en 1997. Il a vécu 12 ans à Paris, où il a complété sa
formation supérieure, a exercé des travaux divers et est devenu père
d’une fille. En 2019 il vivait en Colombie]
Ce « double rôle » est déterminant dans la relation établie avec la ville
et ses habitants parisiens. Si l’étudiant est venu pour se former, il est censé
fréquenter des établissements éducatifs et des espaces académiques.
Or, pour assurer son quotidien, il pourra être amené à réaliser des
« petits boulots » qui en général n’ont aucun rapport avec sa formation
académique et pour lesquels il est surqualifié. Le travail devient parfois
plus permanent qu’« accessoire », et la quantité et la qualité du temps
consacré aux études peuvent en être sérieusement affectées. Cet aspect
de la vie étudiante ressort souvent comme une des principales difficultés
nuisant aux études. Il est fortement présente chez les individus
interviewés par Brice Mankou dans son enquête sur les Camerounaises
non-boursières du Nord-Pas-de-Calais et les contraintes qui les obligent
parfois à choisir entre les études et le travail.
En ce sens, les trajectoires reconstituées dans l’enquête montrent
l’instabilité et les limites poreuses entre des figures sociaux à partir
desquelles on analyse les mobilités humaines. Comme le rappelle
Catherine Wihtol de Wenden (2010), au long de son parcours un
immigrant peut « glisser » d’un profil à l’autre ou appartenir à plusieurs
groupes de manière simultanée. Ainsi, on peut être réfugié et étudiant
et, en même temps, travailler pour assurer son quotidien et celui des
siens en Colombie.
| 160 | RASV. Vol. 23, n.º 1, ene.-jun. 2021. pp. 155-178« Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
Envisager le départ pour étudier en France
L’élaboration d’un projet migratoire résulte en effet rarement d’un
simple choix personnel. Parce qu’il plonge souvent ses racines dans
la longue histoire de l’individu, de son groupe d’appartenance et,
plus largement, du type de société dans lequel il se situe.
Cette citation au sujet des étudiants algériens en France, empruntée
à Constance de Gourcy (2009, p. 97), nous rappelle la complexité des
éléments en jeu à l’origine du départ pour études. Comme le montrent
Alain Coulon et Saeed Paivandi (2003), pour comprendre pourquoi on
choisit la France pour continuer ses études, il faut prendre en compte
l’ensemble des acteurs institutionnels et individuels : le contexte d’origine
et celui d’accueil, les agents intermédiaires, les réseaux sociaux et les
conditions du candidat au départ.
Nous restons dans le sillage de ces auteurs pour intégrer différentes
conditions structurelles à nos analyses, telles que les différences entre
le système éducatif supérieur en France et en Colombie, les rapports
académiques et culturels entre la France et l’Amérique Latine, l’influence
des institutions intermédiaires en Colombie, le rôle de la famille et l’âge
auquel on part, ou encore l’existence des réseaux sociaux d’étudiants
colombiens à l’étranger.
Les faiblesses de l’enseignement supérieur en Colombie
En ce qui concerne l’enseignement supérieur en Colombie, il
faut signaler que, malgré l’augmentation massive des programmes
universitaires à partir des dernières décennies du XXe siècle, la Colombie
a un des taux de couverture les plus bas en éducation supérieure parmi
les pays de l’Amérique Latine à PIB similaire. Dans les années 1940 et 1960
« le titre universitaire constituait un mécanisme d’ascension économique
et sociale relativement sûr, en étant l’une des voies les plus importantes
ouvertes aux secteurs de classe moyenne »5 (Melo, 1985, p. 260).
Cette haute valorisation sociale des diplômes a contribué à la
croissance chaotique de l’éducation supérieure en Colombie les décennies
suivantes. De 190 programmes de licence en 1960, on passe à 471 en 1971,
et à près de 8 000 en 1999 (Aldana, 2001). Cette massification, comme
dans d’autres pays latino-américains, s’est concentrée dans les principaux
centres urbains du pays. En conséquence, une proportion importante
5
Traduit de l’espagnol par nos soins.
| 161 |Marcia Carolina Ardila Sierra
des personnes provenant des régions pauvres et des secteurs ruraux
du pays est empêchée d’accéder à l’éducation universitaire (Melo, 1985;
Gomez, 2000; Aldana, 2001). La couverture est encore plus limitée dans
les formations de troisième cycle. En dépit d’une hausse des programmes
et des effectifs à partir des années 2000, la Colombie est loin d’autres pays
latinoaméricains comme l’Argentine, le Chili, Cuba, l’Uruguay ou Puerto
Rico (Melo, Ramos & Hernández, 2014).
Ces restrictions sont liées surtout aux prix élevés des droits
d’inscription, à l’absence d’allocations et de bourses, aux difficultés
d’autofinancement, au nombre réduit des programmes, et au fait qu’ils
n’existent que dans les grandes villes. Bien que dans les dernières années
les modalités de financement et les crédits éducatifs aient augmenté pour
des études post-graduées en Colombie et à l’étranger, ceux-ci sont encore
largement insuffisants. Dans ces circonstances, on comprend mieux que
les candidats regardent à l’étranger, vers des destinations où la qualité de
l’enseignement est reconnue, et les coûts d’inscription plus bas.
Les étudiants colombiens qui suivent des études de troisième
cycle à l’étranger font partie de cette proportion du pays qui a eu accès à
l’éducation universitaire. Sans être forcément issus d’une élite sociale et
économique, ces jeunes appartiennent à un milieu cultivé et disposent d’un
capital culturel élevé. Même si leurs profils sociaux et leurs trajectoires
de vie sont divergentes, ils et elles partagent certaines conditions : ce
sont de jeunes adultes des classes moyennes et supérieures, issus des
milieux urbains, diplômés des universités publiques et privées de longue
tradition en Colombie.
Les liens académiques et culturelles entre la France et l’Amérique Latine
La longue tradition d’accueil d’étudiants internationaux dans les
universités françaises est bien connue. Actuellement, la France est le
quatrième pays d’accueil des étudiants internationaux derrière les
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie (Ministère de l’éducation
nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2019).
Dans notre enquête, les avantages de la France et plus
particulièrement de Paris, comme pays d’accueil d’étudiants de tous les
coins de la planète, font mention de la concentration et de la qualité
de l’enseignement français, du prestige des universités, des frais
d’inscription peu élevés, de la grande diversité de centres de recherche.
Et puisque les étudiants colombiens en France sont majoritairement
financés par des ressources personnelles, le choix dans leur cas est
| 162 | RASV. Vol. 23, n.º 1, ene.-jun. 2021. pp. 155-178« Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
également influencé par l’autorisation accordée aux étudiants étrangers
de travailler à temps partiel. Néanmoins, à l’heure où notre enquête
s’est achevée, ces conditions ont commencé à subir des mutations
substantielles, notamment en ce qui concerne la forte augmentations
des frais d’inscription pour les élèves étrangers non-européens.6
Dans leur recherche sur les étudiants étrangers en France,
Ridha Ennafaa et Saeed Pavandi (2008) identifient quatre grandes
caractéristiques des étrangers inscrits dans des universités françaises :
leur rapport à la langue française ; le fait que la France constitue leur
premier choix ; le projet de compléter leurs études, après avoir obtenu
un premier diplôme supérieur dans leur pays ; le départ dans le cadre
d’une initiative individuelle, sans financements institutionnels. Le profil
des étudiants colombiens en France correspond à ces observations, sauf
en ce qui concerne le premier aspect. En effet, malgré les limitations
susceptibles d’entraîner la méconnaissance plus ou moins élevée du
français, chez les étudiants et les intellectuels de l’Amérique Latine,
l’attirance pour la France s’explique par les rapports historiques entre
les deux régions, particulièrement renforcés au long du XXe siècle.
Denis Rolland et Maire Touzalin (1994) abordent l’évolution des
liens entre la France et le sous-continent à partir de la fin des années
1930. Pendant la guerre, la création des instituts français en Amérique
Latine, marque l’intérêt de préserver l’affinité culturelle et de favoriser
la francophilie. L’Alliance Française de Bogotá, par exemple, est fondée
dans ce cadre en 1944. Ensuite, après la Libération, cet objectif se
prolonge par la multiplication des lieux de rencontre à Paris à l’enseigne
de l’Amérique Latine (tels que la Maison de l’Amérique Latine en 1945, ou
le groupe d’amitié France Amérique Latine en 1947), une relance qui, selon
les auteurs, semble s’achever avec l’inauguration en 1954 de l’Institut des
Hautes Études de l’Amérique Latine.
Au cœur de ces relances, les artistes, étudiants et réfugiés venus à
Paris entre les années 1950 et 1980 – parmi eux notamment les écrivains
du boom latino-américain, enrichissent les imaginaires sur la figure de
l’intellectuel latino-américain à Paris. Ils sèment les bases d’une migration
plus récente, capable d’accueillir et orienter une affluence étudiante
ultérieure, incluant désormais les classes moyennes et non seulement
6
A la fin 2018, le gouvernement a annoncé une augmentation des frais d’inscription pour les étudiants
étrangers non éuropeens, de seize fois plus que pour les étudiants français et européens. Cette annonce
a été contesté au sein de la communauté universitaire et a donné lieu à des mouvements de mobilisation,
car elle remet en question le principe d’égalité propre au système éducatif français. Le 1er juillet 2020, le
Conseil d’État a validé cette hausse controversée (Le Monde, 2020).
| 163 |Marcia Carolina Ardila Sierra
les élites, comme cela avait été le cas dans les décennies précédentes.
Pour eux, l’idée d’être de passage prédomine ; l’Europe n’est pas
pensée comme terre d’installation définitive (Yépez & Herrera, 2007).
Cette ouverture vers les classes moins aisées s’explique également par
la mondialisation du marché de la formation, par l’essor mondial du
transport et par l’augmentation d’une migration colombienne de travail en
Europe, facteurs qui ont contribué à baisser les coûts associés au voyage
et à étendre les réseaux sociaux.
Les processus à travers lesquels s’affirme l’intention de se rendre
en France pour étudier, doivent être compris dans la continuité de cet
intérêt pour maintenir actives les relations culturelles et académiques
entre les deux rives de l’Atlantique. Ces processus sont mijotés dans les
institutions françaises présentes en Colombie, dans d’autres institutions
locales cultivant des liens avec la culture française et dans le milieu
universitaire colombien. Au même titre, la famille et les proches du
candidat (parents et amis) sont déterminants dans l’accumulation
des différentes ressources favorisant une ouverture sur le monde.
Ces espaces intermédiaires, font l’écho à des représentations plus vastes
de Paris en tant que ville accueillant des étudiants du monde entier en
opposition avec un contexte local où le système éducatif présente de
grandes faiblesses et inégalités par rapport à l’accès et aux opportunités.
Le fait d’être familier de la mobilité, de cultures et de langues
étrangères, de voyages longs ou courts à l’étranger augmente les
possibilités de projeter un départ pour études, et atténue les difficultés
dérivées d’un tel programme lorsque l’étudiant arrive à sa destination.
Dans ce sens intervient la notion de « capital international » proposée par
Anne Catherine Wagner (2011) : un capital « indissociablement culturel,
linguistique, et social, en grande partie hérité, renforcé par des cursus
scolaires internationaux et des expériences professionnelles dans plusieurs
pays » (p. 6). Ce capital est plus ou moins affermi selon le candidat et son
milieu social de départ. En fonction des instances intermédiaires qu’il a
intégrées au long de sa vie, l’individu aura un rapport plus faible ou plus
solide avec la dimension internationale.
Par structures intermédiaires nous entendons les institutions ou les
personnes, françaises ou colombiennes, qui se trouvent en Colombie et qui
établissent des ponts avec la France par le biais de la culture, de l’art, de la
langue, ou par l’étude d’une discipline précise. Par exemple les universités,
les institutions éducatives et culturelles françaises, les écoles de langue
française, ou encore les migrants français en Colombie ou les Colombiens
revenus au pays depuis la France. En fait, à de rares exceptions près, tous
| 164 | RASV. Vol. 23, n.º 1, ene.-jun. 2021. pp. 155-178« Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
les étudiants que nous avons rencontrés comptaient sur des amis ou des
proches à Paris, ayant un profil similaire au leur, qui confirment, par leur
expérience, la faisabilité du projet de réaliser des études de troisième cycle
en France. Ces intermédiaires peuvent intervenir dans la vie des individus
bien longtemps avant que le projet international soit effectif, comme
quoi, et comme constaté chez les étudiants brésiliens non-boursiers en
France (Xavier de Brito, 2009), ce sont des projets dont l’implantation est
ancienne. Voyons de plus près les institutions éducatives en Colombie
(les universités colombiennes et les lycées bilangues français-espagnol).
En effet, le fait de privilégier la France sur d’autres destinations est
en rapport avec l’influence de l’Académie française dans le développement
des nombreuses disciplines, notamment dans le domaine des lettres et des
sciences humaines. Dans les salles de cours universitaires, on construit
un capital intellectuel et symbolique nourri d’écoles de pensée et de
référents théoriques français, entre autres. En outre, dans ces espaces, on
est en contact avec des enseignants d’origine française, des enseignants
colombiens formés en France, des camarades qui ont déjà visité la France
et, ces dernières années, des étudiants français en Colombie, profitant
des échanges entre des établissements d’enseignement supérieur des
deux pays. Tout cela constitue un substrat riche qui n’est pas forcément
mobilisé durant la licence, ou juste après le diplôme, mais qui peut rester
en repos et resurgir lors de moments critiques de réorientation de la vie.
Nous rejoignons des enquetes précedents qui ont souligné
l’importance de la période universitaire comme l’occasion d’acquérir des
ressources qui favorisent le projet de départ pour études dans le futur
(Agulhon & de Brito, 2009; Pinto, 2013). Ceux qui ont eu des dispositions
favorables à l’international consolident leur savoir, et ceux qui ont été
exposés à une faible influence internationale gagnent de nouvelles
compétences. On fait mention à la découverte des auteurs et des travaux
étrangers, à l’exposition aux langues étrangères, aux séjours à l’étranger
dans le cadre d’échanges universitaires, ou à l’influence de certains
professeurs qui motivent l’étudiant à faire des études à l’étranger.
Les extraits d’entretien suivants placent bien l’articulation
des différents facteurs mentionnés jusqu’ici, individuels, sociaux et
contextuels, dans la matérialisation d’un voyage d’études : des interactions
avec des référents et avec des enseignants français dans les universités
colombiennes ; les réseaux sociaux transnationaux constitués d’étudiants
de troisième cycle ; les cours de langue française ; les états d’âme et la
situation émotionnelle et affective ; et les coûts d’inscription, largement
inférieurs par rapport à la Colombie. Ils ont tous un rôle déclencheur
| 165 |Marcia Carolina Ardila Sierra
dans le départ. A la question « comment avez-vous décidé de venir en
France? », on répond :
Parce qu’il y avait un programme entre l’Université des Andes…
Je ne sais plus si c’était Paris 1 ou Paris 2. Je voulais faire économie
du développement. En fin de compte, je suis allé à l’IEDES [Institut
d’étude du développement économique et social]. À l’époque ça
coûtait 800 francs, soit 120 euros. L’équivalence de ce que j’allais
faire à l’IEDES, aux États-Unis coûtait 5 000 dollars. Pareil en
Angleterre. Ici [à Paris] ça ne coûtait rien. […] Je suis arrivé en juin,
et en septembre j’étais dans un amphithéâtre avec un professeur
que je lisais en Colombie. Pierre Salama. Je me rappelle très bien!.
[Homme originarie de Cali. Arrivé en France en 1983. Il a vécu 30 ans
à Paris, où il a fait un DEA, a travillé, s’est marié et est devenu père de
deux filles. En 2019 il vivait en France].
À l’université [en Colombie] il y avait des professeurs venus de
France, du Mexique, d’Espagne. Et avec le professeur français nous
nous sommes mis à travailler et il insistait : « va continuer tes études
en France ». C’est lui qui m’a semé l’envie. Mais quand j’ai terminé
la formation, je n’ai pas voulu venir parce que j’avais mon couple,
et parce que pour moi l’Europe n’était rien d’extraordinaire.
J’étais un peu hautaine à l’époque. Mais après, les choses ont
commencé à aller mal, très mal dans ma vie sentimentale. Je
me sentais très triste, j’avais envie de changer. Alors, mes deux
meilleures copines de l’université, elles étaient déjà ici [à Paris].
J’avais appris le français, à l’école et à l’Alliance. Alors je suis venue
faire un DEA. [Femme originaire de Bogota. Arrivée en France
en 1999. Elle a abandonné son DEA à Paris. En 2019 elle vivait et
travaillait en France, avait divorcé de son mari et était mère de
deux enfants].
Quant aux lycées français en Colombie, c’est peut-être au
sein des ces espaces qui s’ancrent le plus fermement les systèmes de
représentation de la culture française, dans le sens énoncé par Hall
(1997), c’est-à-dire comme le partage d’une série de cartes conceptuelles,
traduites dans un langage commun, au sens large du terme : langage
sonore, oral, écrit, corporel, etc. Wagner (2011) affirme que ces écoles
bilingues consolident des habitus cosmopolites, de manière que la
mobilité internationale, le passage d’une langue à l’autre, et les relations
avec les étrangers s’intériorisent depuis l’enfance, et se considèrent
comme naturels chez les élèves (cité par Pinto 2013). Cette ancienne
élève du Lycée Louis Pasteur à Bogotá le décrit très bien :
| 166 | RASV. Vol. 23, n.º 1, ene.-jun. 2021. pp. 155-178« Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
J’avais eu toute ma vie des professeurs français, j’avais appris à
parler français dès l’âge de quatre ans, et ça faisait une influence
culturelle très forte. La pensée aussi. J’ai eu des professeurs
colombiens aussi bien évidemment. Mais la façon d’interagir avec la
connaissance, la manière de penser, de chercher certaines choses,
elles étaient toutes marquées par la culture française. J’ai eu des
professeurs qui m’ont beaucoup touchée, spécifiquement durant
le baccalauréat. Pendant ma formation en médecine à Bogotá, j’ai
compris que j’étais très marquée par l’éducation française, dans la
manière de penser, de concevoir la connaissance, de l’appliquer.
[Femme originaire de Bogota. Arrivée en France en 2001, où elle s’est
spécialisée en pédopsychiatrie. En 2018 elle travaillait à Paris dans
son domaine d’études].
L’interaction quotidienne, et depuis le plus jeune âge avec des
savoirs, des narrations, des référents culturels français a bien entendu
des conséquences importantes sur les projections d’un avenir en France
à la fin des études secondaires. Le voyage d’études apparaît comme la
suite naturelle du parcours scolaire et le lycée comme une première étape
de préparation. Comme Carolina Pinto l’a constaté (2013), ces jeunes ne
rencontrent pas les mêmes difficultés pour intégrer le système éducatif
français car ils possèdent un capital culturel et international qui les rend
capables d’installer une communication plus efficace avec l’administration.
Partir dans un moment de redéfinition subjective
Nous suivons Rea et Caestecker (2012) lorsqu’ils affirment que
l’élaboration et la matérialisation du projet d’études varient selon l’âge des
candidats et le niveau d’études visé, en particulier par rapport à l’implication
de la famille. Les auteurs montrent que la participation de la famille est
plus forte chez les candidats plus jeunes, qui vont plutôt commencer une
licence, alors que les plus âgés prennent leurs décisions individuellement
ou avec leur conjoint. C’est le cas des étudiants colombiens qui partent
pour des études de master ou doctorat : leur choix de migrer est plus le
résultat des décisions individuelles que la conclusion d’un projet familial.
Leurs parents interviennent peu dans le choix de telle ou une telle
formation ou établissement, et la relation d’engagement de retourner
au pays une fois la formation conclue est faible, contrairement à ce qui
a été constaté chez d’autres jeunes étrangers profitant de l’éducation
supérieure en France.
Les jeunes colombiens envisageant un départ pour études de
troisième cycle en France ont souvent un âge avancé par rapport aux
| 167 |Marcia Carolina Ardila Sierra
étudiants nationaux. Dans notre étude, nos interlocuteurs ont 26 ans en
moyenne à leur arrivée à Paris pour y commencer leurs spécialisations.
Or, nonobstant leur âge « mûr », la plupart des Colombiens cohabitent
avec leurs parents, sont dans une relation de dépendance économique
partielle ou totale vis-à-vis d’eux. En effet, en Colombie 84 % des jeunes
entre 15 et 29 ans résident dans leur famille d’origine (CEPAL, 2014,
p. 83). Ici, comme dans d’autres pays de l’Amérique Latine, des facteurs
économiques, sociaux et culturels retardent la sortie des jeunes adultes
du domicile parental. Dans ce cadre, le passage à l’âge adulte, associé
dans une perspective sociologique à l’insertion dans le monde du
travail, à la fondation de nouvelles cellules familiales et à l’indépendance
économique et résidentielle de l’individu, se cristallise pour beaucoup
au cours du processus éducatif et migratoire en France. En ce sens, le
voyage éducatif représente souvent une possibilité d’émancipation et
de prise de distance.
Dans nos entretiens, lorsqu’on parlait des circonstances personnelles
entourant le départ, ressortaient des questions sur la trajectoire vitale de
l’intéressé, qui allaient au-delà des études : le sentiment, par exemple, de
vivre la fermeture d’un cycle, de passer par un moment de redéfinition,
d’éprouver une inadaptation au contexte local ; l’envie également de
prendre de la distance avec sa famille et de devenir plus indépendant tout
en profitant de sa liberté de choix et de mouvement. Cette position sociale
de départ permet de mieux comprendre la suite de la trajectoire des
étudiants immigrants, et la bifurcation chez certains vers une installation
durable en France.
Le provisoire durable des étudiants
Coulon et Paivandi (2003) signalent deux aspects de l’augmentation
des taux d’échec des étudiants en France : l’ajournement ou la prolongation
des études et les abandons. Bien que les questions du retard et de l’échec
ne soient pas propres aux étrangers, ces auteurs notent qu’à la différence
des nationaux, les étudiants non français ont une double affiliation à
accomplir : « l’une parce qu’ils sont souvent de nouveaux étudiants, l’autre
parce qu’ils sont étrangers » (p. 35).
Nous regroupons en trois catégories les obstacles qui marquent
le séjour de nos interlocuteurs durant leur période d’études : celles
dérivées des conditions matérielles d’existence ; celles proprement
scolaires, associées à l’apprentissage de la culture académique française ;
et enfin celles de type administratif, relatives aux contrôles imposés aux
étudiants ressortissants de pays tiers. Ces difficultés, de pair avec des
| 168 | RASV. Vol. 23, n.º 1, ene.-jun. 2021. pp. 155-178« Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
transformations subjectives et des nouvelles configurations familiales
prenant place en France comme en Colombie, affectent les parcours des
jeunes colombiens.
Les conditions d’existence
Une série de contraintes dérive directement du fait d’être
originaire d’un pays tiers non francophone et d’une région plus pauvre
que l’Europe. Ces contraintes se manifestent dans la difficulté d’assurer
certains besoins, tels que la recherche d’un hébergement ou d’un travail
rémunéré, et sont plus importantes durant les premiers mois. À la suite
d’Élie Cohen (2001), Coulon et Paivandi (2003) ont signalé l’absence d’une
politique d’accueil dans les universités françaises pour les étudiants
étrangers. Les différents documents analysés par ces auteurs mettent en
évidence « un environnement géographique et social de l’université très
peu accueillant » (p. 28), qui manque de moyens matériels et humains,
de structures spécialisées pour accueillir et aider les étudiants étrangers
dans leurs démarches, et les guider face au « problème de la lisibilité de
l’offre éducative ».
Le rapport de Cohen signale la question du logement comme un
des problèmes majeurs dans le déroulement de la « chaîne d’accueil »
des étudiants étrangers. Cette difficulté affecte également les étudiants
français mais, comme nous explique l’auteur évoquant le cas de la région
Ile-de-France, les étudiants étrangers « l’éprouvent plus encore que leurs
camarades compte tenu de l’éloignement de leurs appuis familiaux, de
leur isolement relatif et des délais dont ils disposent pour préparer la
recherche d’une solution de logement » (p. 80). Les étudiants colombiens,
à différence d’autres étudiants latino-américains comme les Brésiliens,
les Mexicains, ou les Argentins, ne comptent pas sur des « maisons » ou
des résidences universitaires pouvant les accueillir à Paris7. Ils logent
principalement dans le secteur privé. À l’arrivée à Paris, les personnes que
nous avons interviewées ont toutes été hébergées par quelqu’un.
Face à l’impossibilité de se procurer un logement individuel, soit
pour des raisons financières, soit du fait de la difficulté de fournir toutes
les garanties nécessaires à la signature d’un bail (notamment un garant de
nationalité française), elles ont eu recours à des solutions intermédiaires.
Ces solutions, souvent temporaires, passent par la cohabitation avec des
amis, par les sous-locations, par l’improvisation et l’adaptation d’espaces
7
En 2011, lors d’une visite officielle en France, le président colombien Juan Manuel Santos, a annoncé qu’une
résidence colombienne serait ouverte à la cité internationale en 2016. En 2020 ce n’est pas encore fait.
| 169 |Marcia Carolina Ardila Sierra
qui n’ont pas vocation à l’hébergement. À cela s’ajoutent la précarité
économique et des emplois disponibles pour financer le séjour à Paris,
peu qualifiés et mal rémunérés. La méconnaissance plus ou moins
importante de la langue française aggrave les circonstances, tant pour les
discriminations que les accents étrangers sont susceptibles d’entraîner de
la part de certains propriétaires et agences immobilières ou chez certains
employeurs, que pour les limitations dues aux incompréhensions.
D’autre part, comme nous l’avons mentionné plus haut, le fait d’être
salarié apporte un regard tout à fait particulier de la société d’accueil,
différent de celui d’un étudiant étranger non travailleur. Bien que tous
les étudiants interviewés regrettent le fait d’avoir dû travailler en menant
leurs études, nous voulons souligner que ces travaux précaires assurant
le quotidien leur ont donné accès à des facettes de la société parisienne
et de la ville qui autrement resteraient inaccessibles. Les baby-sitters
connaissent ainsi l’intérieur domestique des classes hautes et moyennes
résidant à Paris, les relations de la vie privée, les manières d’habiter et
d’aménager les espaces, les habitudes de consommation, les pratiques
culinaires. Les assistants scolaires (surveillants, assistants d’espagnol,
assistants d’élèves handicapés, assistants de vie) sont au cœur du
fonctionnement de l’enseignement primaire et secondaire de certains
quartiers parisiens. Ceux qui s’emploient dans le tourisme ou dans la
restauration découvrent deux secteurs économiques majeurs en France.
Aussi, ces activités rémunérées peuvent être à l’origine de
rencontres importantes, d’amitiés, parfois des personnes susceptibles de
placer les étudiants à de meilleurs postes. Dans certains cas, ces travaux
peu qualifiés, déclarés ou « au noir », en principe destinés à assurer le
quotidien, prennent une place centrale dans la vie du travailleur étudiant
et peuvent susciter des réorientations importantes dans leurs parcours.
Ainsi, par le biais de ces « petits boulots » émergent des formes importantes
de connaissance et d’appropriation de la ville et des installations plus
durables sont favorisées.
L’apprentissage d’un habitus académique
Un des grands désavantages de la condition d’étudiant étranger est
lié au fait de ne pas partager les codes de la culture scolaire française.
Selon Coulon et Paivandi (2003), en dehors de son pays l’individu doit
« réapprendre son métier d’étudiant » (p. 32). Il doit se familiariser avec
les méthodes de travail et les modes d’enseignement français, le type
de relations avec les autres étudiants et les professeurs, le système
d’évaluation et l’organisation pédagogique, entre autres. Les auteurs
| 170 | RASV. Vol. 23, n.º 1, ene.-jun. 2021. pp. 155-178« Me fui quedando » : le provisoire durable des étudiants colombiens à Paris
affirment que ces connaissances limitées du système éducatif et de ses
astuces peuvent entraîner des inégalités entre les habitués, qui évoluent
dans un système de plus en plus complexe, et ceux qui sont contraints
de subir le processus d’orientation. Cette situation a bien évidemment
des effets sur le parcours universitaire des étudiants étrangers. Elle
représente une cause importante d’échec scolaire, ou de réorientations
radicales comme dans l’extrait suivant :
Je voulais étudier vétérinaire mais là-bas [à Paris], ça c’est très
difficile. C’est en Grande École, il faut faire un an préparatoire, et
je n’ai pas pu le faire puisqu’on n’acceptait que ceux qui venaient de
terminer le bac dans les lycées publics. […] Je suis arrivé là-bas sans
parler un seul mot de français. Je suis allé à l’école de vétérinaire
pour expliquer que je voulais y étudier. Et je me souviens que la dame
me regardait avec un air de… « Comment je lui dis ? Comment je lui
explique que c’est comme ça… ». […] Alors, j’ai commencé à étudier
l’Histoire parce que vétérinaire c’était évident que je ne pourrais pas.
[Homme originaire de Zipaquirá. Arrivé en France en 1979. Il a vécu 30
ans à Paris, où il a fait une licence et un DEA, a travaillé et est devenu
père d’une fille. En 2019 il vivait en Colombie].
L’apprentissage d’un habitus académique universitaire est un
processus complexe au long duquel l’étudiant étranger est censé
intérioriser les normes et les pratiques de l’environnement universitaire
français. Ce processus, souvent accompagné de tensions et de frustrations
est entravé par les barrières relatives à la langue française, dont on ne
peut prendre conscience que lorsqu’on est en France.
D’autre part, nous coïncidons avec Pinto (2013) pour constater que
« le décalage entre la position sociale d’origine et celle d’arrivée joue
fortement sur la perception de sentir classifié ou infériorisé dans le pays
hôte » (p. 378). Dans nos entretiens, nos interlocuteurs ont parlé d’un
sentiment de malaise provenant de cette distance. Autre décalage, le
constat qu’en Colombie ils comptaient sur une culture scolaire solide, qui
leur fait défaut en France. Ces constatations ressortent à plusieurs reprises
comme un élément important pour expliquer un premier moment de
repli sur soi ou vis-à-vis d’autres étudiants étrangers, notamment latino-
américains. Dans des situations plus difficiles, elle est signalée comme
cause de démotivation, d’affectation de l’estime de soi, d’absentéisme ou
de désertion :
La première année a été super dure, parce que de toute manière
on n’appartient pas à cette culture. Il y a eu des choses qui m’ont
| 171 |Vous pouvez aussi lire