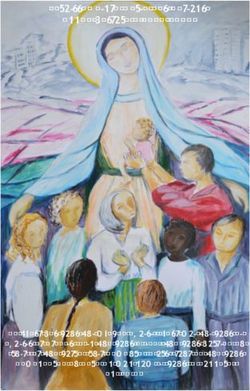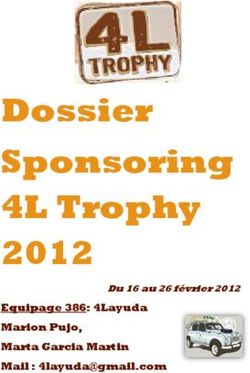Peine de mort : une exécution programmée au Texas, la première en 2021
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Publié le 19 mai 2021(Mise à jour le 19/05) Par Rédaction Réforme Peine de mort : une exécution programmée au Texas, la première en 2021 L’État américain du Texas prévoit d’exécuter mercredi un Afro-Américain condamné à la peine capitale pour le meurtre d’une octogénaire, qui a tenté d’obtenir la clémence du gouverneur avec une vidéo peu commune. Dans ce film de quatre minutes, tourné au parloir et mis en ligne par le New York Times, Quintin Jones s’adresse directement à l’élu républicain Greg Abbott pour lui demander de commuer sa peine en rétention à la perpétuité. “J’ai tué quelqu’un il y a plus de 20 ans”, reconnaît cet homme noir de 41 ans qui, en 1999, a battu à mort sa grande-tante, âgée de 83 ans, avec une batte de baseball, avant de lui voler 30 dollars pour acheter de la drogue. Mais “je ne suis plus la même personne, je suis devenu un homme dans les couloirs de la mort“, plaide-t-il, avant d’ajouter, en fixant la caméra: “Monsieur le gouverneur, si vous pouviez trouver dans votre coeur de quoi m’accorder votre clémence, je pourrais continuer à vivre pour m’améliorer.” En parallèle, ses défenseurs, parmi lesquels figurent la soeur de sa victime mais aussi l’actrice
Sarah Paulson, ont mis en ligne une pétition adressée, elle aussi, au gouverneur de cet État du Sud et qui avait recueilli plus de 160 000 signatures mercredi matin. Recours devant la Cour suprême Greg Abbott, qui n’a accordé sa clémence qu’à un seul condamné à mort en six ans, n’avait pas réagi mercredi matin. En parallèle, les avocats de Quintin Jones ont adressé un ultime recours à la Cour suprême des États-Unis pour tenter d’obtenir un sursis. Ils soutiennent notamment que leur client souffre d’un “handicap intellectuel” ce qui le rend, selon eux, inéligible à la peine de mort. Si ces efforts échouent, il recevra une injection létale dans le pénitencier de Huntsville en fin de journée. Aucune exécution n’a eu lieu aux États-Unis depuis l’accession à la présidence du démocrate Joe Biden, un opposant à la peine capitale. Même les États les plus répressifs, comme le Texas, ont à de rares exceptions renoncé à cette pratique depuis le début de la pandémie. À contre-courant, l’administration de son prédécesseur républicain Donald Trump avait renoué en juillet 2020 avec les exécutions fédérales et procédé à un nombre record (13) d’injections létales jusqu’aux derniers jours de sa présidence. AFP À lire également : Pourquoi la peine capitale continue de diviser les chrétiens américains Vers la fin de la peine de mort aux États-Unis ? Peine de mort aux États-Unis : l’espoir des abolitionnistes Les victimes invisibles de la peine de mort
P comme… peine de mort La foi, la résistance et le combat contre la peine de mort de Noëlla Rouget Publié le 20 juin 2018(Mise à jour le 22/06) Par Noémie Taylor-Rosner Donald Trump : les chrétiens divisés sur le sort des enfants migrants Aux États-Unis, depuis avril, 2 000 enfants ont été isolés de leurs parents sans- papiers, arrêtés par l’administration. Une politique justifiée par le ministre de la Justice. Enfermés dans de grandes cages métalliques, des enfants entre 3 et 15 ans dorment sur des matelas posés à terre, recouverts de couvertures chauffantes. Aux États-Unis, ces images filmées dans un centre de détention pour mineurs
sans-papiers au Texas, tournent en boucle sur les chaînes de télévision, depuis dimanche dernier, jour de la fête des pères. Résultat: face à la vague d’indignation, nationale et internationale, Donald Trump a finalement signé un décret interdisant la séparation des familles, mercredi 20 juin, tout en réaffirmant sa volonté de mener une politique “ferme face à l’immigration illégale”. Certains de ces enfants font partie des quelque 2 000 jeunes qui ont été séparés de leurs parents depuis le mois d’avril dernier, en application de la politique de tolérance zéro, prônée par l’administration Trump à l’encontre des clandestins. Son but : dissuader les immigrés de passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis. « Politique immorale » Pressé de s’expliquer sur ces séparations qui ont choqué l’opinion publique américaine, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a justifié jeudi 14 juin ces méthodes, en s’adressant spécifiquement aux chrétiens américains. Il a ainsi déclaré : « Je voudrais répondre aux préoccupations exprimées ces derniers jours par nos amis au sein des Églises. Ces critiques sont injustes. Je pourrais vous renvoyer à l’apôtre Paul et à son commandement clair et sage qu’il faut obéir aux lois du gouvernement car Dieu les a décrétées afin d’assurer l’ordre ». « Entrer illégalement aux États-Unis est un délit. Et avoir des enfants ne vous protège pas », a-t-il martelé. Le discours de Jeff Sessions a peu convaincu la plupart des Églises américaines. L’Église méthodiste unie, à laquelle appartient le ministre de la Justice lui-même, a appelé à lutter contre la séparation des familles immigrées sur son site Internet et a publiquement demandé à l’administration Trump de cesser ces pratiques. La Convention baptiste du Sud, la plus large dénomination protestante aux États- Unis avec quinze millions de membres, a pour sa part publié une résolution demandant que les immigrés soient traités avec la même dignité que les Américains et a appelé à une solution migratoire permettant de légaliser les sans- papiers. Certaines Églises ont également peu apprécié que Jeff Sessions utilise la Bible pour justifier la politique migratoire de Donald Trump. « Les fondateurs de cette nation ont utilisé le même genre de tactique pour asservir nos ancêtres
africains », a estimé de son côté l’Église épiscopale méthodiste africaine. Du côté des progressistes et des Églises historiques (dites mainline), nombreux sont les pasteurs à avoir choisi d’évoquer la question des séparations d’enfants lors de leur prédication du week-end dernier. « Cette politique immorale est justifiée par une déformation des Écritures, venant de gens qui ne connaissent ni l’impératif biblique de traiter l’étranger avec compassion, ni la Constitution qui protège les droits humains les plus basiques », a par exemple affirmé devant ses fidèles le pasteur luthérien Robert Franek, dans l’Illinois. De nombreuses Églises ont aussi participé à des veillées ou à des manifestations. La semaine dernière, le cardinal du New Jersey, Joseph Tobin, a quant à lui encouragé les évêques catholiques à se rendre en délégation à la frontière pour y inspecter les centres de détention. Le discours de Jeff Sessions a en revanche trouvé un écho plutôt favorable auprès des évangéliques blancs qui soutiennent en grande majorité Donald Trump. Bien qu’ils soient touchés par les séparations des familles de sans-papiers, « les évangéliques blancs estiment que le problème est beaucoup plus nuancé que ce que les médias suggèrent », notait en début de semaine le Washington Post. « Ils continuent par ailleurs de penser que le fait d’apporter un fort soutien à Donald Trump est important pour parvenir à atteindre leurs autres objectifs », tels que la protection des libertés religieuses et la lutte contre l’avortement. Ce fossé avec le reste des chrétiens américains s’illustrait déjà en janvier dernier, à l’occasion d’un sondage publié par le quotidien américain : celui-ci révélait que 75 % des évangéliques blancs percevaient l’arrestation d’immigrés sans-papiers comme quelque chose de positif, contre seulement 46 % des Américains dans leur ensemble et 25 % des chrétiens non-blancs. Appel à Donald Trump Des chiffres qui reflètent aussi l’écart grandissant entre les fidèles évangéliques blancs et les institutions religieuses qui les représentent. Début juin, l’Association nationale des évangéliques n’avait pas hésité à appeler Donald Trump à mettre fin à sa politique de tolérance zéro, pour le bien-être des enfants. « En tant qu’évangéliques chrétiens, guidés par la Bible, l’une de nos
croyances clés réside dans le fait que Dieu a établi la famille en tant que pierre angulaire fondamentale de notre société, rappelait l’organisation. Nous sommes très inquiets des traumatismes dévastateurs que ces séparations pourraient infliger à de si jeunes enfants. » Elle semble avoir été entendue par la président américain mais la vigilance demeure. Publié le 8 novembre 2017(Mise à jour le 10/11) Par Noémie Taylor-Rosner Fusillade au Texas : la sécurité des églises en question Une nouvelle tuerie dans une église texane qui a fait au moins 26 morts, dimanche 5 novembre, relance le débat autour du port des armes dans les lieux de culte. La fusillade survenue dimanche 5 novembre au sein de la First Baptist Church, à Sutherland Springs, au sud-est de San Antonio, est à ce jour la plus meurtrière de l’histoire moderne du Texas. Vingt-six personnes, dont la moitié étaient des enfants, ont péri en plein office dominical, sous les balles d’un Texan de
26 ans, Devin Kelley, plongeant une nouvelle fois l’Amérique dans l’angoisse et le chagrin. L’Église est affiliée à la Convention baptiste du Sud (Southern Baptist Convention), la plus importante dénomination protestante américaine, qui compte 15 millions de fidèles et regroupe des Églises chrétiennes évangéliques de courant baptiste. Cette nouvelle tuerie d’une violence inouïe relance inévitablement le débat sur la sécurisation des lieux de culte aux États-Unis, qui sont de plus en plus souvent la cible de la violence armée. En juin 2015, le massacre de neuf personnes dans une église noire de Charleston en Caroline du Sud avait notamment plongé le pays dans le deuil. En plein office religieux Selon Jimmy Meeks, spécialiste de la sécurité des lieux de culte aux États-Unis, l’escalade et la multiplication des actes violents au sein des Églises a débuté au tournant des années 2000, après le massacre, en 1999, de sept personnes dans une église baptiste de Fort Worth, au Texas, où se déroulait un office pour adolescents. « C’est l’année où toutes les digues ont sauté », explique l’expert. Dallas Drake, criminologue au sein du Centre de recherche sur les homicides dans les églises, un organisme indépendant basé à Minneapolis, a lui constaté qu’il y avait eu plus de meurtres par armes à feu dans des lieux de culte chrétiens entre 2006 et 2016 (147 au total) qu’au cours des 25 années précédentes. Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer pourquoi les Églises représentent souvent une cible privilégiée pour les tireurs. Ce sont d’abord des lieux de forte affluence, faciles d’accès et où l’heure des rassemblements est prévisible. Les églises sont aussi une cible facile pour les tireurs souhaitant symboliquement s’en prendre à une communauté ethnique ou religieuse particulière. Mais surtout, les lieux de culte aux États-Unis sont fréquemment des « gun-free zones » où les armes ne sont pas autorisées, soit par l’État, soit, le plus souvent, par la congrégation elle-même. « Dans ces cas-là, les églises deviennent des cibles importantes. Dans la plupart des lieux de culte, la congrégation tourne le dos à la porte. N’importe qui peut rentrer et vous tirer dans le dos », expliquait en 2015, au magazine Time, Bryan Crosswhite, président d’une association qui milite pour le maintien du second
amendement de la Constitution [le droit de porter et de posséder une arme, ndlr]. Depuis la tuerie de Sutherland Springs, les appels à armer les lieux de culte se multiplient à travers tout le pays. « Ce genre d’incidents va se reproduire dans le futur. Nous avons donc besoin de personnes au sein des églises, qu’il s’agisse de professionnels de la sécurité ou de fidèles armés, qui puissent réagir lorsqu’un événement comme celui-ci se produit », a martelé, sur Fox News, le procureur général républicain du Texas Ken Paxton, quelques heures seulement après le drame. Interviewé récemment par la presse américaine, Robert Jeffress, pasteur baptiste texan, expliquait que sa communauté était bien protégée car la moitié de la congrégation était armée pendant les offices. « Si un tireur tentait quelque chose dans mon église, il parviendrait peut-être à tirer un ou deux coups, mais il n’irait pas beaucoup plus loin. » Des cours de tir gratuits Ironiquement, certains magasins d’armes aux États-Unis vont aujourd’hui jusqu’à proposer des cours de tir gratuits aux pasteurs ou aux fidèles qui souhaitent mieux protéger leur communauté. Mais l’idée d’encourager les armes à feu dans les églises n’est toutefois pas du goût de tous, même après les événements de Sutherland Springs. « La présence de la croix dans nos églises nous rappelle que la réponse de Dieu à la violence n’est pas de réagir avec encore plus de violence », expliquait le pasteur presbytérien Baron Mullis, à Atlanta, au moment de la tuerie de Charleston en 2015. Les églises « sont des endroits de paix. Les armes n’y ont pas leur place ». Pour Chuck Chadwick, un expert en sécurité, formateur dans les églises, basé à Dallas, la protection des lieux de culte n’implique pas nécessairement d’armer tous les fidèles mais parfois simplement des agents dédiés à la sécurité. Un point de vue partagé notamment par de nombreuses Églises mennonites. « Il est important d’avoir quelqu’un qui soit spécifiquement formé à ces situations et qui puisse jouer le rôle de premier intervenant », assure Chuck Chadwick. Les faits se déroulent généralement si rapidement, selon lui, que seuls des professionnels ou des fidèles formés au maniement des armes ou aux gestes d’autodéfense peuvent être réellement efficaces.
Ces États qui autorisent le port d’armes dans les lieux de culte Le massacre de 2015 dans une église noire de Charleston a amené certains États à revoir leur législation concernant le statut des « gun-free zones » (zones sans armes) des lieux de culte. Le Dakota du Nord, par exemple, l’un des rares États qui interdisaient jusqu’à présent le port d’une arme dans une église, a assoupli sa législation en février 2017, permettant aux fidèles de transporter une arme cachée (comme dans un sac), avec l’accord de la congrégation. L’État de l’Arkansas a adopté, en mars, un système de permis d’armes à deux niveaux : l’un, basique, qui ne permet pas aux fidèles de se rendre à l’église armés. L’autre, plus avancé, qui s’obtient après un entraînement au tir de huit heures et qui offre la possibilité d’aller prier avec une arme cachée sur soi ou dans un sac. Mais là encore, l’accord de l’Église demeure toujours une condition sine qua non. En avril 2016, le Mississippi avait voté une loi appelée « Church Protection Act » visant à encourager les Églises à améliorer leur sécurité. Le texte autorise les fidèles ayant reçu une formation spéciale au tir (à la demande de leur Église), à porter une arme au sein de leur communauté religieuse et à agir en tant qu’agents de sécurité bénévoles. À l’heure actuelle, une poignée d’États (comme le Dakota du Nord, l’Arkansas, l’Ohio ou la Géorgie) autorisent le port d’une arme cachée dans les églises, avec accord du lieu de culte. La vaste majorité des autres États laissent les Églises libres de déterminer quelle politique elles souhaitent voir appliquer concernant le port des armes en leur sein.
Vous pouvez aussi lire