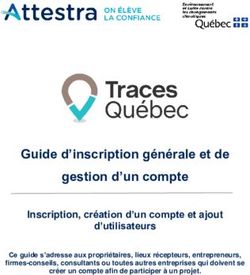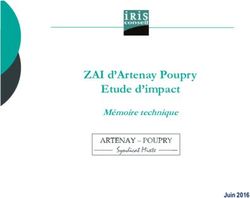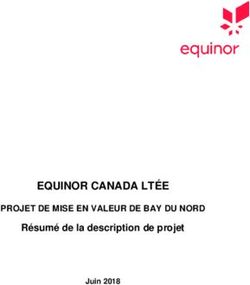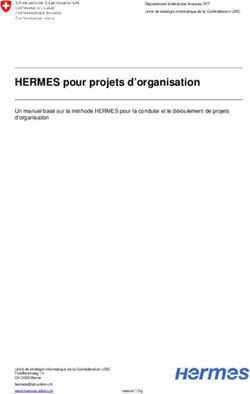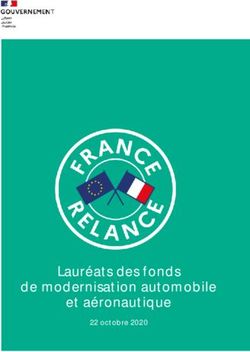Pièce H EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Janvier 2018
Pièce H
EVALUATION ECONOMIQUE
ET SOCIALE
EIRIAM
Dossier d’enquête publique unique relative à :
la déclaration d’utilité publique pour la section Veigné - Poitiers
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour la section Veigné - Poitiers
la demande d’autorisation environnementale (volet loi sur l’eau et volet dérogation espèces protégées)
pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine
l’enquête parcellaire pour la section Veigné – Sainte-Maure-de-TourainePhotos de couverture : ©Thierry Marzloff / Illustration de couverture : Kubilaï / Photos du sommaire : ©Thierry Marzloff Les sources des photographies, cartes et illustrations situées dans les pages numérotées de la pièce sont mentionnées sous chaque image.
1. PREAMBULE................................................................................................................................................................................................................................................... 1 2.3.3. De forts écarts de revenus qui bénéficient aux couronnes périurbaines.................................................................................. 20
2.3.4. L’essentiel à retenir....................................................................................................................................................................................... 20
1.1. | Objet et contexte réglementaire de l’évaluation.............................................................................................................................................1
2.4. | Un appareil productif solide et un patrimoine touristique valorisé.................................................................................................... 21
1.2. | Rappel des éléments de contexte............................................................................................................................................................................2 2.4.1. Une économie de plus en plus tertiarisée............................................................................................................................................ 21
1.2.1. Présentation générale du projet..................................................................................................................................................................2 2.4.2. Une agriculture plutôt dynamique qui cherche à se maintenir sur un marché en voie de dérégulation....................... 22
1.2.2. Au cœur de l’axe Paris-Bordeaux................................................................................................................................................................3 2.4.3. Un corridor industriel sur l’axe Tours-Poitiers.................................................................................................................................... 23
1.2.3. Une section d’autoroute traversant vingt-sept communes...............................................................................................................5 2.4.4. Un secteur du BTP dépendant de la construction de logements mais dynamisé
1.3. | Présentation du périmètre d’étude.........................................................................................................................................................................7 par les grands projets d’infrastructures de transports..................................................................................................................... 25
2.4.5. Une économie tournée principalement vers les services à Tours et plus encore à Poitiers............................................... 26
1.4. | L’essentiel à retenir..........................................................................................................................................................................................................8
2.4.6. Le patrimoine du Val de Loire et le Futuroscope, des atouts touristiques majeurs............................................................... 28
2.4.7. L’essentiel à retenir....................................................................................................................................................................................... 30
2. ANALYSE STRATEGIQUE : LA SITUATION EXISTANTE................................................................................................................................................. 9 2.5. | Les déplacements structurés par l’axe historique Tours-Bordeaux................................................................................................... 31
2.1. | Définition des termes et concepts d’analyse territoriale utilisés dans l’analyse stratégique................................................9 2.5.1. Des réseaux de transports qui structurent le périmètre d’étude................................................................................................. 31
2.5.2. Une structure des déplacements polarisée par les agglomérations et qui privilégie la voiture....................................... 32
2.2. | Un dynamisme démographique qui profite surtout au périurbain..................................................................................................... 10
2.5.3. L’essentiel à retenir....................................................................................................................................................................................... 34
2.2.1. Un territoire globalement sous influence des agglomérations de Tours et de Poitiers........................................................ 10
2.2.2. Une périurbanisation de plus en plus éloignée des pôles.............................................................................................................. 11 2.6. | Zoom sur les conditions de circulation sur l’A10 entre Poitiers et Veigné..................................................................................... 35
2.2.3. Une population vieillissante et une difficulté à conserver les jeunes actifs............................................................................. 13 2.6.1. Les trafics moyens journaliers actuels................................................................................................................................................... 35
2.2.4. Une population très diplômée dans les aires urbaines de Tours et de Poitiers et peu diplômée 2.6.2. Profil annuel du trafic actuel...................................................................................................................................................................... 36
au centre du périmètre d’étude................................................................................................................................................................ 14 2.6.3. Une fréquentation à la hausse sur cette dernière décennie.......................................................................................................... 37
2.2.5. Deux pôles universitaires importants qui constituent un atout pour le territoire.................................................................. 15 2.6.4. Estimation de la gêne ressentie en situation actuelle...................................................................................................................... 38
2.2.6. L’essentiel à retenir....................................................................................................................................................................................... 16 2.6.5. Conditions de circulation en journée de pointe estivale................................................................................................................. 38
2.3. | Une évolution de l’emploi touchée par la crise............................................................................................................................................. 17 2.6.6. Déplacements locaux et d’échanges principalement impactés par ces difficultés................................................................ 40
2.3.1. Deux agglomérations points d’ancrage de l’emploi.......................................................................................................................... 17 2.6.7. Analyse de l’accidentalité........................................................................................................................................................................... 41
2.3.2. Une hausse du chômage à l’image des tendances générales....................................................................................................... 19 2.6.8. Contraintes sur les conditions d’exploitation de l’infrastructure................................................................................................. 42
I Pièce H ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE2.6.9. L’essentiel à retenir....................................................................................................................................................................................... 42 6.2.1. Une amélioration des conditions de circulation sur l’A10.............................................................................................................. 60
2.7. | Les perspectives d’avenir pour le territoire d’étude................................................................................................................................... 43 6.2.2. Des gains de temps et de fiabilité........................................................................................................................................................... 61
2.7.1. Le SCoT de l’agglomération tourangelle................................................................................................................................................ 43 6.2.3. Des reports de trafics très limités............................................................................................................................................................ 63
2.7.2. Le SCoT du Seuil du Poitou........................................................................................................................................................................ 43 6.2.4. Conservation de la possibilité de réaliser la maintenance de jour............................................................................................... 63
2.7.3. Le SCoT du Pays du Chinonais.................................................................................................................................................................. 44 6.2.5. Amélioration du niveau de service en situation perturbée............................................................................................................. 64
2.7.4. Les PDU de Tours et de Poitiers............................................................................................................................................................... 44 6.2.6. Effets sur la sécurité routière..................................................................................................................................................................... 64
2.7.5. L’essentiel à retenir....................................................................................................................................................................................... 45 6.2.7. Effets sur le développement du tourisme............................................................................................................................................. 64
2.8. | Synthèse des attentes des acteurs locaux........................................................................................................................................................ 45 6.3. | Les effets environnementaux................................................................................................................................................................................... 64
6.3.1. Amélioration des performances environnementales de l’infrastructure................................................................................... 64
2.9. | L’essentiel à retenir de la situation existante................................................................................................................................................. 46
6.3.2. Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques............................................................................................. 64
6.3.3. Protection de la biodiversité...................................................................................................................................................................... 65
3. ANALYSE STRATEGIQUE : LE SCENARIO DE REFERENCE...................................................................................................................................... 47 6.4. | L’essentiel à retenir des effets sociaux, environnementaux et économiques
de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 de Poitiers à Veigné................................................................................................................ 65
3.1. | Le contexte social........................................................................................................................................................................................................... 47
3.2. | Le contexte économique............................................................................................................................................................................................ 48
7. ANALYSE MONETARISEE DES EFFETS DE L’OPTION DE PROJET.................................................................................................................... 66
3.3. | Le contexte des transports et de la mobilité................................................................................................................................................... 49
3.3.1. Les projets qui font appel à la mobilité.................................................................................................................................................. 49 7.1. | Principes et méthodologie........................................................................................................................................................................................ 66
3.3.2. Projection à long terme de la demande de déplacements............................................................................................................. 50 7.1.1. Définition.......................................................................................................................................................................................................... 66
3.4. | Le contexte environnemental.................................................................................................................................................................................. 51 7.1.2. Documents de référence............................................................................................................................................................................ 66
7.1.3. Horizons de mise en service et horizons de modélisation.............................................................................................................. 66
3.5. | L’essentiel à retenir du scénario de référence............................................................................................................................................... 52
7.1.4. Période sur laquelle est conduite le bilan monétarisé..................................................................................................................... 66
7.1.5. Unité monétaire............................................................................................................................................................................................. 66
4. LES OBJECTIFS HIERARCHISES DU PROJET ET DU TERRITOIRE...................................................................................................................... 52 7.1.6. Taux d’actualisation...................................................................................................................................................................................... 66
7.2. | Les hypothèses considérées..................................................................................................................................................................................... 67
7.2.1. Les hypothèses macro-économiques.................................................................................................................................................... 67
5. L’OPTION DE REFERENCE ET L’OPTION PROJET.......................................................................................................................................................... 53
7.2.2. Les hypothèses de croissance du trafic................................................................................................................................................. 67
5.1. | Description de l’option de référence................................................................................................................................................................... 53 7.2.3. Les coûts d’investissement, d’entretien et d’exploitation............................................................................................................... 68
5.1.1. Présentation du modèle de trafic............................................................................................................................................................. 53
7.3. | Le calcul des gains de temps de parcours........................................................................................................................................................ 69
5.1.2. Des trafics qui augmentent........................................................................................................................................................................ 53
7.3.1. Estimation du gain de temps.................................................................................................................................................................... 69
5.1.3. Hausse de trafic qui renforce le sentiment de gêne des usagers................................................................................................ 54
7.3.2. Gains de fiabilité............................................................................................................................................................................................ 70
5.1.4. Des plages d’intervention de maintenance de plus en plus contraintes................................................................................... 55
7.4. | Les valeurs de référence............................................................................................................................................................................................. 71
5.1.5. Une augmentation des temps de parcours en référence................................................................................................................ 56
7.4.1. Valorisation du gain de temps.................................................................................................................................................................. 71
5.1.6. Synthèse........................................................................................................................................................................................................... 56
7.4.2. Estimation des coûts d’utilisation des véhicules............................................................................................................................... 72
5.2. | L’option de projet............................................................................................................................................................................................................ 57 7.4.3. Les externalités.............................................................................................................................................................................................. 73
7.5. | Bilan socio-économique du projet........................................................................................................................................................................ 76
6. ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES EFFETS DE L’OPTION DE PROJET......................................................................... 59 7.5.1. Résultats du bilan global............................................................................................................................................................................. 76
7.5.2. Bilan par poste................................................................................................................................................................................................ 76
6.1. | Les effets sociaux............................................................................................................................................................................................................ 59
7.5.3. Distribution des effets par acteur............................................................................................................................................................ 76
6.1.1. Un projet approuvé par le Plan de relance autoroutier.................................................................................................................... 59
6.1.2. Accompagnement du développement des agglomérations de Tours et de Poitiers............................................................. 59 7.6. | Mode de financement du projet............................................................................................................................................................................. 77
6.1.3. Articulation des échanges avec les territoires périphériques........................................................................................................ 59 7.7. | Conclusion.......................................................................................................................................................................................................................... 77
6.1.4. Effets sur le développement de modes alternatifs à la voiture individuelle............................................................................. 59
6.2. | Les effets sur l’économie locale.............................................................................................................................................................................. 60
II Pièce H ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE8. LA SYNTHESE DE L’EVALUATION.............................................................................................................................................................................................. 78
8.1. | L’atteinte des objectifs de l’option de projet.................................................................................................................................................. 78
8.1.1. Les objectifs principaux.............................................................................................................................................................................. 78
8.1.2. Les objectifs secondaires............................................................................................................................................................................ 78
8.2. | Les effets environnementaux................................................................................................................................................................................... 79
8.3. | Les effets sociaux............................................................................................................................................................................................................ 79
8.4. | Les effets économiques............................................................................................................................................................................................... 80
8.5. | Exploitation de l’analyse monétarisée................................................................................................................................................................ 80
8.6. | En résumé..................................................................................................................................................................................... 80
9. ANNEXES....................................................................................................................................................................................................................................................... 81
9.1. | Signification des sigles utilisés............................................................................................................................................................................... 81
9.2. | Bibliographie..................................................................................................................................................................................................................... 81
9.3. | Attentes des acteurs locaux...................................................................................................................................................................................... 82
Pièce H ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE IIIIV Pièce H ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
1. 1PREAMBULE
PREAMBULE Il sʼarticule autour de trois grandes parties :
1. Une analyse dite stratégique qui comprend :
1.1. 1.1
| Objet etetcontexte
Objet contexteréglementaire
réglementaire de l’évaluation
de lʼévaluation
• Une présentation des aires dʼétudes ;
Le code des transports, qui intègre la loi dʼorientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982,
prévoit notamment que « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport • Une analyse territoriale présentant les dynamiques économiques et sociales qui influent sur la
dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur lʼefficacité demande actuelle de déplacement ;
économique et sociale de lʼopération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité • Une analyse fonctionnelle, traitant de lʼoffre et de la demande de transports et de déplacements en
et de protection de lʼenvironnement, des objectifs de la politique dʼaménagement du territoire, des nécessités situation actuelle ;
de la défense, de lʼévolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et,
plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des • La définition des perspectives dʼévolution retenues : le scénario de référence ;
atteintes à lʼenvironnement. ». Il précise également que « les grands projets dʼinfrastructures […] sont évalués • Une synthèse de lʼanalyse stratégique, confirmant les objectifs du projet en lien avec les besoins
sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, actuels et futurs du territoire.
lʼenvironnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à lʼintérieur dʼun même mode de
transport ainsi quʼentre les modes ou les combinaisons de modes de transport. »
2. Une présentation du projet soumis à évaluation des options de projet à la variante
préférentielle.
Lʼévaluation économique et sociale dʼun grand projet dʼinfrastructure de transports est menée conformément
1
aux articles L1511-2 et suivants et aux articles R1511-1 et suivants du code des transports, ainsi quʼà lʼarticle
17 de la loi n°2012-1558 du 31 décembre 2012 relative à la programmation pluriannuelle des finances 3. Lʼévaluation socio-économique avec :
publiques et à son décret dʼapplication du 23 décembre 2013, relatif à la procédure dʼévaluation des
investissements publics. • Lʼanalyse de la variante préférentielle : prévisions de trafics à la mise en service, analyse de lʼatteinte
des objectifs et analyse multidimensionnelle des effets (thématiques environnementales, sociales et
économiques) ;
Au-delà de ces dispositions législatives et réglementaires, lʼévaluation économique et sociale sʼappuie en • Les résultats du calcul socio-économique et leur exploitation (indicateurs socio-économiques, analyse
particulier sur lʼinstruction du gouvernement du 16 juin 2014, relative à lʼévaluation des projets de transports et des risques) ;
la note technique de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer du 27 juin 2014
relative à lʼévaluation des projets de transports. Cette instruction présente le cadre général de lʼévaluation des • La synthèse de lʼévaluation.
projets de transports de lʼÉtat, de ses établissements publics et de ses délégataires en application des
dispositions du code des transports ci-dessus mentionnées. Elle annule et remplace lʼinstruction cadre du 24
mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005.
Le présent document constitue la pièce H du dossier DUP lʼévaluation économique et sociale du
dossier dʼenquête préalable à la déclaration dʼutilité publique (DUP) du projet dʼaménagement à 2x3
voies de lʼA10 entre Poitiers et Veigné. Il vise à évaluer lʼintérêt de sa réalisation pour la collectivité et à
éclairer le public sur le choix dʼaménagement soumis à enquête.
1
Le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 relatif à lʼapplication de lʼarticle 14 de la LOTI a été abrogé et intégré à la partie réglementaire du
code des transports (et notamment articles R1511-1 et suivants) par décret n°2014-530 du 22 mai 2014. L’autoroute A10 à Monts (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
Pièce
Pièce H – Évaluation
H ÉVALUATION économiqueETetSOCIALE
ÉCONOMIQUE sociale 1 1 /831.2. 1.2
| Rappel des
Rappel éléments
des élémentsde
decontexte
contexte Pour lʼensemble de ses projets, Cofiroute souhaite sʼengager dans une démarche de mobilité durable en
déclinant les principes de lʼéco-autoroute autour de trois axes :
o La sécurité ;
1.2.1 Présentation générale du projet o La convivialité et la proximité des territoires ;
Cofiroute exploite un réseau dʼenviron 1 200 kilomètres couvrant le Centre-ouest de la France. Lʼautoroute A10 o Le respect de lʼenvironnement.
constitue un axe majeur de cette trame autoroutière au sein de laquelle la section entre Poitiers et Veigné
occupe une position centrale stratégique.
Si le premier item concerne davantage l'infrastructure (phase chantier et phase exploitation), les deux autres
items sollicitent la socio-économie au travers de lʼinsertion du projet dans son environnement au sens large du
Longue de 543 kilomètres, lʼA10 est la plus longue autoroute de France sous un même numéro. Elle a été terme, ainsi que des liens entre lʼinfrastructure autoroutière et le territoire impacté.
concédée à deux sociétés dʼautoroutes : Cofiroute pour la partie nord (Paris-Poitiers) et Autoroutes du Sud de
la France (ASF) pour la section sud, entre Poitiers et Bordeaux. En effet, Cofiroute désire inscrire le projet dans une démarche de développement durable et de développement
socio-économique des territoires sur lesquels le projet dʼaménagement pourrait avoir une influence.
Cofiroute veut sʼappuyer sur une étude lui permettant de disposer des éléments nécessaires à une bonne
Dans le cadre de la préparation du Plan de relance autoroutier, Cofiroute s'est engagé auprès de l'État sur : définition des enjeux et des contraintes de la zone de passage à 2x3 voies. L'objectif est lʼinsertion optimale du
o les études jusquʼà lʼobtention de la déclaration dʼUtilité publique de lʼaménagement de lʼA10 projet dans son environnement. A cela sʼajoute pour Cofiroute le besoin de disposer dʼune analyse des impacts
entre la bifurcation A10/A85 et lʼéchangeur de Poitiers-sud, soit sur 93 km ; économiques et sociaux de lʼaménagement au regard des besoins fonctionnels de lʼaire dʼétude, les données
rassemblées devant être dʼun niveau suffisant pour servir ensuite à lʼélaboration de lʼétude dʼimpact.
o les travaux de mise à 2x3 voies entre la bifurcation A10/A85 et lʼéchangeur de Sainte-Maure-
de-Touraine, soit sur 24 km. Cʼest lʼobjet de la présente étude, qui concerne lʼanalyse économique et sociale globale du territoire traversé
(préalable et dans le cadre de la LOTI). Cʼest à lʼéchelle de ce territoire, au travers de lʼanalyse de ses grandes
caractéristiques socio-économiques, des tendances à lʼœuvre, des stratégies et des projets des acteurs
Le Plan de relance autoroutier arrêté par décret paru au Journal Officiel du 23 août 2015 a retenu ce projet. Il identifiés notamment dans leurs documents de planification, quʼil sʼavère intéressant de mesurer lʼapport pour
porte sur une section de lʼautoroute A10 déjà ancienne, construite selon les normes de lʼépoque et vallonnée, le développement du territoire, que pourrait avoir le projet d'aménagement autoroutier.
créant de lʼinconfort pour les usagers en voiture (notamment quand deux camions se doublent).
Lʼaménagement à 2x3 voies sera lʼoccasion dʼobtenir à la fois une meilleure intégration paysagère et une mise
aux normes de sécurité et dʼenvironnement
Vingt-sept
Vingt-sept (27)
(27) communes
communes sontsont directement
directementconcernées
concernéespar
parleleprojet : 14
projet communes
: 14 en en
communes Indre-et-Loire et 13
Indre-et-Loire et
communes
13 communes dans la Vienne.
dans la Vienne.*
Le planning prévisionnel qui porte sur une longueur de 93 kilomètres, est le suivant :
o Commande de lʼÉtat : décret du 21 août 2015, paru au journal officiel du 23 août 2015
o Concertation interservices et avec les collectivités concernées : à partir dʼoctobre 2015
o Désignation du maître dʼœuvre des études du projet suite à un appel dʼoffre restreint (maîtrise
dʼœuvre complète) : mars / avril 2016
o Enquête
Enquête publique
publique préalable
préalable àà l'obtention
l’obtentionde
delalaDUP
DUP ::fin 20172018
janvier
o Arrêté DUP avant le 23 août 2018
o Mise en service de la section 1 (Sainte-Maure-de-Touraine/Veigné) prévue pour 2023.
Le coût du projet est estimé à environ 865 millions dʼeuros juillet 2012 HT (et 825 millions dʼeuros octobre
2016 HT), dont 244 millions dʼeuros pour la phase dʼétudes de lʼensemble du linéaire, et les travaux de
la section 1 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine.
* En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
certaines communautés de communes ont fusionnées. Les études ayant été réalisées sur des données communales de 2016, elles ne
prennent pas en compte les périmètres des nouvelles communautés de communes. L’autoroute A10 au niveau de Saint-Epain (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
2 Pièce
Pièce H – Évaluation
H ÉVALUATION économiqueETetSOCIALE
ÉCONOMIQUE sociale 2 /831.2.2 Au cœur de lʼaxe Paris-Bordeaux
1.2.2 Au cœur de lʼaxe Paris-Bordeaux
Lʼautoroute A10 constitue le principal itinéraire de liaison entre l'Europe du nord et la péninsule
Ibérique et, àA10
Lʼautoroute uneconstitue
échelle plus fine, entre
le principal la région
itinéraire de parisienne
liaison entre et le sud-ouest
l'Europe de la et
du nord France comme
la péninsule
illustré enet, à une échelle plus fine, entre la région parisienne et le sud-ouest de la France comme
Ibérique
illustré en figure 1.
Figure 1.
1.2.2
Figure 1.Au cœur de lʼaxe Paris-Bordeaux
Au sein de ce vaste corridor à longue distance, lʼA10 a des itinéraires alternatifs :
Lʼautoroute
Au sein de ceA10 vasteconstitue
corridor à le principal
longue itinéraire
distance, lʼA10 a de
desliaison
itinérairesentre l'Europe
alternatifs : du nord et la péninsule
Ibérique et,oà une À lʼouest,
échelle lʼA83
plus: Nantes-Bordeaux
fine, entre la régionvia Niort ;
parisienne et le sud-ouest de la France comme
en o À lʼouest, lʼA83 : Nantes-Bordeaux via Niort ;
illustré1.2.2 oAu À cœur
lʼest, lʼA20de: lʼaxe Paris-Bordeaux
Paris-Toulouse via Vierzon, Châteauroux, Limoges et Brive (réseau non
x 1. o
FigureLʼautoroute concédé).
À lʼest, lʼA20 : Paris-Toulouse via Vierzon, Châteauroux, Limoges et Brive (réseau non
A10 constitue le principal itinéraire de liaison entre l'Europe du nord et la péninsule
concédé).
e liaison entre l'Europe
Au sein Ibérique
du ce
de nordet, et
vaste à corridor
une échelle
la péninsule
à longue plus fine, entre
distance, lʼA10 la région
a des parisienne
itinéraires et le: sud-ouest de la France comme
alternatifs
n parisienne et le Au illustré
sud-ouest
nord, Tours en
de la France comme
o constitue
À lʼouest, le point
lʼA83 de convergence des
: Nantes-Bordeaux autoroutes
via Niort ; A10, A28 et A85, tandis quʼau sud, Poitiers
A10 – Aménagement à 2x3
apparait
Au nord, comme
Tours
Figure 1. un point
constitue dʼéclatement
le point de du trafic
convergence vers le
des littoral
autoroutesde Poitou-Charentes,
A10, A28 et A85, ainsitandisque verssud,
quʼau Angoulême
Poitiers
Àunlʼest, voies––Aménagement
A10 Section à lʼétude (93 km)
à 2x3
(avec la RD910
apparait o aménagée
comme pointlʼA20 : Paris-Toulouse
en 2x2
dʼéclatement voies)duettrafic
Limogesvia (avec
vers Vierzon,
le Châteauroux,
la RD147
littoral de aménagée Limoges
Poitou-Charentes, en 2x2 etque
Brive
voies).
ainsi vers(réseau non
Angoulême
voies – Section à lʼétude (93 km)
(avecAu sein de aménagée
la RD910 ce vaste corridor
concédé). en 2x2àvoies)
longueetdistance,
Limoges lʼA10
(avecalades itinéraires
RD147 aménagéealternatifs
en 2x2: voies).
es itinéraires alternatifs :
o À lʼouest, lʼA83 : Nantes-Bordeaux via Niort ;
iort ; La ligne ferroviaire Paris-Bordeaux qui épouse assez précisément le tracé de lʼA10, représente aussi une
Au nord,
alternative
La Tours
ligne ferroviaire les À lʼest,
o Paris-Bordeaux
pourconstitue
déplacementslʼA20
le point de:entre
Paris-Toulouse
convergence
qui etdes
Paris assez
épouse via Vierzon,
autoroutes
Bordeaux.
précisément Châteauroux,
A10,
le A28
Lʼentrée en et
tracé A85,
service
de Limoges
tandis
lʼA10, et Brive
la quʼau
de représente
LGV sud,
Sud (réseau
une non
Poitiers
Europe
aussi
erzon, Châteauroux, Limoges et Brive concédé).
(réseau non A10 – Aménagement à 2x3
apparait
Atlantique
alternative comme
entre un
lespoint
pour Tours dʼéclatement
et Bordeaux
déplacements 2 du
leentre trafic
juillet vers
2017
Paris le littoral
et devrait deLʼentrée
rendre
Bordeaux. Poitou-Charentes,
ce trajeten service ainsi
ferroviaire plus
de laque versSud
attractif.
LGV Angoulême
Europe voies – Section à lʼétude (93 km)
(avec la RD910
Atlantique entre aménagée en 2x2 voies)
Tours et Bordeaux et Limoges
le 2 juillet (avec rendre
2017 devrait la RD147 ce aménagée en 2x2
trajet ferroviaire voies).
plus attractif.
SeuleAu la nord,
desserte Toursaérienne
constitueapparaît
le point en-deçà
de convergence de ce quʼon des autoroutes
pourrait attendreA10, A28pour et A85,destandis quʼau sud, de
agglomérations Poitiers
A10 – Aménagement à 2x3
autoroutes A10, A28Seule
La et apparait
A85,
ligne
lʼimportance tandis comme
la ferroviaire quʼau
de Tours
desserte un
sud,point dʼéclatement
Poitiers
Paris-Bordeauxapparaîtqui
et de Poitiers.
aérienne du
épouse de
L'aéroport
en-deçà trafic
assez
de vers
Nantes
ce le littoral
précisément
quʼon de Poitou-Charentes,
pourraitle4attendre
accueille tracé
millions depourlʼA10,
de ainsi
représente
passagers
des que vers Angoulême
aussiBrest
annuels,
agglomérations une
A10de– Aménagement à 2x3 voies – Section à lʼétude (93 km)
ittoral de Poitou-Charentes,
environ (avec
alternative 1ainsila
pourRD910
que
million, vers
les
Rennesaménagée
Angoulême
déplacements en 2x2
et Poitiers. entre
Clermont-Ferrand voies)
Paris etplus
Limoges
et Bordeaux.
de 400 (avec000, la Limoges
RD147
Lʼentrée aménagée
en service
environ de 300en 2x2
de la LGV
000, voies). Sud
etannuels,
La Europe
Rochelle
lʼimportance de Tours et de L'aéroport de Nantes accueille 4 millions passagers voies: – Section à lʼétude (93 km)
Brest
ec la RD147 aménagée plus en
environ de 2x2
Atlantique 200 voies).
entre
000…
1 million, Tours
Rennes et Bordeaux
En comparaison, leTours
et Clermont-Ferrand 2 juillet 2017
plusdevrait
nʼaccueille deque 400rendre
150 000,000ce trajet ferroviaire
passagers
Limoges par an.
environ plus
300 attractif.
Lʼaéroport
000, et La de Rochelle
Tours-Val:
de Loire,
plus de 200 dont 000…la communauté
En comparaison, dʼagglomération
Tours nʼaccueille est actionnaire,
que 150 000 est situé
passagers à cheval par suran. les communes
Lʼaéroport de Tours
de Tours-Val
et de
de La
Loire, ligne
dont ferroviaire
Parçay-Meslay au nord
la communauté Paris-Bordeaux
de lʼagglomération
dʼagglomération qui épouse assez
et actionnaire,
est près précisément
de lʼA10. estLa à le
proximité
situé chevaltracé
dessur de lʼA10,
aéroports
les représente
communesparisiens deet aussi
leur une
Tours
précisément le tracé Seulede
facilité
et alternative
lʼA10,
la
dʼaccès
de Parçay-Meslay pour
représente
desserte pouraérienne
les les déplacements
aussi
au Tourangeaux une
nord apparaît entre
en-deçà de
expliquent
de lʼagglomération Paris
sans
et prèset
ce doute Bordeaux.
quʼon cepourrait
de lʼA10. niveau Lʼentrée
attendre en
de fréquentation
La proximité des service
pour des
aéroportsmaisde la LGV
agglomérations
elle suppose
parisiens Sud Europe
de
de
et leur
deaux. Lʼentrée enfacilité
disposer Atlantique
service
lʼimportance de la entre
depour
de dessertes
dʼaccès LGV
Tours Tours
Sud
leset et
routières Bordeaux
Europe
de Poitiers.
Tourangeaux le 2 juillet 2017
L'aéroportsatisfaisantes.
et ferroviaires
expliquent de
sans Nantes devrait
doute accueille
ceEn rendre 4de
termes
niveau ce trajet
millions ferroviaire
de passagers
de destination
fréquentation plus
et de
mais attractif.
annuels,
elle Brest
fréquentation,
suppose de
ait rendre ce trajet ferroviaire
environ
l'aéroport1de
disposer plus
de attractif.
million,
Poitiers
dessertesRennesnʼest et Clermont-Ferrand
quant
routières à lui
et que le deuxième
ferroviaires plus de de 400sa000,
satisfaisantes. En Limoges
région, derrière
termes deenviron 300 de
l'aéroport
destination 000,
etLa etRochelle-Ile
de La Rochellede:
fréquentation,
plus de 200
Ré. Anciennement
l'aéroport de000…
Poitiers En
géré comparaison,
nʼest par la CCI
quant à luiTours
de nʼaccueille
la Vienne,
que le deuxièmeil estque
de 150
depuis 000
2013
sa région, passagers par
géré parl'aéroport
derrière Vincian.Airports.
Lʼaéroport de Tours-Val
Il dessert
de La Rochelle-Ile deux
de
de Seule
Loire,
destinations
Ré. dont
Anciennement la desserte
la communauté
régulières aérienne
géréauxquelles
par apparaît
ladʼagglomération
CCIsʼajoutent
de la Vienne, en-deçà
estlignes
trois de saisonnières.
est ce quʼon
ilactionnaire,
depuis est
2013 pourrait
situéIlgéré attendre
à cheval
enregistre
par sur
Vinci pour
les
un Airports.
trafic des
communes Il agglomérations
oscillant de Tours
autour
dessert de de
deux Figure 1 - Localisation du projet dʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné (Source :
quʼon pourrait attendre
et de000
110 lʼimportance
pour
destinations des
Parçay-Meslay
passagers de Tours
agglomérations
régulières et
auauxquelles
dont nord en
60% de de
de vols Poitiers.
lʼagglomération
low-cost.
sʼajoutent L'aéroport
troisetlignes de Nantes
près saisonnières. accueille
de lʼA10. La proximité 4
Il enregistre millions
desun de
aéroports passagers
parisiens
trafic oscillant annuels,
et leur
autour de Brest Figure Site
1 - Localisation du internet
projet Plan de relance
dʼaménagement autoroutier,
à 2x3 août de
voies de lʼA10 2016)
Poitiers à Veigné (Source :
ntes accueille 4 millions
facilité
110 environ
de 1
passagers
000dʼaccès
passagers million,
pourdont Rennes
annuels, Brest
les Tourangeaux et Clermont-Ferrand
60% en vols low-cost. plus de 400 000, Limoges
expliquent sans doute ce niveau de fréquentation mais elle suppose de environ 300 000, et La Rochelle : Site internet Plan de relance autoroutier, août 2016)
400 000, Limoges disposer
environ plus300dede dessertes
200
000,000… En
et Laroutièrescomparaison,
Rochelle et: ferroviairesTours satisfaisantes.
nʼaccueille queEn 150termes
000 passagers
de destination par an.etLʼaéroport de Tours-Val
de fréquentation,
ue 150 000 passagers parde
l'aéroport
Le Loire,
an.
diagnostic dont
Lʼaéroport
de Poitiers la
territorial communauté
de Tours-Val
nʼestquiquant
suitàpart dʼagglomération
lui que le deuxième
du constat est
qu'a de actionnaire,
sa région,
priori est situé à
derrière l'aéroport
lʼaménagement cheval
de lʼA10 de sur les
surLacettecommunes
sectionde
Rochelle-Ile deTours
nnaire, est situé à cheval et
lʼitinéraire
Le de
sur
Ré.diagnostic Parçay-Meslay
les
Anciennementaura communes
ungéréimpact
territorial au
de
par nord
Tours
la
quiplus
suit CCI de
limité
part lʼagglomération
de du laqueVienne,
celuiilqu'a
constat et près
est priori
dʼune depuis de
autoroute lʼA10.
2013 nouvelle La proximité
géré par de
lʼaménagement Vinci
sur des
un aéroports
Airports.
lʼA10 territoire
sur cette parisiens
Il dessert
non deet leur
deux
encore
section
de lʼA10. La proximité facilité
des dʼaccès
aéroports
destinationsaura régulières pour
parisiens lesetTourangeaux
auxquelles leur sʼajoutent expliquent sans doute ce niveau de fréquentation mais elle suppose
de de Figure 1 - Localisation du projet dʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné (Source :
desservi.
lʼitinéraire un impact plus limité quetroisceluilignes
dʼune saisonnières.
autoroute nouvelle Il enregistre surun untrafic oscillant
territoire non autour
encore
oute ce niveau de fréquentationdisposer de
mais
110 000 passagers dont ème dessertes
elle suppose routières
de
60% en vols low-cost. et ferroviaires satisfaisantes. En termes de destination et de fréquentation, Site internet Plan de relance autoroutier, août 2016)
desservi.
santes. En termes de Lʼaménagement
l'aéroport et
destination dedʼune
de 3 nʼest
Poitiers voie permettra
fréquentation, quant à luidequefaire
le face
deuxièmeaux évolutions
de sa de trafic
région, derrièreà moyen et long
l'aéroport de terme,
La dans la de
Rochelle-Ile
ème
de sa région, derrièremesure Ré.où
Lʼaménagement
l'aéroport cette
Anciennement
de La section
dʼune devoie
3 géré
Rochelle-Ile lʼitinéraire
par dela CCIest
permettra dedéjà
de faire
la enface
Vienne, limite
aux de
il est fonctionnement
évolutions
depuis de trafic
2013 géréàactuellement
moyen
par Vinci et long (environ
terme,
Airports. 30 000
dans
Il dessert la deux
véhicules/jour
mesure oùAirports.
destinationscetteen moyenne
section de annuelle)
lʼitinéraire etestconnait
déjà un
en volume
limite de soutenu
fonctionnement de poids-lourds
actuellement (18 à 20%
(environ selon
30 les
000 Figure 1 - Localisation du projet dʼaménagement à 2x3 voies de lʼA10 de Poitiers à Veigné (Source :
depuis 2013 géré Le pardiagnostic
Vinci territorial qui suit part du constat qu'a priori lʼaménagement de lʼA10 sur cette section de de
régulières
Il dessert auxquelles
deux sʼajoutent trois lignes saisonnières. Il enregistre un trafic oscillant autour
sections).
véhicules/jour
saisonnières. Il enregistre 110 un000 Le ressenti
enoscillant
moyenne
passagers
trafic des
dont usagers
annuelle)
autour 60% en est
delimité celui
et que
vols Figure
connait
low-cost.d'une 1
undʼune- Localisation
autoroute
volume soutenu du
très nouvelle projet
chargée.
de poids-lourdsdʼaménagement
Lesun travaux à 2x3
(18 à dʼaménagement
20% voies
selon les de lʼA10 de Poitiers à Veigné (Source : Site internet Plan de relance autoroutier, août 2016)
lʼitinéraire aura un impact plus celui autoroute sur territoire non encore
apporterontLedavantage
sections). ressenti de desconfort
usagers auxest usagers
celui dansd'uneles échanges
autoroute très Site internet
interrégionaux
chargée. Les Plan
et même de relance
travauxinternationaux, autoroutier,
dʼaménagement ils août 2016)
desservi.
faciliteront
apporterontaussi les conditions
davantage de
ème
confortde déplacement
aux usagers de
dans proximité
les (emploi,
échanges domicile,
interrégionaux services)
et même et ils permettront
internationaux, une
ils
Lʼaménagement
meilleure
faciliteront aussi dʼune
intégration
Le diagnostic 3
les conditions
territorialvoiequi
environnementaledepermettra
suit de
déplacement
part dedu faire
de face
lʼinfrastructure. aux
proximité
constat qu'a évolutions
(emploi, de trafic services)
domicile,
priori lʼaménagement à moyen et
de lʼA10et long terme,
cettedans
ils permettront
sur unela de
section
mesure
meilleure où cette
intégration
lʼitinéraire suraurasection de lʼitinéraire
environnementale deest déjà en
lʼinfrastructure. limite de fonctionnement actuellement (environ 30 000
priori lʼaménagement La de
Figure lʼA10
véhicules/jour 2 permet deun
cette
en moyenne
impactdeplus
section
comparer
annuelle)
limité
lʼimportance
et connait
que
desun celui
grandes dʼune autoroute nouvelle
volumeagglomérations
soutenu de poids-lourds
sur un territoire
du centre-ouest (18 àde20%
non en
la France
selon les
encore
ne autoroute nouvelle termes
La desservi.
sur
Figure un territoire
de population
2Lepermet de non
et des encore
dʼemploi.
comparer lʼimportance
sections). ressenti usagers est celui des d'une grandes
autorouteagglomérations
très chargée. du centre-ouest
Les travaux de la France en
dʼaménagement
termes
apporteront de population
Lʼaménagement
davantagedʼune et dʼemploi.
3
ème
de confort voie
auxpermettra
usagers dans de faire lesface aux évolutions
échanges interrégionauxde traficetàmême moyeninternationaux,
et long terme, ils dans la
aux évolutions de trafic àmesure
moyen
faciliteront oùlong
et
aussi cette
les section
terme,
conditions dans deladéplacement
de lʼitinéraire estdedéjà en limite
proximité de fonctionnement
(emploi, domicile, services) actuellement (environ
et ils permettront une30 000
ite de fonctionnement véhicules/jour
actuellement
meilleure en
intégration(environ moyenne
30 000annuelle)
environnementale et connait un volume soutenu de poids-lourds (18 à 20% selon les
de lʼinfrastructure.
olume soutenu de poids-lourds sections). (18Leà ressenti
20% selon deslesusagers est celui d'une autoroute très chargée. Les travaux dʼaménagement
utoroute très chargée.La Figure 2 permet
apporteront
Les travaux de comparer
davantage
dʼaménagement de confortlʼimportance
aux usagers des grandes
dans lesagglomérations
échanges interrégionaux du centre-ouest et même de lainternationaux,
France en ils
termes
s échanges interrégionaux de population
faciliteront
et mêmeaussi et dʼemploi.
les conditions
internationaux, ils de déplacement de proximité (emploi, domicile, services) et ils permettront une
meilleureetintégration
mité (emploi, domicile, services) ils permettront environnementale
une de lʼinfrastructure.
e. Pièce H
La Figure 2 permet de comparer lʼimportance des grandes agglomérations du centre-ouest de– la
Évaluation
France en économique et sociale 3 /83
termes de population
ndes agglomérations du centre-ouest de la France et dʼemploi.
en Pièce H – Évaluation économique
Pièce H ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE et sociale 3 3 /83Vous pouvez aussi lire