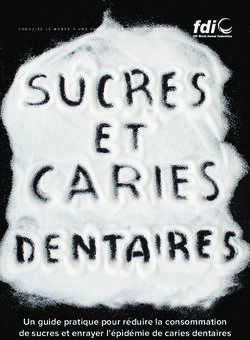Podcast : la crise en Afghanistan va-t-elle renforcer l'État islamique
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Publié le 9 octobre 2021(Mise à jour le 8/10) Par Cathy Gerig Podcast : la crise en Afghanistan va-t-elle renforcer l’État islamique ? Depuis la reprise du pouvoir par les Talibans, l’État islamique semble plus que jamais déterminé à occuper le devant de la scène en Afghanistan. Peut-il sortir plus fort de la crise en Afghanistan ? Radio France internationale (RFI) propose différents podcasts sur la reprise du pouvoir par les Talibans en Afghanistan. Dans l’un d’eux, Matteo Puxton, agrégé d’Histoire et spécialiste de la propagande militaire de l’État islamique (EI), et Murielle Paradon, journaliste au service International de RFI, de retour de Syrie, se demandent si la crise que traverse le pays peut renforcer l’État islamique. Celui-ci a, en effet, la particularité d’être sorti grandi de plusieurs phases d’instabilités. Pour le chercheur, l’attentat du jeudi 27 août, qui a fait 85 morts à l’aéroport de Kaboul, comme les tirs de roquettes interceptés par les Américains la veille de leur départ du pays, sont des démonstrations de force. Une manière de dire que l’EI conserve des capacités en Afghanistan, malgré la prise de pouvoir par les
talibans. Il dispose d’ailleurs de cellules très actives dans la capitale afghane depuis 2016. En agissant ainsi, aux yeux et à la barbe des talibans, l’EI veut mettre en avant l’incapacité de ses derniers à assurer la sécurité. Bombes à retardement L’État islamique au Khorasan compte parmi ses hommes d’anciens talibans pakistanais, mais également afghan. Mais auparavant, il a usé de sa capacité de nuisance pour affaiblir le gouvernement afghan, délogé le 15 août dernier par les talibans. De retour de Raqqa, en Syrie, l’ancienne capitale du califat autoproclamé de l’EI entre 2014 et 2017, Murielle Paradon parle d’une ville meurtrie et d’habitants encore traumatisés par les exactions commises par les djihadistes. Ces derniers ne sont pas vraiment partis, puisque des cellules dormantes ont été recensées par les forces démocratiques syriennes. Et, qui plus est, des liens très forts existent entre l’EI au Khorosan et l’EI central. Pour suivre ce podcast et comprendre la situation, pas besoin d’être un expert en groupes terroristes ou en géopolitique. Les intervenants éclairent nos lanternes avec simplicité et font également le point sur les camps de combattants, qualifiés de bombes à retardement. À écouter : La crise en Afghanistan va-t-elle renforcer l’Etat islamique ? sur RFI. Durée : 20 minutes.
Publié le 5 octobre 2021(Mise à jour le 5/10) Par Rédaction Réforme Afghanistan : des filles de retour au collège et au lycée dans une province Des filles ont fait leur retour dans certains collèges et lycées de la province de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan, a annoncé mardi 5 octobre un responsable taliban, mais cette mesure ne s’applique pas au reste du pays. Une vidéo publiée par Suhail Shaheen, un porte-parole taliban, montre des dizaines de filles de retour à l’école à Khan Abad, une ville et un district de la province de Kunduz située dans le nord de l’Afghanistan. La plupart portent la traditionnelle tenue scolaire des filles afghanes, une longue tunique noire et un foulard blanc, mais d’autres ont revêtu un niqab noir couvrant tout le visage à l’exception des yeux. Elles sont assises sur des bancs et brandissent des drapeaux talibans. “Les filles vont dans les écoles secondaires à Khan Abad”, a écrit Suhail Shaheen, qui a été désigné par les talibans comme leur représentant permanent aux Nations unies. Mais à Kaboul, Mohammad Abid, un responsable du ministère de l’Éducation, a indiqué à l’AFP que les règles n’avaient pas changé. “Les écoles secondaires restent fermées pour les filles”, a-t-il déclaré. À la mi-septembre, les collèges et lycées afghans avaient rouvert, mais seulement pour les garçons. Les filles sont déjà autorisées à aller à l’école dans le primaire et dans les universités privées, mais dans des classes non mixtes et à condition d’être entièrement voilées.
Quelques jours après la réouverture des collèges et lycées, le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, avait assuré que les filles retourneraient à leur tour en cours “aussi vite que possible”. Le gouvernement souhaite d’abord offrir aux filles un “environnement éducatif sûr”, en accord avec l’interprétation stricte de la charia par les talibans, qui prévoit la non-mixité des classes, avait-il justifié. Les femmes appelées à rester à la maison L’absence des filles des écoles secondaires en Afghanistan a suscité l’indignation de la communauté internationale, qui craint que les talibans n’imposent le même type de régime fondamentaliste et brutal que lorsqu’ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001. Les femmes étaient alors largement exclues de la vie publique et n’étaient, à de très rares exceptions près, pas autorisées à étudier ni à travailler. Les islamistes ont aussi appelé les femmes à rester chez elles et à ne pas reprendre le travail pour l’instant, invoquant des raisons de sécurité. Ils ont assuré qu’elles pourraient ensuite retourner travailler, mais séparément des hommes. Même si depuis leur retour au pouvoir à la mi-août, les talibans ont tenté de rassurer la population afghane et la communauté internationale en affirmant qu’ils se montreraient moins stricts que par le passé, leurs promesses peinent à convaincre. Rédaction Réforme avec AFP
Publié le 10 septembre 2021(Mise à jour le 10/09) Par Sophie Nouaille Afghanistan : le patrimoine culturel suspendu aux décisions des talibans On a tous en tête les statues géantes de Bouddha détruites par les talibans en 2001. Aujourd’hui le monde international de la culture tout comme les afghans guettent les décisions des islamistes concernant l’art non musulman. Mais depuis 2016, la destruction du patrimoine est considérée comme un crime de guerre. Le centre culturel de Bamiyan en Afghanistan devait être achevé fin août puis inauguré en grande pompe début octobre. Mais le tapis rouge et les festivités devront attendre: depuis le retour des talibans au pouvoir le 15 août, tout a été mis en suspens. “Ça ne sera pas possible de l’inaugurer à la date prévue”, confirme à l’AFP Philippe Delanghe, chargé de programme culture du bureau de l’Unesco à Kaboul, replié temporairement à Almaty (Kazakhstan). Dans l’attente des décisions des talibans Même si les travaux se poursuivent sur place, “tout est suspendu” en attendant les décisions du nouveau gouvernement, ajoute-t-il. Le choix du lieu et la date de l’inauguration avaient tout d’un symbole: ériger un centre culturel dans la province même où, en mars 2001, deux Bouddhas géants sculptés au cœur d’une falaise avaient été dynamités sur ordre des talibans. La destruction de ces statues avait propulsé l’idéologie radicale des talibans sur le devant de la scène planétaire quelques mois avant les attentats du 11 septembre et reste considérée comme l’un des pires crimes archéologiques de l’histoire.
Inquiétude et incertitude sur l’avenir du patrimoine Vingt ans après, le retour du mouvement islamiste réveille les craintes des défenseurs du patrimoine, contraints de naviguer à vue. En février, le mouvement a affirmé sa volonté de “protéger, surveiller et préserver” le patrimoine historique afghan qui, outre la vallée de Bamiyan (centre), comprend le minaret et les vestiges archéologiques de Djam, plus à l’ouest, ou encore le sanctuaire bouddhiste de Mes Aynak, près de Kaboul. Mais depuis leur prise de pouvoir, les talibans n’ont pas donné plus de précisions permettant d’apaiser définitivement les inquiétudes du monde du patrimoine. Et mi-août, des habitants les ont accusés d’être derrière la destruction partielle à Bamiyan de la statue d’un ex-dirigeant de l’ethnie hazara, qu’ils ont persécutée dans les années 1990, sans que leur participation soit toutefois confirmée. La situation est différente de celle de 2001 “On est tous un peu dans l’expectative”, souligne Philippe Marquis, directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan (Dafa). Les déclarations de février “sont des déclarations d’intention qui valent ce qu’elles valent mais c’est plutôt un bon signe. On n’a pas de déclarations disant: On va tout détruire ou tout effacer du passé non islamique de ce pays”, ajoute-t-il. Même prudence à l’Unesco. “On juge sur l’histoire et il y a 20 ans il y a eu des résultats terribles”, note Ernesto Ottone, sous-directeur général pour la culture. Les choses ont changé par rapport à 2001, veut-il croire, rappelant notamment que l’Afghanistan a signé plusieurs conventions et que depuis 2016 la destruction du patrimoine est considérée comme un crime de guerre. Un temps redouté, un scénario à l’irakienne – lorsque des dizaines de milliers de pièces avaient été volées à Bagdad après la chute de Saddam Hussein en 2003 – ne semble quant à lui pas s’être produit à Kaboul. Pour l’heure du moins. Depuis la chute du premier régime taliban en 2001, un travail d’inventaire a été engagé, précise Ernesto Ottone, mais “c’est un processus très long”. A ce stade, seul un tiers des milliers d’objets d’arts du musée national, à Kaboul, ont été répertoriés.
La sécurité d’abord Sur le terrain, signe de l’effroi que provoquent toujours les talibans, les Afghans travaillant dans le domaine du patrimoine préfèrent ne pas parler par crainte de représailles. Certains ont quitté le pays quand d’autres vivent terrés chez eux. Le 20 août, le directeur du musée national – qui avait avait été pillé et délibérément saccagé pendant la guerre civile (1992-1996) et sous le régime taliban (1996-2001), avait indiqué au New York Times avoir reçu la promesse du nouveau régime qu’il protégerait l’établissement. “Mais nous sommes encore très préoccupés par la sécurité de notre équipe et de la collection”, ajoutait Mohammad Fahim Rahimi. Des défenseurs du patrimoine exilés Désormais réfugié en Allemagne avec sa famille, Mustafa, ancien employé de l’Unesco à Bamiyan, ne se fait lui aucune illusion sur les intentions des nouveaux maîtres du pays. “Les talibans ne croient pas aux conventions internationales (sur le patrimoine), notamment parce qu’elles ont été signées par le gouvernement précédent”, note-t-il. Et “comme ils sont illettrés et extrémistes, ils sont fiers de détruire des monuments non musulmans”. Terré dans la capitale après avoir été interrogé à deux reprises par les talibans, Abdul, employé provincial de Bamiyan, raconte de son côté les “instruments de musique brisés” et les “objets d’arts volés ou réduits en miettes” au début août. “J’étais triste mais je n’ai pas pu protester”, confie-t-il. “Je n’avais aucune garantie qu’ils n’allaient pas m’accuser (…) d’idolâtrie et retourner leur arme contre moi et me tuer”. Fragilisé par cette fuite des cerveaux, le secteur du patrimoine afghan doit également composer avec une inconnue de taille, celle de la date de reprise de l’aide internationale, pour l’heure largement suspendue. “On retient notre souffle”, résume Philippe Marquis. “Mais j’espère que bientôt on aura la possibilité de respirer de façon un peu plus légère”. Sophie Nouaille avec AFP
Publié le 9 septembre 2021(Mise à jour le 13/09) Par Louis Fraysse George W. Bush ou le bien contre le mal Dans les mois qui suivent les attentats du 11 septembre 2001, la rhétorique religieuse du président américain George W. Bush déconcerte en Europe. « Notre guerre est une guerre contre le mal. C’est clairement une question de bien contre le mal, et ne vous y trompez pas, le bien l’emportera. » Accoudé sur son pupitre, George W. Bush, martial, marque une pause. Les applaudissements retentissent. En ce 5 janvier 2002, le président des États-Unis donne un discours au palais des congrès d’Ontario, en Californie. Depuis le 11 septembre de l’année passée, alors que la mémoire des attaques terroristes est encore vive dans le pays, George W. Bush ne cesse, dans ses prises de parole, d’évoquer la lutte mondiale qui oppose le bien et le mal. Les États-Unis, martèle-t-il, ont pour mission de diffuser la liberté dans le monde, en repoussant la « terreur », les « méchants » et « l’axe du mal ». « Nous sommes dans un conflit entre le bien et le mal, et l’Amérique appellera le mal par son nom », déclare-t-il encore aux diplômés de l’académie militaire de West Point, le 1er juin 2002. Après l’Afghanistan et ses bases d’entraînement d’Al-Qaïda, l’Irak du dictateur
Saddam Hussein devient rapidement la cible de l’administration Bush Jr. La foi portée en étendard du président républicain, chrétien born again, attire l’attention des commentateurs européens. Vu de France, c’est entendu : George W. Bush est en « croisade », un terme qu’il n’utilisera pourtant qu’à une seule reprise, lors d’une conférence de presse le 16 septembre 2001, et qu’il regrettera par la suite. « La secte Bush attaque », clame par exemple la une de l’hebdomadaire Marianne en mars 2003, qui ajoute que « le centre du pouvoir planétaire est tombé aux mains d’extrémistes illuminés ». Même son de cloche pour Le Nouvel Observateur, qui titre, un an plus tard : « Les évangéliques. La secte qui veut conquérir le monde ». Pour nombre d’observateurs, note l’historien Sébastien Fath, spécialiste de l’évangélisme, « la guerre contre l’Irak de 2003 est (…) perçue comme un djihad à l’américaine ». Bush, Chirac et Magog C’est sur ce type de sujet que l’on mesure le fossé qui existe entre une société française largement sécularisée et des États-Unis où le religieux conserve une grande influence. « Pour de nombreux Américains, notamment parmi les évangéliques, qui constituent de 25 à 30 % de la population, le vocabulaire et les références bibliques sont quelque chose de familier, et la lecture de la Bible teinte la façon dont est perçue le Moyen-Orient, Israël en particulier, explique Célia Belin, chercheuse invitée à la Brookings Institution. Outre-Atlantique, le discours d’un George W. Bush ne détonne pas. Par le passé, des présidents comme Woodrow Wilson, Harry Truman ou Ronald Reagan ont eux aussi mobilisé ces thèmes chrétiens. » Des références qui passent parfois bien loin au-dessus de la tête des Européens, comme l’illustre une anecdote rapportée en 2007 par Allez savoir !, le magazine de l’université de Lausanne. Nous sommes alors début 2003. George W. Bush, qui a déjà pris la décision de renverser Saddam Hussein, tente de convaincre le président français Jacques Chirac d’être de l’aventure. Au détour d’une phrase, le chef de l’État américain annonce que Gog et Magog sont à l’œuvre au Moyen- Orient, que les prophéties bibliques sont en train de s’accomplir. Interloqué, l’Élysée demande un éclaircissement à la Fédération protestante de France, qui fait appel à l’un des meilleurs spécialistes francophones de l’Ancien Testament, l’exégète Thomas Römer, alors professeur à l’université de Lausanne. Le bibliste rédige un texte rappelant les fondements théologiques de Gog et Magog,
notamment mentionnés dans le livre d’Ézéchiel. « Comme de nombreux chrétiens américains, George W. Bush croit que Dieu sera auprès d’Israël lors de la confrontation finale, donc que les ennemis de ce pays seront dans le camp de l’Antéchrist, expliquait Thomas Römer dans Allez savoir ! Il soutiendra donc Israël sans faiblir, parce qu’il est intimement persuadé que, quand la fin des temps arrivera, il faudra être du côté d’Israël. » Or Saddam Hussein, qualifié de « dément », de « malfaisant » par l’administration Bush, avait bombardé Israël en 1991 lors de la guerre du Golfe. « Cette lecture américaine échappe effectivement aux Européens, qui ont perdu ce rapport aux textes bibliques, avançait Thomas Römer. Si l’on oublie le religieux dans l’analyse du soutien des États-Unis à Israël, on se trompe. » Messianisme et realpolitik Faut-il pour autant voir dans la réponse américaine au 11-Septembre le résultat d’une vision messianique du monde, destinée à précipiter la fin des temps et le retour du Christ ? Ce serait faire fi d’autres raisons, bien plus terre à terre. « Les attentats du 11-Septembre ont été si choquants pour les États-Unis qu’ils présentent une indéniable dimension apocalyptique, admet Célia Belin. Mais le choix d’intervenir en Afghanistan puis en Irak relève avant tout de la volonté d’éradiquer Al-Qaïda doublée de l’intention d’en finir avec Saddam Hussein, de démocratiser le Moyen-Orient, tout en tenant compte d’intérêts industriels et énergétiques. » Pour les néoconservateurs, très influents lors du premier mandat de Bush fils, le changement de régime, y compris par la force, est considéré comme une stratégie rôdée. Ces théoriciens en veulent pour preuve les pays qui, à partir des années 1970, ont mis fin à leur programme de développement d’armes nucléaires après avoir opté pour la démocratie. C’est sur cet arrière-fond que vient se greffer la rhétorique religieuse de George W. Bush, bien utile pour justifier la guerre auprès des Américains. À lire Célia Belin, Jésus est juif en Amérique. Droite évangélique et lobbies chrétiens
pro-Israël, Fayard, 2011, 360 p., 21,50 €. Sébastien Fath, Dieu bénisse l’Amérique. La religion de la Maison-Blanche, Seuil, 2004, 288 p., 17,20 €. Lire également : « Nos sociétés sont obsédées par le terrorisme depuis le 11-Septembre » Face au terrorisme : « La démocratie, c’est la justice, pas la vengeance » Publié le 9 septembre 2021(Mise à jour le 13/09) Par Louis Fraysse « Nos sociétés sont obsédées par le
terrorisme depuis le 11- Septembre » Le 11 septembre 2001 est l’un de ces rares événements dont on garde un souvenir toute notre vie. Les vingt ans des attentats du World Trade Center sont l’occasion de s’interroger sur leurs conséquences pour les relations internationales. C’était il y a tout juste vingt ans, le 11 septembre 2001. À 8 h 46, heure locale, un avion de ligne s’écrasait dans l’une des tours du World Trade Center. Dix-sept minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles était à son tour ciblée par un Boeing 767. Dans les heures qui suivent, les Twin Towers s’effondrent, sous le regard médusé des New-Yorkais et de millions de téléspectateurs à travers le monde. Avec plus de 2 900 morts et quelque 25 000 blessés, les attentats du 11- Septembre créent une onde de choc dans le monde entier et un traumatisme durable pour les États-Unis. Avec le recul historique dont nous bénéficions aujourd’hui, peut-on déterminer quelles en ont été les principales répercussions ? Entretien avec Pierre Grosser, professeur de relations internationales à Sciences Po. Il y a vingt ans, dans la foulée des attentats, les États-Unis envahissaient l’Afghanistan et faisaient chuter le régime Taliban. Aujourd’hui, ces mêmes Talibans sont de retour au pouvoir. Il semble difficile d’y voir autre chose qu’un échec total de la stratégie américaine de l’après 11- Septembre… Avant tout jugement hâtif, il est essentiel de rappeler le contexte dans lequel survient cette opération. On tend à l’oublier pour une raison simple : vingt ans, c’est long. Vingt ans, je le répète souvent à mes étudiants, c’est 1919-1939, c’est 1968-1988, il peut se passer beaucoup de choses, et on tend souvent à se souvenir d’événements passés à partir de ce qu’on en sait par la suite. Vous avez par exemple utilisé le verbe « envahir », mais les États-Unis n’ont pas envahi l’Afghanistan en 2001, à la différence des Soviétiques en 1979, qui l’ont occupé avec 300 000 hommes. Les Américains, au contraire, ont fait chuter le régime Taliban avec peu d’hommes sur le terrain, essentiellement en soutenant des forces locales. Au départ, dans la base militaire de Bagram, dans l’Est du pays, il
n’y avait pas de douches. Quelques années plus tard, c’était devenu une base énorme, à l’américaine, avec piscines, pistes de bowling, fast-foods et même un vendeur de Harley-Davidson… La question, dès lors, est de savoir à partir de quand l’objectif de mission est passé de la chasse à Al-Qaïda au state building, cette volonté de construire de toutes pièces un État afghan en adéquation avec les intérêts américains. Si l’on peut se désoler de l’immense gâchis de vies humaines et d’argent, le retour au pouvoir des Talibans n’est pas réellement une surprise, car tout le monde savait que les Américains ne pourraient pas rester éternellement dans le pays. Avec le recul, on peut donc se demander si le refus de discuter avec les chefs Talibans fin 2001, de les intégrer au processus politique, n’a pas constitué une erreur majeure. Nous sommes alors quelques mois seulement après la chute des tours jumelles… Pour comprendre cette période, il me semble en effet nécessaire de rappeler le choc, la sidération qui règne alors aux États-Unis. Ces attentats, au cœur de la première puissance mondiale, c’est du jamais-vu. Outre leur bilan humain, particulièrement lourd, ils sont spectaculaires, extrêmement médiatisés, avec ces images à peine imaginables tournant en boucle à la télévision. Cette sidération ne dure cependant qu’un temps. Rapidement, elle débouche sur une peur intense qui s’étend à toute la société, y compris au sein de l’administration Bush. Dans les jours et les semaines qui suivent l’attentat, personne ne sait ce qui peut se passer. On imagine le pire. Au sein des services de renseignement, c’est la panique totale, certains craignent que le 11-Septembre ne soit qu’un avant-goût ; on parle alors de terrorisme nucléaire ou bactériologique, de terrorisme « apocalyptique »… La priorité absolue est alors de tout faire pour empêcher une nouvelle attaque. Une fois la panique passée, vous rappelez qu’un sentiment domine chez beaucoup d’Américains : l’humiliation. Oui, un sentiment d’humiliation cuisante, particulièrement à la Maison Blanche et au Pentagone. Cette attaque brutale met à terre un symbole de la puissance américaine, sous les yeux de la planète entière. De là va émerger un élément intimement lié au 11 septembre, et dont les effets se feront sentir en Afghanistan puis en Irak : la colère et la volonté de montrer que les Américains ont certes été
touchés, mais qu’ils ne sont pas abattus, qu’ils restent plus forts que jamais. C’est notamment passé par une réaffirmation virile de puissance – souvenons-nous de George W. Bush en combinaison de vol, s’exprimant le 1er mai 2003 sur le pont du porte-avions Abraham Lincoln pour annoncer la victoire en Irak. Une guerre que l’on a trop hâtivement qualifiée de « guerre pour le pétrole », alors que la question était au moins tout autant stratégique et symbolique : il fallait faire savoir que les États-Unis étaient toujours la première puissance mondiale. J’ajouterai une chose : le choc a été tel, la surprise a été si forte qu’au-delà de l’Amérique, une grande partie de l’Occident, mais pas seulement, a donné un blanc-seing aux États-Unis dans les mois qui ont suivi les attentats. On se souvient de l’éditorial du Monde du 13 septembre 2001, intitulé « Nous sommes tous Américains ». On avait alors le sentiment qu’il fallait à tout prix témoigner de notre solidarité avec le pays, quitte à mettre de côté certaines réserves. Le « comprendre » était souvent l’excuser. Faire du 11-Septembre une rupture majeure ne témoigne-t-il pas d’une vision trop occidentale des relations internationales ? Certes, ce qui touche les États-Unis nous concerne aussi au premier lieu, de par notre proximité culturelle. Mais les analystes rappellent depuis longtemps que la grande majorité des victimes du terrorisme vivent dans des pays du Sud. Sans parler du Moyen-Orient, où toutes les guerres ont depuis 2001 une dimension terroriste, il faut rappeler qu’Al-Qaïda puis le groupe État islamique (EI) ont fait des émules aux Philippines, en Thaïlande, en Somalie, au Nigeria, désormais dans le nord du Mozambique… La vision internationaliste d’Al-Qaïda se greffe sur des multiples situations locales. Quelques jours à peine après les attentats, George W. Bush autorisait la CIA à détenir et interroger des « terroristes présumés ». Si le terrorisme n’est pas une invention du 11 septembre 2001, ne constitue-t-il pas l’un des mots clés de la période que nous vivons depuis ? Nos sociétés sont effectivement obsédées par le terrorisme depuis lors. Entre la vague d’attentats menés par Al-Qaïda puis, une décennie plus tard, par l’EI, nous ne sommes jamais vraiment sortis de cette inquiétude, de cette peur qui est d’ailleurs l’un des objectifs premiers des terroristes. Pourtant, si l’on considère de manière très analytique le risque terroriste en matière de vies humaines, on peut
estimer que les divers gouvernements lui ont sans doute accordé trop d’importance au regard d’autres risques, qui font ou feront bien plus de victimes. Il est plus mobilisateur de combattre une menace que de gérer un risque. Il était toutefois difficile de faire autrement, tant les dirigeants politiques doivent composer avec leur opinion publique et les médias. De plus, à partir du moment où l’on a mis en place, parfois dans l’urgence, tout un ensemble d’institutions liées à la lutte contre le terrorisme, avec de multiples programmes de recherche à la clé, on tend à se retrouver face à un mécanisme qui s’auto-entretient : la menace terroriste semble la plus forte… mais c’est aussi la plus étudiée. Ce n’est que depuis quelques années que l’on commence à octroyer un petit peu moins d’importance au contre-terrorisme pour se pencher davantage sur les effets de l’émergence de nouveaux acteurs au discours fortement nationaliste, qu’ils soient d’envergure internationale, comme la Chine, ou plus régionale, comme la Turquie. La perception stratégique dominante, aujourd’hui, est que le risque sécuritaire provient moins de pays faibles gangrenés par le terrorisme que d’États trop forts. Mais les institutions sont de gros paquebots, et leur faire changer de cap prend du temps. Propos recueillis par Louis Fraysse À lire Pierre Grosser, Traiter avec le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXI siècle, Odile Jacob, 2013, 368 p., 25,90 €. Lire également : George W. Bush ou le bien contre le mal Face au terrorisme : « La démocratie, c’est la justice, pas la vengeance »
Publié le 1 septembre 2021(Mise à jour le 1/09) Par Louis Fraysse Combien de réfugiés afghans pour la France ? Depuis l’invasion soviétique en 1979, l’Afghanistan est l’un des premiers pays d’origine des migrations internationales. Quelque 3 000 personnes, 2 834 pour être précis, dont 142 Français et plus de 2 600 Afghans. Voilà les données officielles de l’évacuation par la France de l’aéroport de Kaboul, après la prise de pouvoir des Talibans le 15 août dernier. Moins de deux semaines plus tard, le dernier avion français quittait le sol afghan, vingt ans après le début de l’invasion occidentale. En visite en Irak pour une conférence régionale, Emmanuel Macron a indiqué samedi 28 août que la France continuait à mener des « discussions » avec le mouvement Taliban et le Qatar afin de poursuivre l’évacuation d’Afghans menacés par le changement de régime. Le sujet de l’accueil de ces derniers s’est quasi instantanément transformé en question de politique intérieure. Dans son allocution télévisée du 16 août, le président de la République a ainsi affirmé qu’il était de « l’honneur de la France » d’« aider » certains Afghans mais qu’il importait également de « nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants ». À plusieurs reprises, le
Rassemblement national s’est opposé à leur arrivée en France, arguant via son numéro deux Jordan Bardella qu’une « grande partie du peuple afghan souhaite vivre sous le régime et sous la loi islamiques, sous le règne de la charia ». À l’inverse, la Cimade, association de soutien aux réfugiés, a lancé une pétition appelant l’Élysée à « respecter les engagements de (la France) en faveur des droits humains en proposant la protection et l’accueil à toutes les personnes afghanes qui les sollicitent » mais aussi à suspendre les expulsions vers l’Afghanistan. Certes, l’afflux de migrants afghans n’est pas chose nouvelle, comme le rappellent les professeurs de droit Thibaut Fleury Graff, Alexis Marie et Julian Fernandez dans un article pour la revue en ligne The Conversation. Avant d’être détrôné par la Syrie en 2013, l’Afghanistan était depuis 1979 le premier pays d’origine des migrations internationales. Fin 2020, on comptait ainsi plus de 2,6 millions de réfugiés afghans dans le monde et plus de 550 000 déplacés internes. 61 000 d’entre eux avaient déposé une demande d’asile dans un pays de l’Union européenne en 2019 – dont 12 000 en France. En vertu de l’article 1A2 de la convention de Genève de 1951, précisent les chercheurs, doit se voir reconnaître la qualité de réfugié toute personne qui « craint avec raison d’être persécutée » dans son pays d’origine pour son ethnie, sa religion, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques. La France est donc tenue juridiquement de les accueillir. Mais à moins d’un an de l’élection présidentielle, le sort de ces Afghans risque d’être pris dans la tourmente de la campagne. Lire également : Afghanistan : quand l’évacuation de Kaboul rappelle la chute de Saïgon Afghanistan : “Emmenez-nous avec vous !”, des milliers d’Afghans bloqués à l’aéroport de Kaboul Afghanistan : les 45 ressortissants français et étrangers évacués sont arrivés en
France Afghanistan : Paris organise une ultime évacuation pour ses ressortissants Afghanistan : les filles de retour à l’école mais jusqu’à quand ? Afghanistan : les Hazaras, minorité chiite menacée par les talibans Mouvement des talibans qui sont les “étudiants en religion” ? Publié le 1 septembre 2021(Mise à jour le 1/09) Par Louis Fraysse
Les Talibans et l’obsession de la loi Tout à la fois fondamentaliste et nationaliste, le mouvement Taliban s’est notamment imposé dans les campagnes afghanes par sa capacité à rendre la justice. C’est un pont aérien comme on en a rarement vus dans l’histoire. Depuis le 14 août, pas moins de 114 000 personnes ont été exfiltrées d’Afghanistan via l’aéroport de Kaboul. Tombée aux mains des Talibans il y a deux semaines, à la suite d’une offensive éclair, la capitale afghane est encore sous le choc du violent attentat du 26 août. Revendiqué par le groupe État islamique au Khorasan (EI-K), ce dernier a fait près de 200 victimes, dont treize soldats américains. Alors que le mardi 31 août marque la fin de vingt années de présence militaire occidentale en Afghanistan, la victoire des Talibans ravive le spectre des cinq années de pouvoir du mouvement islamiste, entre 1996 et 2001. Le souvenir en reste vivace : lapidations, exécutions de femmes en place publique, destruction des bouddhas de Bamiyan… et accueil des cadres d’Al-Qaïda, qui justifiera l’invasion des États-Unis et de leurs alliés. Repoussoir par excellence, incarnation de l’obscurantisme le plus barbare, le mouvement Taliban s’est pourtant vu accorder le statut d’interlocuteur acceptable dans la foulée de l’attentat du 26 août. C’est qu’un nouvel acteur est entré en jeu. Partisan d’une violence totale contre ceux qu’il juge « mécréants », l’EI-K exècre en effet autant les Occidentaux que les Talibans, ce qui fait de ces derniers des alliés objectifs dans la lutte contre les djihadistes. L’ennemi de mon ennemi… Comment vont gouverner les nouveaux maîtres de l’Afghanistan ? Le flou règne sur leurs intentions réelles. Mais les Talibans suscitent une telle défiance en Occident qu’il est parfois difficile de considérer le mouvement avec le recul nécessaire. En témoignent les mentions récurrentes de leur idéologie et de leurs pratiques « moyenâgeuses ». Un terme qui a le don d’irriter Gilles Dorronsoro, professeur de science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l’Afghanistan. « Outre le fait qu’il faudrait réhabiliter le Moyen Âge, qualifier le mouvement Taliban de “moyenâgeux” est un non-sens historique, soutient-il. En pays musulman, il est très rare que les oulémas (docteurs de la loi
islamique, NDLR) disposent du pouvoir politique, c’est même quelque chose d’assez exceptionnel. Quant à l’islam que professent les Talibans, s’il s’inspire de jurisprudences très anciennes, il s’inscrit surtout dans l’héritage du déobandisme, création du XIXe siècle. » Une sociabilité commune Né en 1867 dans la ville de Deoband, en Inde britannique, le déobandisme est un courant réformiste musulman. Structuré autour d’un réseau d’écoles coraniques, les madrasas, il prône à la fois un retour aux fondements de l’islam et une application des préceptes de l’école de jurisprudence hanafite – l’hanafisme est l’une des quatre écoles du droit islamique sunnite. Le poids de cet héritage est déterminant pour comprendre qui sont les Talibans. « Contrairement à l’image chaotique que l’on a souvent de lui, le mouvement Taliban est centralisé, bien structuré, indique Gilles Dorronsoro. Surtout, ses dirigeants sont soudés par une socialisation commune ; ce sont des religieux qui ont étudié dans les mêmes madrasas, notamment la madrasa Haqqaniyya, au Pakistan. Cette solidarité profonde a permis que l’organisation survive à l’invasion américaine, et de limiter les dissidences en son sein. » Outre ce socle commun, les Talibans ont su, depuis leur défaite de 2001, faire preuve d’un certain pragmatisme. Historiquement pachtoune – la première ethnie d’Afghanistan, qui rassemble environ 40 % de la population –, le mouvement a développé dans les années 2000 une stratégie d’ouverture envers les autres ethnies, Hazaras chiites exceptés. « Les Talibans ne sont ni une organisation tribale, ni une organisation ethnonationaliste, c’est avant tout un mouvement religieux avec une base cléricale, résume Gilles Dorronsoro. Leur ouverture aux Ouzbeks et aux Tadjiks explique qu’ils se soient cette fois emparés assez facilement des provinces du Nord du pays, celles-là mêmes qui leur avaient farouchement résisté dans les années 1990. » Mais leur popularité, réelle, auprès d’une partie de la population s’explique aussi par leur capacité à rendre la justice de manière impartiale, bien davantage que les juges de l’ex-régime, notoirement corrompus. C’est justement la thèse d’Adam Baczko, chargé de recherche CNRS à Sciences Po et auteur d’un ouvrage consacré aux tribunaux des Talibans en Afghanistan. « En 1996, quand les Talibans sont arrivés au pouvoir, leurs juges se sont montrés aptes à juger de
manière impartiale, mais aussi à imposer leurs verdicts par la coercition, ce qui leur a permis de trancher des conflits, confiait-il récemment dans un entretien pour Philosophie magazine. C’est mis à leur crédit, y compris par leurs opposants. » Arguties juridiques et « vrai » islam Chassé du pouvoir en 2001, le mouvement s’est méthodiquement réimplanté dans les campagnes afghanes, village par village. Dans le contexte volatil de la guerre civile, en opposition à la corruption des magistrats officiels, ils ont mis en place un système juridique « relativement prévisible » pour la population. Pour Adam Baczko, le mouvement Taliban se caractérise d’ailleurs par une « obsession » pour le droit. « Pour ramener l’ordre en Afghanistan, ils raisonnent comme des juges : il faut réguler les comportements individuels, rééduquer les Afghans en contrôlant par le droit toutes les choses quotidiennes, expliquait-il à Philosophie magazine. Le régime taliban, c’est le gouvernement des juges, mais des juges ruraux et très conservateurs. » Ce tropisme juridique suscite d’ailleurs l’hostilité du groupe État islamique, qui qualifie les Talibans d’« apostats ». Ces derniers sont accusés de privilégier les arguties juridiques au détriment du « vrai » islam et d’avoir accepté de négocier avec les États-Unis en 2020 à Doha, au Qatar. L’autre distinction majeure entre les deux groupes porte sur leur projet géopolitique. « Le groupe État islamique au Khorasan souhaite abolir la frontière afghano-pakistanaise, qu’il ne reconnaît pas, et rêverait d’éradiquer les minorités religieuses comme les chiites, dans une optique clairement génocidaire, révèle Gilles Dorronsoro. Les Talibans, à l’inverse, s’inscrivent dans une logique nationaliste ; ils veulent s’emparer de l’État, en expulser les étrangers et le gouverner selon la charia, la loi islamique. » De quoi convenir à une partie de la population afghane, marquée par plusieurs décennies de guerre civile. Talibans et talibans, question de majuscule En persan, le mot talib (ou taleb), dont le pluriel est taliban (taleban), signifie « étudiant ». Au Pakistan et en Afghanistan, le mot taliban désigne plus
particulièrement des étudiants en religion, ceux des madrasas, les écoles coraniques. Les chercheurs distinguent ces derniers des Taliban (avec une majuscule), mouvement politique apparu en 1994 dans la province afghane de Kandahar. La distinction importe, affirment-ils : beaucoup de taliban n’appartiennent pas à l’organisation Taliban, et certains Taliban ne sont pas taliban. De plus, comme le pluriel persan est déjà marqué dans le mot taliban, les chercheurs ne lui ajoutent pas de « s » en français, à la différence de la plupart des titres de presse francophones. Enfin, les spécialistes insistent aussi sur la nécessité de différencier le mouvement Taliban afghan de son homonyme pakistanais. Ultraviolent, ce dernier – Tehrik-i-Taliban Pakistan ou TTP – se rapproche davantage du groupe État islamique par son mode opératoire. Documentaire Afghanistan, pays meurtri par la guerre est un documentaire en quatre épisodes décryptant les 50 dernières années de ce pays. Disponible jusqu’au 11 septembre. À lire Gilles Dorronsoro, Le gouvernement transnational de l’Afghanistan. Une si prévisible défaite, Karthala, 2021, 288 p., 29 €. Adam Baczko, La guerre par le droit. Les tribunaux Taliban en Afghanistan, CNRS éditions, 2021, 384 p. 25 €. Lire également : Afghanistan : “Emmenez-nous avec vous !”, des milliers d’Afghans bloqués à l’aéroport de Kaboul
Afghanistan : quand l’évacuation de Kaboul rappelle la chute de Saïgon Afghanistan : les 45 ressortissants français et étrangers évacués sont arrivés en France Afghanistan : Paris organise une ultime évacuation pour ses ressortissants Afghanistan : les filles de retour à l’école mais jusqu’à quand ? Afghanistan : les Hazaras, minorité chiite menacée par les talibans Mouvement des talibans qui sont les “étudiants en religion” ? Publié le 25 août 2021(Mise à jour le 25/08) Par Rédaction Réforme
Afghanistan : les Hazaras, minorité chiite menacée par les talibans Majoritairement chiite, les Hazaras comptent représentent entre 10 % et 20 % de la population afghane. Les Hazaras, une minorité majoritairement chiite persécutée depuis des siècles en Afghanistan, ont beaucoup à perdre après l’arrivée au pouvoir des talibans. Ils craignent que ces extrémistes sunnites ne se tournent contre eux, comme ils l’avaient fait dans les années 1990, même si les talibans ont promis de se montrer cléments envers tous leurs anciens ennemis. Qui sont les Hazaras ? Originaires des plateaux du centre du pays, les Hazaras sont présentés comme des descendants des hordes mongoles de Gengis Khan qui ravagèrent l’Afghanistan au XIIIe siècle. Représentant entre 10 et 20 % des 38 millions d’Afghans en l’absence de statistiques fiables, ils ont été marginalisés par les sunnites pour leur foi majoritairement chiite, dans un pays régulièrement en proie à des divisions religieuses et ethniques. Selon certaines estimations, environ la moitié de la population hazara a été exterminée à la fin du XIXe siècle, lorsque leurs territoires traditionnels ont été conquis par les Pachtounes sunnites. Au fil des siècles, la minorité a été soumise à l’esclavage, aux persécutions religieuses, au nettoyage ethnique et aux déplacements forcés. Elle a également été visée par différents groupes dans les quatre dernières décennies de conflit, y compris lorsque ses territoires ont été bombardés par les moudjahidine combattant les Soviétiques dans les années 1980. Les combattants hazaras ont été à leur tour accusés d’atrocités lors de la guerre
civile qui a suivi le retrait de l’armée soviétique en 1989. On estime que des milliers d’entre eux ont été abattus par les talibans lorsque ceux-ci ont pris le contrôle du pays à la fin des années 1990. Pourquoi sont-ils visés ? Les Hazaras constituent l’essentiel de la minorité chiite du pays, méprisée par les extrémistes sunnites qui les considèrent comme des hérétiques. Ils ont également été accusés d’être trop proches de l’Iran chiite, où des dizaines de milliers d’entre eux sont partis au fil des années pour y travailler. Des milliers de Hazaras ont été entraînés par les forces de sécurité iraniennes et mobilisés au sein de milices chiites en Syrie au cours de la dernière décennie. L’année dernière, le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié les combattants hazaras de “meilleure force” pouvant être mobilisée contre le groupe jihadiste État islamique (EI) en Afghanistan. Quelles conséquences de la prise du pouvoir par les talibans ? Peu de communautés ont autant bénéficié de la nouvelle donne lorsque les États- Unis sont intervenus en Afghanistan et ont renversé le précédent régime taliban fin 2001. Depuis 20 ans, les Hazaras ont pu envoyer leurs enfants à l’école – y compris leurs filles – et accéder à une participation sans précédent à la vie politique et économique du pays. Mais ces gains sont restés fragiles. Ils n’ont cessé d’être ciblés par l’escalade de violence. Des attentats-suicides parfois revendiqués par l’EI ont visé leurs mosquées, écoles, rassemblements ou hôpitaux dans l’enclave hazara de Dasht-e-Barchi à Kaboul, faisant des centaines de morts. Craignant d’être à nouveau massacrés au départ des troupes internationales le 31 août, certains Hazaras avaient commencé à reprendre les armes ces derniers mois. Une milice créée dans la province du Wardak (centre) avait recruté et entraîné de nouveau des combattants.
Peu après la prise du pouvoir par les islamistes, la statue d’un homme politique hazara, Abdul Ali Mazari, tué alors qu’il était prisonnier des talibans en 1995, a été partiellement démolie à l’explosif la semaine dernière à Bamiyan (centre). L’incident a ravivé la crainte pour les Hazaras que les nouveaux maîtres du pays s’en prennent une nouvelle fois à eux. AFP Publié le 23 août 2021(Mise à jour le 23/08) Par Rédaction Réforme Afghanistan : “Emmenez-nous avec vous !”, des milliers d’Afghans bloqués à l’aéroport de Kaboul “S’il vous plaît, emmenez-nous avec vous” : pour accéder dimanche 22 août à l’aéroport de Kaboul, dans un convoi de bus escortés par les talibans, des Afghans ont dû fendre la foule de leurs compatriotes désespérés de les rejoindre sur un vol
vers l’étranger. Un journaliste faisant partie d’un groupe d’employés de presse et d’universitaires parti d’un hôtel du centre de Kaboul dimanche matin, a raconté à l’AFP avoir croisé un large rassemblement de gens qui semblaient avoir passé la nuit à un carrefour proche de l’aéroport. “Aussitôt qu’ils ont vu notre convoi, ils se sont levés et ont couru vers nous”, a-t-il décrit. “Ils nous montraient leurs passeports et d’autres documents (…) Un homme est venu à ma fenêtre avec sa femme et son enfant, et a agité son passeport en me disant: “J’ai un visa britannique, mais je ne peux pas monter. S’il vous plaît, laissez-nous monter dans le bus”.” Anarchie totale à l’aéroport Depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août, des dizaines de milliers de personnes ont assiégé dans une anarchie totale l’aéroport de la capitale, tentant, souvent en vain, de monter à bord d’un des vols d’évacuation mis en place par les États-Unis et leurs alliés. Les images de gens écrasés dans la mêlée, de jeunes hommes accrochés au fuselage d’un avion américain sur le départ, ou de ce bébé passé à bout de bras au-dessus d’un mur à des soldats américains, ont sidéré le monde. Une semaine après, des milliers de familles sont toujours massées dans l’espace vide entre les deux rangs de barbelés qui séparent les talibans et les Américains. Ces derniers sont en charge de ce que leur président, Joe Biden, a qualifié d’une des opérations d’évacuation parmi “les plus difficiles de l’histoire”. “Ils nous montraient leurs passeports et criaient: “Emmenez-nous avec vous, s’il vous plaît emmenez-nous avec vous”, a ajouté ce journaliste. “Le combattant taliban dans le camion devant nous a dû tirer en l’air pour les disperser.” Lest talibans ont été accusés de bloquer, harceler ou même mettre en détention les Afghans qui essaient de s’enfuir. Mais selon ce journaliste, son convoi est passé sans le moindre problème. “Ils n’ont pas prêté attention à nous”.
Vous pouvez aussi lire