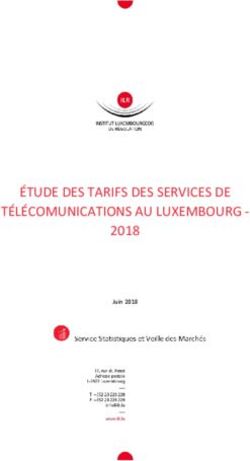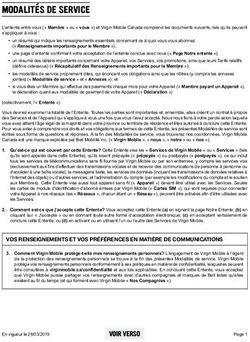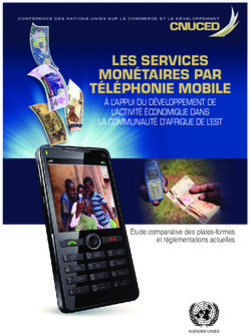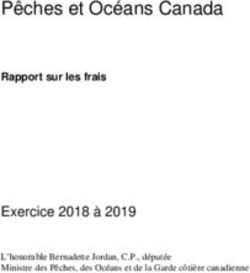Promouvoir l'investissement et l'innovation privés - pour répondre aux besoins en information et en communication des populations pauvres ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Promouvoir l’investissement
et l’innovation privés
pour répondre aux besoins en information
et en communication des populations pauvres
d’Afrique subsaharienneAvertissement Le présent rapport, financé conjointement par infoDev et Alcatel, a été rédigé par les consultants Peter Baldwin et Laurent Thomas. Ce rapport a été super- visé par Kerry McNamara et Seth Ayers d’InfoDev et Souheil Marine du Département « Digital Bridge Initiative » d’Alcatel. Les auteurs et les superviseurs internes et externes qui ont lu les épreuves initiales du présent rapport et suggéré des améliorations conséquentes. Nous remercions spécialement Cathe- rine Camus, éditrice de la Revue des Télécommunications, pour son aide lors des phase de relecture, traduction, mise en formes ainsi que la production matérielle du présent rapport. Les constatations, interprétations et conclusions qu’il contient n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’Alcatel, d’infoDev, des donateurs d’infoDev, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale ou de ses institutions affiliées, ni des membres du Conseil des Administrateurs de la Banque mondiale ou des pays qu'ils représentent. La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données figurant dans ce document. Les frontières, les couleurs, les dénominations et toute autre information figurant sur les cartes du présent docu- ment n’impliquent de la part de la Banque mondiale aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire quelconque et ne signifient nullement que la Banque mondiale reconnaît ou accepte ces frontières. Le contenu de cette publication fait l’objet d’un dépôt légal. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite ou transmise sans l’autorisation préalable de la Banque mondiale. La Banque mondiale encourage la diffusion de ses études et, nor- malement, accorde sans délai l’autorisation d’en reproduire des passages. Pour obtenir cette autorisation, veuillez contacter infodev@worldbank.org. Copyright © 2005 Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. Tous droits réservés Illustrations et mise en page : Atelier Antoine Maiffret (www.maiffret.net) Imprimé en France par : MACON Imprimerie 22, rue du 134e Régiment d’Infanterie - 71000 Macon. France Crédits photos couverture : © Alcatel et © Afrique Initiatives
SOMMAIRE
Résumé 1
Introduction 4
Chapitre 1 : Études de cas 8
Chapitre 2 : Comprendre les structures de la demande en TIC
dans les pays en développement 21
Chapitre 3 : La desserte des zones rurales : de nombreux défis à relever 28
Chapitre 4 : Miser sur les nouvelles technologies et les infrastructures existantes
pour couvrir les besoins en TIC des populations rurales pauvres 35
Chapitre 5 : Comprendre la chaîne de valeur 47
Chapitre 6 : Développer des modèles économiques viables pour les opérateurs
de réseaux en zone rurale 53
Chapitre 7 : Création de cadres favorables aux TIC en Afrique subsaharienne 64
Chapitre 8 : Pistes pour l’avenir 71
Annexe A : Glossaire 73
Annexe B : Entraves possibles à l’efficacité réglementaire 75
Bibliographie 76Avant-propos
Aujourd’hui, plus de deux milliards de personnes, soit près du tiers de la population mondiale,
sont abonnés à des services de télécommunications. Pourtant, malgré l’explosion des services
mobiles ces dernières années, plusieurs milliards de personnes, vivant en majorité dans les pays
en développement, n’ont toujours pas accès à des services susceptibles de couvrir leurs besoins
essentiels en matière d’information et de communication. De surcroît, si la fracture numérique
entre pays développés et pays en développement tend à se réduire, elle ne cesse de s’aggraver
en revanche au sein même des pays en développement. Il s’agit là d’un enjeu particulièrement
important pour de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, dont la population est rurale à plus
de 60 % en moyenne, et qui réclament dès lors des solutions innovantes pour la fourniture d’ap-
plications et de services localisés, l’extension de la couverture en infrastructures et l’optimisa-
tion des opportunités de marché.
infoDev et Alcatel œuvrent depuis de nombreuses années pour répondre à ce défi en assistant
les acteurs clés du secteur dans la mise en place d’un cadre propice à l’utilisation des TIC comme
instrument de lutte contre la pauvreté et de développement durable et diversifié. Notre travail
a porté sur la demande aussi bien que sur l’offre de services TIC. Du côté de la demande, nous
avons, indépendamment ou de concert, soutenu des projets pilotes innovants pour faire la démons-
tration du potentiel de développement que recèlent les services d’information et de communi-
cation localisés ; projets qui ont aussi permis de mettre en évidence les entraves politiques et
réglementaires à la fourniture de ces services. Du côté de l’offre, Alcatel a développé des modè-
les économiques et commerciaux innovants, mobilisant les infrastructures de télécommunica-
tions existantes et à venir pour fournir des services à valeur ajoutée, tout particulièrement dans
les zones rurales ou mal desservies.
Pour être plus efficaces, il est clair que nous devons mieux comprendre l’écart entre l’offre et la
demande, et permettre aux acteurs locaux de combler cet écart. Notre collaboration dans le cadre
de cette étude tente d’apporter un peu de lumière sur ces questions. Nous croyons que les moyens
et les possibilités pour combler cet écart sont à portée de main, mais qu’il faut pour cela ima-
giner des approches innovantes en matière de technologies, d’applications et de services, déve-
lopper des modèles d’entreprise viables, et mettre en place des cadres politiques et réglemen-
taires propices à la fourniture de services TIC dans les zones mal desservies. Le secteur privé
est appelé à jouer un rôle majeur, mais il faudra aussi explorer des pistes de partenariat public-
privé innovantes.
En tant que contribution conjointe à la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de
l’information, cette étude vise à mettre en lumière les possibilités qui s’offrent à nous d’attein-
dre des objectifs de développement essentiels en comblant l’écart entre l’offre et la demande en
TIC, afin de répondre aux besoins en information et en communication des communautés rura-
les et/ou mal desservies d’Afrique subsaharienne.
Mostafa Terrab Thierry Albrand
InfoDev Program Manager Alcatel, Vice President Digital BridgeRésumé
L’
idée, derrière cette collaboration entre bien les spécificités de la structure de la
infoDev et Alcatel, était que le premier demande en ASS : les pays subsahariens ont
procède à une analyse de la demande des taux de mortalité infantile parmi les plus
pour les services d’information et de élevés du monde, et il n’existe pas de service
communication, tandis que l’équipementier télé- TIC comparable dans le monde développé ;
coms se pencherait sur les contraintes du côté • l’information étant un bien normal, la demande
de l’offre, afin de dresser un tableau complet du augmenterait avec la diminution du coût de la
marché des services liés aux technologies de l’in- bande passante, qui est plus élevé en Afrique que
formation et de la communication (TIC) en Afri- partout ailleurs dans le monde. Les solutions pour
que subsaharienne (ASS). infoDev a puisé dans faire baisser ce coût passent nécessairement par
son imposante bibliothèque de projets TIC en une concurrence accrue entre opérateurs, l’intro-
ASS. Nombreux étaient ceux qui donnaient un duction d’obligations d’accès universel et la mise
aperçu intéressant du marché africain des ser- en place d’échangeurs IXP nationaux ou régionaux.
vices TIC, mais la liste des projets demandant à Une infrastructure dorsale suffisante est également
être examinés de plus près s’est sensiblement une condition indispensable au développement de
réduite au regard des critères suivants : services TIC sur une base élargie ;
• s’il faut s’attendre à ce que la téléphonie vocale soit
1. les services proposés représentent le fruit la technologie dominante, surtout dans les pays à
d’une étude de marché réalisée par le secteur faible taux d’alphabétisation, la demande pour des
privé des pays concernés ; services de données n’est pas négligeable pour
2. les services répondent à des besoins non sat- autant. La clé réside dans le développement de con-
isfaits identifiés par les objectifs du Millénaire tenus applicatifs locaux et de services à valeur
pour le développement ; ajoutée à des tarifs abordables. Chacun des cinq
3. dans la mesure du possible, les projets sont prestataires de services à valeur ajoutée étudiés au
financièrement autonomes. chapitre 1 témoigne de l’existence d’une demande
effective pour des services de données ;
Nous avons ainsi sélectionné cinq projets • la diffusion des TIC en Afrique subsaharienne
répondant à ces critères. Ils portent sur des se heurte à des obstacles majeurs – réglemen-
domaines aussi différents que la santé, la ban- tation inadéquate, entraves au marché, manque
que mobile ou les systèmes d’information sur d’infrastructures. Plus précisément, l’absence
les prix et les marchés. de cadre politique constructif en matière de con-
D’importantes recherches documentaires et currence et d’accès universel, les difficultés
de terrain ainsi que de nombreuses consulta- d’accès aux capitaux d’investissement ainsi que
tions auprès d’opérateurs télécoms implantés le manque de culture informatique générale et
en Afrique subsaharienne ont permis de déga- de ressources humaines qualifiées dans le
ger plusieurs constatations : secteur des TIC constituent trois grands
chantiers à ouvrir pour les gouvernements sub-
• la demande pour des services d’information et sahariens. En termes absolus, le projet malien
de communication est forte en ASS. Les IKON dépense, par kilobit, près de huit fois ce
prestataires locaux ont identifié des besoins qu’il dépenserait dans un pays développé. La
dans le secteur de la santé, de la banque, de la société sénégalaise Manobi rencontre
géolocalisation, de la gestion foncière, des d’énormes difficultés pour obtenir un crédit
places de marché virtuelles, etc. Les services bancaire, car elle ne possède pas d’actifs
proposés répondent à d’autres réalités que dans physiques qu’elle puisse offrir en garantie. Les
les pays développés, et empruntent d’autres deux entreprises supportent en outre des
canaux. Des services comme le programme de taxes de l’ordre de 50 à 100 % sur le matériel
«cyberpédiatrie» Pésinet, au Sénégal, illustrent informatique et de télécommunications ;
Promouvoir l’investissement et l’innovation privés 1Résumé
• les opérateurs et les prestataires de services la Mauritanie et de l’Éthiopie. Entre 1995 et 2003,
peuvent réaliser des profits dans les zones la Mauritanie a mis aux enchères deux licences de
rurales et les marchés à faible ARPU (revenu téléphonie mobile, privatisé l’opérateur historique
moyen par abonné) s’ils parviennent à réduire et institué une autorité de régulation transparente
leur coût total de possession en optimisant et efficace. L’Éthiopie n’a rien fait de semblable. Au
leurs dépenses d’investissement (CAPEX) et cours de cette période, le taux de pénétration des
leurs dépenses d’exploitation (OPEX). Il leur télécommunications a grimpé en flèche en Mau-
faut pour cela mettre au point des solutions ritanie, passant de 0,41 % à 11,07 %, tandis que
rentables adaptées aux configurations rurales/ celui de l’Éthiopie plafonnait à un très bas niveau
périphériques. Les opérateurs doivent aussi (de 0,25 % à 0,61 %), alors même que le taux de
faire usage de modèles économiques et com- pénétration des communications mobiles pour l’en-
merciaux innovants, exploitant de nouveaux semble de l’Afrique subsaharienne (hors Afrique
dispositifs financiers, qui leur permettent de du Sud) progressait de 0,26 % à 3,34 %.
mieux répondre à la demande en s’appuyant
sur des stratégies de commercialisation et des Meilleur accès aux capitaux
canaux de distribution adaptés ; Le projet IKON, au Mali, de même que la
• les utilisateurs à faibles revenus ont besoin de société Manobi, au Sénégal, ont fait état de leurs
solutions personnalisées, adaptées à leurs con- difficultés à obtenir des prêts des établissements
traintes et à leurs besoins en termes de de crédit de leurs pays respectifs. Le manque
microcrédit, de plans tarifaires, de solutions d’actifs physiques, les fortes exigences en
de paiement/prépaiement/rechargement élec- matière de constitution de garanties (jusqu’à 80
tronique, de fonctionnalités du terminal, etc. % du montant du prêt), le niveau des commis-
sions prélevées, les retards importants dans le
Facteurs déterminants de succès versement des fonds, sans compter les droits
Au-delà de ces constatations communes, l’étude d’importation relatifs au matériel TIC (qui peu-
a permis de faire ressortir plusieurs facteurs vent atteindre 50 %), empêchent les start-ups de
déterminants pour la réussite du déploiement de capitaliser sur leur projet.
services d’information et de communication :
Gisement de main-d’œuvre qualifiée
Concurrence effective dans le secteur des TIC1 Les dirigeants d’IKON et de Manobi ont égale-
Un récent rapport de la Banque mondiale met en ment insisté sur le problème du manque de cul-
lumière l’importance de la concurrence pour sti- ture informatique et de compétences en appli-
muler l’investissement dans les infrastructures TIC. cations TIC. Il n’est pas rare que les candidats
Il compare à cet effet les politiques respectives de à un poste manquent des connaissances infor-
matiques les plus élémentaires et ne sachent pas
Appels internationaux : tarifs élevés en Afrique subsaharienne même se servir d’un ordinateur. Si les pays sub-
par manque de concurrence sahariens veulent rejoindre l’économie mon-
diale, il faut que leurs universités dotent les étu-
6 50% diants des compétences nécessaires.
Coût d’un appel de 3 mn vers les Etats-Unis (USD)
45% 45% La réforme du système éducatif, à tous les
5
40% niveaux, est une condition préalable à la réus-
38%
35%
site du déploiement des infrastructures et des
4
30%
services d’information et de communication.
29%
Quatre des cinq projets étudiés dans le cadre
3 25%
du présent rapport sont le résultat d’une thèse
20%
2 17% de doctorat soutenue par le fondateur de la
15%
13% société. À côté de cela, on peut se demander
10%
1 combien de services à valeur ajoutée demeu-
5%
rent en friche en Afrique subsaharienne, faute
0 0%
Afrique Asie orientale Asie Amérique latine Europe et d’un enseignement adapté.
subsaharienne et Pacifique du Sud et Caraïbes* Asie centrale rojets étudiés dans le cadre du présent rapport
Coût d’un appel de 3 mn vers les Etats-Unis (USD) (2000) sont le résultat d’une thèse de doctorat soute-
% de pays de pleine concurrence
nue par le fondateur de la société. À côté de cela,
* Les données ALC remontent à 1999.
La région MENA ne compte aucun pays de pleine concurrence. on peut se demander combien de services à
Source: : Competition in International Voice Communications, Banque mondiale,
2004, sur la base des Indicateurs du développement dans le monde 2003, citant des valeur ajoutée demeurent en friche en Afrique
données de l’UIT.
subsaharienne, faute d’un enseignement adapté.
2 Promouvoir l’investissement et l’innovation privésRésumé
Contenus locaux
Le faible taux d’alphabétisation reste un obsta- finals. Les cinq projets décrits dans ce rapport ont
cle majeur à la diffusion des TIC. À cela s’ajoute identifié chacun une demande spécifique et, mal-
le manque de contenus locaux proposés dans les gré toutes les difficultés – manque d’infrastructu-
langues locales. Le projet IKON est une parfaite res, déficit de ressources humaines, contraintes
illustration des avantages d’un logiciel adapté, financières -, presque tous dégagent aujourd’hui des
utilisant Linux en langue bambara. profits. Un meilleur accès au financement ainsi
qu’aux ressources réseaux permettraient à ces
Cadre politique, législatif et réglementaire favorable entreprises de se développer et de monter en
au développement de services TIC en zone rurale charge, ce qui se traduirait aussi par une croissance
Les pays subsahariens doivent s’atteler à des du trafic pour les opérateurs de réseaux.
questions comme l’accès universel, la confiden- À la lumière des résultats des ateliers organisés
tialité des données, le règlement des différends avec différents opérateurs de télécommunications
ou les frais d’interconnexion pour faciliter le dans le cadre de cette étude, les auteurs sont
déploiement des services d’information et de convaincus que la solution au défi du « seuil de
communication. Il leur faudra également régler croissance» pour les prestataires de services (exis-
la question de la téléphonie VoIP (Voice over tants ou futurs) passe par l’analyse du terrain, qui
Internet Protocol – Voix sur IP). doit permettre d’identifier au plus près les besoins
en information et en communication des popula-
Partenariats public-privé tions rurales pauvres. C’est la réponse à ces
Les partenariats public-privé sont une solution besoins qui doit dicter les choix technologiques et
à envisager pour le déploiement d’infrastructu- les considérations commerciales, et non l’inverse.
res TIC2, mais ils peuvent aussi produire des Étant entendu qu’une bonne régulation du secteur
externalités négatives. La conception du dispo- des TIC est indispensable à la stabilité d’un mar-
sitif financier est déterminante à cet égard. La ché ouvert, la capacité des individus ou des entre-
mise aux enchères inversées de licences d’ex- prises à fournir des services à valeur ajoutée ne
ploitation du spectre ainsi que d’autres systèmes doit pas être entravée. Les études de cas présen-
de « subventions intelligentes » ont déjà donné tées ici montrent des prestataires de services
des résultats dans certains pays (le Chili par exploitant les infrastructures TIC selon des moda-
exemple). Les partenariats public-privé peuvent lités et pour des usages que les opérateurs
se révéler particulièrement utiles dans le cadre n’avaient pas anticipés, preuve s’il en est que la
du renforcement des capacités (programmes demande en infrastructures TIC est aujourd’hui
éducatifs, incubateurs, etc.). plus forte que ne le pensent les opérateurs télé-
coms, suffisante en fait pour justifier leur déploie-
Délimitation du champ de l’étude ment dans les zones rurales du continent africain3.
Le présent rapport formule une série de
recommandations stratégiques, sans chercher 1
Connecting Sub-Saharan Africa: A World Bank Group
pour autant à se livrer à un examen précis du Strategy for Information and Communication Technology
cadre politique et réglementaire des 48 pays Sector Development, WB Working Paper n° 51, Banque
que compte l’Afrique subsaharienne. Ce soin mondiale, 2005.
est laissé à d’autres publications de la Ban-
2
L’utilisation des technologies de l’information et de la
communication dans les pays les moins avancés pour une
que mondiale ou d’autres organismes. Les
croissance économique durable, Union internationale des
lecteurs qui seraient intéressés par une dis- télécommunications, édition 2004. Voir aussi Anders
cussion plus approfondie des recommanda- Engvall et Olof Hesselmark, Profitable Universal Access
tions en matière de politique et de réglemen- Providers (rapport pour la Swedish International Develop-
tation sont invités à lire, parmi d’autres ouvra- ment Agency), Stockholm, 2004
(http://www.eldis.org/static/DOC14699.htm) et Establi-
ges, l’étude de la Banque mondiale Connecting
shing Community Learning and Information Centers (CLICs)
Sub-Saharan Africa: A World Bank Group in Underserved Malian Communities: Report of Assess-
Strategy for Information and Communication ment Mission, mars 2005, Microsoft Unlimited Potential
Technology Sector Development (2005). Grant (http://www.dot-com-
alliance.org/resourceptrdb/uploads/partnerfile/upload/2
76/mali_MnE.pdf).
Enseignements tirés de la présente étude 3
Pour plus d’informations sur les meilleures pratiques,
Les prestataires de services à valeur ajoutée les études de cas et les technologies d’accès pour
exploitent aujourd’hui les infrastructures TIC pour zones rurales et/ou périphériques, consulter la page
proposer des services innovants aux utilisateurs http://www.itu.int/ITU-D/fg7/.
Promouvoir l’investissement et l’innovation privés 3Introduction
F
ace aux ambitions proclamées par les c’est aussi ce que la présente étude s’attache à
objectifs du Millénaire pour le montrer, les zones non encore desservies con-
développement (OMD)1, certains s’in- stituent un potentiel de profits et de croissance
terrogent sur l’opportunité d’investir important pour les opérateurs télécoms.
dans les technologies de l’information et de la La mondialisation des technologies de l’infor-
communication (TIC). Les critiques estiment en mation et de la communication apparaît, d’une
effet que les moyens limités disponibles seraient certaine façon, comme un phénomène irré-
mieux employés à combattre les causes pro- sistible. Malgré tout ce qui a été dit sur la « frac-
fondes de l’extrême pauvreté et de la faim, de ture numérique », les faits montrent que l’écart
la mortalité infantile, ainsi que de la propaga- entre pays développés et pays en développe-
tion du VIH/sida et d’autres maladies, pour ne ment tend à diminuer dans ce domaine3. Sans
citer que ces trois objectifs du Millénaire *. Il faut surprise, la littérature spécialisée classe les TIC
comprendre néanmoins que les TIC ne viennent parmi les biens économiques positifs, en ce sens
pas en substitution, mais en complément de l’in- que la demande pour ces technologies croît avec
* La déclaration du Millé-
naire, adoptée par la commu- vestissement consenti dans le cadre des efforts le revenu4 (voir tableau ci-après).
nauté internationale et les de développement « classiques »2. Les TIC ser-
États membres des Nations
Unies, énumère huit objectifs vent des objectifs de développement aussi fon- Plus préoccupantes sont les fractures
pour le développement : damentaux que la santé et l’éducation en per- numériques intranationales, qui risquent de
1. Réduire l’extrême pauvreté
et la faim mettant aux « citoyens de seconde classe », et s’aggraver à mesure que les « adopteurs préco-
2. Assurer l’éducation pri- notamment aux populations pauvres des zones ces », les riches et la diaspora adoptent les TIC.
maire pour tous
3. Promouvoir l’égalité et l’au- rurales, de s’autonomiser, de participer directe- La perspective de faciliter l’accès des ruraux
tonomisation des femmes ment à l’identification des problèmes qui les pauvres aux TIC et de réduire les fractures
4. Réduire la mortalité infan-
tile concernent et de s’informer sur les sujets les numériques internes devrait sans doute suffire,
5. Améliorer la santé mater- plus divers, qu’il s’agisse de renseignements à elle seule, à justifier la nécessité de promou-
nelle
6. Combattre le VIH/sida, le vitaux sur la prévention du VIH/sida, ou d’in- voir la diffusion des TIC dans les pays en
paludisme et d’autres formations commerciales, sur les marchés, développement. Or c’est dans les zones urbaines
maladies
7. Assurer un environnement etc. Ainsi mises en perspective, les TIC appa- que les opérateurs télécoms peuvent toucher le
durable raissent comme des outils particulièrement plus de clients potentiels avec des coûts d’infra-
8. Mettre en place un parte-
nariat mondial pour le adaptés pour compenser les handicaps dont structure réduits, ce qui explique qu’ils se
développement. souffrent les ruraux pauvres. D’autre part, et concentrent d’abord sur le tissu urbain. En
PIB par habitant et pénétration des communications mobiles
14
PIB par habitant (USD) (est. 2004)
12
Maurice
Afrique du Sud
10
Botswana
8
Seychelles
Namibie Tunisie
6
Gabon
4 Égypte Maroc
Maldives
Guinée équatoriale
2
Sénégal Mauritanie
Congo-Brazzaville
0 RDC Mali
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Sources: : CIA World Fact Book pour le PIB par habitant en Parité de pouvoir d'achat, Alcatel pour les taux de pénétration des communications mobiles
4 Promouvoir l’investissement et l’innovation privésIntroduction
Afrique subsaharienne - Faits et chiffres (hors Afrique du Sud)
même temps, les populations rurales sont con-
INDICATEURS ANNÉE RÉSULTATS
frontées à des coûts d’opportunité plus impor-
Population 2003 647 M
tants, car les canaux de communication dont
PIB par habitant (USD) 2002 342
elles disposent sont à la fois plus rares et plus
dispersés. Autrement dit, dans les pays en Population urbaine (%) 2003 36
développement, la carence d’infrastructures Taux d’analphabétisme (% de la population de plus de 15 ans) 2003 35
physiques (routes, etc.) fait que l’inaction en Taux brut de scolarisation primaire (% de la population en âge d’être scolarisée) 2003 87
matière d’infrastructures TIC a un coût encore Lignes téléphoniques principales (%) 2003 0,96
plus élevé en milieu rural que dans les zones Lignes principales résidentielles (% des ménages) 2002 3,5
urbaines. Abonnés mobiles (%) 2003 2,78
- % carte prépayée 2003 91,2
Parce qu’il est généralement plus réactif à une - % couverture mobile 2003 47,6
demande et à un environnement en évolution Télédensité effective (fixe + mobile) (%) 2003 2,68
rapide, l’investissement privé constitue un Ordinateurs personnels 2003 0,75
levier essentiel pour la généralisation des TIC Utilisateurs Internet 2003 0,7
dans les pays en développement (PED). Non que Téléviseurs (‰) 2001 60
l’investissement public n’ait pas un rôle impor- Postes de radio (‰) 2001 198
tant à jouer, mais, vu l’ampleur des investisse- Source : UIT African Telecommunication indicators 2004
ments nécessaires et les fortes tensions budgé- Banque mondiale – Indicateurs du développement
taires que doivent affronter les gouvernements
des PED, c’est essentiellement par l’effet démul- se penche sur cette économie de la demande en
tiplicateur qu’il peut induire sur l’investissement analysant les besoins spécifiques des usagers
privé ainsi que par sa concentration dans les des pays en développement. Elle est l’aboutisse-
domaines où l’intervention privée achoppe ment d’un projet conjoint d’infoDev (Informa-
sur des coûts élevés à l’entrée ou sur les tion for Development Program), organisme
risques commerciaux liés à la prestation de multilatéral hébergé par la Banque mondiale,
services en zone rurale que l’investissement et d’Alcatel, équipementier français en télécom-
public s’avère le plus efficace. Nombre de munications.
petites entreprises privées des pays en
développement constituent de véritables Pourquoi l’Afrique subsaharienne ?
moteurs d’innovation dans les TIC ; certains L’explosion des technologies de l’information et
PED sont déjà très avancés dans la constitution de la communication, et notamment de la télé-
d’un secteur TIC, ou capitalisent fortement sur phonie mobile, montre clairement qu’il s’agit là
les TIC pour améliorer la compétitivité de leur de technologies transformationnelles dont nous
secteur privé ou l’efficacité de leurs administra- n’appréhendons pas encore toutes les consé-
tions publiques. Malgré cela, la montée en puis- quences. Les mêmes forces du marché qui ont
sance de l’investissement et de l’innovation transformé l’activité humaine de bout en bout
privés dans les TIC reste un défi majeur pour avec les nouvelles technologies font déjà sentir
la majorité des PED. leurs effets dans les «BRIC» (Brésil, Russie, Inde
et Chine). C’est pourquoi tout le monde s’ac-
L’une des principales difficultés réside dans le corde à dire que le « prochain milliard » d’abon-
développement de nouveaux modèles nés mobiles, à l’horizon 2015, viendra de ces
économiques et de nouvelles structures de pays. Pendant ce temps, l’Afrique subsaha-
services qui répondent directement aux besoins rienne (hors Afrique du Sud) ne fournira pour
des usagers des PED. L’essentiel du débat sur sa part que 20 millions de nouveaux consom-
la facilitation de l’accès aux technologies de l’in- mateurs de TIC. Ce qui amène tout naturelle-
formation et de la communication et sur le ment à s’interroger sur la raison pour laquelle
développement des services TIC dans les PED ce projet s’est focalisé sur le continent noir. La
gravitait ces dernières années autour de l’offre, réponse est simple : les BRIC s’appuient déjà,
c'est-à-dire du déploiement d’infrastructures pour la plupart, sur une certaine dynamique «
réseaux sur les marchés non desservis. Or, s’il offre/demande/cadre incitatif », si bien que
y a un consensus qui se dégage, c’est pour ces pays sont (relativement) avancés dans le
souligner que la clé du succès pour l’innovation déploiement des infrastructures. D’autre part,
privée dans les TIC, dans les pays en développe- bien que l’Afrique subsaharienne parte d’un
ment, réside d’abord dans une bonne com- taux de pénétration plus faible que les autres
préhension de la demande. La présente étude régions, la téléphonie mobile y connaît une
Promouvoir l’investissement et l’innovation privés 5Introduction
croissance plus rapide que partout ailleurs. brièvement d’autres facteurs, comme la régu-
Enfin et surtout, si les TIC constituent un ins- lation, qui ne sont pas sans effets sur la
trument au service des objectifs du Millénaire, capacité des producteurs à créer de la valeur
et notamment de la lutte contre l’extrême pau- le long de la chaîne. Lorsque les cadres régle-
vreté, c’est incontestablement en Afrique qu’il mentaire et financier n’apparaissent pas suf-
faut commencer. fisamment propices à la création de marchés,
nous recommandons des réformes, mais aussi
Le premier chapitre de ce rapport présente cinq le recours à des formes de partenariat public-
exemples d’utilisations innovantes des TIC en privé. Le chapitre 6 propose une analyse des
Afrique subsaharienne *, à partir desquels modèles économiques durables qui pour-
nous essayons d’extrapoler le niveau de la raient permettre aux opérateurs télécoms, avec
demande en TIC sur le continent. Partant de de meilleures stratégies de distribution et de
cette évidence que les fournisseurs de services commercialisation, de créer de la valeur pour
locaux sont les mieux placés pour comprendre eux-mêmes et pour leurs clients des zones
les besoins de leurs marchés locaux5, nous rurales. Le chapitre 7 esquisse les grandes
avons voulu savoir comment ces cinq sociétés orientations politiques et financières à suivre
avaient évalué les besoins de leur clientèle pour faciliter et accélérer le déploiement des
potentielle, et quels obstacles elles avaient infrastructures. Enfin, le dernier chapitre
rencontré — et continuaient éventuellement de récapitule les enseignements tirés des projets
rencontrer — dans la commercialisation de étudiés dans ce rapport et donne des orienta-
leurs services. Sur la base de cette analyse de tions pour l’avenir.
la situation sur le terrain telle que la perçoivent
les prestataires locaux, le chapitre 2 tente de
dégager les facteurs clés de succès qui pour- 1 Voir p. ex. le rapport de l’ONG Social Watch
raient permettre à ces entreprises ou à d’autres Advance Social Watch Report 2005: Unkept
comme elles d’atteindre une taille critique. Promises,
http://www.mdgender.net/upload/
Après cette analyse de la demande, l’étude se monographs/SW-ENG-Advance-2005.pdf.
* L’Afrique subsaharienne
regroupe 48 pays : Afrique du
penche brièvement, au chapitre 3, sur les défis 2 Kerry McNamara, Information And Commu-
Sud, Angola, Bénin, Bots- que devront relever les opérateurs pour four- nication Technologies, Poverty And Deve-
wana, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Cap-Vert, Como-
nir les infrastructures nécessaires aux presta- lopment - Learning From Experience, info-
res, Congo, Côte d'Ivoire, Éry- taires de services dans leur marche vers la Dev, 2003.
thrée, Éthiopie, Gabon, Gam-
bie, Ghana, Guinée, Guinée-
taille critique, avant de passer à l’examen du 3
Voir p. ex. Africa: The Impact of Mobile
Bissau, Guinée équatoriale, côté « offre » du marché des services d’infor- Phones,
Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali,
mation et de communication. Le chapitre 4 http://www.vodafone.com/assets/files/
Mauritanie, Maurice, Mayotte, passe en revue les technologies d’accès exis- en/GPP%20SIM%20paper.pdf.
Mozambique, Namibie, Niger,
Nigeria, Ouganda, Républi-
tantes permettant de desservir les zones rura- 4
Ibid.
que centrafricaine, République les et/ou périphériques avec des services et des 5
À titre d’exemple : à son lancement, la
démocratique du Congo,
Rwanda, São Tomé e Príncipe,
applications à valeur ajoutée rentables. Le cha- téléphonie mobile à carte prépayée était
Sénégal, Seychelles, Sierra pitre 5 décrit les différents acteurs présents censée toucher une clientèle riche, alors
Leone, Somalie, Soudan, Swa-
ziland, Tanzanie, Tchad, Togo,
tout au long de la chaîne de valeur des servi- qu’elle s’est en fait répandue dans tous
Zambie et Zimbabwe. ces TIC en Afrique subsaharienne, en évoquant les pays en développement.
6 Promouvoir l’investissement et l’innovation privésIntroduction
Connectivité en Afrique
Bits/habitant Connexions
sortantes
EUROPE
ME-WE 2/3(2x
SEA- 20
Gb
p s) Amerique du Nord
0.25 1 5
LFON Europe
(5x 2 . 5 G bps)
MAROC TUNISIE
Intra-Afrique
ALGÉRIE Asie
LIBYE
ÉGYPTE
1036
CAP 373
VERT 13
2 Mbit/s totaux
MAURITANIE MALI NIGER 0 200 400 600 800 1000 1200
ERITHRÉE
SÉNÉGAL TCHAD
GAMBIE
GUINÉE BISSAU BURKINA
FASO DJIBOUTI
GUINÉE SOUDAN
BENIN
TOGO SOMALIE
CÔTE NIGERIA
A tl
SIERRA LEONE
D'IVOIRE GHANA
ant
ÉTHIOPIE
LIBÉRIA CENTRAFRIQUE
is-2
CAMEROUN
(2x
200
Ocean Indien
OUGANDA
2 .5
0
GUINÉE EQUATORIALE
KENYA
Gbp
ASIE
s)
SAO TOME GABON RWANDA
ET PRINCIPE RÉPUBLIQUE
CONGO
DEMOCRATIQUE BURUNDI
SAT-3 West Africa Ca
Cabinda DU CONGO TANZANIE
(ANGOLA) SEYCHELLES
AMERIQUE
SA
DU SUD
T-2
(
2x 993
COMORES.
50
1
0
MALAWI
ble (WAS
M
bp
ANGOLA
s)
ZAMBIA
C)( 2 x
MOZAMBIQUE
2.5 G
ZIMBABWE MAURICE
RÉUNION
NAMIBIE
2 0 G b p s)
b p s)
BOTSWANA MADAGASCAR
1000 km
x 2.5
01
1000 mi.
(4
M1
PIB/Habitant SWAZILAND
TD
USD 0-300 )
LESOTHO ps
USD 300-1000 AFRIQUE 2 Gb
200 2 .5
USD 1000-2000 DU SUD ) (2x
S A FE
USD 2000-4000 st (
r Ea
USD 4000-10000
ca & Fa Licences du réseau public VSAT
n Afri
Souther
Source: CRDI (Centre de Recherches pour le Développement International) SAT-3/WASC/
Promouvoir l’investissement et l’innovation privés 7Chapitre 1: Études de cas
L
es données ne manquent pas pour illus- criptions médicamenteuses dans les traitements
trer et documenter le boom des TIC en chroniques ou de longue durée ; Pésinet au Séné-
général et de la téléphonie mobile en par- gal, première ligne de défense contre les causes
ticulier, qui devrait normalement se tra- principales de morbidité et de mortalité chez les
duire par une forte demande d’infrastructures de enfants de moins de cinq ans en Afrique subsa-
réseaux TIC. Il se trouve pourtant des sceptiques harienne ; Manobi, également au Sénégal, plate-
qui remettent en cause la valeur des données rela- forme de services mobiles dédiés au secteur rural
tives à la pénétration des communications mobi- (information sur les marchés et les prix agrico-
les en Afrique subsaharienne. Très concrètement, les, services de géolocalisation, etc.) ; et enfin
s’interrogent ces critiques, doit-on considérer MoPay, service de banque mobile basé en Afri-
quelqu’un qui possède une carte SIM, mais qui n’a que du Sud.
pas de téléphone, comme un utilisateur du
réseau ? Faut-il comptabiliser comme client I. Projet IKON
quelqu’un qui possède un téléphone, mais qui ne Vaste pays enclavé d’une superficie de
dispose pas de crédit prépayé, de sorte qu’il peut 1 240 000 km2 pour une population de 11,6 mil-
seulement recevoir des appels ? La «télédensité», lions d’habitants, le Mali ne compte que trois
ou pénétration, ne répond pas à ces questions : hôpitaux nationaux et six hôpitaux régionaux.
elle se contente de mesurer le nombre de télépho- C’est dans ce contexte que trois étudiants en
nes par habitant, et non pas le niveau d’accès à médecine de l’université de Bamako, passion-
la téléphonie. nés d’Internet et férus de logiciels libres, se sont
Au vu de la difficulté à obtenir des données quan- penchés sur la nécessité d’améliorer l’accès des
titatives fiables, certains experts préconisent de ruraux pauvres aux soins de santé, créant à cet
privilégier les analyses qualitatives, explorant la effet le réseau IKON. Celui-ci assure des servi-
manière dont les gens utilisent leurs téléphones ces de télédiagnostic radiologique dans les vil-
(ou les téléphones auxquels ils ont accès)1. C’est les de Tombouctou, Mopti et Sikasso, qui ne dis-
précisément l’objet des cinq études de cas qui sui- posent d’aucun médecin radiologue sur place.
vent. Ces analyses n’ont aucune prétention à Les radiographies effectuées par un manipula-
l’exhaustivité du point de vue économique. Elle teur radio sont transmises via Internet à un
se limitent à illustrer le fait que i) la demande pour hôpital de Bamako, à des fins d’interprétation
des services d’information et de communication et de diagnostic.
de base existe et qu’elle est en progression ;2) les Le projet IKON est né à l’issue d’un atelier orga-
infrastructures et les technologies TIC existantes nisé en mai 2003 par REOnet et l’ONG néerlan-
sont utilisées pour fournir des services de base daise IICD (International Institute for Communi-
(p. ex. soins de santé, services financiers) selon cation and Development). L’amélioration de la
des formules tout à fait novatrices, inédites couverture des services radiologiques s’est impo-
jusqu’alors dans les pays en développement ;3) ces sée comme l’un des besoins les plus urgents. Le
modèles innovants de prestation de services et les Mali ne compte en effet que 11 médecins radio-
modes d’utilisation correspondants pourraient logues, dont dix pour la seule capitale, Bamako.
rendre nécessaire l’adoption de nouveaux indi- REOnet a élaboré en conséquence un projet pilote
cateurs pour mesurer la demande. articulé autour de quatre objectifs :
Les entreprises étudiées • améliorer la prise en charge des patients ;
Dans le cadre de ce rapport, infoDev et Alcatel ont • réduire le nombre d’erreurs diagnostiques ;
retenu cinq sociétés pour une étude en profon- • éviter les transferts inutiles de patients à
deur : REOnet au Mali, avec son projet IKON de Bamako ;
téléradiologie ; SIMpill en Afrique du Sud, système • réduire les dépenses de santé supportées par
de gestion en temps réel de l’observance des pres- les populations rurales pauvres.
8 Promouvoir l’investissement et l’innovation privésÉtudes de cas
Conception du projet
Flux nets de trésorerie - Phase pilote
L’équipe d’IKON a choisi les hôpitaux régionaux
de Tombouctou, Mopti et Sikasso (qui n’ont pas
300
de médecin radiologue) pour les relier à l’hôpi-
FCFA (x 1000)
tal du Point G à Bamako. Les trois hôpitaux 250
régionaux ont été équipés en matériel pour la
télétransmission des images : scanner à films 200
radiographiques, PC, alimentation électrique de
secours, ligne téléphonique fixe le cas échéant, 150
etc. Au Point G, IKON a installé un serveur pour
100
la réception des images, une imprimante (repro-
graphe) ainsi que d’autres périphériques. IICD
50
a fourni le capital initial nécessaire (69 000 000
FCFA, soit environ 140 000 USD) pour équiper 0
les trois établissements régionaux et l’hôpital du 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mois
Point G en matériel de téléradiologie ainsi que Source: Projet IKON
pour former le personnel médical à l’utilisation
de ces technologies. téléradiologie, IKON envisage, à terme, d’utiliser
son infrastructure pour assurer toute une palette
Méthodologie de services de télémédecine : diagnostic derma-
Lorsqu’un médecin généraliste de l’hôpital régio- tologique, diagnostic traumatique et d’autres
nal décide de faire passer une radio à un patient, diagnostics pathologiques. C’est dans cette inten-
il procède lui-même à l’examen radiologique. tion qu’IKON a fait l’acquisition de caméras numé-
L’image est ensuite numérisée à l’aide d’un scan- riques. Parallèlement, IKON projette d’organiser
ner à films radios, enregistrée au format DICOM des modules mensuels de téléformation à l’inten-
(Digital Imaging and Communications in Medicine) tion du personnel médical.
et envoyée par liaison RTC au serveur de Bamako.
La faible taille des fichiers (de 150 à 350 Ko) per- Perspectives de croissance
met une transmission rapide, même par le réseau Alors que le réseau entre aujourd’hui dans sa
* Les parts revenant à l’hôpi-
commuté. Le spécialiste en radiologie de l’hôpi- phase pleinement opérationnelle, les perspecti- tal régional et au projet IKON
tal de Bamako reçoit le fichier, l’imprime et éta- ves de croissance sont prometteuses. Avec un sont approximatives, car le
montant réparti entre les
blit son diagnostic, qu’il transmet ensuite par cour- investissement supplémentaire de quelque 64000 deux entités dépend du statut
rier électronique au généraliste de l’hôpital régio- USD, IKON peut étendre ses services à quatre public ou privé de l’établisse-
ment de soins. Un hôpital
nal. Sauf dans les situations où le diagnostic est autres hôpitaux et couvrir ainsi l’ensemble des public perçoit 625 FCFA par
urgent, les images radios ne sont transmises établissements hospitaliers du pays. image au titre de la couver-
ture des coûts fixes liés au
qu’une fois par jour à Bamako, d’où un délai de service, ce qui laisse 375
24 heures pour les réponses (ce qui est du reste Obstacles à la croissance FCFA au projet IKON. En
revanche, si la radio est effec-
normal au Mali, même en radiologie in situ). En Bien que le modèle de fonctionnement commer- tuée dans un hôpital privé,
cas d’urgence, le réseau IKON peut produire un cial d’IKON dégage des flux de trésorerie large- IKON encaisse 1 000 FCFA.
diagnostic dans l’heure.
Le service est facturé 2 500 FCFA (environ cinq
dollars) par image. Ce montant est réparti entre Flux nets de trésorerie - Phase opérationnelle
l’hôpital régional (600 FCFA), l’hôpital du Point
300
G (375 FCFA), le médecin diagnostiqueur
FCFA (x 1000)
(1125 FCFA) et IKON (400 FCFA)*.
250
L’ensemble du processus est géré par des systè-
mes ouverts que l’équipe d’IKON a spécialement 200
adaptés à son application de téléradiologie. Le
logiciel de transmission d’images assure le chif- 150
frement de la radio et des données confidentiel-
les du patient, et gère également la facturation. 100
Au terme d’un an de fonctionnement en phase
50
pilote, il s’est avéré que la demande de services
radiologiques était suffisante pour générer des
0
bénéfices. De fait, comme le montre le tableau ci- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
après, IKON a commencé à devenir rentable dès Mois
Source: Projet IKON
le troisième mois de la phase pilote.Au-delà de la
Promouvoir l’investissement et l’innovation privés 9Études de cas
Défis à relever pour une création d'entreprise au Mali
ment positifs, qu’il s’appuie sur des technologies
Les entrepreneurs doivent franchir 13 étapes pour la création d'entreprise qui requiert
robustes et bien adaptées, et qu’il réponde à un
en moyenne 42 jours. Le coût de création s'élève à 190,7% du PNB/habitant.
besoin social, le docteur Romain-Roland Tohouri Les entrepreneurs doivent déposer au moins 490,8% du PNB/capita dans une banque
souligne que le projet a eu les plus grandes dif- pour obtenir le numéro d'enregistrement de leur entreprise.
ficultés à obtenir le financement nécessaire. Au
Mali, les conditions de prêt aux entreprises pré-
voient généralement une garantie d’emprunt qui INDICATEURS MALI REGION OCDE
peut atteindre 80 %, et les droits à l’importation Nombre de formalités 13 11 6
sur le matériel informatique avoisinent les 50 %. Durée (jours) 42 63 19
Le tableau ci-après dresse une comparaison entre Coût (% de revenu/capita) 190,7 215,3 6,5
le Mali et le Royaume-Uni : Rappelons que ces Capital minimum (% de revenu/capita) 490,8 297,2 28,9
taxes sont calculées sur la valeur caf (coût, assu- Source : Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth
rance, fret), qui reste à peu près constante d’un
pays à l’autre, alors que le PIB par habitant du 200 000 FCFA par mois, soit environ 400 USD,
* Voir notamment les enquê-
tes réalisées dans le cadre du Royaume-Uni est de 26 507 USD, soit plus de 100 pour une liaison commutée 128 Kbps. C’est au
document de synthèse Ajuste- fois celui du Mali, estimé en 2004 à 260 USD2. moins dix fois plus cher que les tarifs pratiqués
ment des petites entreprises à
la libéralisation de l’économie D’autres études de la Banque mondiale confir- dans les pays développés pour un service com-
dans cinq pays d’Afrique ment ce problème récurrent de l’accès au crédit*. parable ; il est certain que l’entreprise ne pourra
(http://www-wds.world-
bank.org/servlet/WDSCon- Il est particulièrement important, pour les guère songer à augmenter le volume d’images
tentServer/WDSP/IB/2005/09 petites et moyennes entreprises dont le poten- transmises ou à se doter de capacités de visiocon-
/14/000011823_2005091417
1114/Rendered/PDF/WDP27 tiel de croissance excède les capacités de finan- férence, que ce soit pour la formation ou pour le
1010FRENCH.pdf), où il cement interne ou informel, d’avoir un meilleur diagnostic en temps réel, si ses coûts de connexion
apparaît que la majorité des
répondants (62 à 90 %) consi- accès au crédit. Les mesures destinées à amé- ne baissent pas.
dèrent les difficultés d’accès liorer les pratiques comptables des entreprises Autre obstacle, le temps d’attente ou « latence
au crédit (essentiellement
pour le fonds de roulement) ainsi que leur aptitude à produire des états », c’est-à-dire le délai nécessaire pour la trans-
comme l’une des principales financiers certifiés sont de nature à renforcer mission du trafic sur le réseau. Le Mali ne dis-
contraintes pesant sur leurs
opérations. D’autre part, dans leur capacité de recours à l’emprunt dans la posant pas à l’heure actuelle d’échangeur IXP
son rapport Doing Business in mesure où elles diminuent d’autant, pour les (Internet Exchange Point), tout le trafic entre
2006, la Banque mondiale
relègue le Mali dans les pro- banques, le coût d’obtention d’informations fia- opérateurs Internet doit transiter par des dor-
fondeurs du classement bles. De meilleurs systèmes juridiques documen- sales internationales, ce qui augmente la
(parmi les dix derniers sur
155 pays), en raison notam- tant les biens offerts en garantie et réglemen- latence et fait grimper les coûts. Comme le mon-
ment des contraintes régle- tant, en cas de défaillance de l’emprunteur, leur tre l’impression écran ci-dessous, le trafic
mentaires que l’État malien
fait peser sur les entreprises. saisie et leur vente permettraient aux banques Internet au Mali est grevé d’une forte latence.
Parmi ces dix derniers pays de mieux gérer leur risque de crédit. Le déve- L’auteur a chargé la page d’accueil de REOnet
du classement, neuf sont sub-
sahariens : Burkina Faso, loppement de la concurrence bancaire est depuis une maison de Bamako, en utilisant une
Congo-Brazzaville, Mali, essentiel pour inciter les banques à rechercher connexion via un fournisseur d’accès concur-
Niger, République centrafri-
caine, République démocrati- de nouveaux clients, notamment sur le marché rent. Bien que la distance physique ne fût que
que du Congo, Soudan, des petits comptes3. de cinq km, le trafic a été acheminé via le Séné-
Tchad, Togo.
Les directeurs d’IKON font aussi état du manque gal, le Portugal, l’Espagne, la France (en deux
# Le Royaume-Uni est signa-
de candidats qualifiés en TIC. Ils ont le sentiment points distincts) et l’Italie, pour revenir enfin sur
taire de l’Accord sur les tech-
nologies de l’information que les programmes universitaires actuels ne pré- le continent africain. Une telle latence est
(ATI). L’ATI est un accord parent pas correctement les étudiants à l’ère de rédhibitoire pour le déploiement de services de
commercial multilatéral par
lequel les signataires s’enga- l’information. REOnet s’efforce de remédier à cette visioconférence
gent à éliminer tous leurs carence en organisant des ateliers sur l’utilisation On estime que l’utilisation de bande passante
droits de douane sur les pro-
duits informatiques et de télé- de différentes applications multimédias. internationale pour du trafic Internet local ou
communications qui y sont Le coût de l’accès Internet constitue également un régional coûte à l’Afrique quelque 400 millions
visés. L’accord couvre environ
95 % du commerce mondial frein à la croissance. À l’heure actuelle, IKON paye USD par an4.
en la matière, estimé
aujourd’hui à plus de mille
milliards de dollars. Les pro-
duits visés par l’ATI com- Taxes d’importation au Mali comparées à celles du Royaume-Uni
prennent les ordinateurs, les
Taxe sur les Taxe sur les Taxe sur les Taxe sur les Autres
périphériques, les matériels
ordinateurs composants d’ordinateurs logiciels manuels Taxes
de télécommunications, les
logiciels, les équipements de Mali 5% Inconnue 20% 0% 5% droits de douane
fabrication de semi-conduc- sur la valeur caf ;
teurs, les instruments analy- 7.5-55% taxes additionnelles
tiques ainsi que les semi-
Royaume-Uni# 0% 0% 0% 0% 17.5% TVA
conducteurs et d’autres com-
posants électroniques. Source : US Department of Commerce [ministère américain du commerce], Office of Technology and Electronic Commerce
10 Promouvoir l’investissement et l’innovation privésVous pouvez aussi lire