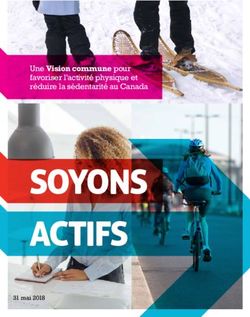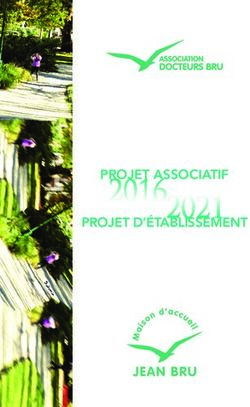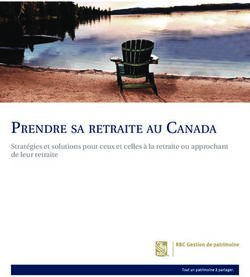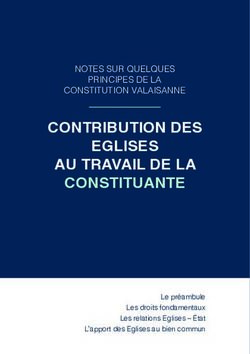Qualité de vie, bien-être et participation des personnes âgées à la société - SÉRIES THÉMATIQUES DU CEPESS
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
SÉRIES THÉMATIQUES DU CEPESS
L’allongement de la vie : une opportunité pour le
développement humain
Cahier
Qualité de vie, bien-être
et participation des
personnes âgées à la société
Par Quentin MARTENS, conseiller au CEPESS
2015Cette étude vise à traiter la question de l’allongement de la vie sous
l’angle du bien-être des personnes âgées et de ce qui conditionne leur
bonheur.
Ces pages s’attardent à démontrer l’ampleur des phénomènes que sont
la solitude et l’isolement social qui touchent près d’un belge de plus de
65 ans sur deux en Belgique.
En nous basant sur de nombreuses études, nous rappelons que le
manque de relations sociales a un impact négatif important sur la santé
des seniors, et donc indirectement sur leur qualité de vie. Vu que notre
pays comptera d’ici 2020 plus d’un million de personnes âgées
souffrant de solitude, il est indispensable de mieux comprendre ces
phénomènes.
Contrairement, la participation des aînés à la société leur permet de
vivre plus longtemps et en meilleure santé. C’est la raison pour laquelle,
nous avons exploré une série d’innovations sociales et d’initiatives
privées et associatives, qui permettent de favoriser cette participation.
Les solidarités familiales et le bénévolat répondent partiellement à ce
besoin de relations puisque l’un comme l’autre maintiennent un lien
avec la société et permettent aux personnes âgées de continuer à y
prendre part.
Ce cahier vise à mettre en évidence l’urgence pour les responsables
politiques de porter un regard différent sur l’allongement de la vie en
se souciant de la participation des personnes âgées à notre société, en
tant que citoyen à part entière.
1A 47 ans, Montaigne écrit :
« Je suis désormais condamné à mourir de mort rare, mort de vieillesse »
2INTRODUCTION
L’espérance de vie au Moyen Âge était de 20 ans… Au cours de ces 100 dernières
années, nous avons gagné un « bonus » de 25 à 30 années de vie en relativement
bonne santé. C’est une excellente nouvelle : on profite plus longtemps de la vie. La
vieillesse est un des signes des formidables progrès du siècle passé.
Figure 1 - Evolution de l’espérance de vie en Belgique entre 1880 et 2011 (source : SPF, DGSIE)
L’allongement de la vie est une évolution sociétale qui nous concerne tous. Il touche
Les individus
toutes les sociétés. Selon les projections des Nations Unies, le nombre de personnes
arrivés à l’âge de
de plus de 65 ans devrait presque tripler d’ici 2050. Il n’y a pas de doutes, le XXIème
la retraite ne se
siècle sera le siècle du vieillissement1 et de la transition gérontologique qui
considèrent plus
bouleverse et bouleversera notre société.
eux-mêmes
comme des La société vieillit mais les vieux sont plus jeunes. Nous restons jeunes beaucoup plus
«vieux» longtemps que par le passé. Les individus arrivés à l’âge de la retraite ne se
considèrent plus eux-mêmes comme des « vieux »2. L’âge biologique et la perception
individuelle du vieillissement sont en décalage chronologique. La retraite est
devenue aujourd’hui le début d’une nouvelle vie qui peut durer vingt, trente,
quarante ans.
1
BROUSSY, Luc, L’adaptation de la société française au vieillissement de sa population :
France : année zéro, Rapport à la Ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie,
2013.
2
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, Génération Seniors, la silver économie, n° 333 mars 2014.
3On constate une
La vieillesse est devenue une période de l’existence diversifiée. « La » personne âgée
très grande
n’existe pas. On constate une très grande hétérogénéité dans la façon dont on vieillit,
hétérogénéité
dans la diversité des vieillesses vécues (dans la sérénité ou dans les difficultés). Les
dans la façon dont
personnes âgées forment un groupe hétérogène. Malgré tout, on distingue plusieurs
on vieillit, dans la
catégories : les jeunes retraités, les personnes âgées du 3ème, du 4ème âge, les
diversité des
personnes âgées dépendantes, les personnes souffrant d’Alzheimer, celles issues de
vieillesses vécues…
l’immigration, touchées par la pauvreté, vivant avec un handicap, vivant à domicile,
il y a aussi deux
vivant en maison de retraite, les personnes seules, les personnes veuves,…
âges du
En plus de cette grande diversité, on peut considérer qu’il y a deux âges du
vieillissement. Le
vieillissement. Le premier de 60 à 75 ans qui est dit actif et en bonne santé et qui est
premier de 60 à 75
associé à la grand-parentalité, les loisirs, l’engagement civique, voire la poursuite
ans… le second
d’une activité professionnelle. Le second âge du vieillissement commence aux
commence aux
alentours de 75 ans. C’est durant cette phase que les risques d’isolement et les
alentours de 75
problèmes de santé s’aggravent3. Cette situation exige que les personnes âgées
ans.
soient de plus en plus aidées par leur entourage.
Le regard social porté sur l’âge joue un rôle important. Pour les sociologues, le
vieillissement est une construction sociale. Il est un processus complexe au cours
duquel s’opèrent des changements dont le maître-mot n’est pas celui de dépendance
ou de déclin mais plutôt celui d’épreuves : épreuves des transitions de vie à franchir,
épreuves du grand âge. La vieillesse est une période où l’individu doit renégocier la
définition de lui-même face à la perte progressive de ses rôles sociaux antérieurs.
Cette réorganisation de l’existence doit également beaucoup au soutien de
l’entourage et passe par une restructuration des liens sociaux. La vieillesse peut aussi
23% de la être une période d’épanouissement personnel.
population belge
est aujourd’hui La lecture sociologique de la vieillesse et du vieillissement oscille entre une version
âgée de 60 ans ou profondément pessimiste, qui souligne le triste sort des plus âgés, et une version
plus. Selon les souriante et optimiste qui tend à montrer que l’allongement de la vie est bien vécu
prévisions, cette par un grand nombre de personnes âgées.
catégorie
représentera un Le défi posé à la société et aux responsables publics est de créer les meilleures
tiers (31%) d’ici conditions pour que tout un chacun puisse donner un sens à ces années de vie
2050 (Forum supplémentaires et faire pleinement partie de la société. Il s’agit de veiller à leur
Economique rendre la vie plus facile et la plus heureuse possible en soignant leur qualité de vie.
Mondial)
3
Ibidem
41. VIEUX RIME AVEC HEUREUX
Une des idées fausses les plus répandues sur les personnes âgées est qu’elles sont
C’est précisément
plus malheureuses que le reste de la population. En effet, du fait des pertes (de
dans la catégorie
proches, de capacités physiques, d’autonomie,…) auxquelles est associée la vieillesse,
des seniors que
celle-ci est considérée par certains comme nécessairement triste.
l’on trouve la plus
forte proportion de
Pourtant, les études internationales démontrent que c’est précisément dans la
gens heureux.
catégorie des seniors que l’on trouve la plus forte proportion de gens heureux. Les
aînés rapportent un niveau de bien-être plus élevé que les jeunes. Le grand âge peut
être l’occasion d’un grand bonheur d’accomplissement de sa vie4. Une étude de la
VUB5 sur le bonheur portant sur 4.500 Belges a montré que c’est la catégorie des 66-
75 ans qui se sentait la plus heureuse6 (avec un score de près de 63/100). L’étude a
confirmé que, de manière globale, les personnes âgées en Belgique sont heureuses.
Après 75 ans, le sentiment de bonheur diminue légèrement, tout en restant
sensiblement plus élevé que pour la tranche des 46-55 ans. Nous sommes loin du
mythe du petit vieux malheureux.
Cela peut s’expliquer par trois facteurs :
1°) les stéréotypes négatifs que la société véhicule sur la vieillesse ;
2°) une définition du bonheur propre aux aînés ;
3°) ce qu’on appelle le « paradoxe du vieillissement ». Tout d’abord, le mythe du
« petit vieux malheureux » est sans doute en partie lié à l’image véhiculée p qui est
souvent négative7 : la vieillesse y est présentée comme un renoncement à la santé,
au travail, à l’argent, à la beauté, à l’amour… Nous reviendrons dans le prochain
chapitre sur ce point.
Ensuite, il est vrai que la définition du bonheur varie. Pour les personnes âgées, le
bonheur est associé à la plénitude et au calme, contrairement aux jeunes qui
l’associent à l’agitation, l’activité et l’action. Les personnes âgées soulignent que leur
bonheur dépend de leur qualité de vie au quotidien et de leurs activités habituelles8.
Les aînés n’ont donc pas la même conception du bonheur que leurs cadets. Lorsque
nous voulons les aider à être heureux, nous devons dès lors interroger nos propres
4
DAYEZ, J.B., C’est quand le Bonheur ? Est-on heureux de la même façon à tous les âges de la
vie ?, Analyse Enéo, 2012/27, 2012.
5
ELCHARUS, M. SMITS, W., Le plus grand bonheur, Vrije Universiteit Brussel, 2007.
6
Ibidem.
7
FONDATION ROI BAUDOUIN, La vieillesse, antichambre de l’ennui ou âge d’or ?
Représentations sociales et communication autour du vieillissement, Etude KUL pour la
Fondation Roi Baudouin, 2013.
8
DAYEZ, J.B., C’est quand le Bonheur ? Est-on heureux de la même façon à tous les âges de la
vie ?, Analyse Enéo, 2012/27, 2012.
5critères puisque ceux-ci sont relatifs. Les personnes âgées profitent davantage au
jour le jour de ce qu’elles ont acquis, elles sont focalisées sur le présent et sur tout ce
qu’elles ont acquis jusqu’à maintenant. Pour finir, des recherches ont mis en
évidence le fait que les aînés traitent préférentiellement les informations positives au
détriment des informations négatives. Ils ont d’une certaine manière un meilleur
contrôle émotionnel. On appelle cela le paradoxe du vieillissement (« paradox of
ageing »). Cela s’explique principalement par l’influence de la perception du temps
disponible et le sentiment de finitude qui impacte sur la satisfaction de la personne.
Sur base de ces observations, quand le temps se réduit, on préfèrerait approfondir
ses relations existantes, et les événements positifs priment sur les négatifs. Il en
découle que les seniors globalement auraient moins d’émotions négatives que les
jeunes et les gèreraient mieux parce qu’ils profitent généralement de manière plus
consciente du temps qu’il leur reste. Ils éviteraient de se disperser dans de trop
nombreux projets et s’attacheraient à la profondeur des expériences vécues9. Les
petits plaisirs sont souvent une source de grande satisfaction.
Malgré ce constat qui peut aller à l’encontre des intuitions, un grand nombre de
Des études ont
personnes âgées souffrent de solitude. On peut s’en rendre compte par différents
montré que les
facteurs. Un de ceux-ci peut être le fait que les personnes âgées, qu’elles bénéficient
personnes âgées
de soins à domicile ou qu’elles soient en maison de repos, sont nombreuses à
sont heureuses
consommer des antidépresseurs, bien que la première catégorie en consomme
lorsqu’elles ont
moins (près de 32%) que la deuxième (près de 43%)10. Selon une étude de la
vraiment
Fondation Roi Baudouin (2014), nous savons aussi que certaines personnes âgées se
l’impression de
trouvent dans des situations plus difficiles que d’autres : en particulier celles issues
faire partie de la
de l’immigration11, celles qui souffrent d’un handicap physique ou mental ou celles
société.
qui vivent dans la pauvreté12.
Des études ont montré que les personnes âgées sont heureuses lorsqu’elles ont
vraiment l’impression de faire partie de la société. Par exemple, de nombreux
chercheurs ont mis en exergue qu’approximativement 40% du niveau de bonheur
peut être influencé par des activités intentionnelles telles que faire preuve de
bienveillance envers autrui, être reconnaissant envers ceux qui sont bons avec nous
9
FONDATION ROI BAUDOUIN, Planifier ses vieux jours et en parler en temps utile, Pensez plus
tôt à plus tard, 2014.
10
LES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, Consommation d’antidépresseurs et d’antipsychotiques en
maison de repos, conférence de presse 12 mai 2011.
11
« Il ressort de focus groups que le vieillissement des personnes d’origine étrangère
présente certaines particularités. Elles se trouvent prises entre différentes normes culturelles,
mais aussi contraintes par des possibilités matérielles qui ne leurs permettent pas
nécessairement d’envisager leur grand âge comme elles auraient cru ou voulu le faire. Les
disponibilités de leurs enfants, l’anonymat de la ville, l’influence culturelle, la présence de
services de soins à domicile, ou d’autres raisons encore, peuvent entraîner un relâchement
des rôles assignés traditionnellement aux enfants et contrarier le souhait de se voir pris en
charge par ses enfants au grand âge. D’autres facteurs, tels que des problèmes financiers,
peuvent contrecarrer un retour espéré au pays d’origine ».
12
FONDATION ROI BAUDOUIN, Planifier ses vieux jours et en parler en temps utile, Pensez
plus tôt à plus tard, 2014.
6ou encore s’adonner à ce qu’on aime faire et à ce dans quoi on est bon13. D’autres
études montrent que, plus on se prépare à temps à la « (dernière) période » de sa
vie, entres autres en en discutant avec son entourage, plus on a de chances de la
« En moi, c’est
vivre de manière heureuse et satisfaisante, avec une bonne qualité de vie14.
l’autre qui est âgé,
c’est-à-dire celui Nous en tirons un enseignement clair : que le bien-être des personnes âgées peut
que je suis pour les être sensiblement amélioré en garantissant les conditions de leur participation à la
autres : et cet société : ancrage local, mobilité, engagement, intégration familiale,… Ces constats
autre, c’est moi » nous poussent à considérer comme centrales les conditions de leur participation à la
(Simone de société. Nous aborderons dans les prochains chapitres la question de la participation
Beauvoir) à la société (solidarités familiales et bénévolat) ainsi que de la non-participation
(isolement et solitude).
2. CHANGER LA PERCEPTION DES PERSONNES
ÂGÉES
Les personnes âgées sont sous-représentées dans les médias. A peine 3,1% des
personnes citées dans les journaux flamands et 3,7% des intervenants dans les
Les aînés ont une
programmes télévisés francophones ont 65 ans ou plus15.
image de
personnes lentes, Au-delà de cette sous-représentation, quelle image est-ce que la société véhicule de
donneuses de nos aînés ? Trop souvent, ils ont une image de personnes lentes, donneuses de
leçons, naïves, leçons, naïves, isolées, dépendantes, incapables de se débrouiller toute seules,
isolées, inadaptées aux nouvelles technologies voire dépassées, passives, poids morts pour la
dépendantes… il société, grabataires, « sans plus-value économique ». En effet, les sociétés
faut une occidentales sont fortement influencées par le regard biomédical, et conçoivent
communication principalement le vieillissement sur le mode du déclin, comme un processus de
plus nuancée sur le « sénescence » marqué par le ralentissement et l’affaiblissement des fonctions
vieillissement et vitales et conduisant à la dépendance16. A l’inverse, on retrouve dans certains
favoriser ainsi le feuilletons ou films des stéréotypes « positifs » à leur égard : sans soucis d’argent ou
dialogue entre les extrêmement actifs. Cela confirme ce que Dominique Verte de la VUB développe : les
générations. personnes âgées sont confrontées à un problème d’image17.
13
SELIGMAN, M., STEEN, T., PARK, N. et C. PETERSON, Positive psychology progress: Empirical
validation of interventions, American Psychologist, vol.60 (5), 2005, pp.410-421.
14
FONDATION ROI BAUDOUIN, VAN GORP, B., La vieillesse, antichambre de l’ennui ou âge
d’or ? Représentations sociales et communication autour du vieillissement, 2013.
15
FONDATION ROI BAUDOUIN, VAN GORP, B., La vieillesse, antichambre de l’ennui ou âge
d’or ? Représentations sociales et communication autour du vieillissement, 2013.
16
CARADEC, V., Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Armand Colin, 2012.
17
FONDATION ROI BAUDOUIN, Conférence « Pauvreté et vieillissement », 27 avril 2010,
Bruxelles, Compte rendu des travaux en ateliers, 2010, p.39.
7Une des conclusions d’un récent rapport de la Fondation Roi Baudouin est que, pour
modifier la perception que nous avons des personnes âgées, il est indispensable de
développer une communication plus nuancée sur le vieillissement et favoriser ainsi le
dialogue entre les générations18. En quoi cela est-il tellement important d’avoir une
perception équilibrée des aînés ? Premièrement, le regard d’autrui est un véritable
adjuvant de sentiment de vieillir. Une enquête australienne19 a démontré que c’est
essentiellement par l’interaction avec les autres que le sentiment de vieillir advient
(ex : coup de klaxon sanctionnant une manière trop prudente de conduire, manque
de patience de la part du médecin,…). Les stéréotypes négatifs liés à l’âge et
concernant la solitude sont néfastes pour les personnes âgées lorsqu’ils sont
intériorisés20. Les personnes âgées qui intériorisent des stéréotypes négatifs liés à
l’âge considèrent leur propre santé comme moins bonne, suivent moins d’actions de
prévention de leur santé, se remettent moins vite des infections et vivent également
moins longtemps21.
Deuxièmement, par ce sentiment de vieillesse intériorisée, la place dans la société
peut être perçue de manière anxiogène. La présence au sein d’un espace public par
exemple, peut devenir source d’anxiété et d’angoisse (crainte de perturber les flux
piétonnier, difficulté à prendre le bus,…). Cela illustre comment notre attitude à
l’égard de ceux qui sont vieillissant porte atteinte à leur qualité de vie22.
Troisièmement, des études démontrent que la manière dont les personnes âgées
Les stéréotypes
sont traitées repose sur des automatismes qui sont eux-mêmes influencés par ces
négatifs liés à l’âge
images stéréotypées. Ces stéréotypes négatifs sont à l’origine de discriminations
et concernant la
envers les plus âgés. Ce mécanisme est d’autant plus prégnant qu’il est généralement
solitude sont
considéré que les stéréotypes discriminatoires envers des personnes âgées peuvent
néfastes pour les
être exprimés de manière ouverte dans notre société23. Cette discrimination envers
personnes âgées
les personnes âgées est appelée « l’âgisme ». D’après la Plateforme pour le
lorsqu’ils sont
Volontariat, les personnes âgées correspondent à la tranche de la population la plus
intériorisés.
discriminée (devant les personnes d’origines étrangères24), au point que certains
s’interrogent sur le besoin de lutter contre l’âgisme par une convention
18
FONDATION ROI BAUDOUIN, VAN GORP, B., La vieillesse, antichambre de l’ennui ou âge
d’or ? Représentations sociales et communication autour du vieillissement, 2013.
19
MINICHIELLO, V., Perceptions and consequences of ageism, Ageism and Society, vol.20,
2000, p.253-278.
20
FONDATION ROI BAUDOUIN, Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique, ULg, Ipsos, KUL, 2012.
21
MEISNE, B., A meta-analysis of positive and negative age stereotype priming effects on
behavior among older adults, The Journals of gerontology, Series B: Psychological Sciences
and Social Sciences, vol. 66, 2011.
22
FONDATION ROI BAUDOUIN, Un autre regard sur la démence : des recommandations de la
Fondation Roi Baudouin, Communiqué de presse, 4 mars 2009.
23
FONDATION ROI BAUDOUIN, VAN GORP, B., La vieillesse, antichambre de l’ennui ou âge
d’or ? Représentations sociales et communication autour du vieillissement, 2013.
24
PLATEFORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT, Le volontariat des aînés, c’est bon pour la
santé ! Faut-il mettre en place des mécanismes spécifiques pour accueillir les aînés en tant que
volontaires, Analyse.
8internationale des droits des personnes âgées comme il y en a une pour les femmes
(1979), pour les enfants (1989) ou pour les personnes handicapées (2006).
Bien que d’autres études nous apprennent que les seniors arrivent remarquablement
bien à prendre distance avec les stéréotypes négatifs, véhiculer une image différente
des personnes âgées est non seulement nécessaire pour mieux refléter leur réelle
plus-value dans la société mais également parce que cette image plus juste a une
valeur performative, dans la mesure où elle renforce la capacité des personnes âgées
à développer une image positive d’elle-même.
C’est également vrai dans le contexte professionnel25. C’est le cas par exemple dans
les maisons de repos. Y supposer que les plus vieux sont par nature distraits, naïfs et
physiquement faibles, entraine l’idée qu’il faut les protéger, voire les infantiliser.
Nous devons communiquer au sujet de la vieillesse en étant plus conscient des
images que nous véhiculons et des préjugés qui peuvent en découler. La qualifier
nécessairement de « problématique » a pour conséquence de renforcer les tabous à
son sujet. Comme le dit Dominique Verte, nous pourrions déjà faire un grand pas en
avant si nous pouvions transformer l’image des personnes âgées de consommateurs
passifs de soins à des concitoyens actifs et des architectes de la société. Une voie vers
cet équilibre de l’image, est de travailler davantage sur la représentation de
l’épanouissement personnel et mettre plus l’accent sur les compétences des seniors
(et non uniquement sur les seuls éléments positifs de la « chaleur humaine » qui
nous ramène à une image d’Epinal de grands parents idéaux). L’intergénérationnel a
une importance capitale pour les aînés mais joue également un rôle capital dans la
lutte contre les stéréotypes.
25
FONDATION ROI BAUDOUIN, VAN GORP, B., La vieillesse, antichambre de l’ennui ou âge
d’or ? Représentations sociales et communication autour du vieillissement, 2013, p.43.
93. LUTTER CONTRE LA SOLITUDE ET L’ISOLEMENT
SOCIAL
On garde en mémoire la canicule de l’été 2003 qui, en France, a fait plus de 15.000
La solitude peut
morts chez les personnes âgées. Celle-ci a révélé au grand jour l’immensité de la
être définie comme
solitude et de l’isolement social des seniors ainsi que l’importance du tissu social
un ressenti
pour leur bien-être.
subjectif lié au
manque
désagréable ou
intolérable de 3.1. La définition de la solitude
(qualité de)
certaines
relations… il faut
la distinguer du Quand on parle de solitude, il faut la distinguer du concept d’isolement social
concept (mesurable objectivement sur base de nombre de contacts sociaux). La solitude, elle,
d’isolement social peut être définie comme un ressenti subjectif lié au manque désagréable ou
(mesurable intolérable de (qualité de) certaines relations26. La qualité des relations importe
objectivement sur autant que leur quantité et le degré d’exigence de chaque individu concernant ces
base de nombre de relations. Ces deux concepts sont souvent associés car ils sont présents chez les
contact sociaux). personnes âgées. Mais une personne âgée peut être isolée socialement et ne pas
souffrir de solitude et inversement. Si la solitude est par définition négative,
l’isolement peut être recherché comme source de concentration, d’apprentissage ou
de créativité.
3.2. L’état de la solitude en Belgique
La Fondation Roi Baudoin a réalisé une étude auprès de 1.500 Belges portant sur la
En Belgique, 46%
solitude et l’isolement social des personnes âgées. Il en ressort que 45% des aînés
des aînés souffrent
sont considérés comme bien armés socialement, ce qui veut dire qu’ils peuvent
de solitude, dont la
compter sur un réseau social et qu’ils ne sont donc pas seuls. Par contre, 46% des
moitié d’entre eux
aînés souffrent de solitude ce qui est énorme. Seule la moitié d’entre eux est
« seulement » sont
véritablement isolée socialement. Par ailleurs, 9% des seniors ont un réseau social
véritablement
limité mais ne se sentent pas seuls pour autant.
isolés socialement
(Fondation Roi
On note des différences entre les Régions. Le pourcentage de personnes souffrant de
Baudouin).
sentiment de solitude est plus élevé en Wallonie (26%) qu’en Flandre (22%) ou à
Bruxelles (19%). En termes d’isolement, c’est Bruxelles qui a le taux le plus élevé
26
Fondation Roi Baudouin, « Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique », ULg, Ipsos, KUL, 2012.
10(29%), pour 24% en Wallonie et 21% en Flandre. D’après l’enquête de Santé Publique
2004, en Wallonie, 12% des hommes et 9,5% des femmes déclarent avoir moins
d’une fois par semaine un contact social, alors qu’ils sont à Bruxelles, près de 16,9%
des hommes et 12,2% des femmes.
Figure 2 - Typologie des contacts sociaux chez les seniors (plus de 65 ans) (source : Fondation Roi
Baudouin, 2012)
En Belgique, le
nombre de
personnes de plus
de 65 ans ne cesse
de croître. Dès lors,
si les pourcentages
cités plus haut Tableau 1 - Isolement et sentiment de solitude. Comparaison entre Régions (source : Fondation Roi
restent stables, Baudouin, 2012)
notre pays
comptera d’ici Personnes souffrant de
Personnes isolées27
2020 plus d’un solitude28
million de
personnes âgées Wallonie 24 % 26 %
souffrant de
Flandre 21% 22 %
solitude.
(Fondation Roi
Bruxelles 29 % 19 %
Baudouin).
27
FONDATION ROI BAUDOUIN, Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique, ULg, Ipsos, KUL, 2012, p.148.
28
Ibidem.
11Tableau 2 - Fréquence des contacts sociaux chez les seniors (source : enquête Santé publique, 2004
Seniors qui déclarent avoir un contact social moins d’une fois par semaine29
Hommes Femmes
Bruxelles 12 % 9,5 %
Wallonie 16,9 % 12,2 %
La solitude touche de manière inégale les seniors. En effet, certaines catégories de
seniors souffrent davantage de la solitude. Il s’agit des veufs/veuves et les seniors qui
rencontrent soit des problèmes de santé soit des problèmes financiers. Les femmes
sont également plus touchées par le sentiment de solitude, en partie parce qu’elles
vivent plus longtemps et sont donc plus fréquemment veuves. En Belgique, 82% des
veufs ont plus de 65 ans, parmi lesquels 81% sont des femmes30. La tendance à
associer l’isolement à la vieillesse est partiellement fondée31 puisque certaines
études confirment que la solitude émotionnelle n’augmente considérablement qu’à
partir de 75 ou 80 ans.
L’isolement social Le statut économique joue également un rôle sur l’isolement social. Le capital
est plus fréquent économique des personnes âgées détermine en partie le fait d’être bien armé
chez les résidents socialement. Par exemple, parmi les seniors qui ont des revenus supérieurs à 2.000
de maisons de euros, ils sont 55% à être bien armés socialement contre 26% chez ceux qui ont un
repos et de soins revenu inférieur à 1.000 euros. Et la Belgique compte 21% de pauvres dans la tranche
qui souhaiteraient 65 ans et plus32.
souvent avoir plus
Une autre différence existe entre les personnes vivant à domicile et les personnes en
de contacts,
maison de repos. Les premières sont plus nombreuses à être socialement bien
surtout avec leurs
armées, comparées aux secondes, bien que le sentiment de solitude soit autant
petits-enfants.
29
D’après l’enquête Santé publique (2004).
30
DIRECTION GÉNÉRALE STATISTIQUE ET INFORMATION ÉCONOMIQUE, Structure de la
population par sexe, état civil, groupe d’âge et région en 2011,
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/structure/etatcivil.
31
FONDATION ROI BAUDOUIN, Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique, ULg, Ipsos, KUL, 2012.
32
FONDATION ROI BAUDOUIN, Compte rendu des travaux en ateliers de la Conférence
« Pauvreté et vieillissement », 27 avril 2010, Bruxelles, p.3.
12partagé dans les deux groupes33. L’isolement social est donc plus fréquent chez les
résidents de maisons de repos et de soins qui souhaiteraient souvent avoir plus de
contacts, surtout avec leurs petits-enfants. Les sentiments de solitude expliquent en
partie que ces personnes âgées sont dépressives. Les chercheurs plaident donc pour
que la prévention de la solitude soit reprise comme un objectif important dans le
développement des programmes de soins.
Par ailleurs, certains critères renforcent le sentiment de solitude : les incapacités
physiques, l’appauvrissement du réseau social, la probabilité plus grande de perdre
son conjoint, les difficultés de transport34. C’est la combinaison de quelques éléments
de risques qui conduit à des formes d’exclusion : l’âge (qui s’accompagne du risque
d’être dépendant), la précarité, la maladie ou le handicap et le manque de diversité
dans le réseau social (par exemple uniquement la famille proche).
Figure 3 - Liste des raisons de la solitude invoquées par les seniors (source : Casman, 2010)
Il y a un demi-
siècle, les
personnes de plus
de 65 ans se
sentaient plus
fréquemment
seules
qu’aujourd’hui. En
1966, ils étaient
14% à se sentir «
souvent seuls »,
aujourd’hui ils ne
Rien ne prouve que les sentiments de solitude chez les personnes âgées aient
sont plus que 9%.
augmenté ces dernières décennies. On peut d’ailleurs affirmer le contraire : il n’y a
pas plus de sentiment de solitude aujourd’hui qu’auparavant. Il y a un demi-siècle, les
personnes de plus de 65 ans se sentaient plus fréquemment seules qu’aujourd’hui.
En 1966, ils étaient 14% à se sentir « souvent seuls », aujourd’hui ils ne sont plus que
9%35. Cela s’explique en partie par le fait qu’aujourd’hui, les personnes âgées sont en
meilleure santé, plus indépendantes et plus actives qu’auparavant.
33
FONDATION ROI BAUDOUIN, Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique, ULg, Ipsos, KUL, 2012.
34
CASMAN, M-T., Atelier 7 : Isolement, Présentation Power point, université de Liège, 27 avril
2010.
35
FONDATION ROI BAUDOUIN, Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique, ULg, Ipsos, KUL, 2012, p.142.
13En Belgique, il y a une différence entre les villes et les campagnes. En ville, les
personnes isolées socialement sont plus nombreuses, par contre en milieu rural le
sentiment de solitude est plus élevé36.
3.3. La solitude au niveau européen
La solitude n’a pas la même fréquence dans tous les pays. En France par exemple, le
sentiment de solitude est un peu plus fréquent que chez nous. De manière générale,
on peut dire que les personnes âgées sont le plus souvent seules en Europe de l’Est
et en Europe du Sud et moins souvent en Europe du Nord. Ces différences semblent
être dues à la composition de la population, aux caractéristiques du pays ainsi que
l’interaction de ces deux facteurs. Les attentes des personnes âgées varient d’un pays
à l’autre. En Europe du Sud, les personnes âgées s’attendent plus souvent à ce que
leurs familles prennent soin d’elles alors qu’au Nord, les seniors considèrent qu’il est
logique de passer aux soins institutionnels37.
36
FONDATION ROI BAUDOUIN, Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique, ULg, Ipsos, KUL, 2012.
37
COMMISSION EUROPEENNE, Eurobaromètre Spécial 283, 2007.
14Figure 4 - Solitude chez les personnes de plus de 65 ans qui habitent chez elles, en Belgique et en
Europe, en 2004 (en %) (source : Sundström & al., 2009, données issues de l’enquête SHARE 2004-
2006).
Presque toujours La plupart du temps Parfois Presque jamais
38
55 54 53
60 58
65 63
70
75 74
42
30 29
26 28 36
25 28
23
19 22 11
7 7
7 12
4 6 7
4 4 7 8 10
2 3 5 3 6 3 3
2 1
Après 80 ans, les
très âgés ont plus
tendance au repli 3.4. Les stratégies d’adaptation des personnes plus âgées
sur l’espace
domestique et à la
baisse de
L’avancée en âge se traduit par un repli de l’espace domestique, les sorties se font
sociabilité. Par
moins nombreuses, l’espace parcouru se réduit, le rythme des activités quotidiennes
conséquent, le plus
se fait plus rigide. Passé 80 ans, les très âgés ont plus tendance au repli sur l’espace
grand âge se
domestique et à la baisse de sociabilité. Par conséquent, le plus grand âge se
caractérise aussi
caractérise aussi par un plus grand isolement. Il est à noter que la cohabitation
par un plus grand
intergénérationnelle est beaucoup moins fréquente qu’autrefois38. On ne peut pas
isolement.
conclure pour autant que la vieillesse se caractérise par le vide relationnel et affectif.
38
CARADEC, V., Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Armand Colin, 2012.
15Le repli qui va généralement de pair avec les années qui passent peut être vécu de
différentes manières et pas nécessairement comme un enfermement.
Les personnes dépendantes recourent à diverses stratégies pour faire face à leurs
handicaps (ex : solliciter les voisins pour des services, diminuer ses activités de
lecture quand la vue baisse et privilégier la radio, installer un tabouret dans la
douche pour éviter de tomber,…). On parle également de « déprise » qui consiste à
poursuivre ses activités antérieures mais à plus petite échelle (ex: continuer son
potager mais de plus petite taille, conduire mais des trajets moins longs, suivre la
messe mais à la télévision…). Ces personnes veulent garder une prise sur le monde
mais s’adaptent à leurs nouvelles capacités. La personne âgée peut évoluer à travers
un double mouvement : d’une part de désengagement et d’autre part d’engagement
permettant d’entrer dans des mondes sociaux ignorés jusqu’alors.
3.5. Les méfaits de la solitude ou les bienfaits des interactions sociales
Un capital social Faut-il lutter contre la solitude ? Evidemment. Car en plus des motivations morales,
insuffisant éthiques et sociétales évidentes, la solitude est source de problèmes de santé
constitue un mentale et physique importants. La solitude a des effets dévastateurs sur la santé
facteur de risque tant physique que psychique.
de décès au moins
aussi important Elle est un facteur de risque important pour la dépression (avec un risque de suicide
que d’autres plus élevé), - la régression cognitive, et cause d’un mauvais état de santé général (ex :
facteurs plus hypertension, troubles du sommeil, anxiété, stress élevé, maladies
connus, tels que le cardiovasculaires,…)39. Le sentiment de solitude se traduit par des problèmes de
tabagisme, santé et les personnes isolées font plus souvent appel aux soins de santé et
l’obésité ou la constituent donc une charge plus importante pour le système de santé. Une étude
pollution récente montre qu’un capital social insuffisant constitue un facteur de risque de
(Fondation Roi décès au moins aussi important que d’autres facteurs plus connus, tels que le
Baudouin). tabagisme, l’obésité ou la pollution40.
Il a été prouvé qu’interagir avec d’autres personnes participe à revitaliser le cerveau
et la santé mentale. Cela stimule les cellules et les connections41. Ainsi, prendre un
café régulièrement avec une amie ou se balader avec ses petits-enfants diminue les
risques de démence. Par ailleurs, quand les contacts sociaux diminuent, l’individu
risque de devenir moins compétent dans les interactions sociales et l’établissement
de nouveaux contacts devient de plus en plus difficile.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Hello Brain.eu.
16Des études ont
Certaines théories considèrent que l’individu est défini par des rôles sociaux associés
montré que les
aux positions statutaires qu’il occupe42. Le vieillissement se caractérise par une perte
personnes âgées
de rôle à la fois professionnel (au moment de la retraite) et familiaux (avec le départ
sont heureuses
des enfants et le décès du conjoint). La théorie de l’activité considère que l’individu
lorsqu’elles ont
va compenser la perte de certains rôles antérieurs par l’intensification d’autres rôles
vraiment
comme celui de citoyen, de grands-parents. Mais il est possible aussi que la personne
l’impression de
âgée se désengage, ce qui résulterait d’une baisse de ses interactions sociales et d’un
faire partie de la
détachement émotionnel du monde. Lutter contre la solitude permet de répondre au
société.
besoin profondément humain de retrouver un rôle, une place et un sens dans la
société.
3.6. Travailler à l’échelle du quartier
La majorité des Le quartier ou micro quartier est souvent à l’échelle la plus pertinente pour
personnes âgées revitaliser le lien social et renforcer les solidarités. S’il y a bien un « lieu », un
vit au quotidien « territoire de vie » sur lequel il faut investir, c’est celui-là. On sait que la majorité des
dans un périmètre personnes âgées vit au quotidien dans un périmètre inférieur à 500 mètres43. Les
inférieur à 500 achats du quotidien constituent le premier motif de sortie des personnes âgées
mètres. (boulangerie, marché, pharmacie…). Dès lors, l’accessibilité à pied des commerces et
services se révèle un puissant facteur d’intégration sociale, de lutte contre
l’isolement et de maintien dans la vie sociale. L’existence de services médicaux et
sociaux, l’absence de trop grande déclivité des rues (pas plus de 10%), la présence
d’arrêts de transports en commun sont d’autres facteurs essentiels permettant aux
personnes âgées de « bien vieillir » dans un quartier.
42
Caradec, V. « Sociologie de la vieillesse et du vieillissement », Armand Colin, 2012
43
CHAPON, P-M., NADER, B., Les défis territoriaux face au vieillissement, La Documentation
française, 2012.
173.7. Des suicides en augmentation
Prendre part à La dépression ne touche pas plus les personnes âgées que les personnes plus
différents activités jeunes44 mais pourtant la dépression parmi les personnes âgées reste sous-estimée
de loisirs diminue et sous-traitée, car banalisée.
les risques de 38%
Le grand âge est particulièrement exposé aux suicides (un autre indicateur marquant
pour des
du sentiment de solitude). En effet, les personnes âgées (et en particulier les
personnes de plus
hommes) sont près de deux fois plus nombreuses à mettre fin à leurs jours45 que le
de 65 ans de
reste de la population. En France, ce sont 3.000 personnes de plus de 65 ans qui
devenir démentes
choisissent chaque année de mettre fin à leurs jours. Au-delà de 85 ans, le taux de
(Yaakov Stern).
suicides est même le plus élevé de la population46.
En Belgique, le taux de suicides est stable chez les femmes quel que soit l’âge. Chez
les hommes, le suicide augmente nettement après 80 ans. Entre 65 et 79 ans, les
hommes se suicident 3 fois plus que les femmes et au-delà de 80 ans, 5 fois plus. Ces
chiffres sont similaires aux données en France. Cela s’explique en partie parce que les
hommes sont moins bien armés que les femmes pour faire face à ces nouvelles
formes d’adversité (dépendance, solitude, veuvage,…)47. De plus, les hommes
semblent avoir plus de difficulté à exprimer leur vulnérabilité, ce qui s’explique
notamment par une socialisation masculine qui limite l’expression émotionnelle et
qu’ils disposent, en général, d’un réseau de soutien moins riche que celui des
femmes.
44
WALLONIE, FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES, Cahier « Bien vieillir », septembre 2014.
45
UCP, Actes de la journée d’étude « stress, dépression, suicide, Balises, n°38, Juillet 2012.
46
GUEDJ, J., Plaidoyer pour les vieux, Editions Jean-Claude Gawsewitch, 2013.
47
BERSAY, C., De l’avenir pour le suicide des vieux, L’esprit du temps, 2005.
18Figure 5 - Taux de suicide (pour 10 000 personnes) selon la région de la résidence, les tranches d’âge
et le sexe, en 2011 (source : SPF Economie, 2001)
194. LES SOLIDARITÉS FAMILIALES
L’avancée en âge La famille peut constituer pour les individus avançant en âge, un lieu privilégié de
et la diminution de participation sociale, par les échanges qui s’y enracinent.
l’autonomie ne
signifient pas Pendant longtemps, les sociologues ont cru que les solidarités publiques se
nécessairement la substituaient aux formes de solidarités privées, à la fois parce que l’Etat a dû
fin de la réciprocité suppléer aux défaillances des solidarités familiales, désorganisées par
dans les échanges, l’industrialisation et le capitalisme naissant et parce que le développement des
parce qu’il arrive solidarités publiques a provoqué une démobilisation de la famille. Caradec48 nous
que les parents démontre que, au contraire, les solidarités familiales et les solidarités publiques sont
âgés perpétuent interdépendantes. La modernité n’a pas dissous les solidarités au sein de la parenté.
un rôle de
pourvoyeur de
services (soutien 4.1. La réciprocité des échanges
moral, aide
financière,…). Ils
ne sont pas
uniquement L’avancée en âge et la diminution de l’autonomie ne signifient pas nécessairement la
bénéficiaires de la fin de la réciprocité dans les échanges, parce qu’il arrive que les parents âgés
solidarité perpétuent un rôle de pourvoyeur de services (soutien moral, aide financière,…)49. Ils
familiale. ne sont pas uniquement bénéficiaires de la solidarité familiale. En Belgique, quatre
personnes entre 65 et 79 ans sur dix fournissent une aide ou des soins à leur
entourage et trois personnes de 80 ans et plus sur dix.
Les solidarités familiales et publiques sont étroitement imbriquées. Par exemple,
l’instauration de la retraite a permis de « réinventer » la figure oubliée de la famille,
« le grand-père » qui dispose de temps pour s’occuper de ses petits-enfants. En
France, chaque semaine, 23 millions d’heures de garde d’enfants seraient effectuées
par les grands-parents, ce qui représente l’équivalent de 660.000 emplois à temps
plein50.
Une enquête auprès de trois générations familiales montre que les transferts
financiers au sein de la famille circulent en sens inverse des transferts publics, les
plus âgés aidants leurs enfants et petits-enfants.
48
Caradec, V., Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Armand Colin, 2012, p.38
49
LEIDER, B., Le vieillissement actif, une invitation à penser l’implication sociale des aînés dans
la famille, Le vieillissement actif dans tous ses éclats, 2014.
50
GOUVERNEMENT FRANÇAIS, La grand-parentalité active, Conseil d’analyse stratégique,
Note d’analyse, n°199, Novembre 2010.
204.2. Encourager le dialogue et libérer la parole
La Fondation Roi Baudouin a sorti une étude « Penser plus tôt à plus tard »51. Elle met
Deux Belges sur
en évidence le manque de communication et de préparation de la retraite et de la
trois ne parlent
vieillesse. La population belge n’a pas encore l’habitude de préparer la période qui
pas de la vie après
suit la vie active et de dialoguer sur ce sujet bien qu’il y ait une demande
la retraite et 62 %
d’informations. D’après une étude IPSOS52, seul un Belge sur dix a discuté avec ses
ne la préparent
parents de leur vie après la retraite. Un seul senior sur trois vivants à domicile a déjà
pas.
parlé avec quelqu’un de la manière et où il/elle souhaiterait vivre à l’avenir53.
Certains sujets sont considérés comme tabous tels que la mort (56% des
répondants), le déclin des capacités physiques (51%) et la maladie (46%). En général,
les Belges ne préparent pas leur après-carrière avant d’avoir pris leur retraite. La
crainte du déclin et de la dépendance pousse souvent à refouler l’idée de « plus
tard » mais, paradoxalement, cela ne fait qu’accroître le risque de dépendance.
Pourtant, 9 Belges sur 10 sont favorables à une bonne préparation des derniers âges
de la vie. Des études ont montré que, plus on se prépare à temps à ce « second
projet de vie », entres autres en en discutant avec son entourage, plus on a de
chances de le vivre de manière heureuse et satisfaisante, avec une bonne qualité de
vie54.
Il est nécessaire de détecter les personnes âgées vulnérables en vue de les
sensibiliser et de les accompagner dans une discussion et une réflexion sur leurs
vieux jours. L’information peut aussi jouer un rôle important et être diffusée via les
associations pour les personnes âgées en situation de pauvreté, via des intervenant-
clés. Les personnes d’origine étrangère55, en situation de pauvreté ou avec un
handicap sont particulièrement vulnérables56.
51
FONDATION ROI BAUDOUIN, Penser plus tôt à plus tard : dialogue intergénérationnel
autour du ‘second projet de vie, 2013-2014
52
IPSOS PUBLIC AFFAIRS. Positionnement et attentes de la population générale belge à propos
de la planification de ses vieux jours.
53
FONDATION ROI BAUDOUIN, Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et
l’isolement social des personnes âgées en Belgique, ULg, Ipsos, KUL, 2012.
54
FONDATION ROI BAUDOUIN, VAN GORP, B., La vieillesse, antichambre de l’ennui ou âge
d’or ? Représentations sociales et communication autour du vieillissement, 2013.
55
Comme expliqué précédemment.
56
FONDATION ROI BAUDOUIN, Penser plus tôt à plus tard : dialogue intergénérationnel
autour du ‘second projet de vie’, 2013-2014.
21Vous pouvez aussi lire