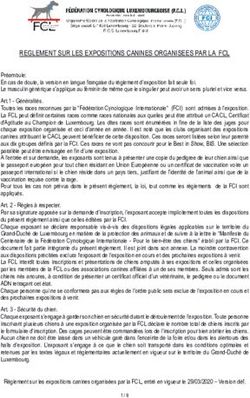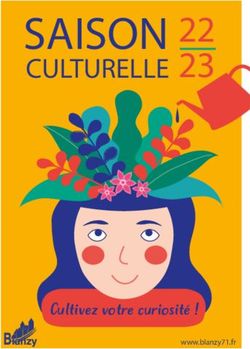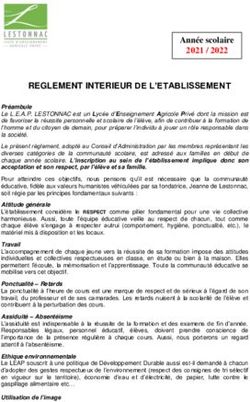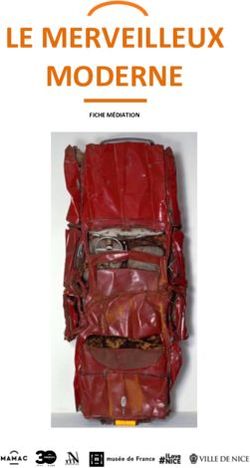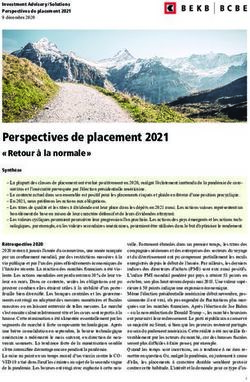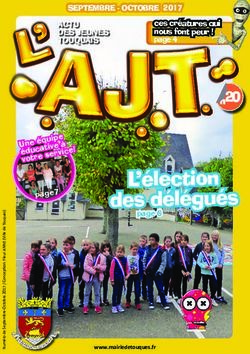Roger Cosme Estève Texte de Luc Lang - Galerie Convergences
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LE POSSIBLE DE LA PEINTURE
« Chaque nouvelle œuvre d’art
réinvente toutes celles qui l’ont précédée. »
Oscar Wilde
C’est une peinture qui se suffit à elle-même, de toute évidence, parce qu’elle n’est pas
là pour servir quelque chose qui lui serait extérieur, une narration, un récit, celui de
l’histoire, les petites ou la grande. C’est une peinture qui se présente pour ce qu’elle
est, de toute sa possible présence, elle s’impose et nous imprègne, en silence, le nôtre,
devenus mutiques, parce qu’elle est hypnotique, offrant de nous absorber à chaque toile
dans son labyrinthe. Faut-il préciser que c’est une œuvre fragmentairement figurative,
mais aussi fragmentairement expressionniste abstraite, sans qu’aucune classification ne
soit satisfaisante.
TECHNIQUES
Le rapport du dessin, du trait à la couleur n’est aucunement complémentaire. Celui-ci
n’est en effet pas là pour la sertir, tel un contour, un agencement de la couleur dans
un ordre classique où l’un servirait l’autre. Baigné entre autre de l’héritage matissien,
Roger Cosme Estève joue à part égale et pour eux-mêmes dessin et couleur sans aucun
ajustement entre le contour des motifs et les aplats de couleur ou les strates de lumière.
Comme s’il jetait sur la toile, tel le marabout sur le sol, des éléments hétérogènes,
morceaux de bois, coquillages, cailloux, dans un lancer où pour finir c’est bien le devenir
et la prophétie qui s’organisent dans la poussière. Ici, dessins et couleurs semblent de
même jetés sur la toile sans aucune considération hiérarchique des uns ou des autres.
La couleur est fracturée, cisaillée par de larges traits noirs qui parfois se brouillent,
se raturent jusqu’à produire des brumes, des biffures, des maculatures, des ombres
graphiques, des lumières noires, des béances obscures, dans l’oubli du dessin. À
l’unisson, les couleurs jouent tous les registres, toutes les fonctions, elles-mêmes sortant
du fond de la toile, telles des lumières ou des aplats, comme taches et maculatures
encore, pour à leur tour faire traits, dessinant contours et formes en tension avec les
formes noires. Le dessin peut tout faire, la couleur peut tout faire, se superposant, se
stratifiant, s’enchâssant, se tramant, le dessin comme la couleur génèrent et enfantent
tout autant qu’ils brouillent, qu’ils empêchent la montée des formes. Dessins et couleurs
sont devenus des milieux tout autant que des labyrinthes, les poissons, les crabes, les
oiseaux, les insectes, les rochers, les maisons y surgissent au détour d’un trait ou d’un
4aplat puis repartent, disparus, fondus dans l’indifférencié du milieu en perpétuelle
mutation, basculement, bouleversement du plus loin au plus près, des côtés vers le
centre, de haut jusqu’en bas, et retours.
En outre, on est d’autant plus confronté à un monde dynamique qu’il n’est pas non
plus organisé dans une composition générale qui présiderait à l’ordre du tableau. Ce
sont des poches, des noyaux d’activité souvent autonomes qui s’engendrent ici et là,
dans n’importe quel coin de la toile, provoquant des embryons d’univers autonomes les
uns par rapport aux autres et pourtant cohabitant, le regard traversant alors des pays
distincts et des paysages encastrés, dans un mouvement latéral qui glisse et balaye, dans
un mouvement frontal qui creuse et s’enfonce, et ce, dans le même espace infini d’un
chaos cependant abouti, chaque fois, et de pure vitalité.
Faut-il ajouter que tous les supports sont possibles. Toile, feutrine, carton, papier, bâche,
moquette… Et tous les formats, du plus grand au plus petit (cf. la série des Impromptu
2018). Et toutes les couleurs, les plus ingrates, ternes, éteintes, plates, les plus difficiles
à utiliser, le vert kaki, le gris moyen, cette non lumière, intraitable… Il précise, installé
dans le sud-ouest : « ce qui m’a plu, c’est l’absence de ciel, et tout ce gris était intéressant
du point de vue pictural », ce gris qu’il rejoue dans cette dernière série des Brots (les
bourgeons) présentée ici. Transfigurant ainsi ces pauvres verts et ces misérables gris
en des velours, des lumières scintillantes, chaudes ou aveuglantes. Et pour s’aventurer
au plus loin des possibles, le peintre peut travailler de la main gauche, moins habile,
certes, mais où le risque est plus grand. Car il aime, à la manière de Willem de Kooning,
insécuriser sa pratique, se mettre en danger, sortir de sa maîtrise pour explorer le monde,
s’y prêter, s’y perdre, que la peinture le prenne et l’emporte, il ne sait où, qu’il en soit
traversé et la serve, non qu’il s’en serve.
MOTIFS
Puisque parmi ces tourbillons, ces nuées, ces ossatures en mouvement surgissent des
figures, elles seraient celles, très simples, des trois règnes : animal, végétal, minéral.
Oiseaux, insectes, poissons et crabes, herbes, buissons, arbres et forêts, enfin pierres
et rochers. Mais sans narration. Ce ne sont pas des formes figuratives, mais plutôt
figurales, comme l’écrivait Deleuze à propos de Bacon (cf. Logique de la sensation,
éd. La Différence, 1981). Ce sont des apparitions, parfois centrales, puissantes, ou au
contraire furtives, elliptiques, enfouies, que le regard saisit un moment, puis qu’il perd,
comme si nous étions pris-dépris de et par la figure, les figures. De véritables apparitions
donc, qui se justifient là encore de leur seule présence défaites de toute relation entre
elles qui pourraient constituer des récits, des histoires. Ce serait des figures iconiques
6en ceci qu’elles sont des signes du vivant tout autant que des images, les oiseaux et les
poissons instaurant des espaces aériens ou liquides, non orientés, ou au contraire les
arbres et les rochers instaurant des espaces pondéreux et gravitationnels, tous ensemble
indexant l’espace de la toile de qualités paradoxales, de la gravité à l’apesanteur, dont le
crabe serait le lien, lui qui oscille de l’une à l’autre, l’artiste confirmant qu’il est sa figure,
son représentant, le crabe (el cranc, en catalan, le menuisier de carcasse) qui se guide à la
lumière de la lune, se nourrit des restes, nettoie les carcasses et marche de biais (cf. Didier
Goupil, El cant del cranc, catalogue de l’exposition, librairie Ombres Blanches, 2017). Les
figures apparaissent, disions-nous, pour constituer une cosmogonie propre à l’ensemble
de l’œuvre, entendons ainsi des figures qui ici et là participent à la création d’un univers
et en élucident les origines. La cosmogonie particulière de Roger Cosme Estève, liée sans
aucun doute à son histoire personnelle et fortement nomade (cf. Didier Goupil, Rocas
ou l’art de dresser les pierres, catalogue galerie Convergences 2016, ou encore Journal
d’un caméléon, biographie fantasmée du peintre Roger Cosme Estève. éd. Le Serpent à
Plumes, 2015), mais où ces figures surgissantes, fondamentales et génériques à la fois,
autorisent l’artiste à transformer le monde en peinture, ayant sans compter prêté son
corps au monde, écrirait Merleau-Ponty (cf. L’œil et l’Esprit, éd. Gallimard, 1964). Ainsi
ces figures, surgissant ici et là seraient des vecteurs d’engendrement d’un monde tout
autant qu’elles y seraient engendrées, cet univers de peinture devenu à toute force leur
propre milieu et la possibilité de leur devenir.
Restent deux motifs, puissants et décalés, parce qu’ils ne participent d’aucun étant-
donné, entendons d’aucun des trois règnes, animal, végétal et minéral, le motif de la
cabane et de l’écriture, de l’habitat humain et du langage. Comme si l’œuvre, dans
son extrême lucidité, ne pouvait s’exempter d’une emprise humaine, puisque toute
cosmogonie, tout imaginaire saisissant le monde est une reprise de tout l’étant-donné,
un embrassement de notre planète toute entière, constituée de grouillantes existences
diverses qui sont autant de hasards de croisements chimiques et biologiques dépourvus
de sens, de but, de finalité, une simple immanence du vivant, complexe, subtile, et tout
à fait désarmante. Cette absolue hétérogénéité à laquelle nous sommes confrontés fait
loi et nécessité, nous contraignant, sous peine de n’y survivre, à élaborer une syntaxe,
une cohérence, aussi débridée, aussi trouée, aussi bricolée soit-elle. Il s’agit donc de
prendre pied, d’y construire son habitat, son abri, sa cabane, mais aussi de constituer
à minima une syntaxe, d’inventer une origine, de proposer une cosmogonie puisque tel
est son rôle, afin que cette planète, à la fois luxuriante et insignifiante, prenne sens, en
acquiert un, que la nature des origines, telle une jungle impénétrable, devienne le jardin
du futur. D’où la présence centrale, latérale ou évanescente de la maison, côtoyant la
traversée récurrente de l’écriture qui vient par endroit couvrir la toile d’un texte sans
fin. Après l’espace de la gravité et celui de l’apesanteur, voici le dernier espace, celui
8de la feuille d’écriture, du plan. Et peu importe les dialectes ou la langue (catalan,
français, sanscrit…), peu importe les graphes ( indo- européen, cyrillique, phénicien,
grec, inventé…), peu importe la lisibilité, l’écriture traverse les strates de peinture, les
vagues de couleurs, les couches du monde, elle trace des lignes de sens, inlassablement,
de génération en génération, l’écriture annote et organise souterrainement la pensée du
monde, le commente, le remémore, le projette, le vectorise, le trace, l’apaise dans un récit,
le rend habitable. La cabane peut y être construite.
Ainsi, dans le chaos envisagé du monde se peint et s’écrit le chaos inenvisagé de la
peinture, le peintre y engage son corps, son bras, sa main, ses mains quand il peint
l’espace, il y engage le poignet et la main quand il écrit le temps. De la représentation à
la signification, tout est délivré, d’un corps érudit et d’une pensée sauvage, tout nous est
présenté, nonobstant d’une saisissante beauté, d’un aboutissement sans reste, l’artiste
chevauchant le volcan, tous risques pris.
CORRESPONDANCES
Si l’on se prête au jeu des correspondances, elles sont nombreuses. En établir la somme
serait une gageure.
Pour ce qui est du rapport très libre et libéré de la couleur au dessin, nous avons cité
Matisse, mais il faudrait également penser à Karel Appel, Asger Jorn, Pierre Alechinsky
pour la façon dont dessins et couleurs s’échangent rôles et fonctions, engendrant des
maelströms de peinture et de formes.
Pour ce qui est de l’écriture, on pourrait évidemment songer à Cy Twombly, sinon que
chez Roger Cosme Estève, elle n’est pas théâtralisée, elle s’impose même souvent comme
un fond, un substrat insécable persistant sous les vagues de peinture, tel un palimpseste
constant.
Pour ce qui est de l’usage du trait noir jusqu’à son aplat, jusqu’au cri de la forme
anéantissant ou ressuscitant la lumière, on peut aisément cheminer de Louis Soutter
à Robert Motherwell en s’attardant longuement sur l’œuvre de Jean-Pierre Pincemin.
Enfin, pour ce qui est des grandes plages de couleurs saturées de lumière mais cisaillées,
fracturées de traits et de figures, on penserait volontiers à Per Kirkeby.
Il faut ici s’entendre sur ce qui motive le tissage de possibles correspondances
comme d’éventuelles influences. En se méfiant, comme le souligne Nietzsche dans
Les Considérations inactuelles (1874, au chapitre De l’utilité et des inconvénients de
l’histoire pour la vie, éd. Gallimard) de ce réflexe historiciste qui nous anime, consistant
10Série “Brots”. Huile sur toile, 2020 – 80 x 80 cm.
11à trop immédiatement classer et classifier toute œuvre en la rabattant dans une tradition
et une histoire de l’art, une façon de l’ensevelir déjà dans un passé qu’on suppose à
tort neutralisé. Puisant à loisir références et citations pour parader en discours, vêtu de
tous les signes extérieurs de savoir. Une façon mortifère en somme, de fuir le présent en
l’étouffant sous le poids d’un passé consacré, laissant « les morts ensevelir les vivants »
écrit Nietzsche. Sans quoi, en effet, il faut bien affronter le surgissement de l’œuvre,
celle ici de Roger Cosme Estève dans ce qu’elle a de plus vital, de plus neuf, de plus
improbable, de plus décisif, un présent de peinture qui fait évènement jusqu’à l’effroi, la
stupéfaction et l’indicible parce que nous sommes soudain face à ce qui nous excède,
de vie et de beauté, envahi du sentiment parfois inconfortable d’être débordé, que
Kant définit comme le sublime. C’est justement à ce surgissement, à cet évènement de
peinture que nous sommes ici confrontés : « Celui qui ne sait pas s’installer au seuil de
l’instant, en oubliant tout le passé, celui qui ne sait pas, telle une déesse de la victoire,
se tenir debout sur un seul point, sans crainte et sans vertige, celui-là ne saura jamais
ce qu’est le bonheur, pis encore : il ne fera jamais rien qui rende les autres heureux. »
(Nietzsche, op. cit. La Pléiade, Gallimard, p. 502). Or, c’est bien de cette joie et de ce don
que nous sommes ici affectés. Et ce détour référentiel, loin d’infuser ici devant l’œuvre
de Roger Cosme Estève le poison d’un passé simplement reconduit et qui bégaye, nous
permet au contraire d’affirmer, en cette possible filiation, combien l’artiste poursuit à sa
façon, irréductible et singulière, le travail toujours inachevé de la très grande peinture.
Luc Lang
Perpignan – Montreuil,
juin 2019 / février 2021
Nota bene (1)
J’aurais pu tout au long de cette approche citer nombre de peintures, évidemment,
sinon que nous n’aurions eu qu’une infinie succession de Sans titre avec une date différente,
ce qui ne nous aurait guère avancés dans l’approche du travail. Il existe d’une certaine façon
des séries, celle des Rocas, du Cranc, des Casas, des Scarabées, des Bois, qu’on pourrait
par moment penser liées à des périodes précises dans le travail, ce qui est en partie vrai,
mais en partie seulement, car ces éléments des séries circulent et se redistribuent finalement
assez souvent dans d’autres séries, défiant bien sûr toute désignation textuelle stable
et précise des œuvres pour lesquelles le seul repère demeure donc la date. Et le temps.
Nota bene (2)
La série ici présentée à la galerie Convergences est tout à fait particulière et devait s’intituler
Brots (les bourgeons), avant que le peintre, peut-être, renonce à un titre quelconque,
comme il en a souvent l’habitude. Le gris domine, ce fameux gris moyen intraitable auquel
il aime s’attaquer, celui d’une lumière neutre, étale, en attente d’une déchirure, d’une trouée
de lumière, où les couleurs comme les formes sont encore en germination, au bord de surgir,
de se dégager de cette gangue grise, vers le meilleur ou vers le pire.
L’attente donc, d’un mouvement, alors que le monde s’immobilise dans le repliement,
dans le confinement… D’où ces formats modestes, non pas conçus dans le grand atelier,
mais dans le petit, le restreint, à l’échelle du jardin, parce que le peintre, comme le
bourgeon, guette la renaissance d’un possible dehors, d’un possible ailleurs, d’un possible
et nouveau commencement.
12Huile sur toile, 2020 – 60 x 60 cm.
13Série “Brots”. Huile sur toile, 2020 – 50 x 50 cm. 14
Huile sur toile, 2020 – 50 x 50 cm.
15Huile sur toile, 2020 – 60 x 60 cm. 16
Huile sur toile, 2020 – 60 x 60 cm.
17Série “Brots”.
Huile sur toile,
2020 – 100 x 100 cm.
1819
Huile sur toile, 2020 – 60 x 60 cm. 20
Huile sur toile, 2020 – 70 x 70 cm.
21Série “Brots”. Huile sur toile, 2020 – 50 x 50 cm. 22
Série “Brots”. Huile sur toile, 2020 – 73 x 60 cm.
23Huile sur toile, 2020 – 70 x 70 cm. 24
Huile sur toile, 2020 – 70 x 70 cm.
25Série “Brots”.
Huile sur toile,
2020 – 100 x 100 cm.
2627
Huile sur toile, 2020 – 60 x 60 cm. 28
Huile sur toile, 2020 – 70 x 70 cm.
2930
Série “Brots”. Huile sur toile, 2020 – 50 x 50 cm.
31Roger Cosme Estève a souvent exposé en Europe – Allemagne,
Espagne, Italie, Hollande –, mais aussi en Asie centrale.
En l992, il fait deux séjours sur la frontière entre le Kirghiszistan
et le Kazakhstan. Il expose à Bichkek, la capitale du premier des
deux états ; Almaty, la capitale du second, le fait entrer dans les
collections de son musée des Beaux-Arts.
Resté fidèle, coûte que coûte, à la peinture, Estève, sans
dissocier le sacré de sa pratique artistique, n’a pas éludé les
possibilités technologiques et esthétiques offertes à sa génération.
Ainsi s’est-il intéressé à l’installation, à la performance, à la vidéo et
au multimédia, domaines explorés en particulier lors de sa période
land art, dite des « pells de la terra ».
Il a également exploré le design graphique, qu’il a appliqué au livre,
à l’affiche et à la pochette de disque.
De 2010 à 2016, Roger Cosme Estève partageait son temps entre
Tarn et Roussillon, exposant plus particulièrement la série « Arbres »
au musée des Beaux-Arts de Gaillac et au Centre de sculpture
Romane de Cabestany.
Depuis 2017 il vit et travaille à Perpignan.
Didier Goupil
32Série “Brots”. Huile sur toile, 2020 – 50 x 50 cm.
33œuvres dans les collections publiques
FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier.
Affaires culturelles de Hanovre, Allemagne.
DRAC Musée d’art moderne, Céret.
Département de la culture, Vic, Espagne.
Xarxa cultural, Barcelone, Espagne.
State Museum, Alma-Ata, Kazatchtan.
The State Museum, Kirghistan.
DRAC Centre d’Art sacré, Ille-sur-Têt.
DRAC Centre d’Art contemporain, Saint Cyprien.
DRAC Bibliothèque Centrale de prêt, Thuir.
Musée d’art Hyacinthe Rigaud, Perpignan.
Futur Musée d’Art Moderne et Contemporain de Palestine.
catalogues et Ouvrages
La minvada , dessins textes catalans, édition Trabucaire, 1986.
Olé , texte de Georges-Henri Gourrier, édition Trabucaire, 1987.
Dual ! texte de Christophe Massé, édition Trabucaire, 1989.
Une écriture peinture qui pourrait être ça, texte catalan/français, édition Trabucaire, 1996.
Le hareng de Diogène, texte de Christophe Massé, édition Voix – édition R. Meier, 2006.
La Licorne d’Hannibal, N°12, revue artistique, littéraire & sans baise-main du Cercle
des Authentiques Cabochards de l’IF d’Elne, texte de Jacques Quéralt, 2006.
La balle au mur, texte de Thérèse Roussel, édition Voix – édition R. Meier, 2008.
Sang d’encre, texte de Mireille Calle-Gruber, édition Voix – édition R. Meier, 2008.
Jungle, peintures, texte de Mireille Calle-Gruber, édition Voix – édition R. Meier, 2010.
Le hareng de Diogène 2, texte de Mireille Calle-Gruber, édition Voix – édition R. Meier,
2012
Toro de fuégo, édition Voix – édition R. Meier, 2014.
Journal d’un Caméléon, texte de Didier Goupil, éditions Le Serpent à Plumes, 2015.
El cant del cranc, texte de Didier Goupil, édition Voix – édition R. Meier, 2016.
Rocas, catalogue Galerie Convergences, 2016.
Casa de Foc, texte de Didier Goupil, édition Voix – édition R. Meier, 2017.
Impromptu, texte de Didier Goupil, édition Voix – édition R. Meier, 2018.
Sóc res, texte de Jean-Michel Collet, édition Voix – édition R. Meier, 2018.
Impromptu, catalogue Galerie Convergences, 2019.
34Série “Brots”. Huile sur toile, 2020 – 100 x 100 cm.
35Expositions
1980 Fondation Boris Vian, Paris.
Viallat, Clément, Massé, Estève. Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
1983 « Pells de la terra », CDACC musée Puigt, Perpignan.
1984 Fondation Joan Miro, Barcelone.
Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
1986 « Sol-Sol », musée d’Art Moderne, Céret.
Kubus, Hanovre, Allemagne.
« Les Ruines de l’Esprit » : Buraglio, Foulon, Lestié, Mario Mertz, Estève,
université de Toulouse-Le Mirail.
1987 Palais des Congrés – galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
La ruée vers l’Art, galerie Sarradet-SNCF : Morellet, Clarbous, Estève.
1993 Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
Burri Baj, Schifano, Tapies, Studio Délise, Porto-Gruaro, Venise.
The Kirghiz State Museum, Bischkek, Kirghistan.
Kazakh State Museum, Almaty, Kazakhstan.
Galerie Zoo, Musée Huelgas, Burgos, Espagne.
1994 Galerie Witteveen, Amsterdam.
1995 Le sacré dans l’art contemporain, Halle aux poissons, Perpignan.
1997 Centre d’étude Catalane, La Sorbonne, Paris.
Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
Centre d’art Contemporain, Saint-Cyprien.
2000 Rétrospective : Espace Maillol, Palais des Congrès, Perpignan, catalogue Didier Goupil.
Galerie Kandler, Toulouse.
2001 Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
2002 Galerie Al manar, Casablanca.
2003 6 toros – 6 peintres : Le Gac, Albérola, Formica, Vila, Viallat, Estève,
musée d’Art moderne, Céret.
Palais des congrès Tautavel, musée de l’Homme.
Centre d’art contemporain, Saint-Cyprien.
2005 « Lotja del blat », Vic, Espagne.
362006 Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
2008 « Acentmétreducentredumonde », Perpignan.
« Sang d’encre », La Capelleta, Céret.
2009 Galerie Witteveen, Amsterdam.
« Bâches et Jungles », fort Bellegarde, Le Perthus.
2010 « Toréador » exposition collective, Nimes, Madrid, Paris.
2012 « Des arbres », galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
2013 « La lumière, je l’ai trouvée dans les arbres », musée des Beaux-Arts de Gaillac.
2014 Lask, Chateau, Estève, Centre de sculpture Romane, Cabestany.
2015 « Les plages », Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
2016 « Rocas », galerie Convergences, Paris.
2017 Œuvres sur papier, galerie Convergences, Paris.
2018 « Soc res », galerie Odile Oms, Céret.
« Le chant du Crabe – peintures, dessins et textes – dialogues entre le peintre
Roger Cosme Estève et l’écrivain Didier Goupil », grande médiathèque Cabanis
et librairie Ombres Blanches à Toulouse.
2019 « Impromptu », galerie Convergences, Paris.
« En couleur », à l’invitation de Bruno Cali, exposition collective au Séchoir de Mulhouse.
« L’esprit du lieu (20 artistes en 2020) », exposition collective au musée d’Art
2020
Hyacinthe Rigaud de Perpignan. Catalogue de l’exposition écrit par Didier Goupil.
« Impromptu(s) – Peinture et littérature », Roger Come Estève et Didier Goupil
à la librairie L’échappée Belle et à la médiathèque François Mitterrand de Sète.
3738
Photographies artiste et atelier :
Maud Landes, galerie Convergences.
Texte : Luc Lang,
Didier Goupil.
Graphisme : Luc-Marie Bouët.
Le catalogue est publié
par la galerie Convergences
à l’occasion de l’exposition
de Roger Cosme Estève
du 4 au 27 mars 2021.
Galerie Convergences
22, rue des Coutures-Saint-Gervais
75003 Paris
06 24 54 03 09
graisvalerie@yahoo.fr
www.galerieconvergences.com
© Galerie Convergences, Paris 2021
39Galerie Convergences 10,00 e
Vous pouvez aussi lire