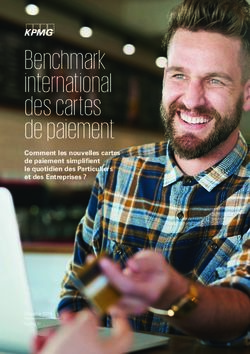SYNTHÈSE SUR LES PRIORITÉS D'AMNESTY INTERNATIONAL POUR LA 49E SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
AMNESTY INTERNATIONAL Index : IOR 40/5228/2022
SECRÉTARIAT INTERNATIONAL
www.amnesty.org 23 février 2022
SYNTHÈSE SUR LES PRIORITÉS D’AMNESTY INTERNATIONAL
POUR LA 49E SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DES
NATIONS UNIES
Cette synthèse présente les grandes priorités d’Amnesty International et ses principales recommandations en
prévision de la 49e session du Conseil des droits de l'homme, qui doit se dérouler à Genève du 28 février au
1er avril 2022.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Une nouvelle fois, les États membres et observateurs se voient présenter des occasions historiques, assorties
de délais déterminés, de mener et de soutenir des efforts significatifs durant la 49e session du Conseil des
droits de l'homme afin d’agir face à des crises urgentes en matière de droits humains, de prévenir de
nouvelles violations, et d’assister les victimes et les témoins dans leur quête de justice.
Un de ces sujets est la situation pressante et difficile des droits humains en Israël et dans les territoires
palestiniens occupés, où des crimes contre l’humanité d’apartheid sont commis en toute impunité. Compte
tenu de l’ensemble de résolutions devant être négociées, la 49e session sera un moment clé permettant au
Conseil des droits de l’homme d’aborder de front la situation actuelle de discrimination institutionnelle en
Israël et dans les territoires palestiniens occupés, dont il est de plus en plus largement confirmé,
notamment par Amnesty International, qu’il s’agit d’un système d’apartheid. Le Conseil doit adopter des
mesures concrètes afin de faciliter le démantèlement de ce système d’oppression et de domination. Des
détails sur nos recommandations à ce propos sont fournis dans ce document.
Le renouvellement des mandats de différents mécanismes essentiels de suivi des droits humains est une
autre question au programme de la 49e session, et nous exhortons les États à soutenir ces renouvellements
sans réserve, notamment les mandats existants sur le Bélarus, le Myanmar, le Soudan du Sud et la Syrie.
Durant cette session, Amnesty exhorte le Conseil à adopter une démarche plus ferme face aux crises des
droits humains en Iran et au Nicaragua, notamment en établissant de véritables mécanismes de suivi et
d’enquête. Alors que les autorités de ces pays refusent de coopérer avec les mécanismes et procédures
existants en relation avec les droits humains, et que la situation sur place continue à se dégrader, le Conseil
ne peut continuer à faire comme si de rien n’était. D’importantes discussions auront lieu sur d’autres
situations de crise lors de cette session, notamment sur l’Afghanistan, l’Éthiopie, le Sri Lanka, le Soudan,
l’Ukraine et le Venezuela. Nous espérons voir les États participer activement lors de ces débats, notamment
en prenant connaissance des divers rapports et mises à jour qui seront présentés, et réclamer une meilleure
protection pour les droits humains et un renforcement de l’obligation de rendre des comptes.
Tous les États membres et observateurs du Conseil des droits de l’homme ont la responsabilité de garantir
que le Conseil remplisse son mandat de prévention des violations des droits humains et réponde aux
urgences sur ce terrain. À ce propos, Amnesty exhorte les États à adopter des mesures dignes de ce nom,
afin d’essayer de résoudre les crises pressantes en matière de droits humains ayant pour l’instant échappé à
un examen scrupuleux, malgré des informations crédibles faisant état de violations systématiques des droits
humains et de possibles crimes de droit international. Cela inclut les situations de plus en plus alarmantes
en Chine, au Cameroun, en Égypte, en Inde et en Russie ainsi que d’autres crises en développement et
émergentes telles qu’en Ukraine et au Kazakhstan. Le Conseil des droits de l'homme doit utiliser tous les
outils à sa disposition, notamment la création, lorsque cela est nécessaire, de mécanismes de suivi, de
communication d’informations et d’enquête afin de répondre à ces crises et d’en empêcher d’autres.
1Il est prévu que le Conseil des droits de l'homme examine et adopte différentes résolutions thématiques
durant la session, notamment concernant les défenseur·e·s des droits humains et un accès équitable aux
vaccins dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Amnesty espère que le Conseil adoptera des
résolutions ambitieuses sur ces terrains, qui fassent avancer la protection des droits, et reçoivent un soutien
massif de la part d’États de toutes les régions du monde.
Les États doivent se montrer déterminés à défendre le système international des droits humains et à
défendre avec force le Conseil des droits de l’homme et ses mécanismes contre toute attaque et tentative de
les affaiblir. Plus précisément, les États doivent se prémunir contre les initiatives nouvelles et résurgentes
visant à mettre à mal les principes fondamentaux du mandat du Conseil, notamment en matière de réponse
aux violations, à vider de leur substance ou déformer le droit international relatif aux droits humains et les
normes en la matière ou à mettre à mal ou attaquer les procédures spéciales.
Enfin, Amnesty appelle tous les États à prendre des mesures supplémentaires pour consulter de manière
appropriée la société civile, notamment les acteurs nationaux et régionaux, et à veiller à ce que leur capacité
à participer à l’ensemble du travail du Conseil, notamment par des débats et négociations officiels, ne soit
pas entravée de manière indue par des restrictions en rapport avec la pandémie de COVID-19.
© Amnesty International 2022, Index : IOR 40/5228/2022 février 2022 LANGUE : Amnesty International est un mouvement rassemblant plus de 10 millions de personnes qui
FRANÇAIS Sauf exception dûment mentionnée, ce document est sous licence Creative fait appel à l’humanité en chacun et chacune de nous et milite pour que nous puissions
Commons : Attribution-NonCommercial-NoDerivatives-International 4.0. toutes et tous jouir de nos droits humains. Notre vision est celle d’un monde dans lequel les
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode dirigeants et dirigeantes tiennent leurs promesses, respectent le droit international et sont
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page relative aux autorisations sur notre
tenus de rendre des comptes. Essentiellement financée par ses membres et des dons
site : www.amnesty.org/fr.
individuels, Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute
2
Lorsqu’une entité autre qu’Amnesty International est détentrice du copyright, le matériel
n’est pas sous licence Creative Commons. tendance politique, de toute puissance économique et de tout groupement religieux. Nous
avons la conviction qu’agir avec solidarité et compassion aux côtés de personnes du monde
entier peut rendre nos sociétés meilleures.Recommandations
RÉSOLUTIONS SPÉCIFIQUES ATTENDUES SUR CERTAINS PAYS LORS DE LA
49e SESSION
ISRAËL ET TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS (TPO)
Au terme d’un processus de recherche et d’analyse très approfondi d’une durée de quatre ans, Amnesty a
conclu dans un récent rapport que les autorités israéliennes imposent un système d’apartheid à tous les
Palestinien·ne·s vivant sous son contrôle effectif - qu’ils vivent en Israël, dans les territoires occupés, ou
dans d’autres pays en tant que réfugié·e·s. Ce système est perpétué par des violations qui, d’après les
conclusions d’Amnesty International, constituent un crime contre l’humanité, l’apartheid. Le rapport
d’Amnesty vient s’ajouter à de nombreux autres travaux réalisés par des organisations palestiniennes,
israéliennes et internationales arrivant à la même conclusion. Il est prévu que le rapporteur spécial sur les
territoires occupés examine la question de l’apartheid dans les TPO dans son rapport qui sera soumis dans
le cadre de la session. À l’heure actuelle, il est de plus en plus intenable pour le Conseil des droits de
l’homme d’éviter d’aborder les questions cruciales et urgentes suivantes : (1) la situation de discrimination
institutionnelle en Israël et dans les TPO, qui s’apparente à un système d’apartheid conçu pour opprimer et
dominer les Palestinien·ne·s au profit de la population juive israélienne, par biais d’un ensemble complexe
de lois, de politiques et de pratiques de ségrégation, de fragmentation, de dépossession et de contrôle ; et
(2) la meilleure manière de favoriser le démantèlement de ce système d’oppression et de domination. Nous
exhortons également le Conseil des droits de l’homme à demander à Israël de cesser de tenter de réduire
l’opposition au silence, notamment en révisant et révoquant l’ordre militaire d’octobre 2021 qualifiant de
groupes terroristes six organisations de la société civile palestiniennes.
BÉLARUS
Le Conseil des droits de l’homme doit veiller au renouvellement du mandat de l’examen de la situation du
Bélarus par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), car il s’agit d’une
composante importante de la démarche coordonnée visant à établir les responsabilités pour les graves
violations recensées au Bélarus. Les récentes violations systématiques des droits humains prouvent la
nécessité d’un suivi rigoureux. Entre autres, la peine de 18 ans d’emprisonnement prononcée contre Siarhieï
Tsikhanouski, arrêté en mai 2020 après avoir fait part de son intention de se présenter à l’élection
présidentielle au Bélarus, ainsi que les peines de prison prononcées contre ses collaborateurs sur la base de
charges similaires ; et les poursuites lancées contre des organisations de défense des droits humains telles
que Viasna et certaines catégories professionnelles sont représentatives de la répression menée par le
gouvernement bélarussien dans le contexte des élections récentes. Les autorités bélarussiennes jouent par
ailleurs un rôle central dans l’exacerbation des difficultés de migrant·e·s et de personnes en quête d’asile,
en attirant ces personnes vers le Bélarus, puis en les transportant près de la Pologne, parfois en les
détroussant et en les frappant, et en les poussant vers la frontière polonaise. Après que les autorités
polonaises ont - en violation du droit international - systématiquement repoussé ces migrant·e·s et
demandeurs et demandeuses d'asile vers le Bélarus, recourant parfois à la violence, les autorités
bélarussiennes les ont brutalisés et arrêtés, et dans certains cas les ont renvoyés de force dans leur pays
d’origine, notamment en les expulsant illégalement sans avoir évalué leurs besoins de protection.
IRAN
Amnesty exhorte le Conseil : à renouveler le mandat du rapporteur spécial sur l’Iran ; à se pencher avec
attention sur les conclusions et recommandations du prochain rapport du rapporteur spécial ; et à se
concentrer davantage sur le problème de l’impunité systémique en Iran pour les crimes passés et présents
contre l’humanité et autres violations flagrantes des droits humains. Outre le renouvellement du mandat du
rapporteur spécial, Amnesty International demande la mise en place d’un mécanisme impartial et
indépendant sur l’Iran afin de lutter contre l’impunité solidement enracinée dans ce pays pour les crimes les
plus graves relevant du droit international, avec pour mission de recueillir, rassembler, protéger et analyser
les éléments de preuve en vue de futures enquêtes et, s’il existe suffisamment de preuves recevables, de
poursuites judiciaires.
3Amnesty recommande que les crimes de droit international et les violations des droits humains nécessitant
une enquête par un mécanisme de ce type incluent les homicides illégaux de centaines d’hommes, de
femmes et d’enfants non armés, ainsi que le recours généralisé à la détention arbitraire, à la torture et aux
disparitions forcées depuis la répression des manifestations dans tout le pays en novembre 2019. Cette
enquête devrait aussi s’étendre aux crimes contre l’humanité passés et présents liés aux disparitions forcées
et exécutions extrajudiciaires de plusieurs milliers de dissident·e·s politiques en 1988. Comme un groupe
d’expert·e·s des Nations unies l’a déclaré en septembre 2020, les violations passées et présentes liées aux
massacres commis dans les prisons en 1988 « pourraient constituer des crimes contre l’humanité ». Ces
expert·e·s ont également indiqué que si le gouvernement iranien continuait à refuser d’honorer ses
obligations au regard du droit international relatif aux droits humains, ils appelleraient la communauté
internationale à agir par le biais de l’établissement d’une enquête internationale. Le fait qu’aucune enquête
n’ait été menée sur des personnes qui, selon les éléments de preuve disponibles, ont participé directement
à ces crimes, parmi lesquelles l’ancien chef du pouvoir judiciaire et actuel président, Ebrahim Raïssi, a non
seulement érigé l’impunité en système, mais également favorisé la répétition de violations flagrantes et
systématiques. En 2021, des milliers de personnes ont été interrogées, poursuivies de façon inique ou
détenues arbitrairement alors qu’elles n’avaient fait qu’exercer pacifiquement leurs droits humains, et des
centaines ont été injustement maintenues en détention. Les forces de sécurité ont eu recours illégalement à
la force meurtrière et à des armes à grenaille pour réprimer des manifestations. La torture et les autres
formes de mauvais traitements, y compris le fait de priver des personnes détenues de soins médicaux
adaptés, sont restées généralisées et systématiques. Des dizaines de décès suspects en détention n’ont pas
donné lieu à des enquêtes et sont restés impunis, en dépit d’informations crédibles selon lesquelles ils ont
résulté d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements, en particulier des privations délibérées
de soins médicaux. Les autorités ont continué à utiliser la peine de mort comme arme de répression
politique contre les opposant·e·s, les manifestant·e·s et les membres de minorités ethniques, et à appliquer
ce châtiment à des personnes mineures accusées d’infractions pénales. Les opposants et les journalistes
vivant à l’étranger sont par ailleurs confrontés à un risque accru d’enlèvements et d’exécutions. Dans son
rapport de juillet 2021 à l’Assemblée générale, le rapporteur spécial sur l’Iran « exhorte la communauté
internationale à demander des comptes » et souligne que « l’absence de recours nationaux met en évidence
le rôle important joué par la communauté internationale pour faire en sorte que les auteurs de violations
flagrantes des droits de l’homme en République islamique d’Iran répondent de leurs actes ». Le rapport que
doit bientôt remettre le rapporteur spécial au Conseil donnera une occasion cruciale à la communauté
internationale de répondre avec fermeté à la crise de l’impunité existant en Iran, ce qui est essentiel à la
prévention de la récurrence de violations manifestes et systémiques des droits humains.
MYANMAR
Amnesty demande au Conseil des droits de l’homme d’adopter une résolution robuste sur le Myanmar, qui
doit renouveler le mandat du rapporteur spécial et garantir les ressources nécessaires, compte tenu de
l’intensification de la crise depuis l’an dernier. Cette résolution doit prévoir la communication régulière
d’informations sur la situation des droits humains au Myanmar, ainsi qu’un suivi en continu du rôle des
Nations unies au Myanmar, et maintenir l’objectif de la justice internationale et de l’obligation de rendre des
comptes, à la fois dans le contexte des crimes de droit international et d’autres violations graves contre les
minorités ethniques, notamment les Rohingyas, et dans celui de la campagne de répression consécutive au
coup d’État depuis le 1er février 2021. Nous espérons prendre connaissance de nouvelles mises à jour sur le
travail de la mission internationale indépendante d'établissement des faits quant aux intérêts économiques
de l’armée du Myanmar, notamment en réponse au rapport que doit présenter le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme lors de la 51e session du Conseil, en septembre (conformément à la résolution 46/21,
paragraphe 53). Il reste urgent d’agir au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies, et nous espérons
que les États membres et observateurs étudieront soigneusement les différents rapports présentés à ce
propos au Conseil des droits de l’homme lors de la session, et se prononceront en faveur d’actions concrètes
de la part du Conseil de sécurité, notamment la saisine de la Cour pénale internationale, des sanctions
financières ciblées contre de hauts représentants de l’État et un embargo mondial sur les armes.
4NICARAGUA
Le Conseil des droits de l’homme doit renforcer sa réaction face à la situation des droits humains au
Nicaragua, qui continue à se détériorer, notamment en lançant un mécanisme robuste, doté d’un mandat
permettant un suivi et la remontée régulière d’informations, et contribuant à l’établissement des
responsabilités pour les crimes internationaux. Il est indispensable d’agir en ce sens, compte tenu de la
dégradation de la situation des droits humains au Nicaragua en 2021, notamment l’arrestation arbitraire de
dizaines d’opposant·e·s politiques, de journalistes et de militant·e·s dans le contexte des élections ; la
disparition forcée de certaines de ces personnes ; et d’autres atteintes à la liberté d'expression, comme
l’annulation de l’enregistrement légal d’au moins 45 organisations non gouvernementales (ONG), et les
descentes effectuées dans les locaux de médias indépendants. Au cours des trois années écoulées depuis
l’adoption de la première résolution du Conseil des droits de l’homme sur le Nicaragua, le gouvernement a
non seulement refusé de participer au processus proposé par le Conseil, et de mettre en œuvre les
résolutions ou suivre les recommandations du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, mais il
a même pris des mesures contraires aux recommandations. Les autorités ont ainsi intensifié la répression,
par le biais de détentions arbitraires et de la criminalisation de défenseur·e·s des droits humains et
d’opposant·e·s au gouvernement, et des lois ont été adoptées afin de restreindre les droits. Le Conseil doit
répondre avec fermeté face à cette régression, et agir afin de soutenir les défenseur·e·s nicaraguayens des
droits humains.
SOUDAN DU SUD
Amnesty exhorte le Conseil des droits de l’homme à renouveler le mandat de la Commission sur les droits de
l'homme au Soudan du Sud (« la Commission ») et profiter de la session pour mettre en avant des questions
essentielles liées à l’obligation de rendre des comptes, notamment l’établissement en urgence du tribunal
hybride pour le Soudan du Sud, ainsi que la nécessité d’une réforme et d’une refonte judiciaire à l’échelle
nationale. Des pressions continues de la part du Conseil, ainsi que la collecte et la préservation constantes
d’éléments de preuve par la Commission restent essentielles face aux violations continues du droit
humanitaire et du droit relatif aux droits humains, et l’absence d’avancées préoccupante en termes
d’engagement ou d’obligation de rendre des comptes pour les crimes commis par les autorités dans le cadre
du conflit, en dépit de promesses répétées, en particulier l’approbation par le gouvernement, en 2021, de
l’établissement de mécanismes de justice. En 2019, Amnesty International a recueilli de nombreuses
informations mettant en évidence un manque de volonté politique en matière d’établissement des
responsabilités pour certains crimes. L’organisation a en outre recommandé de fixer un délai pour
l’établissement de la Haute cour du Soudan du Sud, au-delà duquel l’Union africaine pourrait prendre les
choses en main en créant un tribunal ad hoc1. Nous espérons que les États s’inspireront des priorités en
matière de droits humains pour le gouvernement du Soudan du Sud récemment publiées conjointement par
Amnesty, Human Rights Watch et le réseau Défenseurs des droits humains du Soudan du Sud, à la fois
dans le contexte de la résolution et dans leurs déclarations orales. > Voir la lettre conjointe de la société
civile relative à la 49e session du Conseil.
AUTRES SITUATIONS
Le Conseil des droits de l'homme doit renouveler pleinement les mandats d’autres mécanismes en cours,
comme la Commission d’enquête sur la Syrie et les mandats des procédures spéciales sur la situation des
droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée et au Mali. Les États membres doivent
se prononcer en faveur d’une résolution sur la Géorgie appelant à fournir une assistance technique et une
aide au renforcement des capacités, ainsi qu'à autoriser les observateurs des droits humains à se rendre sur
le territoire.
5AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À DES PAYS SPÉCIFIQUES
ET AUX DIALOGUES INTERACTIFS À LA 49e SESSION
AFGHANISTAN
Nous exhortons les États de toutes les régions à participer activement au dialogue interactif sur
l’Afghanistan, qui portera sur la profonde crise humanitaire et des droits humains dans laquelle le pays a
basculé. Ils doivent user de leur voix et de leur influence afin de faire pression sur les talibans, et de les
inciter à respecter le droit international et les droits humains sans discrimination. Amnesty a recensé des
crimes de droit international, notamment des crimes de guerre, commis par les talibans depuis qu’ils ont
pris le contrôle du pays, en particulier des actes choquants commis contre des minorités ethniques et
religieuses, et la détention arbitraire, la torture et l’exécution de journalistes, de militantes, d’anciens
fonctionnaires, de membres des forces de sécurité et d’autres opposant·e·s. L’organisation a aussi recueilli
des informations sur des homicides de civil·e·s, notamment d’enfants, et le bombardement de cibles civiles
par les forces nationales de défense et de sécurité, l’armée des États-Unis et l’armée de l’air afghane.
L’assaut mené par les talibans contre les droits des femmes et des filles s’est amplifié, celles-ci étant
privées de droits fondamentaux tels que les droits à l’éducation, au travail et aux soins de santé, et étant
prises pour cibles lorsqu’elles manifestent de manière pacifique pour réclamer le respect de leurs droits. Les
procédures spéciales des Nations unies ont exprimé des inquiétudes sur les discriminations systématiques
et de grande ampleur visant les femmes et les filles, et les agissements des talibans ayant pour but de faire
disparaître les femmes et les filles de la vie publique. Les victimes de violences sexuelles et liées au genre
ont essentiellement été abandonnées, les talibans ayant fermé des centres d’accueil et libéré de nombreux
détenus accusés de violences liées au genre. La situation humanitaire dans le pays est par ailleurs
désastreuse. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) estime que 97 % des
Afghan·e·s pourraient sombrer dans la pauvreté d’ici la mi-2022. Nous encourageons tous les États à
exprimer leurs préoccupations face à ces graves violations, lors de la session, et à demander aux talibans de
respecter le droit international. > Voir le rapport intitulé No escape: War crimes and civilian harm during the
fall of Afghanistan to the Taliban, ainsi que deux enquêtes : Les talibans responsables du massacre
d’hommes hazaras, août 2021, et 13 Hazaras tués par les combattants talibans dans la province de
Daykundi, octobre 2021.
ÉTHIOPIE
Depuis que le Conseil des droits de l’homme a abordé la crise en Éthiopie pour la première fois, en
juin 2021, le conflit et les violations et abus de grande ampleur se sont propagés au-delà de la région du
Tigré. Amnesty International a recensé une longue liste de violations et d’abus en Éthiopie commis par
l’ensemble des parties au conflit dans la région du Tigré et la région Amhara - notamment des violences
sexuelles et liées au genre, des exécutions extrajudiciaires, des bombardements aveugles et des pillages
généralisés2 - des atteintes au droit international dont certaines constituent des crimes de guerre et de
possibles crimes contre l’humanité. L’ampleur et la brutalité des violences sexuelles et des violences liées
au genre comme arme de guerre est particulièrement choquante. Amnesty International a établi que des
forces affiliées au gouvernement éthiopien ont soumis des femmes et des filles du Tigré à des viols,
notamment en réunion, à l’esclavage sexuel, à des mutilations sexuelles, et à d’autres formes de torture,
proférant souvent des insultes à caractère ethnique et des menaces de mort, dans un contexte et dans des
proportions constituant des crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité3. Amnesty a aussi recueilli
des informations sur des violations graves, notamment des violences sexuelles, commises par les forces
tigréennes dans la région Amhara. Les victimes ont décrit avoir subi des viols en réunion, des viols sous la
menace d’une arme, des vols, et des agressions physiques et verbales de la part de combattants du Front
populaire de libération du Tigré4. Des enfants, des femmes, des personnes déplacées à l’intérieur de leur
2
Voir par exemple : Amnesty International, Éthiopie. Le massacre par les troupes érythréennes de centaines de civil·e·s à Aksoum est susceptible de
constituer un crime contre l’humanité , 26 février 2021 ; Amnesty International, Ethiopia. Summary killings, rape and looting by Tigrayan forces in
Amhara, 16 février 2022.
3Amnesty International, Éthiopie. Des militaires et des miliciens violent et enlèvent des femmes et des filles dans le Tigré,10 août 2021 ; Amnesty
International, Ethiopia. “I don’t know if they realized I was a person”: Rape and Sexual Violence in the Conflict in Tigray, Ethiopie 10 août 2021.
4Amnesty International, Éthiopie. Les victimes d’une attaque menée par le FPLT décrivent des viols en réunion, des pillages et des agressions
physiques, 9 novembre 2021 ; Ethiopia. Summary killings, rape and looting by Tigrayan forces in Amhara, 16 février 2022.
6pays, et des réfugié·e·s ont été tués lors de frappes aériennes incessantes en décembre 2021 et
janvier 2022, et des centaines d’autres civil·e·s ont été blessés. Pendant ce temps, à Addis-Abeba et dans
d’autres zones du pays, nous avons été alarmés par une vague d’arrestations arbitraires de masse à
motivation ethnique visant des Tigréens. Si le gouvernement éthiopien a établi une commission ministérielle
conjointe afin de mettre en œuvre les recommandations du rapport conjoint d’enquête du HCDH et de la
Commission éthiopienne des droits humains, aucune mesure digne de ce nom n’a été prise afin d’ouvrir des
poursuites et de juger les forces soupçonnées d’avoir commis des violations des droits humains dans le
cadre du conflit jusqu’à présent, et les violations se poursuivent sans faiblir. Nous encourageons tous les
États à attirer l’attention sur ces faits - sur les graves violations et abus qui se sont propagés du Tigré au
reste du pays - durant le dialogue interactif prévu lors de la session. Les États doivent exhorter toutes les
parties au conflit à : mettre un terme à ces graves violations et abus des droits humains ; à coopérer
pleinement avec la Commission internationale d’experts des droits de l’homme sur l’Éthiopie, et la
Commission d’enquête établie par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ; et à
permettre un accès plein et sans entrave à l’aide humanitaire.
SRI LANKA
Un dialogue interactif important aura lieu sur la mise à jour écrite du Haut-commissariat aux droits de
l’homme à propos des progrès enregistrés en matière de réconciliation et d’établissement des responsabilités
au Sri Lanka (conformément à la résolution 46/1 du Conseil des droits de l’homme). Les États pourront à
cette occasion évoquer la détérioration de la situation dans ce pays. Nous déplorons vivement le
rétrécissement drastique de l’espace civique ; les représailles visant des défenseur·e·s des droits humains,
des journalistes et même des personnes exprimant des préoccupations face la réponse donnée à la
pandémie de COVID-19 ; le démantèlement de mécanismes nationaux de réparation, tels que le Bureau des
personnes disparues et la Commission nationale des droits humains ; et l’intensification de la
discrimination, du harcèlement et de la violence contre la communauté musulmane. Dans le cadre de ce
dialogue interactif, nous encourageons les États à demander au gouvernement sri-lankais de remplir son
devoir de protection à l’égard des musulmans, d’amener les agresseurs à rendre des comptes et de mettre
un terme aux politiques gouvernementales prenant pour cible la communauté musulmane et induisant
harcèlement et discriminations. Ils doivent aussi exhorter le gouvernement à mettre un terme aux
représailles visant des opposant·e·s avérés et présumés, et, dans ce contexte, à cesser immédiatement
d’utiliser, puis à abroger, la Loi relative à la prévention du terrorisme, ainsi que la nouvelle réglementation
se rapportant à cette loi. Les autorités continuent à utiliser la Loi relative à la prévention du terrorisme afin
de maintenir des centaines de personnes en détention sans procès pour des périodes prolongées. Diverses
tentatives de modifier ce texte se sont avérées vaines ; la dernière série de modifications en date ne permet
pas de combler certaines lacunes importantes de cette loi afin de la mettre en conformité avec le droit
international.
SOUDAN
Le Conseil des droits de l’homme doit utiliser le dialogue interactif avec le Haut-Commissariat sur le Soudan
afin de demander aux autorités militaires soudanaises de mettre immédiatement fin à toutes les formes de
réactions violentes aux manifestations, de lever l’immunité accordée aux membres des forces de sécurité, de
poursuivre les éléments impliqués dans l’homicide de manifestant·e·s et de libérer les personnes détenues
arbitrairement. La situation des droits humains continue à se dégrader depuis le coup d’État militaire il y a
trois mois. Les forces de sécurité se livrent systématiquement à un ensemble de tactiques violentes,
recourant notamment à une force meurtrière et des détentions arbitraires, afin de combattre l’opposition et
les manifestations de rue contre le coup d’État. Jusqu’à présent, plus de 70 personnes, principalement de
jeunes manifestants ne portant pas d’arme, ont été tuées et des centaines d’autres blessées. Les
arrestations et incarcérations de manifestant·e·s et militant·e·s sont fréquentes. Les forces de sécurité ont
également attaqué à de nombreuses reprises des hôpitaux où étaient soignés des manifestants blessés,
agressant et arrêtant le personnel médical. Ils ont aussi effectué des descentes dans les bureaux d’agences
de presse couvrant les manifestations et ont attaqué leurs journalistes. Le Conseil des droits de l’homme et
les États doivent prendre toutes les mesures possibles afin d’amener l’armée à mettre un terme à ces
violations, et de demander des comptes pour ces violations.
7UKRAINE
La possibilité qu’un véritable conflit ait lieu est désormais une réalité dévastatrice, après que le président
Poutine a ordonné le lancement d’« opérations de maintien de la paix » dans les soi-disant « République
populaire de Donetsk » et « République populaire de Louhansk », dans l’est de l’Ukraine. La protection des
civil·e·s en Ukraine doit désormais être la priorité absolue ; tous les efforts doivent être déployés afin de
réduire au maximum les souffrances des civil·e·s et d’accorder la priorité à l’humanité dans cette crise.
Toutes les parties sont légalement tenues d’agir en ce sens. Amnesty International a adressé une mise en
garde contre le fait qu’une nouvelle escalade du conflit armé en Ukraine aura des conséquences
dévastatrices pour les droits humains dans la région : menaces contre la vie des civils, les moyens de
subsistance et les infrastructures, graves pénuries alimentaires et possibles déplacements massifs de
population. Compte tenu du comportement passé des parties au conflit - à savoir leur manque de respect
pour le droit international -, comme nous l’avons observé en Ukraine, ainsi que dans d’autres contextes, par
exemple la Syrie et la Tchétchénie ces dernières années, Amnesty craint fort que l’histoire ne se répète.
Dans ce contexte d’escalade du conflit, Amnesty est également très préoccupée par la situation des
défenseur·e·s des droits humains, des militant·e·s pacifiques, des groupes menacés, ainsi que par le
déplacement de migrant·e·s et de réfugié·e·s. Le Conseil des droits de l’homme doit veiller à ce que les
opérations et activités du Haut-Commissariat en Ukraine soient pleinement soutenues, et doit se tenir prêt à
agir rapidement en s’appuyant sur tous les outils à sa disposition, afin de prévenir de nouvelles violations,
de protéger les civil·e·s, de recenser les violations, et de favoriser et promouvoir l’obligation de rendre des
comptes.
VENEZUELA
Nous encourageons les États à participer activement aux dialogues interactifs avec la mission
d'établissement des faits et la haute-commissaire à propos du Venezuela, et à continuer d’inciter le
Venezuela à prendre des mesures concrètes afin de mettre immédiatement terme à sa politique de
répression, libérer tous les prisonniers et prisonnières d’opinion et donner pleinement accès au pays à la
mission d'établissement des faits. Amnesty a continué de recevoir des informations faisant état d’attaques
contre des organisations humanitaires et de la société civile, d’arrestations arbitraires motivées par des
considérations politiques, d’exécutions extrajudiciaires de masse et de manœuvres de harcèlement visant
certains médias. Dans un récent rapport (février 2022), le Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), le
Foro Penal et Amnesty International ont montré que la stigmatisation et les propos discriminatoires contre
les défenseur·e·s des droits humains s’inscrivent dans une politique gouvernementale répressive, et ont à
plusieurs occasions été liés à des arrestations arbitraires à caractère politique. Le rapport conclut à
l’existence du crime de persécution, qui est un crime contre l’humanité pour lequel les autorités
vénézuéliennes, y compris au plus haut niveau, doivent faire l’objet d’enquêtes, afin que les responsabilités
puissent être établies pour ces actes. > Voir le récent rapport intitulé - Venezuela: Calculated repression –
correlation between stigmatization and politically motivated arbitrary detentions.
CRISES RELATIVES AUX DROITS HUMAINS QUI NE FIGURENT PAS À L’ORDRE
DU JOUR DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
Un certain nombre de situations des droits humains alarmantes et en pleine détérioration ont pour l’instant
échappé à un examen officiel de la part du Conseil, en dépit de très nombreuses informations crédibles
ayant révélé de graves violations des droits humains systématiques et de possibles crimes contre l’humanité.
Nous exhortons les États à prendre les mesures qui s’imposent pour que soient abordées les crises des droits
humains suivantes durant la 49e session.
8CAMEROUN
La crise des droits humains au Cameroun nécessite depuis longtemps une réaction de la part du Conseil des
droits de l’homme, par le biais d’une résolution ou de déclarations conjointes axées sur l’action. Le Conseil
doit spécifiquement, lors de sa prochaine session, effectuer un suivi sur les recommandations émises par le
HCDH après une mission dans le pays en 2019, et sur la déclaration conjointe sur le Cameroun remise par
le Royaume-Uni au nom de 38 pays en mars 2019. Les forces de sécurité et les groupes armés continuent
de commettre de graves atteintes aux droits humains. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a fait
état d’exécutions extrajudiciaires, d’actes de torture, de violences sexuelles et liées au genre ainsi que
d’enlèvements. Des procédures spéciales ont exprimé leur inquiétude quant à la répression de la dissidence
pacifique et des personnes critiquant les autorités et aux actes d’intimidation et agressions croissantes dont
sont victimes les défenseur·e·s des droits humains. Des centaines de milliers de personnes ont été
déplacées par ces violences. Lors de sa 49e session, le Conseil doit prendre des mesures attendues de
longue date pour résoudre la crise, idéalement en adoptant une résolution sur la mise en place d’un
mécanisme de suivi et de compte rendu de la situation, et le suivi de la mise en œuvre des
recommandations du HCDH. Pour cette session, les États membres doivent au grand minimum présenter
une déclaration conjointe axée sur l’action, établissant des critères clairs que le gouvernement du Cameroun
devra respecter pour garantir des progrès mesurables en matière de droits humains sur la base des
recommandations du HCDH.
CHINE
Le Conseil des droits de l’homme doit adopter une démarche plus ferme face à la situation de plus en plus
alarmante des droits humains en Chine, après plusieurs déclarations conjointes faites au Conseil5 et devant
la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies6 ces dernières années. Il est crucial que
le Conseil des droits de l’homme cesse de se perdre en atermoiements et passe à l’action - pour répondre à
la campagne de répression en cours à Hong Kong et lancer une enquête qui n’a que trop tardé sur les graves
violations des droits humains commises contre les Ouïghour·e·s, les Kazakh·e·s et d’autres groupes
ethniques majoritairement musulmans dans le Xinjiang. Avec plus de 300 autres acteurs de la société civile
du monde entier, Amnesty continue à encourager le Conseil des droits de l’homme à convoquer une session
extraordinaire ou un débat urgent afin d’examiner la situation des droits humains en Chine, et de lancer un
mécanisme indépendant international chargé d’enquêter sur toutes les allégations, conformément aux
demandes claires et fortes en ce sens d’un nombre sans précédent de titulaires de mandats relatifs aux
procédures spéciales en 20207.
ÉGYPTE
Le temps est aussi venu pour le Conseil des droits de l’homme d’établir un mécanisme de suivi et de
communication de l’information sur la situation des droits humains en Égypte. La déclaration conjointe
remise il y a près d’un an lors de la 46e session du Conseil a fortement contribué à la libération, en 2021
et 2022, de plusieurs Égyptiens arbitrairement détenus pour avoir exercé leurs droits fondamentaux. Ces
libérations ne sont cependant pas le signe d’une rupture avec la politique répressive systématique du
gouvernement égyptien contre les droits humains et la moindre forme d’opposition. La publication de la
première stratégie nationale en matière de droits humains de l’Égypte et la levée de l’état d'urgence ont été
immédiatement suivies de l’adoption d’une législation répressive, qui a encore davantage fragilisé les
garanties d’équité des procès, étendu la compétence des tribunaux militaires et érigé en infraction le fait de
relayer des informations sur l’armée. Les autorités égyptiennes recourent par ailleurs de plus en plus souvent
à des tribunaux d’exception pour condamner à des peines de prison des militant·e·s et membres de
5
Notamment, en 2020 : https://www.gov.uk/government/speeches/un-human-rights-council-44-cross-regional-statement-on-hong-kong-and-xinjiang;
and 2021 https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/un-onu/statements-declarations/2021-06-22-
statement-declaration.aspx?lang=fra.
6En 2019 (https://usun.usmission.gov/joint-statement-delivered-by-uk-rep-to-un-on-xinjiang-at-the-third-committee-dialogue-of-the-committee-for-
the-elimination-of-racial-discrimination/) ; 2020 https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/201006-heusgen-china/2402648; and 2021
https://www.dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/unga-third-committee-statements/76th-session/joint-statement-human-
rights-situation-xinjiang-21-october-2021.
7Haut-Commissariat aux droits de l'homme, « UN experts call for decisive measures to protect fundamental freedoms in China », 26 juin 2020,
disponible sur https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006&LangID=E.
9l’opposition politique au terme de procès manifestement iniques. Les défenseur·e·s des droits humains
continuent à être visés par des arrestations arbitraires, des enquêtes motivées par des considérations
politiques, des interdictions de voyager et d’autres manœuvres de harcèlement, tandis que les autorités
menacent les organisations non gouvernementales de fermeture pour ne s’être pas fait enregistrer au titre de
la loi répressive sur les ONG. Des fonctionnaires de l’Agence de sécurité nationale continuent à abuser de
leur pouvoir afin de punir et menacer défenseur·e·s des droits humains et militant·e·s politiques, et de les
empêcher de mener une action en faveur des droits fondamentaux ou une action politique, par le biais de
convocations constantes, d’interrogatoires coercitifs et de mesures de probation illégales. L’établissement
d’un mécanisme de suivi et de communication de l’information permettrait l’examen scrupuleux et
systématique que demande la situation.
KAZAKHSTAN
Par le biais de déclarations individuelles et collectives, les États membres du Conseil des droits de l’homme
doivent de toute urgence établir un dialogue avec le Kazakhstan, qui est un nouveau membre du Conseil des
droits de l’homme, afin d’obtenir des éclaircissements sur la situation des droits humains dans le pays après
de récentes opérations de sécurité en réponse à des manifestations, et d’exhorter les autorités à se pencher
sur un certain nombre de questions pressantes en matière de droits humains (voir ci-après). Si les violences
récentes se sont atténuées, des questions pressantes subsistent quant aux nombre de personnes mortes
dans le contexte de ces violences, et sur les circonstances, ainsi que sur l’identité des personnes
maintenues en détention, pour quels motifs et dans quelles conditions. Ce manque de transparence est très
préoccupant, notamment en ce qui concerne : les circonstances dans lesquelles des civil·e·s ont perdu la vie
lorsque des responsables de l’application des lois ont employé la force meurtrière après avoir reçu l’ordre de
« tirer sans sommation » ; et les personnes qui sont détenues au secret, du moins dans un premier temps.
Les informations dont nous disposons ne sont pas encourageantes - certaines font état d’actes de torture et
d’autres formes de mauvais traitements par la police, et d’allégations selon lesquelles une force meurtrière
excessive a été employée face à des manifestant·e·s pacifiques. Amnesty est particulièrement préoccupée
par le contexte dans lequel tout cela survient, qui est caractérisé par un environnement répressif - marqué
par de nombreuses années de restrictions gouvernementales persistantes, l’érosion des garanties juridiques
relatives à la protection des droits humains, et la persécution de celles et ceux qui ont essayé d’exercer leurs
droits. Pour l’heure, il est crucial que le gouvernement du Kazakhstan promeuve et respecte la liberté
d'expression - afin que nous puissions en savoir plus sur les événements survenus ces dernières semaines et
la manière de continuer à avancer. Il est également crucial de tirer parti de ce moment, caractérisé par une
transition politique, afin de travailler avec les autorités kazakhes dans l’objectif de remédier à certains
problèmes systémiques en matière de droits humains, de réviser et réformer les lois indûment restrictives du
pays sur la liberté de réunion pacifique, d’association et d’expression.
RUSSIE
Le Conseil des droits de l’homme doit aussi renforcer son travail sur la Russie, en particulier face à une
situation qui se dégrade rapidement sur place depuis la diffusion de la déclaration conjointe en mars 2021,
dans l’optique de l’adoption d’une résolution établissant un suivi de la situation en Russie et la remontée
d’informations à ce propos. Le mois de janvier 2022 a marqué le premier anniversaire de l’arrestation
d’Alexeï Navalny à l’aéroport de Moscou et du début de sa détention arbitraire. Depuis lors, ce politicien, ses
sympathisant·e·s, des organisations de la société civile russe, des militant·e·s et des médias indépendants
ont subi une répression implacable. Les autorités ont qualifié les organisations d’Alexeï Navalny
d’« extrémistes » et bloqué leurs sites Internet. Un certain nombre de collaborateurs/collaboratrices et
sympathisant·e·s d’Alexeï Navalny sont poursuivis sur la base de charges forgées de toutes pièces,
notamment pour « extrémisme » ; un nombre croissant d’entre eux sont placés en détention et de nombreux
autres ont dû quitter le pays. Parallèlement, les militant·e·s dont les autorités pensent qu’ils entretiennent
des liens avec le mouvement Russie Ouverte, désormais dissous, sont poursuivis en vertu de la loi sur les
« organisations indésirables ». Les autorités ont invoqué cette loi et celle sur les « agents de l'étranger » afin
d’imposer des restrictions discriminatoires et arbitraires sur les organisations de la société civile, les médias
indépendants, les avocat·e·s spécialisés dans la défense des droits humains et les militant·e·s. Par ailleurs,
en décembre 2021, les autorités ont ordonné la fermeture de Memorial International et de son organisation
sœur, le centre Memorial de défense des droits humains, les organisations de la société civile les plus
respectées de Russie, après l’ouverture de poursuites au titre de la loi sur les « agents de l'étranger ». Cette
10Vous pouvez aussi lire