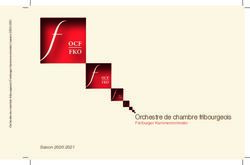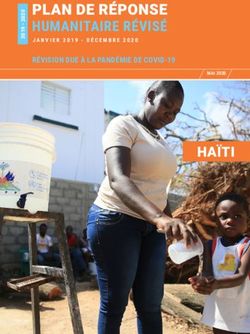Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Untervazer Burgenverein Untervaz
Texte zur Dorfgeschichte
von Untervaz
1858
Das "Verbrasilianern" der Kolonisten in Brasilien
Email: dorfgeschichte@burgenverein-untervaz.ch. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter
http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter
http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini.-2-
1858 Das "Verbrasilianern" der Kolonisten in Brasilien Jeroen Dewulf
«Verbrasilianern» L'émigration suisse au Brésil et la question de
l'intégration", in: Seminar - Canadian Journal of Germanic Studies,
University of Toronto, Volume XLII, Nr. 3, 2006, S. 229-241.
“Verbrasilianern”
L’émigration suisse au Brésil et la question de l’intégration
Lorsqu’on parle d’identité suisse, la figure de Wilhelm Tell est presque incontournable.
Le fameux archer d’Uri apparaît dès qu’il s’agit de légitimer la Suisse comme nation.
En règle générale, il s’agit d’une légitimation restrictive, dans laquelle le pays est
comparé à un gigantesque hôtel Ritz: tout le monde est bienvenu, mais seuls ceux qui
ont les moyens ou ceux qui sont prêts à laver le linge sale des autres résidents peuvent y
rester. À moins qu’on ne soit descendant de ceux qui vivent “depuis toujours” dans cet
hôtel, c’est-à-dire des vrais “fils” de Wilhelm Tell.
Aujourd’hui, presque tout le monde semble avoir oublié qu’au milieu du 19ème
siècle la pauvreté sévissait encore en Suisse, ce qui provoquait une forte émigration vers
les Amériques. Dans les discussions suisses de l’époque, lorsqu’il est question
d’émigration, le nom de Wilhelm Tell apparaît fréquemment. À première vue, il paraît
logique que ce soient les adversaires de la politique d’émigration qui citent Wilhelm
Tell. Ainsi, dans une chanson de 1857, on peut lire:
Und willst du hier nicht länger weilen? / Im grünen Tal am blauen See?
/ Du willst der Heimat Los nicht theilen? / Nicht deines Volkes Wohl
und Weh? / So wandre nach Amerika! / Ich bleib im Land der Alpen da.
[...] Du willst nicht länger Schweizer heiβen? / Schwörst unserm Bund
auf ewig ab? / So wandre... – Die Väter, die in Unglückstagen / nie feig
aus ihrer Heimat flohn, / die Tell und Winkelriede klagen / um dich, um
den verlornen Sohn. / So lebe für Amerika! / [...] Als Schweizer leb und
sterb’ ich da! (Greverus 186)-3-
Cette chanson fourmille de clichés patriotiques: les Alpes et les lacs, le serment du
Grütli et la confédération, le vaillant Winkelried de l’époque de la révolte contre les
Habsbourgs et, tout naturellement, Wilhelm Tell. Le propos est représenter ceux qui
veulent émigrer comme des traîtres à la patrie, comme s’ils voulaient tourner le dos à
celle-ci pour des raisons égoïstes, en méprisant les sacrifices des ancêtres.
Cependant, une lecture précise de l’histoire classique de Wilhelm Tell, telle
qu’elle est racontée dans la pièce de théâtre de Friedrich Schiller, datant de 1804, rend
cette interprétation unilatérale problématique. En effet, bien que Wilhelm Tell se soit
aujourd’hui transformé en un symbole d’une Suisse plutôt réactionnaire, une Suisse qui
cultive précisément le mythe voulant que le pays appartienne d’abord à ceux qui y
vivent “depuis toujours,” c’est dans cette version la plus classique de la révolte des
confédérés helvétiques qu’on trouve la thèse, surprenante, voulant que les Suisses
forment un peuple de migrants.
Dans la fameuse scène sur la prairie du Grütli, au bord du Lac des Quatre-
Cantons, peu de temps avant le serment des représentants d’Uri, de Schwyz et
d’Unterwald – lequel provoquera la révolte armée contre les Habsbourgs –, Werner
Stauffacher, l’un des confédérés, raconte l’origine du peuple suisse de la manière
suivante: “Es war ein groβes Volk, hinten im Lande / Nach Mitternacht, das litt von
schwerer Teurung. / In dieser Not beschloss die Landsgemeinde, / Dass je der zehnte
Bürger nach dem Los / Der Vater land verlasse – das geschah” (Wilhelm Tell, II, 2) .
Autrement dit, Schiller représente clairement les Suisses comme des descendants
d’étrangers qui, forcés par la misère, avaient dû quitter leur pays. Mais l’histoire ne
s’arrête pas là: quand ces émigrants arrivent en Suisse, ils constatent que cette terre est
déjà peuplée. Schiller parle d’une hutte au bord du lac où se trouve un homme qui veille
sur le bac permettant de le traverser.-4-
On n’en apprend pas plus sur cet homme mystérieux – ce qui est étrange
puisqu’il est finalement le seul “vrai Suisse” dans la pièce. Quand Stauffacher poursuit,
en racontant comment ces immigrés ont commencé à bâtir – on pourrait même dire à
“coloniser” – le canton de Schwyz, il ne précise aucunement ce qui est advenu de cet
homme et de sa cabane. A-t-il participé à la construction de Schwyz? S’est-il mêlé aux
immigrants? Peut-être fut-il expulsé, voire assassiné par eux – on ne le sait pas.
L’idée selon laquelle les Suisses sont des descendants de migrants n’est pas de
Schiller, elle fait partie intégrante de l’histoire de Wilhelm Tell. Déjà dans Le Livre
Blanc de Sarnen, qui date de 1474, cette origine étrangère est mentionnée. Et si le mythe
de Wilhelm Tell, tel qu’il était présenté par Schiller en 1804, a marqué des générations
de Suisses, il n’a pas manqué de marquer également ces Suisses qui, au milieu du 19ème
siècle, quittaient leur pays pour émigrer vers les Amériques. Les ressemblances entre
leur destin et celui des émigrés chez Schiller sont frappantes, en particulier parce que
Schiller les présente comme de vrais colons, qui “manchen sauren Tag [hatten], den
Wald / Mit weitverschlungnen Wurzeln auszuroden” (Wilhelm Tell, II, 2). La phrase la
plus importante chez Schiller reste néanmoins: “Doch blieben sie des Ursprungs stets
gedenk” (Wilhelm Tell, II, 2). Schiller transmet ainsi l’idée surprenante que la
population suisse, bien qu’elle soit d’origine étrangère, possède une pureté culturelle qui
est restée intacte depuis toujours. La conclusion que les émigrants suisses, prêts à partir
vers les Amériques, pouvaient tirer de la pièce est qu’il était parfaitement possible
d’émigrer tout en restant bon patriote, dès lors qu’on restait fidèle à ses origines, car au
fond, dans leurs pérégrinations, ils ne faisaient rien d’autre que ce que leurs ancêtres
avaient eux-mêmes fait. D’une certaine façon, leur émigration pouvait être considérée
comme une prolongation de l’histoire du Grütli.-5-
Il faut, cependant, remarquer que Schiller, en défendant l’idée que l’émigration
n’implique pas nécessairement la perte de l’identité, abordait un sujet passablement
problématique dans le contexte allemand du 19ème siècle.
À l’époque, les opinions sur l’émigration étaient encore fortement influencées
par la théorie climatique de Herder, exprimée dans ses Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit (1784-91), selon laquelle l’émigration vers une zone
climatique différente conduirait nécessairement à une dégénérescence: “Europäischer
Fleiss in gesitteten amerikanischen Kolonien hinderte nicht, dass die Fruchtbarkeit der
Auswanderer früher erlosch, ihre in der Fremde gezeugten Kinder weniger
widerstandsfähig wurden und die eigene Lebensdauer sank” (Herder 25). Pour illustrer
les conséquences de l’émigration, Herder utilise la métaphore d’un arbre déraciné: celui
qui émigre perd inévitablement le lien avec son milieu naturel, ce qui conduit à un
déracinement et, pour finir, à la dégénérescence totale.
Pourtant, pour la plupart des philosophes romantiques allemands, cette position
de Herder demeurait trop radicale. On tenta alors de réinterpréter sa théorie en faisant
valoir que la dégénérescence n’était pas le résultat inévitable de l’émigration et qu’elle
ne s’exprimait que lorsque l’émigrant reniait son identité culturelle, ce qui menait à la
perte de sa pureté originelle. C’est pour cela qu’en 1846, Jacob Grimm, en pensant aux
émigrants allemands en Amérique, plaidait en faveur de mesures afin de “[...] auch
unter ihnen an der neuen Stätte, die sie sich erwählen, die althergebrachte Sprache und
dadurch warmen Zusammenhang mit dem Mutterlande zu bewahren” (cfr. Greverus
165).
C’est dans ce contexte qu’on doit interpréter l’histoire de l’origine de la Suisse,
racontée par Schiller dans sa pièce Wilhelm Tell. Schiller combine ici le mythe de
l’origine des Suisses comme un peuple de migrants avec l’obsession, typique du 19ème
siècle, liée à la conservation d’une identité pure,-6-
et il souligne, s’inscrivant en faux contre les théories de Herder, qu’émigration
ne signifie pas nécessairement perte d’identité. Tout comme Jacob Grimm le fera
quarante ans plus tard, Schiller voit la solution dans la détermination à conserver des
traditions culturelles fortes.
Nous rencontrons la même idée dans un roman classique de la littérature suisse,
Martin Salander (1886) de Gottfried Keller, où l’émigration vers le continent américain
est un thème important. Gottfried Keller commence son roman en racontant comme
Martin Salander rentre en Suisse après avoir vécu sept ans au Brésil. Étonnamment, ces
sept ans n’ont eu aucune influence sur Salander: il se rappelle encore le chemin comme
s’il n’avait jamais quitté son village, il parle Schwyzertütsch comme si, au Brésil, il
n’avait parlé aucune autre langue et ainsi, sa réintégration en Suisse se fait apparemment
en quelques secondes. Même après avoir vécu sept ans au Brésil, Salander n’a rien de
brésilien, il est resté 100 % suisse. La phrase centrale de cette ouverture, racontant le
retour de Salander, est l’observation, faite par sa femme, que “nichts Fremdes haftete
ihm an” (G. Keller, Martin Salander 35).
L’émigrant que Gottfried Keller nous présente ici correspond entièrement à la
vision défendue par Jacob Grimm et par Schiller dans leur saga sur l’origine suisse.
Bien qu’ayant vécu sept ans au Brésil, Salander est resté aussi suisse qu’avant son
départ ou, pour utiliser l’expression de Schiller, pendant les sept ans passés à l’étranger,
Salander n’oublia pas son origine.
Ce n’est pas un hasard si Gottfried Keller présente le retour de Salander de cette
façon. Bien qu’il soit assez douteux qu’un émigré puisse vivre sept ans au Brésil sans
souffrir le plus petit changement, il ne s’agit ici aucunement d’une déficience
conceptuelle du romancier suisse. Car si Salander, comme représentant de la civilisation
européenne “supérieure,” avait été influencé par la culture brésilienne,-7-
cela correspondrait, dans la vision germanique du 19ème siècle, à une
dégénérescence. La plus petite trace d’accent, la plus petite différence dans ses
habitudes aurait suffi à invalider Salander comme figure centrale d’un roman politique
et social.
Pourquoi Gottfried Keller a-t-il choisi le Brésil comme destination pour
Salander? Il y a, tout d’abord, une relation personnelle avec le pays.
Gottfried Keller lui-même n’a jamais quitté l’Europe, mais son ami Christian
Heusser avait visité le Brésil en 1856. Gottfried Keller lui avait même consacré un
poème, intitulé “Abschiedslied an einen auswandernden Freund,” qui se termine par une
phrase qui nous ne surprend guère: “Bleib treu dem Vaterlande, / So bleibst dir selber
treu!” (G. Keller, “Abschiedslied” 320f.). Cependant, le choix de Gottfried Keller
s’explique aussi par d’autres raisons. Pendant longtemps, c’est-à-dire jusqu’à ce que le
dictateur Getúlio Vargas, en 1937, ne force les communautés italienne, japonaise et
allemande à l’intégration dans la société brésilienne, le Brésil étant considéré, surtout
dans les pays de langue allemande, comme la destination idéale pour les émigrants
opposés à l’intégration dans le pays d’accueil. En effet, alors que le grand flux
d’émigration allemande vers le Brésil datait du milieu du 19ème siècle, en 1940 encore,
70 % des descendants d’émigrants allemands utilisaient l’allemand comme langue
principale (cfr. Kestler 26). On constate ainsi une grande différence avec la situation en
Amérique du Nord et cette différence existait dès le début de l’émigration allemande
vers le Brésil: “Die deutschen Kolonien in Brasilien bewahren ihre Nationalität viel
leichter, als diejenigen in Nordamerika” (Steger 13), écrivait Adolf Steger, un agent
d’émigration, en 1857. Et en 1849, l’Association Hambourgeoise de Colonisation avait
vanté les mérites du Brésil avec le slogan: “Brasilien, ein Land, wo der Deutsche
Deutscher bleibt” (cfr. Cunha 40).-8-
Ainsi, en choisissant le Brésil comme destination pour Salander, Gottfried Keller
opte pour un pays qui était, à l’époque, connu pour permettre aux émigrants de langue
allemande le maintien d’une identité germanique, c'est-à-dire qu’il choisit un pays où,
du moins en théorie, “sie des Ursprungs stets gedenk [blieben]” (Wilhelm Tell, II, 2) et
ou il semble être possible de vivre selon le conseil “Bleib treu dem Vaterlande, / So
bleibst dir selber treu!” (G. Keller, “Abschiedslied” 320f.).
Vue de cette manière, la réaction de la femme de Salander, qui, en revoyant son
mari après ses sept ans au Brésil, constate que rien d’étranger ne s’attache à lui, nous
paraît moins étrange, car on comprend que le Brésil était le pays idéal pour ce concept
de l’émigration que défend Gottfried Keller.
Examinons maintenant comment le maintien de l’identité s’exprime dans la
réalité chez des immigrants suisses. Cette émigration a une importance historique, car
les premiers émigrants non-portugais au Brésil étaient des Suisses. Déjà avant
l’indépendance du Brésil (1822), on y avait fondé une «colonie» suisse – Nova Friburgo
(1819) – mais c’est surtout vers le milieu du 19ème siècle que l’on constate une
émigration de plusieurs milliers de Suisses vers le Brésil. Il s’agit essentiellement de
pauvres, originaires de régions rurales, qui n’avaient pas les moyens de payer leur
voyage et traversaient l’océan dans le cadre du système de parceria. Dans ce système,
un grand seigneur brésilien payait pour le voyage, et en échange, les émigrants
travaillaient dans sa plantation jusqu’à ce que leurs dettes soient payées. Après quelques
années, ils seraient libres et pourraient réaliser leur rêve, devenir “colon,” c’est-à-dire
agriculteur disposant d’une propriété foncière. C’était du moins ce qu’on leur laissait
espérer. La réalité était toute autre: les émigrants étaient en fait vendus à de grands
propriétaires pour remplacer les esclaves dans les plantations.-9-
Dans beaucoup de cas, les communes suisses elles-mêmes participaient à ce
commerce, en se “débarrassant” ainsi de leurs habitants les plus pauvres (cfr. Tschudi
III: 242; Davatz 115; Ziegler, Schweizer statt Sklaven 139ff.). Vers la fin du 19ème
siècle, il y aura encore quelques projets de petite dimension concernant des “colonies”
suisses dans le Sud du Brésil.
Ce qui nous intéresse est l’attitude de ces émigrants suisses face à l’intégration.
Y a-t-il eu un rapprochement naturel avec la société brésilienne? A-t-on cherché la
cohabitation avec d’autres groupes d’émigrants européens? Ou y a-t-il plutôt eu un
grand effort de conservation de l’identité suisse?
Le problème qui se pose ici est qu’il est assez difficile de préciser en quoi
consiste l’identité suisse. Les Suisses ne partagent pas la même langue, ni la même
religion. Dans un certain sens, on pourrait dire que c’est l’histoire qui unit les Suisses,
mais on ne doit pas oublier que ce n’est qu’en 1803 que les anciens alliés des Grisons et
de Saint-Gall et les anciens pays sujets du Tessin, de Vaud, de la Thurgovie et de
l’Argovie s’ajoutèrent aux cantons fondateurs de la Confédération, tandis que Genève,
Neuchâtel et le Valais n’y firent leur entrée qu’en 1815. La fierté suisse (plutôt
alémanique que romande) liée au passé du pays est en rapport étroit avec l’idée de la
conquête de la liberté. Bien qu’il soit vrai que les confédérés de 1291 entendaient, par
liberté, surtout une liberté face aux Habsbourgs, il existait sans doute, chez les émigrés
suisses (alémaniques) au Brésil, la conviction que leurs ancêtres avaient lutté pour la
liberté de toute la population et que chaque Suisse avait le devoir de la défendre.
Dans ce contexte, la réalité brésilienne était, en quelque sorte, un défi à l’identité
suisse. Pour les émigrés francophones, il y avait la proximité de la langue portugaise.
Dès lors, la communication avec les Brésiliens était plus facile qu’avec leurs
compatriotes alémaniques, ce qui pouvait laisser augurer d’une intégration plus facile.- 10 -
À cela s’ajoutait la question religieuse: les seuls mariages reconnus au Brésil –
en tant que pays catholique – étaient les mariages catholiques; les enfants qui n’étaient
pas baptisés officiellement “n’existaient pas” et les cimetières étaient réservés aux
catholiques. Par conséquent l’intégration était particulièrement difficile pour les Suisses
alémaniques protestants. On pourrait alors penser que, pour ce groupe en particulier,
l’attraction pour la grande communauté allemande au Brésil n’a pu qu’être très forte.
Quelques indications vont effectivement dans ce sens. L’historiographe brésilien
Dilney Cunha, qui a étudié la présence suisse dans la “colonie” de Dona Francisca,
l’actuel Joinville, fondée en 1851, considère que le facteur essentiel de résistance ou
d’ouverture face à l’intégration dans la société brésilienne était la religion.
Tandis que les Suisses catholiques choisissaient leurs futur(e)s conjoint(e)s
parmi les familles brésiliennes d’origine portugaise, les protestants se rapprochaient de
leurs coreligionnaires allemands. Mais ce rapprochement lui-même ne se fit que très
lentement, puisque pendant les premières décennies, les Suisses protestants se mariaient
en majorité entre eux; ce n’est que vers la fin du siècle, quand le nombre de Brésiliens
non germanophones menaçait, dans la “colonie,” de dépasser celui des germanophones,
que la communauté suisse protestante se fondit complètement dans la communauté
allemande (Cunha 153 et 217ff.).
Les études de Cunha montrent bien que le rapprochement des Suisses
alémaniques protestants (qui formaient la grande majorité des émigrants suisses au
Brésil) avec la communauté allemande ne s’opérait pas de gaîté de cœur. Et il serait
réducteur de penser qu’une même langue et une même religion étaient des raisons
suffisantes pour que les Suisses alémaniques se tournent dès le début, dans une sorte de
réflexe pangermanique, vers les émigrés allemands au Brésil. Les documents de
l’époque indiquent plutôt que ces émigrants se caractérisent par une tendance très
affirmée à l’isolement et par une conviction forte qu’être un bon patriote signifie
marcher sur les traces de Wilhelm Tell.- 11 -
L’un des textes les plus marquants en ce qui concerne l’émigration suisse au
Brésil est Die Kolonisten in der Provinz St. Paulo in Brasilien de Thomas Davatz.
Davatz, professeur, émigra vers le Brésil en 1855, avec quelques dizaines de pauvres
venus de différents villages grisons, pour y travailler dans la plantation de café
d’Ibicaba, dans l’État de São Paulo. Son but n’était pas de travailler comme journalier
au Brésil; Davatz voulait devenir un vrai colon, avec son propre lopin, mais comme il
n’avait pas les moyens de payer le voyage, il se soumit au système de parceria. Le cas
de Davatz est célèbre parce qu’au Brésil, il est devenu le leader charismatique d’une
révolte d’émigrants suisses contre leur maître, qui les traitait comme des esclaves.
Le texte de Davatz présente cependant bien davantage que la description
mouvementée d’une rébellion; il constitue également un document important en ce qui a
trait à l’identité suisse car nous verrons qu’il montre clairement à quel point le mythe de
Wilhelm Tell a influencé le comportement des émigrants au Brésil.
Il ne fait aucun doute que Davatz se sentait foncièrement suisse; “nous les
Suisses” est une phrase qui revient fréquemment dans le document. Il ne limite donc pas
son identité au canton dont il est originaire, pas plus qu’il ne se considère comme faisant
partie d’une sorte de “grande nation germanique.” Davatz se considère comme un vrai
descendant de Wilhelm Tell, comme un homme libre et qui a donc pour mission de
préserver cette liberté coûte que coûte.
Les ressemblances avec la révolte légendaire contre les Habsbourgs, dans son
récit, commencent dès le sous-titre; Davatz parle de “eine Erhebung gegen die
Bedrücker,” ce qui, du reste, est étonnant dans la mesure où le mot “oppresseur” est
utilisé en général pour désigner des étrangers qui viennent opprimer les autochtones, et
non le contraire. Mais Davatz ne se considère pas du tout comme un étranger qui doit
s’adapter aux coutumes d’un autre peuple. Pour lui, il n’existe pas vraiment de peuple
brésilien, il existe des Indiens, des Africains, des mulâtres, des descendants de Portugais
et des colons européens, mais pas de Brésiliens.- 12 -
Le Brésil est ainsi vu comme un pays qui n’appartient à personne, un pays où
chacun a le droit de créer ou de recréer une patrie. C’est pour cela que Davatz, même à
quinze mille kilomètres de sa patrie, lutte pour défendre ses droits comme s’il était en
Suisse, une lutte complètement en accord avec le Wilhelm Tell de Schiller.
Dans les faits, la révolte dans la plantation d’Ibicaba commence avec la
rencontre nocturne et secrète d’une poignée de patriotes suisses, et elle semble se
dérouler de la même manière que sur la prairie du Grütli en 1291, lorsque trois hommes
établirent une confédération de résistance en prononçant leur serment.
Et Davatz rapporte la scène en des termes qui sont la répétition pratiquement
littérale du serment de la pièce de Schiller: “Unter die uns auf diese Weise auferlegten
Verpflichtungen nahmen wir auch diejenigen der völligsten Verschwiegenheit und des
treusten Zusammenhaltens nach dem Grundsatze: ‘Einer für Alle, und Alle für Einen!’
auf” (Davatz 139).
Cette réaction suisse est opposée à l’indifférence apparente des Allemands qui
travaillaient dans la même plantation. Le rôle de la communauté allemande dans la
révolte semble insignifiant. Davatz mentionne que des Thuringiens s’associèrent plus
tard à la confédération ainsi formée, bien que cela aille contre la volonté de la plupart
des Suisses. Johann Jakob von Tschudi, un représentant diplomatique de la Suisse qui
visita Ibicaba après la révolte, écrivait même que “[d]ie deutschen Colonisten
betheiligten sich nicht an dem Aufstande. Sie begnügten sich damit, die Faust in der
Tasche zu machen” (Tschudi III: 249).
La réaction des Suisses à Ibicaba, telle que Davatz l’a retranscrite, montre que le
système politique suisse, quoique très peu démocratique pendant plusieurs siècles, a
sans aucun doute influencé la population. Même de pauvres émigrés suisses
(alémaniques) avaient déjà, au milieu du 19ème siècle, la ferme conviction qu’être
citoyen suisse impliquait le droit à la liberté, une conviction qui, dans les États
allemands semi-féodaux, n’existait pas.- 13 -
Le cas Davatz illustre aussi le fait que les émigrés suisses ne considéraient pas
leur émigration comme une rupture avec leur patrie. De leur point de vue, la vraie
trahison ne résidait pas dans l’émigration elle-même, mais bien dans l’intégration au
sein d’un nouveau pays. C’est ainsi que si l’on émigrait, on n’en tentait pas moins, en
même temps, d’emporter avec soi la Suisse, ou du moins son canton suisse. Cette
volonté de maintenir une identité suisse devient de plus en plus forte au cours du 19ème
siècle. Si, au début du siècle, on s’identifie plutôt avec la région, avec le canton
d’origine, vers la fin on constate un patriotisme clairement national.
Dans ce contexte, les noms choisis par les Suisses pour leurs “colonies”
brésiliennes sont représentatifs: la première, fondée en 1819, porte le nom du canton –
“Nova Friburgo” – tandis que pour les “colonies” fondées vers la fin du siècle, on
choisit plutôt un nom national, comme “Alpina,” “Nova Suíça,” “Heimat,” “Helvetia” –
on avait même prévu que l’une d’elles s’appellerait “Rütli.”
Le récit de Johannes Keller, datant de 1897, illustre bien cette nouvelle
préoccupation, confortée par des éléments nationalistes. Le jeune professeur Johannes
Keller cherchait à diffuser l’idée d’une nouvelle “colonie” suisse qui serait fondée en
Funil, dans l’État de São Paulo, et il mentionna qu’au cours des négociations avec les
autorités locales, les onze familles ouvrières zurichoises et argoviennes concernées
avaient obtenu quelques concessions particulières grâce à leur identité nationale. La
principale était que les Suisses pourraient constituer un Schützenverein – une
association de tir. Pour comprendre l’importance de cette revendication, il faut savoir
qu’en Suisse, les associations de tir représentent un symbole de la liberté suisse et sont
le reflet de la forte vague nationaliste qui s’est propagée dans le pays vers la fin du 19ème
siècle. Chaque membre d’une association de tir se considérait comme un arrière-petit-
enfant de Wilhelm Tell et entendait, par son affiliation, souligner sa fierté patriotique
ainsi que sa disposition à se battre pour préserver la liberté conquise par ses ancêtres.- 14 -
L’importance donnée par les Suisses au Brésil à la fondation de ces associations
montre à quel point ils souhaitaient préserver leur propre identité et elle témoigne de
l’acuité du mythe de Tell et de son lien avec cette identité.
Lors de sa visite à la “colonie” suisse Helvetia, fondée en 1880 par des
agriculteurs d’Obwald, Rudolf Streiff-Becker, un ingénieur zurichois qui avait émigré
très jeune vers le Brésil et y avait ensuite fondé sa propre usine, observe même que
l’association de tir portait le slogan: “Die Taten der Väter sollen Euer Vorbild sein”
(Streiff-Becker 13), ce qui correspond dans une très large mesure à la phrase “Doch
blieben sie des Ursprungs stets gedenk” (Wilhelm Tell, II, 2.).
Il n’est pas étonnant qu’avec cette conception de la vie, les émigrés n’aient été
guère ouverts à une intégration à la société brésilienne. Et l’historienne suisse Béatrice
Ziegler a effectivement pu démontrer que jusque peu de temps avant la Seconde Guerre
mondiale il existait à Helvetia une endogamie presque intacte (cfr. Ziegler,
“Schweizerinnen” 135).
Dans les années 1930, la “colonie” Helvetia devient fameuse, car elle est
présentée en Suisse comme un véritable modèle pour “la cinquième Suisse” – la
communauté suisse à l’étranger, qui vient s’ajouter à la Suisse allemande, française,
italienne et romanche. Ainsi Gottfried Keller, un conseiller cantonal d’Argovie,
considère en 1936 les habitants d’Helvetia comme des pionniers exemplaires de
l’émigration: “[D]iese wackern Obwaldner und vorbildlichen Auswanderungspioniere
[verdienen] unsere hohe Anerkennung für die bisherige treue Aufrechterhaltung ihres
Schweizertums, ohne dass sie je eine Unterstützung aus der Heimat verlangt oder
bezogen hätten” (G. Keller, Auswanderungs-Problem 27).
Le prêtre Emil Immoos, qui visita Helvetia en 1936, considérait même les
émigrés comme étant plus suisses que les Suisses, puisqu’ils parlaient encore un
dialecte d’une pureté déjà disparue en Suisse:- 15 -
“Bewahrt haben sie ihren Obwaldnerdialekt, der sich hier auf Kind und
Kindeskinder, die nie die Schweiz gesehen haben, mit solcher Reinheit und
Tonhaftigkeit übertragen hat, wie wir ihn im Obwaldnerland selbst vielleicht kaum
mehr finden” (Immoos 37). Ces commentaires ne sont pas accidentels. Ils font partie
d’un réveil nationaliste dans le cadre de la “geistige Landesverteidigung,” la “défense
spirituelle du pays,” une stratégie politique ultranationaliste qui prétendait sauvegarder
la Suisse de l’infiltration des idées fascistes et/ou nazies en provenance des pays voisins.
Pourtant, cette obsession de la préservation de l’identité, qui devient de plus en
plus marquée dans l’entre-deux-guerres, entraîne une radicalisation à plusieurs égards.
Non seulement en Suisse même, où des milliers de réfugiés juifs étaient refoulés
à la frontière sous prétexte qu’ils menaçaient la préservation de l’identité suisse, mais
aussi chez les émigrés suisses au Brésil, où le discours nationaliste prenait un caractère
de plus en plus raciste.
En même temps, au Brésil, les émigrés suisses alémaniques sont exposés à la
propagande ultranationaliste allemande, véhiculée par un réseau de sections de
l’association Alldeutscher Verband. Celles-ci s’adressent même explicitement aux
émigrés suisses et autrichiens et affichent l’espoir que dans le Sud du Brésil, les Suisses
et les Autrichiens s’associeront au pangermanisme (cfr. Cunha 218).
L’historiographe brésilien Dilney Cunha a pu démontrer que les écoles
allemandes et surtout les églises protestantes encourageaient cette ambition (cfr. Cunha
213). Ainsi, vers la fin du 19ème siècle, on constate chez les émigrés suisses alémaniques
des régions rurales une diminution de l’usage du Schwyzertütsch au profit du
Hochdeutsch, en même temps que l’apparition de slogans traduisant la sympathie à
l’égard de l’idée pangermaniste, tels que “Schweiz mit Deutschland Hand in Hand!” ou
“Auf ewig ungetheilt! Ein Schweizer für die deutsche Einigkeit” (cfr. Cunha 218).- 16 -
Cependant, dans les villes brésiliennes, où les Suisses appartiennent généralement à
la classe la plus aisée, où ils sont mieux organisés et où les contacts avec la patrie sont
plus nombreux, on se distancie plutôt de la propagande allemande et insiste, comme en
Suisse, sur la préservation de l’identité suisse. Ces réserves face aux appétits allemands
sont manifestes dans les mémoires de Streiff-Becker lorsqu’il décrit en ces termes sa
visite à la Société Allemande de São Paulo:
Ich stand hinter einigen mir persönlich befreundeten Süddeutschen, als
das ‘Deutschlandlied’ gesungen wurde. Ich sang nur halblaut mit,
jedoch mit einer kleinen Änderung des Textes: anstatt ‘Deutschland’
sang ich ‘Schweiz, o Schweiz, über alles, über alles in der Welt.’ Der
vor mir Stehende wandte sich entrüstet um: ‘Aber, aber, Herr Streiff,
was soll das heissen!’ Ich erwiderte ihm: ‘Wenn Sie aus reiner
Heimatliebe singen: ‘Deutschland über alles in der Welt,’ dann werden
Sie es mir als Schweizer hoffentlich nicht verübeln, wenn mir die
Schweiz über alles geht. Wenn aber der Satz politisch gemeint ist:
Deutschland (herrsche) über alles, dann kann ich erst recht nicht
mitsingen’” (Streiff-Becker 132).
Indépendamment de l’attitude face à la propagande allemande, on constate en tout cas
une tendance, dans les discours d’émigrés suisses au tournant du siècle, à emprunter des
idées et des expressions racistes. Ainsi, dans son livre rassemblant quelques conseils
concernant l’émigration vers le Brésil, datant de 1921, le prêtre suisse Hans Frehner ne
parlait pas d’intégration, mais préférait l’expression méprisante “verbrasilianern”:
Die Regierung erreicht auf diese Art am besten ihr Ziel, denn sie will,
dass die Ansiedler ihre Nationalität vergessen, sie sollen, wie die alten
Kolonisten sagen, ‘verbrasilianern,’ wie das mit der Schweizerkolonie
in Novo Friburgo [sic] geschah,- 17 -
wo vom Schweizertum nur noch die Namen existieren und vom
‘Schwitzerdütsch’ nur noch die Worte ‘Chaib und Chog’ gehört werden,
die auch von den dortigen Negern im Mund geführt werden. Saubere
Schweizer das! Mir sagten schon Auswanderer, dass sie drüben weder
Deutsche noch Schweizer sein wollen, sondern sich mit den Völkern des
Urwalds verbrüdern – verbrüdern mit Mulatten und Negern. – Welch
ein Blödsinn!» (Frehner 22).
Frehner utilise ici le verbe “verbrasilianern” (“s’embrésilianiser,” devenir Brésilien)
comme synonyme de “vernegern” (devenir nègre), “verkanackern” (devenir Canaque)
ou “verkaffern” (devenir Cafre), mots qui apparaissent vers la fin du 19ème siècle, quand
l’Allemagne devient une puissance coloniale, et qui expriment la répulsion à l’égard du
mélange du sang.
Dans l’opinion de Frehner, le croisement entre un Européen et une Brésilienne
susciterait une race dégénérée, et de continuer: “Moralisch abgestumpft, verlottern diese
Sprösslinge solcher Mischehen schon in der zweiten Generation und verkommen in den
Urwäldern Brasiliens, wo genug solcher undefinierbarer Gestalten ihr Dasein fristen”
(Frehner 22).
La devise romantique de Schiller et de Jakob Grimm, consistant à rester fidèle à
ses origines, répétée avec détermination, en 1886, par Gottfried Keller dans Martin
Salander, est devenue ici plus qu’une simple recommandation; elle s’est transformée en
une véritable profession de foi. Ainsi, dans les derniers documents concernant les
émigrés suisses au Brésil, on constate une radicalisation, qui transforme la simple fierté
liée aux exploits des ancêtres en une haine et une aversion face à l’intégration à la
société brésilienne.- 18 -
À l’approche de la Seconde Guerre mondiale, le choix, par le Brésil, du camp
des alliés, le fait que les trois plus grandes communautés d’émigrés du pays (les Italiens,
les Japonais et les Allemands) faisaient partie des puissances de l’Axe et, surtout, la
propagande nazie chez les émigrés allemands du Sud du Brésil, requéraient, dans la
perspective du gouvernement brésilien, des mesures d’intégration forcée, radicales.
Après la défaite du fascisme et du nazisme, l’intégration de ces communautés, y
compris les Suisses alémaniques qui s’étaient alliés à la communauté allemande, fut
opérée en un temps record. L’intégration fut si systématique que presque toutes les
traditions, y compris la langue, furent abandonnées au profit d’une intégration à la
société brésilienne. Même si on vit refleurir quelques traditions par la suite, comme le
fameux Oktoberfest à Blumenau, les descendants d’émigrés au Brésil ne se caractérisent
pas, contrairement à ce qu’on constate souvent en Amérique du Nord, par une “identité
à trait d’union” (hyphenate-identity).
Au Brésil, on évite les expressions comme ‘italo-brésilien,’ ‘nippo-brésilien’ ou
‘germano-brésilien,’ qui ont même une légère connotation négative, comme si elles
exprimaient un manque de patriotisme (cfr. Magalhães 96).
En 1985, le grand public, en Suisse, put se remémorer les péripéties de ces
émigrés au Brésil grâce au roman Ibicaba – Das Paradies in den Köpfen, de Eveline
Hasler, une spécialiste du ‘roman biographique.’ L’histoire se fonde certes sur des
documents authentiques, mais quand on lit que le rêve des femmes suisses, en route vers
le Brésil, était de se marier avec des Brésiliens et qu’elles aspiraient à avoir des enfants
brésiliens qui pourraient s’appeler ‘Luis Eduardo’ et avoir des ‘cheveux tout noir,’ on
doit y voir la trace de l’imagination prolifique d’une écrivaine contemporaine plutôt que
le rappel d’un objectif qui aurait été répandu parmi les émigrées au 19ème siècle (Hasler
69). D’une façon générale, de telles idées n’auraient pas été considérées comme un beau
rêve, mais comme un cauchemar, puisqu’elles remettaient directement en question le
conseil donné par Wilhelm Tell – rester fidèle à ses origines, coûte qui coûte.- 19 -
Bibliographie
Allemann, Fritz A. “Eine Schweizerkolonie in Brasilien. Ein Rückblick – und eine Aufgabe.”
Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft Vol. number (1935): 534-45.
Arlettaz, Gérald. “Émigration et colonisation suisses en Amérique 1815-1918. Le Brésil.”
Studien und Quellen 5 (1979): 149-78.
Cunha, Dilney. Das Paradies in den Sümpfen. Eine Schweizer Auswanderungsgeschichte nach
Brasilien im 19. Jahrhundert. Zürich: Limmat Verlag, 2004.
Däniker-Haller, Cécile. Tagebuch von Cécile Däniker-Haller. Vol. I-II. 1934. Ed. Eduard
Rübel-Bass. Zürich: Schulthess, 1963.
Davatz, Thomas. Die Kolonisten in der Provinz St. Paulo in Brasilien. Chur: Verlag Leonh.
Hitz, 1858.
Dewulf, Jeroen. “Felix Moeschlins brasilianische Träume.” Partir de Suisse, Revenir en
Suisse/Von der Schweiz weg, in die Schweiz zurück. Ed. Gonçalo Vilas-Boas. Strasbourg:
Presses Universitaires de Strasbourg, 2003. 97-109.
Dietrich, Eva, ed. Der Traum vom Glück. Schweizer Auswanderung auf brasilianische
Kaffeeplantagen 1852-1888. Baden: hier + jetzt, 2002.
Ermatinger, Emil. Gottfried Kellers Leben, Briefe und Tagebücher. Vol. I-III. Stuttgart: J.G.
Cotta, 1924.
Frehner, Hans. Ein Wort an Auswanderungslustige. Von einem ehemaligen schweizerischen
Urwaldpfarrer in Brasilien. Uzwil: J. Fischer, 1921.
Grange, Didier. “Des Suisses et des esclaves. La colonie de Leopoldina (Bahia/Brésil).”
Equinoxe. Revue Romande de Sciences Humaines 3 (1990): 23-37.
Greverus, Ina-Maria. Der territoriale Mensch: ein literaturanthropologischer Versuch zum
Heimatphänomen. Frankfurt/M.: Athenäum, 1972.
Hasler, Eveline. Ibicaba. Das Paradies in den Köpfen. 1985. München: dtv, 1995.
Herder, Johann Gottfried von. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Herders
Werke. 1791. Ed. Theodor Matthias. Vol. IV. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1936.
Heusser, Christian. Die Schweizer auf den Kolonien in St. Paulo in Brasilien. Zürich: Friedrich
Schulthetz, 1857.
Ilg, Karl. Das Deutschtum in Brasilien. Wien: Eckartschriften, 1978.
Immoos, Emil. Süd-Amerika? Aus dem Tagebuch eines Mitgliedes der eidgenössischen
Studienkommission für Auswanderung und Siedlung in Süd-Amerika. Zürich: H. Börsig’s
Erben, 1936.
Katz, Friedrich. “Einige Grundzüge der Politik des deutschen Imperialismus in Lateinamerika
1898 bis 1941.” Der deutsche Faschismus in Lateinamerika 1933-1943. Ed. Heinz Sanke.
Berlin: Verlag der Humboldt-Universität, 1966. 9-60.
Keller, Gottfried. “Abschiedslied an einen auswandernden Freund.” 1856. Sämtliche Werke und
ausgewählte Briefe. Vol. 5. München: Carl Hanser, 1958. 320-21.
---. “Das Sinngedicht.” 1881. Sämtliche Werke und ausgewählte Briefe. Vol. 3. München: Carl
Hanser, 1958. 933-1186.
---. Martin Salander. 1886. München: Wilhelm Goldmann, 1959.
Keller, Gottfried. Das Auswanderungs-Problem in der Schweiz. Mit besonderer
Berücksichtigung von Brasilien. Rorschach: E. Löpfe-Benz, 1936.
Keller, Johannes. Aus der Schweiz nach Brasilien. Affoltern am Albis: E. Epprecht, 1897.
Kestler, Izabela Maria Furtado. Die Exilliteratur und das Exil der deutschsprachigen
Schriftsteller und Publizisten in Brasilien. Frankfurt/M.: Lang, 1992.- 20 -
Magalhães, Marion Brepohl de. Presença alemã no Brasil. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 2004.
Mesmer, Beatrix, ed. Geschichte der Schweiz und der Schweizer. Basel: Helbing &
Lichtenhahn, 1986.
Moeschlin, Felix. Ich suche Land in Südbrasilien. Erlebnisse und Ergebnisse einer Studienreise.
Zürich: Albert Müller, 1936.
Nicoulin, Martin. La genèse de Nova Friburgo. Émigration et colonisation suisse au Brésil
1817-1827. Fribourg: Éditions Universitaires, 1978.
Oberacker, Karl Heinz. Der deutsche Beitrag zum Aufbau der brasilianischen Nation. São
Paulo: Herder Editora, 1955.
Raffard, Henri. La colonie suisse de Nova Friburgo et la Société Philanthropique Suisse de Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro: G. Leuzinger & Filhos, 1877.
Schiller, Friedrich. Wilhelm Tell. 1804. Stuttgart: Reclam, 1993.
Schneider, Lukas M. Die Politik des Bundes gegenüber projektierten Kolonisationsunternehmen
in Argentinien und Brasilien. Ein Beitrag zur organisierten Auswanderung aus der Schweiz
(1880-1939). Bern: Lang, 1998.
Steger, Adolf. Brasilien, für deutsche und schweizerische Auswanderer. Lichtensteig: G. J.
Meisel, 1857.
Streiff-Becker, Rudolf. Erinnerungen eines Überseers. Glarus: Tschudi, 1943.
Tschudi, Johann Jakob von. Reisen durch Südamerika. 1866. Vol. I-IV. Stuttgart: Brockhaus,
1971.
Ziegler, Béatrice. Schweizer statt Sklaven: Schweizerische Auswanderer in den Kaffee-
Plantagen von São Paulo (1852-1866). Stuttgart: Steiner, 1985.
---. „Schweizerinnen wandern aus.” Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 44 (1994): 114-
43.
Wir danken dem Verfasser bestens für die freundliche Wiedergabebewilligung.
Internet-Bearbeitung: K. J. Version 12/2006
---------Vous pouvez aussi lire