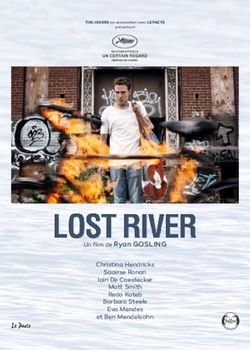THÉORIE DE SÃO PAULO Aujourd'hui et toujours - Revue Des Deux Mondes
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Aujourd’hui et toujours
THÉORIE
DE SÃO PAULO
› Sébastien Lapaque
Pour Bento Mineiro
V ol JJ 3257 de la compagnie chilo-brésilienne Latam
entre Belo Horizonte et São Paulo, hier soir. Aux
alentours de 20 h 30, l’Airbus A320 effectue un
virage au-dessus d’un lac artificiel. Les lumières dis-
posées tout autour composent de jolies guirlandes
de Noël. C’est l’un des plus grands réservoirs de l’État. La Represa Bil-
lings contient près d’un milliard de mètres cubes d’eau, apprendrais-je
plus tard. Dans la capitale économique du Brésil, ces chiffres sont en
proportion du reste : 12 millions d’habitants dans la ville, 20 millions
dans l’agglomération, 7 millions de voitures, 500 gratte-ciel, 700 héli-
coptères, dont les rotors bourdonnent nuit et jour dans le ciel.
L’avion s’approche de São Paulo, que je regarde à travers le hublot.
Un scintillement de lumières rouges et jaunes dans la nuit brésilienne.
Des dizaines, des centaines, des milliers d’immeubles serrés les uns
contre les autres. Un spectacle stupéfiant.
On aurait tort de se laisser effrayer par cet immense enchevêtre-
ment de verre, de béton et d’acier. Il y a quelque chose de fiévreux,
de sublime et d’enchanteur dans toute cette modernité. Arrivé en
138 FÉVRIER-MARS 2018littérature
1924, non par l’avion mais par le port voisin de Santos puis par
la route, Blaise Cendrars l’a célébrée dans un poème de Feuille de
route.
« J’adore cette ville
Saint-Paul est selon mon cœur
Ici nulle tradition
Aucun préjugé
Ni ancien ni moderne
Seuls comptent cet appétit furieux cette confiance abso-
lue cet optimisme cette audace ce travail ce labeur cette
spéculation qui font construire dix maisons par heure de
tous styles ridicules grotesques beaux grands petits nord
sud égyptien yankee cubiste
Sans autre préoccupation que de suivre les statistiques
prévoir l’avenir le confort l’utilité la plus-value et d’atti-
rer une grosse immigration
Tous les pays
Tous les peuples
J’aime ça
Les deux trois vieilles maisons portugaises qui restent
sont des faïences bleues (1) »
Saint-Paul est selon mon cœur et ce Sébastien Lapaque est romancier,
poème lui aussi. En traversant l’aéroport de essayiste et critique au Figaro
littéraire. Il collabore également au
Congonhas, je m’en répète quelques mots. Monde diplomatique. Son recueil
« Ici nulle tradition aucun préjugé ni ancien Mythologie française (Actes Sud,
ni moderne. » À première vue, le Brésil de 2002) a été récompensé du prix
Goncourt de la nouvelle. Dernier
Blaise Cendrars est assez différent de celui ouvrage publié : Théorie d’Alger
de Georges Bernanos, que j’ai découvert le (Actes Sud, 2016).
premier et que je connais le mieux, mais il › slapaque@gmail.com
sonne juste. Celui de l’auteur de Journal d’un curé de campagne est
profond, rural. Ce sont les hauts plateaux du Minais Gerais, d’où j’ar-
rivais avant d’atterrir à Saint-Paul. Dans les villes de la route de l’or
et dans les humbles fermes posées sur les collines, on sent la douce et
FÉVRIER-MARS 2018 139aujourd’hui et toujours, par sébastien lapaque
laborieuse patience de l’homme. Sur la route qui mène à Ouro Preto,
l’ancienne cité coloniale, son corps-à-corps séculaire avec la terre
rouge et sauvage, avec une nature qui ne se rend pas et qui ne se rendra
jamais, continue de s’observer. Dans le Minais Gerais s’est jouée une
aventure humaine unique qui a suffi à Bernanos pour comprendre la
totalité de l’immense Brésil où il a séjourné entre 1938 et 1945.
« Votre peuple grandit comme un arbre, ou se compose
comme un poème, par une sorte de nécessité intérieure,
auquel le monde moderne ne comprend absolument
rien, parce que, précisément, il n’a pas de nécessité
intérieure ; parce qu’il s’impose du dehors, qu’il est une
victoire monstrueuse, éphémère, de l’activité désor-
donnée des hommes sur la nature et sur l’homme, une
dissipation, un défi. Votre peuple grandit sans le savoir
– comme nous avons grandi nous-même jadis –, ce qui
est bien la meilleure manière de se développer régulière-
ment, sans risquer de perdre ses proportions originelles,
d’être tôt ou tard une tête de géant sur des jambes de
nain. Ici, comme jadis en Europe, l’homme et la terre
réagissent l’un sur l’autre, se perfectionnent l’un par
l’autre… (2) »
Vue de loin, cette réalité des noces de l’homme et de la nature est
invisible à São Paulo ; vue de près, elle apparaît partout. Ce n’est certes
pas Rio de Janeiro, où la nature enserre la ville, mais ici aussi elle sur-
git sans cesse au coin des rues, où des tico-tico picorent la farine aux
abords des boutiques, comme dans la chanson de Carmen Miranda :
O tico-tico tá / Tá outra vez aqui / O tico-tico tá comendo meu fubá…
On le découvre dans le quartier des Jardins, au milieu de la ville, mais
presque hors de la ville, hors du temps. C’est là qu’on trouve les deux
plus beaux hôtels de Saint-Paul, des établissements où l’on réapprend
ce qu’est la douceur des choses : l’Emiliano et le Fasano, posés dans
des rues où l’on entend couler l’eau et chanter les oiseaux, comme si
l’on était à des kilomètres de l’avenida Paulista, moderne fleuve aux
140 FÉVRIER-MARS 2018théorie de são paulo
milliers de voitures, qui est pourtant à deux pas. Les noms de ces deux
hôtels indiquent l’importance des familles italiennes dans l’histoire
de São Paulo en général et dans sa tradition hôtelière et gastrono-
mique en particulier. Les premières brasseries ont été fondées par des
Italiens. Et l’excellence a souvent l’accent de Milan et des inflexions
vénitiennes aujourd’hui. Après avoir bu une caïpirinha de maracujá au
bar de l’Emiliano ou du Fasano, dans un calme et une paix qui vous
transportent au temps où Dieu inventa le monde, j’aime retrouver la
table du chef Paolo Picchi dans le restaurant qui porte son nom. Quel
festival ! La gastronomie, à São Paulo, est élevée au rang des beaux-
arts, comme la mode, la photographie, l’art contemporain. On est
tenté de se demander si les magazines ne parlent pas que de ça. Un
Français s’y sent forcément bien. Les assiettes de Paolo Picchi sont des
navires qui sortent impeccables de leurs jetées pour mener ses hôtes
tout autour de la terre.
On trouve également des pirates et des bistronomes parmi les chefs
paulistanos. Au Mocotó, un ancien restaurant ouvrier dans lequel il a
succédé à son père, Rodrigo Oliveira propose une cuisine nordestine
inventive, rugueuse et délicieuse. À la Casa do Porco, Jefferson Rueda
fait rôtir deux ou trois cochons entiers chaque jour qu’il sert sous les
formes que lui commande son imagination en buvant des litres de
cachaça.
Originaire de São José do Rio Pardo, une ville de l’intérieur de
l’État où j’ai eu l’honneur et l’avantage d’aller faire un tour avec lui,
Jefferson Rueda est l’apôtre d’une cuisine qu’on nomme ici « caipira »
du nom des paysans du coin, cousins de ceux du Minas Gerais que
Georges Bernanos a célébrés dans ses textes. Une cuisine simple et
directe où la viande de porc ou de bœuf est posée directement sur la
grille et servie sans apprêt avec du riz, des haricots noirs, un œuf au
plat, de la farine de manioc, des bananes. Typique d’une grande région
d’élevage, dans un autre esprit que la fameuse feijoada.
« Mais on passe son temps à manger, à São Paulo ? », m’a un jour
demandé ma femme en m’entendant raconter mes aventures gour-
mandes dans les profondeurs de l’Estado de São Paulo. Au Mercado
municipal, où l’on débite des bêtes entières de 6 heures du matin à
FÉVRIER-MARS 2018 141aujourd’hui et toujours, par sébastien lapaque
6 heures du soir, c’est parfois l’impression que cela laisse. Un peu
comme dans la « rue des fantômes », à Pékin. Mais Saint-Paul est aussi
la capitale d’une très haute culture méconnue chez nous – bien qu’elle
fût étroitement liée à la France dans les années vingt à cinquante et
que ce lien ne soit pas totalement rompu. Saint-Paul a longtemps
parlé français. J’ai naguère eu la chance de rencontrer Claude Lévi-
Strauss chez lui, dans son appartement de la rue de la Faisanderie à
Paris chargé de souvenirs, pour qu’il me parle de cette époque englou-
tie, comme presque tout ce qu’il avait connu et aimé.
« En arrivant à São Paulo en 1935, j’ai observé que la
France et le Brésil étaient presque deux pays unis. Son-
gez que, dans le cadre de la Mission universitaire, nous
donnions nos cours en français à São Paulo sans aucun
problème. À cette époque, toute la bonne société brési-
lienne parlait couramment français. »
Débarqué une décennie après Blaise Cendrars, Claude Lévi-Strauss
a été frappé comme le poète par la construction de « dix maisons par
heure de tous styles ».
« C’est un des aspects essentiels de l’expérience bré-
silienne. La naissance d’une ville, qui s’étale sur des
siècles ou sur des millénaires dans l’ancien monde,
prenait quelques années ou quelques mois au Brésil.
J’envoyais mes élèves observer leur quartier ou leur rue.
À São Paulo, cela changeait tous les jours. Nous obser-
vions également les villes en train de se construire, au
bord du chemin de fer qui pénétrait dans l’ouest de
l’État de São Paulo et du Parana. C’était très étonnant.
La première ville avait 2 000 habitants, celle d’après
n’en avait plus que 90, vingt kilomètres plus loin, elle
en avait 40, et encore vingt kilomètres plus loin, en
avait un seul. »
142 FÉVRIER-MARS 2018théorie de são paulo
C’est ainsi, avec les yeux de Blaise Cendrars et de Claude Lévi-
Strauss, que l’on apprend à regarder, à comprendre et à aimer Saint-
Paul. On rêverait que l’élan, la fièvre, l’espoir et l’énergie créatrice
observés par ici soient contagieux. En se glissant dans les plis sinueux
de la capitale fondée en 1554 par les jésuites, plus souvent en taxi qu’à
pied, car São Paulo est aussi une ville dangereuse, on se plaît à croire
que tous les pays portent en eux un autre pays possible ; et que tout,
chaque matin, peut être réinventé dans ce monde de brutes : l’art, le
bonheur, les rêves, la mesure parfaite de toute chose.
Ces retrouvailles avec l’imprévu ont servi de programme au
mouvement moderniste brésilien, né au cours de la Semaine d’art
moderne organisée au Théâtre municipal de São Paulo, du 13 au
17 février 1922 : la proclamation orgueilleuse d’une ère nouvelle dans
le domaine de la poésie, de la littérature, de la peinture, de la sculpture
et de la musique. Menés par l’écrivain Mário de Andrade, le poète
Manuel Bandeira, la peintre Tarsila do Amaral, le musicien Heitor
Villa-Lobos et le mécène Paulo Prado, les modernistes refusaient de
se laisser dominer par les influences européennes et nord-américaines,
mais au contraire décidaient de les dévorer comme jadis les Indiens
tupinambas les Portugais. « Tupi or not tupi », juraient-il crânement,
proclamant « la naissance émouvante du Brésil ».
Le lien avec le cubisme et le futurisme qui se déployaient en
Europe au même moment transparaît dans le « Manifeste de la poésie
Pau-Brasil »du trublion Oswald de Andrade, publié dans le quoti-
dien Correio da Manhã, le 18 mars 1924. Cet éloge de la coïncidence
des opposés : « Ascenseurs obus, gratte-ciel cube et la savante paresse
solaire. La prière. Le Carnaval. L’énergie intime. Le sabiá. L’hospitalité
un peu sensuelle, amoureuse. La saudade des sorciers/pajés et les ter-
rains d’aviation militaire. Pau-Brasil. »
Le poète, romancier, essayiste et dramaturge né et mort à São Paulo,
très représentatif de l’esprit à la fois commerçant, artiste et bandeirante (3)
qui caractérise souvent les membres de l’élite de cette ville, termine son
manifeste de 1924 – un autre a suivi en 1928 – en réclamant un sentiment
pur, un équilibre géométrique, une fusion totale : « La forêt et l’école. Le
Musée national. La cuisine, le minerai. La végétation. Pau-Brasil. »
FÉVRIER-MARS 2018 143aujourd’hui et toujours, par sébastien lapaque
Ce sentiment, cet équilibre, cette fusion se retrouvent aujourd’hui
à São Paulo dans les musées, les galeries et les écoles d’art, où le mou-
vement de 1922 a laissé une trace longue, persistante. Pour com-
prendre l’esprit du modernisme brésilien en le respirant, on peut se
promener dans les parcs dessinés par le paysagiste Roberto Burle Marx
– non seulement dans celui qui porte son nom mais aussi dans le parc
Ibirapuera, au cœur de la ville, où un monument de granit aux arêtes
martiales honore l’épopée de bandeirantes.
Le sauvage y cohabite partout avec le civilisé. Avec un peu d’effort,
on peut y observer toutes sortes d’oiseaux et apprendre à reconnaître
leur chant : le bem-te-vi, le cardeal, la lavadeira et le sabiá – le merle
à plumage roux chanté par Oswald de Andrade dans son poème.
L’opposition du minéral et du végétal, la confrontation des courbes
et de l’angle droit, les jeux de contraste et de superposition imposent
un univers. Ce qui est impressionnant, c’est la taille des arbres, leurs
formes torturées, inquiétantes, et la variété des plantes épiphytes
– lianes, orchidées, broméliacées, tillandsia – qui les ont colonisés. Le
Parque Burle Marx du quartier de Panamby – « papillon » en langue
tupi – a été inauguré en 1995, un an après la mort de l’architecte et
paysagiste auquel on doit les vagues en noir et blanc de la promenade
de Copacabana à Rio – une autre illustration de l’inspiration moder-
niste. Il permet instantanément de sortir de la métropole et d’oublier
le mugissement de ses sept millions de voitures. Soudain l’imprévu
au coin de la rue. Le jeu, l’étonnement, la surprise réclamés par les
modernistes réinventés.
Saint-Paul, ville fiévreuse, ville gourmande, ville cubiste.
1. Blaise Cendrars, « Saint-Paul » in Du monde entier au cœur du monde. Poésies complètes, Gallimard,
2006.
2. Georges Bernanos, Brésil, terre d’amitié, anthologie, La Table ronde, coll. « La petite vermillon », 2009,
p. 30.
3. Dans l’histoire brésilienne, les bandeirantes sont les aventuriers, généralement originaires de
São Paulo, qui se sont enfoncés dans l’intérieur du pays à partir du XVIIe siècle, lui permettant de repous-
ser ses frontières vers l’ouest et vers le sud.
144 FÉVRIER-MARS 2018Vous pouvez aussi lire