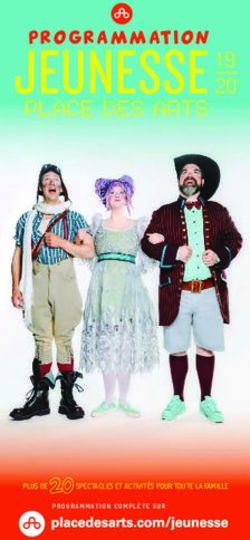" The Semiotics of Theatre and Drama " - Érudit
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Document generated on 11/16/2021 1:10 a.m.
Jeu
Revue de théâtre
« The Semiotics of Theatre and Drama »
E. A. Walker
Number 24 (3), 1982
URI: https://id.erudit.org/iderudit/29491ac
See table of contents
Publisher(s)
Cahiers de théâtre Jeu inc.
ISSN
0382-0335 (print)
1923-2578 (digital)
Explore this journal
Cite this review
Walker, E. A. (1982). Review of [« The Semiotics of Theatre and Drama »]. Jeu,
(24), 139–141.
Tous droits réservés © Cahiers de théâtre Jeu inc., 1982 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/« the semiotics of theatre and drama »
Essai de KeirElam, Methuen, New Accents, Londres teurs. Heureusement, les dernières an-
et New York, 1980, 248 p. nées nous ont apporté plusieurs études
dans ce domaine, sous la plume d'Anne
Ayant défini leurs concepts et raffiné Ubersfeld, de Patrice Pavis et d'Alessan-
leur méthodologie au cours des vingt- dro Serpieri, pour n'en nommer que
cinq dernières années, les diverses trois. C'est précisément en fonction de
écoles de la « nouvelle » critique (struc- cette dichotomie-unité du média drama-
turalisme, post-structuralisme, sémiolo- tique qu'Elam a structuré son vade-
gie) se sont surtout concentrées sur le mecum important pour l'explorateur qui
terrain solide que leur offraient le conte s'aventure sur des terrains encore mal
et le roman et, jusqu'à tout récemment, connus.
ne s'étaient aventurées que sporadique-
ment dans l'analyse du théâtre (et de la Comme son titre l'indique (Sémiologie
poésie). Selon Keir Elam (voir Sub- du théâtre et du drame), et comme son
Stance 18/19, 1977) et d'autres, les arts premier chapitre l'atteste, l'ouvrage est
du spectacle vivant ont surtout été né- organisé de manière à montrer les dis-
g l i g é s à cause de leur c a r a c t è r e tinctions et la relation entre: le theatre.
complexe et multivalent, du fait qu'ils
combinent les qualités littéraires du
texte publié et toute la variété de res- The Semiotics of Theatre
sources disponibles au média de la
représentation, comprenant non seule-
ment la parole, mais aussi les gestes, le
mouvement, le décor, les costumes, les
accessoires, l'espace même de repré-
sentation, l'éclairage, la musique, les ef-
fets spéciaux, les projections de films et
de diapositives, etc. Certains préten-
draient que cette réticence est d'autant
plus étrange que la sémiologie semble
être le biais idéal par lequel aborder le
phénomène de la scène, à partir du mo-
ment où l'on admet que la mise en scène
est en réalité une mise en signes (Patrice
Pavis): cette science est donc l'instru-
ment longtemps attendu qui nous per-
mettra de comprendre la complexité or-
ganique du spectacle, et de sa dynami-
que jeu-texte. Nous disposons enfin,
semble-t-il, du moyen de combler le
fossé entre l'écrit et la scène, entre le
metteur en scène, l'acteur et les specta-
Keir Elam
139défini comme « le complexe de phéno- est constitué par l'effet total » (p. 7) et, de
mènes associés à l'échange acteur- là, vers l'observation de Jîi Veltrusky se-
spectateur: c'est-à-dire à la production lon laquelle tout ce qui est vu ou se pro-
et à la communication d'un sens par la duit sur scène acquiert des caractéristi-
représentation même [...] » (p. 2); et le ques spéciales qui en font non simple-
drama, soit « ce mode de fiction conçu ment un objet ou une action, mais un
pour être re-présenté sur scène et signe. En particulier, à cause de son acti-
construit d'après des conventions parti- vité, l'acteur est un système sémiotique,
culières (« dramatiques »). » (ibid.) Im- soit tout un ensemble de signes englo-
médiatement, et l'auteur le reconnaît, bant tant la parole (et ses discours) que
cette prémisse soulève un problème: le corps (et ses gestes). Elam examine
alors que le drama fournit au théoricien ensuite diverses typologies du signe: le
littéraire (aristotélicien, classique, struc- naturel par opposition à l'artificiel (Ta-
turaliste...) un texte à examiner, quel deusz Kowsan), la triade icône-index-
texte la représentation offre-t-elle au sé- symbole (C.S. Peirce), la métaphore, la
miologue? Comment cerner le corpus métonymie et la synecdoque (R. Jakob-
fixe (corps mort?) d'une entité vivante et son), pour revenir vers la forme la plus
dynamique? De plus, est-il possible de primitive de la signification, Yostension,
résoudre la dichotomie « texte écrit pour qui consiste simplement à montrer plu-
le t h é â t r e » — « t e x t e p r o d u i t a u tôt qu'à dire et dont la pertinence est
théâtre »? « [...] est-il possible de recréer manifeste dans le cas du théâtre.
en termes sémiotiques une poétique en-
globante du type aristotélicien, tenant C'est au troisième chapitre, La commu-
compte de tous les principes communi- nication théâtrale: codes, systèmes et
cationnels, représentationnels, logi- texte de la représentation, que l'étude
ques, fictionnels, linguistiques et struc- d'Elam commence à montrer ses limites
turels du théâtre et du drame? » (p. 3). pour ceux qui s'intéressent à la repré-
sentation plutôt qu'au drame, et en par-
Elam explore ce problème selon un ticulier pour les praticiens. L'auteur pose
mode essentiellement historique et son deux questions qui seront examinées
exposé est un modèle de clarté. Il débute dans les chapitres ultérieurs. D'abord, le
par les structuralistes de l'Ecole de Pra- théâtre constitue-t-il véritablement une
gue, qui ont fondé leurs travaux sur ceux communication dans le sens moderne
des formalistes russes et sur la linguisti- du terme? N'est-il pas unidimensionnel,
que structurelle saussurienne, avec son transmis de l'acteur au spectateur sans
concept essentiel de dualité du signe, rétroaction (feedback)? (Mounin) Quoi
formé du signifiant (qu'Elam, perverse- qu'il en soit, qu'est-ce que le théâtre
ment, appelle véhicule du signe) et du communique, quel est son message si
signifié. De ce point de départ, les théori- celui-ci peut être décodé? Est-il possible
ciens de Prague évoluent vers le concept de construire un modèle de ce proces-
de Mukafovsky, soit que le texte repré- sus, peut-être analogue au schéma bien
senté est « un macro-signe, dont le sens connu de Jakobson?
Code
Émetteur — Média — Message — Média — Récepteur
Réfèrent
140L'étude des travaux des précurseurs (p. 185)! Cette démonstration est-elle fu-
(Birdwhistell, Moles, McLuhan) et des tile? Certainement pas. Outre la bonne
modernes (Cowin, Ruffini, Bettetini, dose d'analyse tout à fait pertinente de
Eco) fait ressortir que l'échange théâtral nombreux éléments scéniques qu'il per-
est fort probablement trop riche, trop met, le système montre une fois de plus
varié et trop dynamique pour permettre l'énorme complexité du problème ini-
une telle analyse réductionniste. (Voir tial, la diversité quasi infinie de permuta-
en particulier les grilles des pages 57 à tions et de combinaisons des éléments
62 reliant les sous-codes théâtraux, les de la représentation, ce que Barthes a
codes culturels et les sous-codes drama- appelé « épaisseur de signes » et « poly-
tiques aux codes systémique, linguisti- phonie informationnelle ».
que, intertextuel générique... et à neuf
autres types de code.) Doit-on faire un constat d'échec quant à
l'ouvrage dans son ensemble? Loin de
Qu'en est-il alors du dramatique, qui oc- là. La représentation et la discussion du
cupe deux chapitres (4. Logique drama- sujet de la sémiotique appliqué au mé-
tique et 5. Discours dramatique) repré- dia du spectacle vivant sont exactes et
sentant pas moins de la moitié du livre? lucides, tant à titre historique qu'à celui
Le discours dramatique peut-il être sou- d'« état présent ». À cet égard, le résultat
mis aux mêmes genres d'analyse que est de loin supérieur au Dictionnaire du
les autres formes littéraires? D'Aristote à théâtre de Patrice Pavis (1980). De plus,
Greimas, en passant par Propp, Souriau, comme tous les volumes de la série New
Lotman, Jeffrey, Van Dijk, Patofi, pré- Accents, celui-ci comporte non seule-
sentant et examinant avec clarté (sinon ment une excellente bibliographie, mais
toujours avec suffisamment de détails) aussi une section « Suggestions de lec-
les questions de référentialité, de mime- tures » subdivisée selon les différents
sis ou d'ostension, d'action et de temps domaines susceptibles d'intéresser le
dramatiques, d'intrigue et de fable, d'ac- lecteur, notamment: contributions de
tion, d'actant, de dramatis personae, de l'École de Prague; le texte de la repré-
contexte et de deixis, d'action parlée, sentation et son analyse; systèmes rela-
d'« implicatures » et de figures (j'en tifs au corps, à la voix et aux éléments
passe, et des meilleures), se dirigeant scéniques; le drame et le texte dramati-
« Vers une analyse dramatologique », que; etc.
l'étude s'éloigne de plus en plus de la
représentation pour se rapprocher du Fondamentalement, ce livre constitue
texte. Elam ne peut résister à la tentation une introduction judicieuse et utile à une
d'offrir une « m/cro-segmentation », question tout aussi complexe qu'impor-
une tentative de définition et de dé- tante. Les praticiens de théâtre et ceux
monstration de l'unité minimale irréduc- qui s'intéressent davantage à la repré-
tible du théâtre, analogue au « nar- sentation qu'au script regretteront par
rème » du narratologue. Qu'il suffise de contre qu'Elam ait lui-même oublié sa
dire qu'appliquant son système aux 79 propre affirmation selon laquelle « c'est
premières lignes du Hamlet de Shakes- avec le spectateur, en bref, que la
peare, il soumet le texte à un test de 17 communication théâtrale débute et se
critères allant de Locuteur à Lexemes/ termine » (p. 97), et qu'il ait fini par subs-
isotopieslparadigmes sémantiques et tituer drame à théâtre comme tant
isole 79 unités discrètes ou « segment(s) d'autres l'ont fait avant lui.
de discours (distingué[sj en fonction
d'une modification d'orientation déicti- e. a. walker
que et/ou de force « illuctionnaire ») » traduit par jean-luc dénis
141Vous pouvez aussi lire