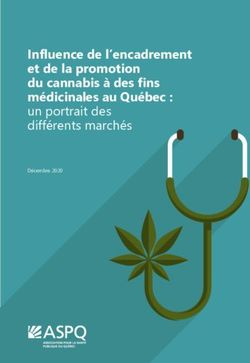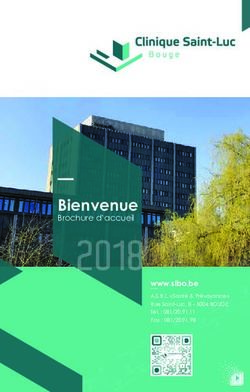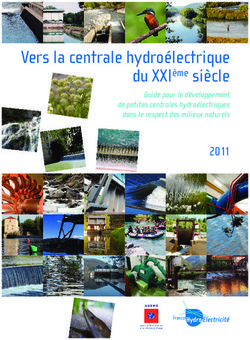Triade noire, personnalité limite et maltraitance émotionnelle chez les adolescents: le rôle médiateur de la mentalisation - Mémoire doctoral ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Triade noire, personnalité limite et maltraitance
émotionnelle chez les adolescents: le rôle médiateur de
la mentalisation
Mémoire doctoral
Camille Leclerc
Doctorat en psychologie
Docteure en psychologie (D. Psy.)
Québec, Canada
© Camille Leclerc, 2020Triade noire, personnalité limite et maltraitance
émotionnelle chez les adolescents: le rôle médiateur
de la mentalisation
Mémoire doctoral
Camille Leclerc
Sous la direction de :
Karin Ensink, directrice de rechercheRésumé
La présente étude s’intéresse à la triade noire (TN) de la personnalité et aux traits de
personnalité limite, ainsi qu’à leurs associations avec la maltraitance émotionnelle et la
mentalisation. Ces construits de personnalité ont tous été associés à des déficits de
cognition sociale et à un environnement adverse à l’enfance, mais la littérature n’est pas
claire sur la nature de ces relations. La présente étude a pour premier objectif d’explorer les
associations entre les construits de la triade noire et la personnalité limite. Le deuxième
objectif est d’examiner la présence de déficits de mentalisation et de maltraitance
émotionnelle chez les adolescents d’échantillons clinique et non clinique, ainsi que
l’association entre ces variables et les construits de personnalité à l’étude. La mentalisation
est alors proposée comme médiateur de la relation entre la maltraitance et les traits de
personnalité chez des adolescents d’un échantillon clinique. Les résultats confirment une
forte association entre les trois construits de la TN et une association modérée entre la
personnalité limite et la TN. Les résultats révèlent que la mentalisation joue un rôle
médiateur dans la relation entre la personnalité limite et la maltraitance émotionnelle. De
plus, les résultats suggèrent que la mentalisation pourrait également jouer un rôle protecteur
dans la relation entre la maltraitance émotionnelle et le machiavélisme. La présente étude
n’a pas su démontrer que la mentalisation jouait un rôle médiateur dans la relation entre la
maltraitance et le narcissisme ainsi qu’avec la psychopathie, mais les résultats suggèrent
qu’il serait pertinent d’explorer davantage cette piste dans le cadre d'études ultérieures.
iiTable des matières
Résumé ................................................................................................................................... ii
Table des matières ................................................................................................................. iii
Liste des tableaux .................................................................................................................. iv
Liste des figures ...................................................................................................................... v
Listes des abréviations ........................................................................................................... vi
Remerciements ..................................................................................................................... vii
Introduction ............................................................................................................................ 1
Chapitre 1 : Recension des écrits ............................................................................................ 1
La triade noire de la personnalité ....................................................................................... 1
Cognition sociale, mentalisation et fonctionnement réflexif .............................................. 5
Impact de la maltraitance sur la mentalisation ................................................................... 7
Triade noire, personnalité limite et cognition sociale ......................................................... 9
Triade noire, personnalité limite et maltraitance .............................................................. 13
Maltraitance, mentalisation et personnalité ...................................................................... 15
Objectifs ........................................................................................................................... 15
Chapitre 2 : Méthode ............................................................................................................ 17
Participants ....................................................................................................................... 17
Matériel............................................................................................................................. 18
Procédure .......................................................................................................................... 20
Chapitre 3 : Analyses statistiques ......................................................................................... 21
Chapitre 4 : Résultats............................................................................................................ 23
Analyses descriptives ....................................................................................................... 23
Analyses corrélationnelles ................................................................................................ 23
Analyse acheminatoire ..................................................................................................... 26
Chapitre 5 : Discussion ......................................................................................................... 28
Relations entre les trois membres de la triade noire ......................................................... 28
Traits de personnalité limite et triade noire ...................................................................... 29
Rôle médiateur de la mentalisation .................................................................................. 30
Limites de l’étude ............................................................................................................. 35
Conclusion ............................................................................................................................ 37
Bibliographie ........................................................................................................................ 38
iiiListe des tableaux
Tableau 1
Description et comparaison des adolescents des échantillons clinique et non clinique…...43
Tableau 2
Comparaison du type de maltraitance émotionnelle rapporté en fonction du parent dans
l’échantillon clinique…………………………………………………………..…………. 44
Tableau 3
Corrélations de Pearson entre les construits de la TN, la personnalité limite, les facteurs de
fonctionnement réflexif et la maltraitance émotionnelle dans l’échantillon clinique….......45
Tableau 4
Estimation des covariances entre les échelles de FR (médiateurs) et les variables
dépendantes…………………………………………………………………..………….…46
ivListe des figures
Figure 1.
Intercorrélations entre les trois membres de la TN (machiavélisme, narcissisme et
psychopathie)………………….…………………………………...………………………47
Figure 2.
Analyse acheminatoire des associations significatives et marginalement significatives entre
la maltraitance émotionnelle maternelle et paternelle, le FR des adolescents (confusion et
intérêt/curiosité) et les traits de personnalité limite et machiavéliques auprès de 40
adolescents d’une population
clinique……………………..……………………………….48
vListes des abréviations
BPFS-C…………………...……….……..Borderline Personality Features Scale for
Children
CECA-Q………………………...…Childhood Experience of Care and Abuse
Questionnaire
DD-Y………………………...………...……………………...………Dirty Dozen for Youth
FR………………………………..………………………………….Fonctionnement réflexif
PIANO……...…………………….Portail intégré d’applications numériques pour
ordinateur
RFQ-Y………………………..………………...Reflexive Function Questionnaire for
Youth
SCEP………………………...………..…..Service de consultation de l’École de
psychologie
ToM…………………………...…………………………………………...…Theory of Mind
TN ……………….…………..…..………………………………………………Triade noire
TPL………………………………………...…………….….Trouble de la personnalité
limite
viRemerciements
J’aimerais tout d’abord remercier ma directrice de recherche, Madame Karin Ensink,
pour avoir cru en moi et en mon projet tout au long de ce processus. C’est vous qui m’avez
introduit au monde de la recherche dans le cadre de ma Recherche dirigée et j’ai
énormément appris sous votre supervision depuis ce temps. Je tiens également à remercier
Madame Lina Normandin, présidente de mon comité d’encadrement, pour ses critiques
toujours constructives concernant mon projet. Je n’aurais jamais pu arriver à ce résultat
sans votre support et votre implication. Je dois également un énorme merci à Hélène
Paradis, statisticienne, pour son aide précieuse en matière d’analyse statistiques.
Je dois également un énorme merci à toute l’équipe du laboratoire de recherche en
psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescents, qui a permis la réalisation de ce projet
par son travail incroyable en matière de recrutement, de saisie de données et de gestion de
banque de données. Un merci spécial à Michaël H. Bégin, qui a toujours été prêt à m’aider
quand j’en avais besoin. Je ne peux pas non plus passer à côté d’Alexandra Thériault
Séréno. En tant que collègue et amie, tu m’as toujours aidée à relativiser quand mon
autocritique me jouait des tours, depuis Recherche dirigée jusqu’à aujourd’hui! Enfin, un
grand merci à Marie-Claude Parent, ma partenaire de rédaction et soutien moral de l’été
2019!
Je tiens également à remercier mon amoureux, Francis, pour son soutien et ses
encouragements. Tu as cru en moi et tu as toujours su voir le verre à moitié plein quand je
le voyais à moitié vide (ou complètement vide, avouons-le)! Tu es arrivé dans ma vie à la
fin de mon parcours doctoral, mais ton optimisme à tout épreuve aura eu plus d’importance
que tu ne pourrais t’imaginer. Ensuite, un grand merci à mes parents et ma famille, qui
m’ont toujours encouragée et supportée dans la poursuite de mes études et de ma carrière.
Finalement, un gros merci à mes amies du doc, Alexandra, Kelly Ann, Émilie,
Sandra et Amber. Qu’aurait été le doctorat sans vous et sans nos sorties pour se changer les
idées? Et Anne-Marie, ma partenaire de P2, je te dois aussi un très grand merci pour ton
soutient à travers les épreuves que nous avons vécues ensemble. On va finir par aller le
prendre notre nachos au pub!
Merci infiniment!
viiIntroduction
Bien que le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme soient trois construits
distincts, la recherche montre qu’ils présentent certains chevauchements. Ces trois
construits de personnalité, qui sont considérés comme aversifs sans nécessairement
atteindre un seuil pathologique, forment la « triade noire » (TN; « dark triad »). Chacun de
ces construits de personnalité implique à divers degrés des comportements d’autopromotion,
une froideur émotionnelle, une tendance à la tromperie et à l’agressivité (Paulhus et
Williams, 2002). Chez les adolescents de la communauté, les traits de personnalité de la TN,
plus particulièrement la psychopathie et le machiavélisme, sont associés à la présence de
délinquance et de symptômes d’agression (Muris, Meesters et Timmermans, 2013). De plus,
les trois construits de la TN sont associés à des déficits au niveau de la cognition sociale,
notamment un déficit d’empathie. Une meilleure compréhension de la relation entre la
triade noire et la cognition sociale pourrait contribuer à améliorer les interventions auprès
d’adolescents présentant ces traits de personnalité. De plus, puisque la plupart des études
sur la TN ont été menées auprès d’adultes, il subsiste des lacunes au niveau des
connaissances quant à l’expression de ces traits de personnalité et leurs relations chez les
adolescents.
1Chapitre 1 : Recension des écrits
La triade noire de la personnalité
Narcissisme. Le narcissisme peut être conceptualisé comme étant la capacité d’un individu
à maintenir une image de soi relativement positive à travers une variété de processus
d’auto-régulation, sous-tendant ses besoins de validation et d’affirmation ainsi que sa moti-
vation à rechercher ouvertement ou secrètement des expériences de valorisation personnelle
dans son environnement social (Pincus et al. 2009). Le narcissisme peu s’exprimer de façon
saine ou de façon pathologique, reflétant une organisation adaptée ou mésadaptée de la per-
sonnalité de l’individu, ses besoins psychologiques et ses mécanismes de régulation. Ces
différents facteurs donnent lieu à des différences individuelles dans la façon de gérer les
besoins de valorisation de soi et de validation (Pincus & Lukowitsky, 2010). Le narcissisme
en tant que construit de la triade noire réfère aux aspects aversifs du concept de narcissisme,
soit davantage au narcissisme pathologique.
Bien que le narcissisme à l’adolescence ait fait l’objet d’un nombre grandissant
d’études dans les dernières années, des lacunes demeurent dans les connaissances à ce sujet.
Pourtant, le narcissisme jouerait un rôle important dans le développement de l’adolescent,
voire même un rôle adaptatif. Selon Hill et Lapsley (2011), le sentiment d’omnipotence
serait une facette plus adaptative du narcissisme à l’adolescence, puisqu’elle est associée à
une meilleure estime de soi et un sentiment accru de valeur personnelle. Toutefois, le
sentiment d’être unique serait plutôt une manifestation maladaptée de narcissisme à
l’adolescence, entraînant un sentiment de vulnérabilité et une certaine anxiété sociale.
Selon Ensink et coll. (2018), le narcissisme pathologique à l’adolescence est associé à la
présence de troubles internalisés et externalisés.
Deux phénotypes de narcissisme pathologique ont été identifiés : le narcissisme
grandiose et le narcissisme vulnérable. Wink (1991) est le premier à avoir soulevé l’idée
que le narcissisme puisse prendre ces deux formes. Il identifie le narcissisme grandiose
comme étant associé à l’extraversion, une haute estime de soi, l’exhibitionnisme et
l’agression, alors que le narcissisme vulnérable serait plutôt associé à l’introversion, une
attitude défensive, une hypersensibilité, de l’anxiété, et une vulnérabilité face aux traumas.
1Malgré ces différences, les deux facettes du narcissisme partagent un noyau commun, soit
l’arrogance, la complaisance et le mépris d’autrui. Si cette structure du narcissisme a
d’abord été révélée au sein d’une population adulte, l’existence de ces deux facettes du
narcissisme a aussi été confirmée récemment chez les adolescents (Ensink et coll., 2018).
Psychopathie. Le concept de psychopathie a d’abord été défini par Cleckley (1988),
à partir de ses impressions cliniques. C’est à partir des critères établis par Cleckley que
Hare (1980) a développé la Psychopathy Checklist (PCL), une échelle largement utilisée en
recherche qui fut révisée plusieurs fois par la suite (Hare, 1991; 2003) sur la base de
travaux empiriques. Des analyses factorielles ont permis d’identifier deux composantes
centrales de la psychopathie : un facteur affectif-interpersonnel et un facteur impulsif-
antisocial. Le premier facteur est défini par un dysfonctionnement émotionnel, impliquant
une réduction de l’empathie, des traits calleux-insensibles et un attachement réduit, alors
que le deuxième facteur réfère à des comportements antisociaux (Hare et coll., 1990;
Harpur, Hakstian et Hare, 1988). Des travaux plus récents remettent toutefois en doute cette
structure à deux facteurs, proposant plutôt un modèle à trois facteurs (Cooke et Michie,
2001; Jones, Cauffman, Miller et Mulvey, 2006), dans lequel le facteur de
dysfonctionnement émotionnel est divisé en deux sous-catégories, soit une dimension
calleuse-insensible et une dimension de narcissisme. De manière similaire, trois dimensions
de psychopathie ont été identifiées chez les enfants et les adolescents: (1) une dimension
affective (émotions superficielles, manque d’empathie, dureté), (2) une dimension
interpersonnelle (charme superficiel, manipulation, grandiosité, mensonge) et (3) une
dimension comportementale (impulsivité, irresponsabilité, recherche de sensation, absence
de but à long terme) (Andershed, Kerr, Stattin et Levander, 2002; van Baardewijk et coll.,
2008). C’est la dimension affective, les traits calleux-insensibles, qui distinguerait de
manière unique la psychopathie des autres troubles de types antisociaux (Sharp et
Vanwoerden, 2014).
Machiavélisme. Le machiavélisme réfère à un style de personnalité marqué par le
cynisme, le pragmatisme, des croyances misanthropes et immorales, une empathie limitée,
la manipulation, l’exploitation des autres, la tromperie et la planification stratégique
(Christie, Geis, Festinger et Schachter, 2013). Le machiavélisme est d’ailleurs associé au
2fait d’être socialement manipulateur et à l’exploitation d’autrui à ses propres fins (Jonason,
Li, Webster et Schmitt, 2009). Les individus ayant un haut degré de machiavélisme tendent
à se comporter de manière froide et manipulatrice autant lors d’expériences en laboratoire
qu’en milieu naturel (Christie et coll., 2013). La plupart des études sur le machiavélisme
ont été effectuées auprès d’échantillons adultes, mais quelques études se sont penchées sur
le machiavélisme chez les adolescents. Chez ces derniers, le machiavélisme serait associé
positivement à différents types de difficultés, dont l’hyperactivité, les problèmes de
comportement, les problèmes avec les pairs et certains symptômes émotionnels. Il
semblerait d’ailleurs que le machiavélisme augmente avec l’âge, suggérant que les
adolescents deviennent plus cyniques en vieillissant (Geng et coll., 2017).
Personnalité limite. Le trouble de la personnalité limite (TPL) est une
psychopathologie sévère qui se caractérise par un mode général d’instabilité des relations
interpersonnelles, de l’image de soi et des affects, avec une impulsivité marquée qui se
manifeste dans divers contextes (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-5) : Americain Psychiatric Association, 2013). Le diagnostic de TPL selon le DSM-5
représente un construit catégoriel. Or, en raison des aspects développementaux de la
personnalité à l’adolescence, il vaut mieux adopter une approche dimensionnelle plutôt que
catégorielle (Sharp et Fonagy, 2015). Chez les adolescents, la personnalité limite a été
associée à une plus grande occurrence de troubles liés à l’utilisation d’une substance, de
problèmes intériorisés et extériorisés (Chanen, Jovev et Jackson, 2007; Ha, Balderas,
Zanarini, Oldham et Sharp, 2014) et d’autres troubles de personnalité appartenant à tous les
groupes (Becker, Grilo, Edell et McGlashan, 2000).
Relations entre les construits de la triade noire. Une méta-analyse (Furnham,
Richards et Paulhus, 2013) conduite sur près d’une centaine de corrélations a cherché à
évaluer la force des corrélations entre les trois construits de personnalité de la TN dans des
échantillons non cliniques. Il en ressort que toutes les corrélations observées sont positives
et significatives et qu’environ le quart d’entre elles sont plus grandes que 0,50. Enfin, selon
cette méta-analyse, les construits les plus fortement corrélés seraient le machiavélisme et la
psychopathie, alors que le narcissisme et le machiavélisme seraient les moins fortement
associés. Une méta-analyse plus récente (Vize, Lynam, Collison et Miller, 2018) a examiné
3les différences entre les composantes de la TN et présente les intercorrélations moyennes
obtenues avec le Dirty Dozen, dont une version adaptée aux adolescents est utilisée dans la
présente étude. Les résultats montrent des corrélations modérées à fortes entre les concepts
(rs = 0,49 pour le machiavélisme et le narcissisme, 0,33 pour le narcissisme et la
psychopathie et 0,53 entre le machiavélisme et la psychopathie).
Triade noire vulnérable. Le narcissisme pathologique et la psychopathie font
preuve d’une certaine hétérogénéité. En effet, la pathologie du narcissisme peut se présenter
selon le type grandiose ou vulnérable, et deux facteurs de psychopathie ont été identifiés,
soit un facteur affectif/interpersonnel (i.e. psychopathie de type 1) et un facteur
comportemental (i.e. psychopathie de type 2). Pour rendre compte de cette hétérogénéité,
Miller et coll. (2010) ont étudié l’existence d’une TN dite « vulnérable », qui combine un
style interpersonnel hostile à une dérégulation émotionnelle. Cette seconde triade serait
composée du narcissisme vulnérable, de la psychopathie de type 2 et de la personnalité
limite. D’un autre côté, la personnalité limite a également été suggérée comme quatrième
membre potentiel de la TN originale (Furnham et coll., 2013), puisqu’elle présente une
association significative avec le narcissisme vulnérable (Miller et coll., 2010) et la
psychopathie (Hunt, Bornovalova et Patrick, 2015; Sprague, Javdani, Sadeh, Newman et
Verona, 2012). Par ailleurs, le chevauchement entre la psychopathie et la personnalité limite
serait particulièrement observable chez les femmes (Sprague et coll., 2012). La personnalité
limite, tout comme les autres construits de la TN originale, est associée à des déficits de
cognition sociale.
La personnalité dans une perspective de psychopathologie développementale
Si l’étude de la personnalité, tant normale que pathologique, s’est longtemps limitée
à l’âge adulte, ces dernières années ont vu s’accroître l’intérêt envers les troubles de
personnalité à l’adolescence. Dans leur revue portant sur l’état des connaissances en
matière de troubles de la personnalité à l’adolescence, Lebel et Normandin (2015)
soulignent le fait que l’adolescence est une période de grands bouleversements aux plans
biologique, psychologique et social mettant grandement à l’épreuve les capacités
d’adaptation des jeunes. De ce fait, l’approche de la psychopathologie développementale
devient tout indiquée afin de mieux comprendre ce qui fait en sorte que certains adolescents
4vivent des difficultés au cours de cette période et d’autres non. Par ailleurs, une grande
attention a été portée au trouble de la personnalité limite à l’adolescence, élargissant les
connaissances quant à ses manifestations, sa stabilité et ses facteurs de risque. Les aspects
plus sombres de la personnalité chez les jeunes ont quant à eux été moins étudiés, laissant
la place aux aspects plus vulnérables. Or, considérant les difficultés associées à la présence
de traits de la TN chez les adolescents, une meilleure connaissance des manifestations, du
développement, de la stabilité et des facteurs de risque associés pourrait s’avérer d’une
grande importance en termes de traitement et de prévention, tant pour la société que pour
les adolescents eux-mêmes. De plus, le fait d’avoir vécu de la maltraitance émotionnelle
durant l’enfance, pourrait potentiellement expliquer que certains adolescents développent
des traits de personnalité narcissiques, psychopathiques, machiavéliques et limite. La
mentalisation pourrait être la clé pour expliquer cette trajectoire, et ce concept sera
davantage développé dans la section suivante.
Cognition sociale, mentalisation et fonctionnement réflexif
Définition de la cognition sociale. La cognition sociale fait référence aux
nombreux processus grâce auxquels les individus comprennent et donnent un sens au
monde qui les entoure (Frith, 2008). Autrement dit, il s’agit du processus par lequel un
individu, enfant ou adulte, se comprend lui-même et comprend les autres en termes de
comment ils pensent, ressentent, perçoivent, imaginent, réagissent, attribuent et infèrent
(Sharp, Fonagy et Goodyer, 2008). De nombreux mécanismes de cognition sociale ont été
identifiés, et ceux-ci existeraient sur deux niveaux. Certains mécanismes sont implicites,
largement automatiques, et considérés comme étant de bas niveau. Ces mécanismes de bas
niveau permettent l’imitation, la contagion émotionnelle et la reconnaissance d’émotions à
partir d’expressions faciales. Il existe également des mécanismes de plus haut niveau, qui
sont plus lents et flexibles, et qui demandent un plus grand effort mental. Ces processus
sont requis pour calculer les intentions, les croyances et les désirs d’autrui, et doivent donc
intégrer une représentation mentale de l’esprit de l’autre, tout en suspendant
temporairement sa propre perspective (Frith et Frith, 2008; Sharp et Vanwoerden, 2014).
Définition de l’empathie. L’empathie est un concept relié à la cognition sociale et
fait l’objet de nombreuses définitions. L’empathie étant un concept multidimensionnel, on
5y distingue généralement trois composantes : l’empathie cognitive, l’empathie émotionnelle
et l’empathie motrice. L’empathie cognitive réfère à la capacité de l’individu de se
représenter les états mentaux des autres, et donc à la théorie de l’esprit (Theory of Mind en
anglais [ToM]), ou mentalisation (Frith et Frith, 2003; Leslie, 1987; Sharp et coll., 2008).
L’empathie émotionnelle désigne plutôt la réponse émotionnelle aux émotions exprimées
par les autres (expressions faciales et vocales, mouvements corporels, etc.) (Sharp et coll.,
2008). L’empathie motrice se produit lorsqu’un individu reflète les réponses motrices d’une
personne qu’il observe (Preston et de Waal, 2002).
Définition de la mentalisation. La cognition sociale englobe de nombreux
construits, dont la mentalisation, qui correspond à la capacité de concevoir les états
mentaux chez soi et chez les autres. La mentalisation est un concept décrit autant dans les
domaines de la psychodynamique (Fonagy, Jurist, Target et Gergely, 2014) que de la
psychologie cognitive (Baron-Cohen, Tager-Flusberg et Lombardo, 2013; Morton et Frith,
1995). Le fonctionnement réflexif (FR) correspond à l’opérationnalisation du concept de
mentalisation, et réfère au processus mental qui sous-tend la capacité de mentaliser.
L’attribution d’états mentaux permet de donner du sens au comportement d’autrui, rendant
celui-ci prévisible (Fonagy, Target, Steele et Steele, 1998). Le FR s’inscrit dans le contexte
de l’attachement, et se développe dans le cadre des premières relations sociales de l’enfant
(Fonagy et coll., 2014; Fonagy et Target, 1997). Le FR implique à la fois une composante
autoréflexive et une composante interpersonnelle. Cette dernière permet à l’individu de
distinguer la réalité interne de la réalité externe, le faire semblant des modes de
fonctionnement « réels », et les processus mentaux et émotionnels intrapersonnels de la
communication interpersonnelle. Le FR est un processus automatique qui permet
d’interpréter de manière inconsciente l’action humaine. Le FR contribue également à
donner forme et cohérence à l’organisation de soi, et ce de manière tout aussi inconsciente,
contrairement à l’introspection, dont l’impact sur l’expérience de soi est clair et explicite
(Fonagy et coll., 1998).
Développement de la mentalisation. La mentalisation se développe dans le
contexte de la relation entre l’enfant et son parent et de leurs interactions. Selon Fonagy et
Campbell (2016), la compréhension qu’une personne a des autres dépend du fait que ses
6propres états mentaux aient été ou non adéquatement compris par des adultes attentionnés
et non menaçants. En effet, le contexte d’un attachement sécure est idéal au le
développement de la mentalisation, puisqu’il offre un environnement exempt d’obstacles à
son développement (Fonagy et Allison, 2012). Selon Fonagy et Allison (2012), le plein
développement de la mentalisation nécessite une interaction avec des esprits plus matures et
sensibles. Lorsque le parent reflète les états mentaux de l’enfant, il organise de ce fait son
expérience et l’aide à savoir ce qu’il ressent. Le reflet se doit d’être juste, mais un certain
écart entre le ressenti de l’enfant et la représentation du parent peut être bénéfique. Un
reflet trop exact peut faire en sorte que la représentation devienne une source de peur pour
l’enfant. Si le reflet n’est pas disponible, s’il est contaminé par les préoccupations du parent
ou si l’état mental de l’enfant est exagéré, cela peut compromettre le développement du soi
(Fonagy et Target, 1997). Il est donc de mise que le développement de la mentalisation peut
être compromis pour un enfant grandissant dans un contexte de maltraitance émotionnelle.
Impact de la maltraitance sur la mentalisation
Puisque la mentalisation se développe au sein du contexte familial et du lien
d’attachement, le fait de grandir dans un contexte d’adversité peut avoir un impact négatif
sur le développement des capacités de mentalisation et la cognition sociale en général.
Selon la théorie de la mentalisation de Fonagy, l’une des conséquences de la négligence, de
la maltraitance et de l’abus est le fait que les émotions de l’enfant ne sont pas reflétées de
manière sensible, ce qui compromet la capacité de l’enfant à comprendre ses états mentaux
et ceux des autres. De plus, dans un contexte d’abus, alors que le parent entretient des
intentions hostiles envers l’enfant, la reconnaissance des états mentaux des autres peut
devenir menaçante pour l’enfant, ce qui mine le FR. Enfin, un déficit de FR peut également
découler non pas des actes d’abus eux-mêmes, mais également de l’atmosphère familiale
qui les entoure (Fonagy et coll., 2014). Plusieurs études empiriques appuient cette
hypothèse théorique, montrant que les enfants ayant vécu de maltraitance présentent des
déficits au niveau de la ToM (Cicchetti, Rogosch, Maughan, Toth et Bruce, 2003; Germine,
Dunn, McLaughlin et Smoller, 2015; O’Reilly et Peterson, 2015; Pears et Fisher, 2005) et
de la reconnaissance des émotions (Ardizzi et coll., 2015; Camras, Grow et Ribordy, 1983;
da Silva Ferreira, Crippa et de Lima Osório, 2014; Leist et Dadds, 2009; Pears et Fisher,
72005; Pollak, Cicchetti, Hornung et Reed, 2000). Il est à noter que certaines études ont
trouvé que les adolescents ayant vécu de la maltraitance émotionnelle ne présentaient pas
de déficit sur le plan de la mentalisation (van Schie et coll., 2017) et que l’âge était un
modérateur de cette relation, les déficits de mentalisation s’atténuant avec l’âge (Luke et
Banerjee, 2013). En ce qui a trait à l’impact de la maltraitance sur le FR, moins de
connaissances empiriques sont disponibles. Selon Ensink, Normandin, et coll. (2015), les
enfants ayant un historique d’abus sexuel présentent des déficits de mentalisation par
rapport à soi et aux autres, avec un impact plus sévère lorsque l’abus est de nature
intrafamiliale. La mentalisation agit également comme médiateur de la relation entre l’abus
sexuel et les difficultés intériorisées et extériorisées chez les enfants. Autrement dit, le fait
d’avoir vécu un abus sexuel à l’enfance aurait un impact négatif sur la mentalisation, ce qui
explique une augmentation des symptômes dépressifs et des comportements extériorisés
(Ensink, Bégin, Normandin et Fonagy, 2016).
Cognition sociale, mentalisation et psychopathologie. Tel que rapporté par Sharp
et coll. (2008), la cognition sociale joue un rôle essentiel dans les interactions sociales et
permet de s’impliquer dans diverses activités humaines, telles que la famille, l’amitié,
l’amour, la coopération, le jeu et la communauté. De ce fait, un déficit de cognition sociale
peut avoir un impact très négatif sur la vie d’un individu et de sa famille, ainsi que sur sa
communauté. Plusieurs psychopathologies sont associées à un tel déficit, et cette relation a
fait l’objet d’un nombre grandissant d’études dans les dernières décennies. Certaines,
comme l’autisme, sont de l’ordre des troubles neurodéveloppementaux (voir Baron-Cohen
et coll., 1985), mais on retrouve aussi des déficits de cognitions sociales dans certains
troubles intériorisés, comme la dépression (Bora et Berk, 2016; Lee, Harkness, Sabbagh, et
Jacobson, 2005), et extériorisés (Gambin, Gambin et Sharp, 2015). Par ailleurs, la cognition
sociale constitue une pierre angulaire dans le développement de la personnalité, tant
normale que pathologique (Sharp et Vanwoerden, 2014). La mentalisation, en tant que
composante de la cognition sociale, peut être elle-même altérée, et des déficits sécifiques de
mentalisation peuvent être associés à différentes psychopathologies. Deux types de
difficultés de mentalisation sont identifiés : l’hypomentalisation (mentalisation faible ou
absente) et l’hypermentalisation (ou ToM excessive) (Dziobek et coll., 2006; Sharp et coll.,
2013).
8Triade noire, personnalité limite et cognition sociale
Quelques études ont examiné le lien entre la triade noire, la personnalité limite et la
cognition sociale, avec des résultats généralement peu cohérents. Dans leurs études, Lishner,
Hong, Jiang, Vitacco et Neumann (2015) ont testé l’hypothèse selon laquelle la
psychopathie et les traits de personnalité narcissiques et limites sont reliés à un déficit dans
l’expérience de l’empathie affective, en exposant des étudiants de premier cycle
universitaire, à une tâche implicite d’empathie affective. Selon leurs résultats, seule la
psychopathie (plus particulièrement les traits calleux) serait associée de manière consistante
à un déficit d’empathie affective. De manière similaire, Lee et Gibbons (2017) ont trouvé
que la psychopathie, en comparaison aux deux autres traits de la TN, était associée de
manière unique à une réduction de la compassion rapportée, alors qu’un déficit d’empathie
cognitive et affective agissait comme médiateur partiel de cette relation. Le narcissisme
était toutefois associé à un plus haut niveau de compassion rapporté, relation expliquée par
l’empathie émotionnelle. Les auteurs attribuent ce résultat à la propension des individus
narcissiques à exprimer leurs émotions et leur supériorité. Aucun lien significatif n’a été
révélé entre la compassion rapportée et le machiavélisme. Stellwagen et Kerig (2013) dans
leur étude sur la relation entre quatre dimensions de la TN (traits calleux-insensibles,
narcissisme, impulsivité et machiavélisme) et la ToM chez les enfants d’âge scolaire ont
observé que les traits calleux insensibles étaient négativement reliés aux capacités de ToM,
alors que le narcissisme y était positivement relié. Le machiavélisme et l’impulsivité
n’étaient pas significativement reliés aux capacités de ToM. Une autre étude (Schimmenti
et coll., 2017), menée auprès d’adultes, montre que tous les construits de la TN sont
positivement associés à l’alexithymie et négativement associés à l’empathie et à la ToM.
Cette variabilité dans les résultats peut être attribuable à l’utilisation de différents
instruments de mesure des construits de cognition sociale. La présente étude pourrait
contribuer à éclaircir la relation entre la triade noire, les traits de personnalité limite et la
cognition sociale. De plus, en abordant la cognition sociale sous l’angle du FR, ce projet
pourrait venir enrichir les connaissances en ce qui a trait aux déficits de cognition sociale
associés à la TN, puisque ceux-ci ont principalement été étudiés sous l’angle de l’empathie
et de la ToM.
9Narcissisme et mentalisation. Si un manque d’empathie constitue un critère du
trouble de personnalité narcissique (TPN) (DSM-5; American Psychiatry Association,
2013), le lien entre narcissisme pathologique et cognition sociale a longtemps manqué de
support empirique. Un nombre grandissant d’études s’est intéressé à la question, mais
considérant le caractère multidimensionnel de l’empathie et du narcissisme, les résultats
demeurent peu cohérents à ce jour. Une étude de Ritter et coll., 2011) révèle que les patients
ayant un TPN présentent un déficit d’empathie affective, tout en conservant une bonne
capacité d’empathie cognitive. L’étude de Marissen, Deen et Franken (2012) contredit
toutefois ces résultats. Ces chercheurs ont observé que les individus ayant un diagnostic de
TPN présentaient un déficit dans la reconnaissance d’expressions émotionnelles, plus
spécifiquement en ce qui a trait à la peur et au dégoût, et concluent donc à un déficit
d’empathie cognitive. Ces résultats divergents pourraient être expliqués par le fait que les
observations de Marissen et coll. (2012) se limitent à la reconnaissance d’émotions.
En ce qui a trait au FR, l’étude de Duval, Ensink, Normandin et Fonagy (2019)
montre que le narcissisme grandiose est positivement associé à une certitude excessive
quant aux états mentaux d’autrui. Ces résultats sont cohérents avec ceux d’Ames et
Kammrath, 2004). En effet, ces auteurs ont trouvé que les individus qui performaient le
moins bien en termes de mentalisation étaient aussi ceux qui surestimaient le plus leur
performance, et que le narcissisme grandiose permettait de prédire cette surestimation des
compétences. Duval, Ensink, Normandin et Fonagy (2019) sont toutefois allé plus loin,
montrant également que le narcissisme vulnérable était associé à une confusion et une
difficulté à identifier et distinguer les états mentaux. Il semblerait de plus que le
narcissisme vulnérable serait associé à un déficit dans la capacité de prendre la perspective
d’autrui (empathie cognitive) tout comme dans la capacité de comprendre
émotionnellement l’expérience des autres (empathie affective) (Luchner et Tantleff-Dunn,
2016). Le manque de consensus quant aux altérations de la cognition sociale associées au
narcissisme pathologique montre la nécessité de poursuivre la recherche dans ce domaine et
soutien la pertinence de la présente étude.
Psychopathie et mentalisation. Tel que rapporté ci-haut, un déficit d’empathie
découlant d’un dysfonctionnement émotionnel constitue l’une des deux composantes
10centrales de la psychopathie. Peu d’études ont utilisé des mesures précises et valides de
mentalisation. Toutefois, il existe plusieurs études portant sur des variables apparentées.
Ainsi, la littérature suggère que le déficit de cognition sociale associé à la psychopathie
serait d’ordre affectif plutôt que cognitif. En effet, plusieurs études n’ont pas montré la
présence de déficit de théorie de l’esprit, terme parfois utilisé de manière interchangeable
pour désigner la mentalisation (Blair et coll., 1996; Dolan et Fullam, 2004; Jones, Happé,
Gilbert, Burnett et Viding, 2010; Morosan et coll., 2017; Nentjes, Bernstein, Arntz, Slaats et
Hannemann, 2015), soutenant l’idée que le réel déficit consiste plus en un manque d’intérêt
envers les victimes potentielles plutôt que des difficultés de mentalisation. Supportant cette
explication, Drayton, Santos et Baskin-Sommers (2018) ont trouvé que les individus
psychopathes auraient la capacité de prendre intentionnellement la perspective d’autrui,
mais présenteraient une propension réduite à penser automatiquement ou spontanément
selon la perspective d’autrui.
D’autres études utilisant des conceptions différentes de la mentalisation sont
toutefois arrivées à des résultats différents. Sharp et Vanwoerden (2014) ont étudié la
relation entre les traits psychopathiques chez les adolescents et la ToM, en utilisant une
conception plus large de la ToM, incluant des mécanismes de haut et de bas niveaux, et une
distinction entre une ToM réduite et une ToM excessive. Leurs résultats soulignent une
relation unique entre la composante affective de la psychopathie (traits calleux-insensibles)
et une altération des processus de bas niveau et de haut niveau de la ToM. De plus, la
composante affective de la psychopathie serait associée à une ToM excessive, alors que les
composantes comportementales seraient plutôt associées à une réduction ou une absence de
ToM. En ce qui a trait au FR, Taubner, White, Zimmermann, Fonagy et Nolte (2013) ont
trouvé que chez les adolescents, les traits psychopathiques étaient associés à un niveau plus
bas de FR. Le FR constitue un concept intéressant dans l’étude des déficits de mentalisation
associés à la psychopathie, puisqu’il tient compte du contexte affectif.
Machiavélisme et mentalisation. Peu d’études se sont penchées spécifiquement sur
la relation entre la mentalisation et le machiavélisme. Parmi les études rapportées ci-haut
ayant étudié simultanément les trois construits de la TN en relation avec la cognition
sociale, certaines ont constaté une absence de lien entre le machiavélisme et la cognition
11sociale (Lee et Gibbons, 2017; Stellwagen et Kerig, 2013), alors qu’une étude a mis en
lumière un déficit, plus précisément une association positive entre le machiavélisme, une
théorie de l’esprit réduite, une faible empathie et l’alexithymie (Schimmenti et coll., 2017).
Bernáth et Kovács (2013) ont étudié le lien entre trois facteurs de mentalisation, soit le
besoin de mentaliser (ou de « lire » les autres), le besoin de relations sereines et l’attitude
envers la mentalisation. Les individus présentant un haut degré de machiavélisme
rapportaient un besoin plus faible de mentaliser, mais n’étaient pas différents des individus
peu machiavéliques sur les deux autres facteurs. Les auteurs concluent donc que ces
résultats appuient la théorie selon laquelle les individus ayant un haut degré de
machiavélisme performent moins bien aux tâches de mentalisation parce qu’ils sont moins
intéressés à lire les états mentaux des autres (argument motivationnel).
Personnalité limite et mentalisation. Les traits de personnalité limite, tout comme
les construits de la TN, ont également été associés à des déficits de cognition sociale.
Certains chercheurs ont observé que les adolescents ayant un trouble de la personnalité
limite (TPL), lorsque comparés à ceux ayant un trouble dépressif majeur, performaient
moins bien à une tâche sollicitant la composante affective de la ToM, mais les deux groupes
ne présentaient pas de différence pour ce qui est de la composante cognitive de la ToM (Tay,
Hulbert, Jackson, et Chanen, 2017). En ce qui a trait à la reconnaissance d’expressions
faciales, les personnes présentant plus de traits limites auraient tendance à détecter des
émotions négatives qui sont à peine présentes, mais cela serait plus vrai pour les individus
présentant un faible contrôle volontaire (Meehan et coll., 2017). Selon Fertuck et coll.
(2009), toutefois, les individus présentant un trouble de la personnalité limite
performeraient mieux que les individus sains en ce qui a trait à la reconnaissance des
émotions à partir des yeux. Les auteurs suggèrent que cette sensibilité supérieure aux états
mentaux des autres pourrait être à la base des déficits sociaux associés à la personnalité
limite. Les individus ayant un trouble de personnalité limite auraient également une
meilleure capacité de ToM, et seraient donc meilleurs pour attribuer des états mentaux aux
autres (Franzen et coll., 2011). Sharp et coll. (2011) ont alors soulevé que les difficultés de
mentalisation observées en lien avec la personnalité limite pourraient découler de
l’émergence d’une stratégie alternative inhabituelle, soit l’hypermentalisation, plutôt que
d’un réel déficit ou une perte de la capacité de mentaliser (hypomentalisation ou absence de
12mentalisation). Sharp et coll. (2013) définissent l’hypermentalisation comme un processus
social-cognitif amenant l’individu à faire des assomptions quant aux états mentaux d’autrui
qui dépassent largement ce qui est observable, au point où il est difficile pour les autres de
voir en quoi ces assomptions sont justifiées. Selon Sharp et coll. (2013), il existe une
relation spécifique entre la personnalité limite et l’hypermentalisation, indépendamment des
difficultés intériorisées et extériorisées. Concernant le FR, Sharp, Penner et Ensink (2019)
ont trouvé une relation inverse entre le FR et les traits de personnalité limite, mais
seulement en présence de troubles extériorisés.
Triade noire, personnalité limite et maltraitance
Le narcissisme pathologique, la psychopathie, le machiavélisme et la personnalité
limite partagent certains facteurs étiologiques communs. Notamment, ces construits de
personnalités ont tous été associés à un environnement adverse à l’enfance, que ce soit
empiriquement ou théoriquement. Miller et coll., (2010) ont observé que le narcissisme
vulnérable, la personnalité limite et le facteur 2 de la psychopathie étaient tous associés à
un patron similaire d’abus à l’enfance, alors que le narcissisme grandiose et le facteur 1 de
la psychopathie seraient plus faiblement reliés à ces facteurs étiologiques. Afifi et coll.
(2011), ont obtenu des résultats similaires, observant une association robuste entre l’abus et
la négligence à l’enfance et les troubles de la personnalité du cluster B, incluant les troubles
de la personnalité limite, narcissique et antisociale.
Peu d’études empiriques sont disponibles en ce qui concerne les aspects
développementaux du narcissisme pathologique, dont le vécu traumatique. Ménard et
Pincus (2014) ont observé que la maltraitance était positivement associée au narcissisme
grandiose et vulnérable, alors que Miller et coll. (2010) ont trouvé que le vécu traumatique
prédisait uniquement les aspects vulnérables du narcissisme. Selon Ensink, Chrétien,
Daigle, Normandin et Fonagy (sous presse) le narcissisme, tant grandiose que vulnérable,
est associé positivement au maltraitement (antipathie, négligence, abus psychologique,
physique et sexuel) chez les adolescents, mais uniquement chez les filles. Les auteurs
suggèrent que l’absence de lien significatif chez les garçons pourrait s’expliquer par une
plus grande vulnérabilité des filles aux effets de la maltraitance. Selon Kernberg, (1975), le
narcissisme pathologique se développerait dans un contexte familial impliquant des parents
13Vous pouvez aussi lire