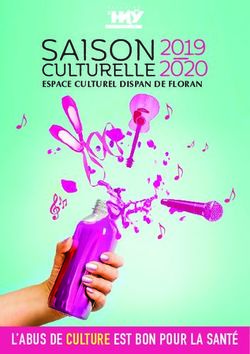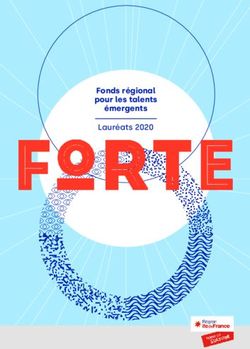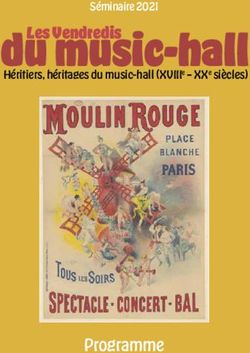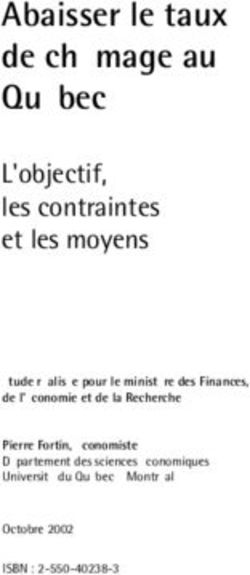Études de genre & éducation au cinéma - Un glossaire en 10 entrées Par Mélanie Boissonneau - Les deux scènes
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Études
de genre
& éducation
au cinéma
Un glossaire en 10 entrées Lycéens et apprentis au cinéma
Par Mélanie Boissonneau en Bourgogne-Franche-Comté
Académie de BesançonSommaire Introduction
Introduction p.3 L’analyse d’un film peut s’appuyer sur Lycéens et apprentis
Corps p.4
plusieurs approches (formelle, historique
ou narrative) afin de comprendre comment au cinéma
Gaze p.6 s’articulent émotions, affects et mécanismes
Gender studies p.8
d’interprétation ou de production de sens.
Le courant des études de genre (gender
Lycéens et apprentis au cinéma est
un dispositif national interministériel, initié
Genre p.10 studies) propose d’étudier, parallèlement et financé en Bourgogne-Franche-Comté
Héroïnes p.12
à ces approches, les représentations des
rapports de genre dans les films qui souvent
par la Région Bourgogne-Franche-Comté,
le ministère de la Culture (DRAC et CNC),
Hétéronormativité p.14 véhiculent les rapports de domination en partenariat avec le Rectorat de l’Académie
Patriarcat p.16
(ici, genrées) des sociétés qui les produisent.
Il ne s’agit pas d’interdire certaines représen-
de Besançon, la DRAAF, les salles et le circuit
de cinéma itinérant de la région. Ce dispositif
Queer p.18 tations qui seraient aujourd’hui politiquement est coordonné pour l’Académie de Besançon
Sous les feux de la rampe p.20
incorrectes, mais bien de déconstruire, afin
de mieux comprendre. Pour se doter
par les 2 Scènes.
Stéréotype p.22 des outils d’analyse et de réflexion néces-
Bibliographie sélective saires, nous avons fait appel à Mélanie
©Gilles Rammant
p.23 Boissonneau, universitaire spécialiste
de cinéma. Elle nous offre, avec ce glossaire
en dix entrées, accompagnées de pistes
pédagogiques, un éclairage aussi passionnant
qu’indispensable dans le cadre de l’éducation
au cinéma, et au-delà.
Marc Frelin
Coordinateur du dispositif Lycéens et apprentis
au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté /
Académie de Besançon
L’autrice
Mélanie Boissonneau enseigne le cinéma
à l’Université, elle intervient également
comme formatrice dans le champ de l’éduca-
tion au cinéma et comme chroniqueuse pour
FilmoTV. Elle a notamment publié Pin Up :
au temps du Pré-code : 1930-1934 (LettMotif,
2019) et elle a récemment co-écrit, avec
Laurent Jullier, Héroïnes ! De Madame Bovary
à Wonder Woman (Larousse, 2020).
Coordination du dispositif Licences d’entrepreneur de spectacles :
Marc Frelin | marc.frelin@les2scenes.fr L-R 2021-006336/006340/006300/006460
Design graphique : Thomas Huot-Marchand
stand. 03 81 51 03 12 | dir. 03 81 55 37 28 Directrice de la publication : Anne Tanguy
Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon Rédaction : Mélanie Boissonneau
CS 22033 - Place de l’Europe, 25050 Besançon Cedex Impression : Ville de Besançon
Couverture : Thelma et Louise ©2020 Solaris Distribution –
www.les2scenes.fr/lyceens-et-apprentis-au-cinema
Wonder Woman ©Warner Bros
2 3Corps Piste
pédagogique
Recherche & analyse d’images – Proposer
aux élèves de sélectionner chacun deux
images de corps au cinéma, l’une qui leur
Corps de cinéma Corps au cinéma
semble valorisante pour le personnage
et l’autre non, en réalisant des captures
d’écran, à partir de films qu’ils connaissent
Comme l’analysent Laurent Jullier et Bernard Au cinéma, le corps, féminin tout d’abord, à titre personnel ou qu’ils ont étudiés
Andrieu (dans la revue Corps n°9), mais aussi masculin (selon les genres en classe. Les élèves, par petits groupes,
au cinéma, il y a « le corps d’avant », qui sert et les époques) est particulièrement exposé. en visionnant les images, s’interrogeront sur
à faire le film. Il s’agit du corps du « modèle », Dès son invention, le cinéma a été utilisé pour la façon dont ces corps sont représentés
qui peut appartenir à une personne réelle montrer des corps. Lorsqu’ils montraient (cadrage, scénographie, costumes, postures
(un acteur, le plus souvent) ou être fabriqué des corps nus, les films restaient le plus et attitudes, rapport aux autres personnages
par un dessinateur ou un infographiste, souvent cantonnés au marché underground, éventuels…). Il s’agira de s’interroger sur
même si, dans de nombreux cas, un corps fournissant notamment les lieux de prostitu- la façon dont l’ensemble des paramètres
« réel » est utilisé comme modèle. Il y a aussi, tion. C’est en 1933 que l’on voit pour la pre- de mise en scène est corrélé au sens produit
de l’autre côté de l’écran, le « corps d’après », mière fois une scène de nudité intégrale par l’image. Puis, en classe entière, les images
un vrai corps, celui du spectateur, qu’il soit en dehors de la pornographie, avec le film en question seront projetées et commentées
dans une salle de cinéma, devant sa télévi- Extase de Gustav Machatý, mettant en scène par le groupe.
sion, son téléphone ou son ordinateur. à la fois le corps nu et le plaisir féminin, grâce
Les deux corps, celui d’avant (le corps à l’actrice Hedy Lamarr. Mais la nudité n’est
de cinéma) et celui d’après (le corps spectato- pas pour autant encouragée et fait même
riel), ont de nombreux points communs l’objet de censure, même avant le renforce-
et interagissent. Le corps spectatoriel réagit ment du code Hays, un code de censure qui
de façon immédiate, en riant, pleurant régule la production cinématographique
et sursautant en voyant le corps de cinéma américaine jusqu’à la fin des années 1960. Tarzan et sa compagne – Cedric Gibbons et Jack Conway
évoluer à l’écran. Nous subissons aussi Et la scène de nu féminin sous l’eau de Tarzan
l’influence du corps de cinéma en différé, et sa compagne (Cedric Gibbons et Jack
en adoptant des gestes, des attitudes, Conway, 1934) sera coupée au montage. Tarzan et sa compagne – Cedric Gibbons et Jack Conway
des expressions en provenance des écrans. Pour autant, l’exposition des corps fait vendre
C’est l’objet d’une célèbre conférence de l’an- et devient un véritable outil marketing pour
thropologue Marcel Mauss en 1934 qui décrit les studios hollywoodiens. Ce phénomène
la façon dont il s’est rendu compte, lors d’une touche les femmes, avec notamment Marilyn
hospitalisation à New-York, de l’impact Monroe, qui a fondé sa carrière sur l’exposi-
du cinéma sur les corps des individus, tion de sa nudité et sa suggestion.
en observant la démarche des infirmières. Mais les hommes sont aussi concernés,
Après avoir constaté que leur démarche était comme en témoigne, dans les années 1950,
la même que celle des actrices américaines la surexposition des corps masculins,
des films de l’époque, il retourne en France et en particulier des torses, sous prétexte
et remarque la même démarche chez de péplums, peuplés de stars dénudées (Kirk
les jeunes Parisiennes : « les modes de marche Douglas, Charlton Heston, Yul Brynner…)
américaine, grâce au cinéma, arrivaient chez et de bodybuilders (Steve Reeves, Reg Park…).
nous. C’était une idée que je pouvais William Holden, star de l’époque, n’a même Certains l’aiment chaud – Billy Wilder
généraliser ». pas besoin de prétexte pour ôter la chemise,
ce qui lui vaut d’être bientôt surnommé de
« The body ». Les films d’action des années
1980, comme les films de super-héros depuis
les années 2000, relancent la mode des corps
masculins très musclés et exposés (Sylvester
Stallone, Arnold Schwarzenegger…).
4 5Gaze Pistes
pédagogiques
Définition Au cinéma
Gaze peut-être littéralement traduit Férue de psychanalyse, la théoricienne
par « regard ». Mais il s’agit surtout d’un outil du cinéma Laura Mulvey s’en empare
critique, conceptualisé au départ par la psy- en 1975 pour analyser le cinéma hollywoo-
chanalyse (Sigmund Freud, Jacques Lacan) dien dans un article fondateur : Plaisir visuel
et la philosophie (Michel Foucault) pour et cinéma narratif. Ce travail, qui aura
montrer que le « regard » implique plus que une résonance médiatique très importante
l’action de regarder, mais place le « porteur dans les pays anglo-saxons, participe
du regard » dans une situation de supériorité à l’analyse critique du cinéma hollywoodien (1) Analyse de séquence #1 - Le Facteur sonne (2) Analyse de séquence #2 - La Leçon
par rapport à l’objet du regard. comme instrument de la domination patriar- toujours deux fois (Tay Garnett, 1946). À partir de Piano (Jane Campion, 1992) - À partir
Le critique d’art anglais John Berger utilise cale. L’autrice met au jour un dispositif de la séquence d’introduction du personnage de l’ouverture du film, décrire les éléments
le concept de male gaze dans Ways of seeing cinématographique reposant sur une vision de Cora (Lana Turner), décrire la mise de mise en scène qui permettent d’adopter
(traduit en France par Voir le Voir) une série masculine (et hétérosexuelle) qui construit en scène du corps de Cora (morcelé, comme le point de vue de l’héroïne (point de vue
de films diffusés avec succès sur la BBC et relaie la fiction (par l’intermédiaire celui d’une pin-up…) et la façon dont la mise subjectif, musique, voix-off). Le point de vue
en 1972, puis dans un livre, qui analysent du réalisateur puis de l’acteur) et auquel toute en scène conduit à épouser le point de vue subjectif (que l’on déduit du plan montrant
le traitement du corps féminin dans la pein- spectatrice et tout spectateur est tenu du personnage masculin (en transcrivant le monde à travers les mains de l’héroïne) est
ture européenne. de s’identifier. Elle démontre ainsi, notam- le regard du personnage masculin par un tra- renforcé par la voix-off de l’héroïne et nous
ment, la façon dont « le plaisir de regarder velling ascendant puis, en fin de séquence, permet, en tant que spectateur privilégié (les
a été partagé entre actif / masculin et passif / son état psychologique, avec l’image autres personnages n’entendent pas cette voix
féminin », ce qui a pour conséquence de la viande trop cuite, signifiant littéralement intérieure) d’épouser son regard, de nous
de transformer les femmes en objets que la situation est « brûlante »). mettre à la place du personnage féminin.
du regard (supposé masculin : le male gaze). Voir l’extrait en ligne : bit.ly/extraitfacteur Voir l’extrait en ligne : bit.ly/extraitleçon
Cette binarité a été depuis nuancée
par de nombreux chercheurs et par Laura
Mulvey elle-même, mais le concept de male
gaze est resté très présent dans les études
féministes et gender studies, et bénéficie
depuis quelques années d’une popularité
grandissante.
En réponse à ce male gaze, certains auteurs
proposent dès 1975 d’analyser le female gaze,
que Laura Mulvey a laissé en suspens dans
son analyse. Il s’agit avant tout de considérer
la possibilité pour les femmes de devenir sujet
du regard. Dans son ouvrage sorti en 2020,
Le regard féminin, une révolution à l’écran,
l’autrice Iris Brey propose de considérer
le female gaze non pas comme une inversion
du male gaze, qui reviendrait à fétichiser
les corps masculins, mais comme une façon
de faire ressentir une expérience féminine,
sans toutefois relier ce female gaze à l’identité
du créateur ou de la créatrice du film.
6 7Gender Studies Définition Au cinéma Avant toute chose : il n’existe pas de « théorie Geneviève Sellier a bien montré les résis- du genre ». Les gender studies, ou « études sur tances françaises aux gender studies (et le genre », ou « étude genre » désignent aux approches socioculturelles en général), un champ de recherche prenant pour objet dans le champ des études filmiques. les rapports sociaux hiérarchisés entre Intimement liées aux origines politiques les sexes. Par définition elles sont transver- de la discipline, et à la conception française sales et parcourent de nombreuses disci- de la cinéphilie, ces résistances sont explici- plines, aussi bien dans les sciences « dures » tées en particulier dans son article de 2005 (comme la neurobiologie avec les travaux Gender studies et études filmiques (disponible de Catherine Vidal) que « tendres » (histoire, en ligne). sociologie, littérature, esthétique, L’apport des gender studies aux études philosophie…). filmiques est pourtant important. Il s’agit Au cours des années 1970, les gender studies surtout de montrer la façon dont le cinéma (et se sont tout d’abord développées aux les productions audiovisuelles en général) États-Unis, au sein des feminist studies construit par des moyens qui lui sont propres ou women’s studies, dans le prolongement (mise en scène, jeu de l’acteur, montage, des mouvements féministes de la Deuxième éclairage, maquillage, casting…) une vision Vague. C’est dans les années 1980 que hiérarchisée de la différence des sexes. le terme de gender studies s’est diffusé, Les gender studies concernent donc les films en même temps que l’institutionnalisation (et des séries) en eux-mêmes mais aussi leur de ce champ de recherche (en intégrant réception, en s’intéressant par exemple les différentes disciplines universitaires, à la cinéphilie féminine (Thomas Pillard, ou en créant des départements et des équipes Geneviève Sellier, Jean-Marc Leveratto, de recherche spécialisés). Delphine Chedaleux) ou aux fans (Mélanie En France, dans les années 1970, Bourdaa et Arnaud Alessandrin). les premiers groupes de recherche féministes universitaires entremêlent également perspectives savantes et militantes, afin de livrer, comme le rappelle Christine Bard, des « théories pour l’action ». Dans les années 1990, les études féministes connaissent un nouvel essor, visible par la création de revues (« Cahiers du genre », « Clio », « Travail, genre et sociétés », « Nouvelles questions féministes ») et l’organisation de colloques où le concept de genre est de plus en plus employé. Mais c’est surtout à partir des années 2000 qu’une nouvelle génération d’universitaires développe des recherches autour des problématiques « genre », croisant aujourd’hui d’autres systèmes de domination (classe, « race », âge, orientation sexuelle…), dans une perspective intersectionnelle. 8 9
Genre Pistes
pédagogiques
Définition Au cinéma
Dans le domaine du cinéma, le terme Aborder la question du genre (gender) permet
« genre » nécessite un double travail de défini- un apport de connaissances. Dans le domaine
tion. Il s’agit tout d’abord de distinguer du cinéma, cela se traduit très concrètement
le genre cinématographique, qui renvoie par la redécouverte et la mise en valeur
le plus souvent à des catégories permettant du travail des femmes, en particulier celui
de définir et de classer les films (western, des réalisatrices oubliées des histoires
mélodrame, comédie, burlesque, fantastique du cinéma. Citons côté français Alice Guy,
par exemple) et le genre en tant que concept pionnière du cinéma de fiction et Jacqueline (1) Analyse de séquence #1 - Panique (Julien (2) Analyse de séquence #2 - Certains l’aiment
(gender, en anglais) dont la première caracté- Audry, réalisatrice à succès dans les années Duvivier, 1947), la scène de retrouvailles chaud (Billy Wilder, 1959), la scène d’arrivée
ristique est de faire éclater les visions 1940-1950. Aux États-Unis, les films d’Alice et d’Alfred. Repérer dans le dialogue, des deux héros à la gare. Dans cette séquence,
essentialistes de la différence des sexes. de Dorothy Arzner et Ida Lupino font enfin le jeu d’acteur (gestes, postures, intonations) nous voyons pour la première fois les deux
Autrement dit, le genre (gender) n’est pas l’objet de rétrospectives et de sorties en DVD et la mise en scène (cadrage, éclairage), ce qui personnages masculins habillés en femme
une « donnée » historique mais une construc- et Blu-Ray. En plus de cette lutte contre caractérise chaque personnage, l’assigne pour échapper à des gangsters. On s’interro-
tion sociale, comme l’avait déjà théorisé l’invisibilisation des femmes et de leur travail, à un genre précis, et définit un rapport gera sur la façon dont la mise en scène joue
Simone de Beauvoir avec son célèbre le genre constitue un outil d’analyse critique de domination / soumission. Les deux notions sur le décalage entre la manière de les filmer
« On ne naît pas femme, on le devient » de l’ensemble des productions, largement du terme « genre » se rejoignent ici, avec (comme des personnages féminins classiques,
en 1949 et comme l’expliquent les travaux androcentrées (envisagées du point de vue les archétypes du film noir : Alfred est c’est-à-dire que l’on cadre le bas du dos
des neurobiologistes (Catherine Vidal, des hommes). Si le concept de genre a bien le voyou et Alice passe du personnage et les jambes pour les suivre) et leur façon
notamment) sur la plasticité cérébrale du mal à se frayer une place au sein de la cri- de femme fatale / vamp à celui de femme de bouger (maladroits, ils ne parviennent pas
(c’est-à-dire la non programmation génétique tique cinéphile française historique (cf entrée au grand cœur, entre soumission et sacrifice. à marcher avec les talons). Petit à petit,
des garçons et des filles à la naissance, Gender Studies), internet permet de diffuser On pourra porter une attention précise ils entrent dans leurs rôles en modifiant leur
et le cerveau qui se modifie en permanence, des analyses et des critiques abordant à la gestuelle (la « faible femme » qui nécessite façon de marcher. Leur dialogue insiste sur
quel que soit le sexe). Le genre en tant que les films et les séries en considérant une protection, par exemple) et l’éclairage le talent et les spécificités nécessaires
concept est aussi un rapport de pouvoir qui explicitement leur dimension genrée. classique en trois points avec la back à la performance féminine. Daphné,
considère que les sexes sont socialement C’est le cas du site Le genre & l’écran light (lumière de contre-jour) qui auréole en contemplant la démarche de Sugar
différents et qu’ils sont hiérarchisés selon (www.genre-ecran.net) créé par Geneviève le personnage féminin d’un halo lumineux (Marylin Monroe) admire sa prestance
une domination des hommes sur les femmes Sellier en octobre 2016 qui propose dans (à la fois objet de désir et figure sacrificielle, et sa grâce : « c’est comme de la gelée sur
(dans la quasi-totalité des sociétés connues). son manifeste de prendre en compte « la façon garce et sainte – dimension soulignée des ressorts », « c’est un sexe complètement
Enfin, le genre est imbriqué dans d’autres dont les fictions audiovisuelles construisent, par la musique, le regard quasi mystique vers différent », ce à quoi Joséphine répond
rapports de pouvoirs : classe sociale, « race » avec les moyens formels qui sont les leurs, le ciel du premier gros plan). « personne ne te demande d’avoir un bébé ».
(en tant que catégorie historiquement les identités genrées, les rapports de sexe Voir l’extrait en ligne : bit.ly/extraitpanique Voilà qu’en quelques phrases, le sexe biolo-
et politiquement construite), âge, orientation et les sexualités, en prenant en compte gique est distingué du genre (qu’ils peuvent
sexuelle (etc) dont l’analyse est qualifiée les dynamiques de domination sociale dont désormais choisir d’incarner dans la suite
« d’intersectionnelle ». ils sont le terrain et l’enjeu ». du film) !
Voir l’extrait en ligne : bit.ly/extraitcertains
10 11Héroïnes Piste
pédagogique
Recherche & analyse d’images : proposer
aux élèves d’établir une liste de séries
et de films qu’ils ont vu (dans un cadre
Définition Au cinéma
personnel ou scolaire), en relevant les titres
portés par des héroïnes ou comportant
des personnages féminins importants.
La définition : voilà bien le premier souci que Il est toujours intéressant de partir Une fois les personnages listés, demander
rencontrent les héroïnes, et surtout l’héroïne, des chiffres. Au cinéma, des études améri- aux élèves d’en choisir un ou deux – images
qui, dans les dictionnaires et sur internet est caines (Geena Davis Institute) et françaises à l’appui - en se posant des questions sur leur
avant tout une drogue ! Il y a pourtant (CNC) parviennent aux mêmes résultats : statut : ont-elles un rôle dans l’histoire ou bien
toujours eu des femmes héroïques mais environ 30 % des personnages parlants sont peuvent-elles être enlevées du film sans que
la fiction a bien du mal à les représenter. féminins, et seulement 21% lorsqu’il s’agit cela impacte le déroulé de l’action ?
Si l’on considère l’ensemble des fictions de films d’action et d’aventure, alors que Comment sont-elles décrites (physiquement, Cléo de 5 à 7 – Agnès Varda
produites par la littérature, le cinéma, le cinéma d’horreur parvient à une réparti- mais aussi psychologiquement) ? Comment
la télévision ou les jeux vidéo, le personnage tion paritaire de la parole. Face à ce constat sont-elles mises en scène lors de leur
féminin est le plus souvent secondaire, sans appel, l’institut de recherche fondé première apparition (que font-elles et com-
et même lorsqu’il devient principal, peut par l’actrice Geena Davis - co-héroïne, ment sont-elles filmées) ?
souffrir du « syndrome de Trinity », en réfé- rappelons-le, de Thelma et Louise (Ridley Scott
rence au personnage féminin de Matrix (Les 1991) - s’est construit sur ce mantra : « if you
Wachowski, 1999), et qui désigne l’injustice can see it, you can be it !». « Si tu peux le voir,
qui veut qu’à qualification égale et même tu peux l’être » s’érige alors comme une façon
supérieure, le candidat soit préféré à la candi- de promouvoir la diversité des représenta-
date (comme Néo est préféré à Trinity malgré tions féminines (au cinéma et dans les médias
la supériorité de cette dernière). en général). En plus de révéler les inégalités
Par ailleurs, on peut choisir de considérer en terme de représentation et d’en guetter
le mot « héroïne » comme synonyme l’évolution (déjà palpable, dans le cinéma
de « personnage digne d’intérêt » et pas hollywoodien), il est important de mettre Thelma et Louise – Ridley Scott
forcément pour désigner quelqu’un qui en avant les héroïnes déjà existantes, dans
accomplit un acte héroïque au péril de sa vie, tous les genres cinématographiques : de Ann
ou un personnage principal. Ainsi, bien que Darrow dans King Kong (Merian C. Cooper
Jane ne soit pas le personnage principal dans et Ernest B. Schoedsack, 1933) à Cléo de 5 à 7
les aventures de Tarzan (littéraires puis (Agnès Varda, 1962) en passant par la prin-
cinématographiques), elle peut être, suivant cesse Fiona dans Shrek (Andrew Adamson
les versions, considérée ou non comme et Vicky Jenson, 2001), Sarah Connor dans
une héroïne. On peut donc proposer que Terminator (James Cameron, 1984), Ellen
ce qui constitue l’héroïne de fiction repose sur Ripley dans Alien (Ridley Scott, 1979) ou Ada
le fait qu’elle laisse des traces dans l’imagi- dans La Leçon de piano (Jane Campion, 1993),
naire collectif, et qu’elle puisse servir pour n’en citer qu’une poignée. Il convient
de modèle au public qui croise son chemin. également de signaler, et c’est le propre
du cinéma, que la mise en scène fait beaucoup
dans la construction de l’héroïne.
Ainsi, Wonder Woman, filmée par Patty
Jenkins en 2017 est un personnage bien
différent que celui filmé par Zack Snyder
un an plus tôt dans Batman vs Superman (il
s’agit pourtant de la même actrice, Gal Gadot,
mais pas du même réalisateur). Wonder Woman – Patty Jenkins
12 13Hétéronormativité Piste
pédagogique
Définition
ou de Richard Dyer, consacrés à l’histoire
des représentations de l’homosexualité
au cinéma, ont bien décrit les stéréotypes
La sociologue Natacha Chetcuti rappelle que dont sont victimes les rares personnages
les termes d’homosexualité et hétérosexualité homosexuels, tout d’abord utilisés à des fins
sont introduits en France à la fin du XIXe humoristiques, comme des objets risibles
siècle. L’hétérosexualité (à visée procréatrice) (Behind the scene, Charlie Chaplin, 1916), puis
suppose une attirance pour le sexe opposé. devenus des personnages en souffrance, qu’il
La chercheuse explique également que, dans faut « guérir » ou éliminer. Se multiplient
ce contexte, l’une des figures de l’opposition alors les personnages de lesbiennes en prison,
à l’ordre « naturel » va être celle de d’homosexuels assassinés ou suicidés, comme Étude de texte et analyse de bande-annonce :
l’homosexuelle. Le terme d’hétéronormativité, dans La Fureur de vivre (Nicholas Ray, 1955), À partir de l’article de Geneviève Sellier
apparait pour la première fois dans le mani- Tea and Sympathy (Vincente Minnelli, 1956), « De battre mon cœur s’est arrêté (Audiard,
feste des Radicalesbians écrit en 1970. ou même Johnny Guitare (N. Ray, 1954) avec 2005) : la masculinité comme souffrance » qui
La notion, théorisée par les chercheuses le personnage d’Emma. Aujourd’hui encore, décrit la façon dont le personnage masculin
féministes, gays et lesbiennes, fait de l’hétéro- l’hétéronormativité continue de décimer « fait l’apprentissage de son identité mascu-
sexualité un modèle normatif définissant les personnages LGBT+ au cinéma et à la télé- line hétérosexuelle » et de son analyse
un système de genre, binaire, asymétrique, vision, au point de pousser les internautes du film, revoir la bande-annonce du film.
où au genre masculin correspond le sexe mâle à dénoncer le phénomène en le nommant : En dégager les éléments marquants repérés
(et au féminin le sexe femelle), et où l’hétéro- « Bury your gays » (littéralement : « enterre par Geneviève Sellier : masculinité en souf-
sexualité (reproductive) est obligatoire. tes gays ») et en comptabilisant le nombre france (mise en scène du personnage
affolant de personnages LGBT+ qui de Romain Duris, dans le noir, en crise, criant,
Au cinéma
connaissent une fin tragique. blessé), hétérosexualité et violence héritées
Par ailleurs, ce que les historiens du cinéma du père (vocabulaire employé par Niels
nous apprennent aussi, c’est que réalisateurs, Arestrup, injonction à la violence), femmes
Pour le chercheur Stevi Jackson l’hétéronor- acteurs, scénaristes, ont toujours tenté transformées en personnages utilitaires
mativité « ne définit pas seulement une pra- de contourner cette norme, par des dialogues (objets sexuels pour les trois femmes fran-
tique sexuelle normative, mais aussi un mode à double sens plus ou moins explicites çaises, et une femme « idéale », éthérée
de vie normal ». L’hétéronormativité est donc ou des sous-textes visibles par celles et ceux et rendue quasi muette par la barrière
un outil de régulation sociale, une institution qui voulaient bien les voir. Les cas les plus de la langue – jamais traduite).
qui marginalise celles et ceux qui y sont célèbres de double lecture sont sans doute
extérieurs. Au cinéma, l’hétéronormativité ceux de Ben-Hur que William Wyler a pensés, Le texte : bit.ly/sellieraudiard
se traduit de plusieurs façons. sans le dire à Charlton Heston (qui incarne La bande annonce : bit.ly/BAdebattre
On constate tout d’abord une invisibilisation Ben-Hur, connu pour ses opinions conserva-
des personnages ne correspondant pas trices) comme une histoire d’amour avec
à ce modèle : l’étude annuelle de l’université Messala (incarné par Stephen Boyd, dont
Annenberg a comptabilisé seulement 1,4% le jeu enflammé propose plusieurs degrés
de personnages parlants LGBTQ+ (Lesbienne, de lecture), et de Spartacus (Stanley Kubrick,
Gay, Bisexuel, Transgenre, Queer) dans 1960), dont la scène de bain (censurée
les 100 films américains ayant eu le plus à la sortie du film et restaurée en 1991)
de succès au box-office en 2019. Par ailleurs, où Crassus (Laurence Olivier) demande
les travaux pionniers de Vito Russo (avec à celui qu’il a choisi pour être son esclave
son ouvrage de 1981 dont est tiré le docu- personnel (Tony Curtis) s’il « considère
mentaire The Celluloïd Closet réalisé en 1995 comme moral de manger des huîtres
par Rob Epstein et Geffrey Friedman) et immoral de manger des escargots »...
14 15Patriarcat Pistes
pédagogiques
Définition Au cinéma
Si l’on peut renvoyer le terme de patriarcat Dans les pays anglo-saxons, les féministes
à sa définition littérale de « pouvoir proposent une déconstruction systématique
des pères », la notion permet surtout de défi- du fondement patriarcal du cinéma commer-
nir les rapports de genre comme des rapports cial (principalement hollywoodien),
sociaux de pouvoir et de domination (E. Macé, au moment où les luttes émancipatrices ont
2015). Dans un article fondateur publié permis l’appropriation du cinéma
en 1981, la chercheuse féministe Christine par les femmes comme outil d’information
Delphy rappelle que si l’adjectif « patriarcal » et de création. Au début des années 1970, (1) Analyse de séquence – Mustang (Deniz le corps de l’homme en objet de plaisir (en
est couramment utilisé en littérature, ce sont Marjorie Rosen et Molly Haskell analysent Gamze Ergüven, 2015), la scène précédent exprimant leur désir et en caressant le corps
bien les féministes des années 1970 qui ont les films hollywoodiens du point de vue l’évasion pour le match de football. On s’inter- de leur partenaire qui reste passif et morcelé-
créé le substantif « Patriarcat » pour mieux des « images de femmes » qu’ils proposaient. rogera sur la manière dont la séquence on voit le dos et les fesses). Les deux scènes
analyser et agir contre « un système d’exploi- En 1975, Laura Mulvey, dans son article dessine en négatif le pouvoir des hommes sur (voir extraits) se font d’ailleurs tellement écho
tation généralisée des femmes ». Le terme fondateur (pour plus de détails, cf gaze) les femmes. On pourra relever que le specta- qu’il est possible d’y voir chez Sciamma
de patriarcat lui semblant insuffisant, théorise les mécanismes de construction teur est avec et du côté des femmes ; l’absence une citation explicite du film de Campion.
l’anthropologue Nicole-Claude Mathieu forge du langage narratif au cinéma en termes des hommes et la présence de leur pouvoir ; Par ailleurs, les deux femmes sont punies
dès 1991 le concept de « viriarcat » pour faire de différence des sexes et de domination la construction spatiale et la séparation de leur audace dans la suite du film, à mesure
référence au pouvoir des hommes en tant que patriarcale. En 1996, en France, l’ouvrage binaire intérieur / extérieur ; le surcadrage que le patriarcat se réinstalle, à chaque fois
personnes de sexe masculin, au-delà des seuls fondamental de Geneviève Sellier et Noël qui « encadre » littéralement les personnages dans la violence, qu’il s’agisse de celle du frère
pères ou patriarches. Enfin, après #MeToo, Burch consacré au cinéma français entre et manifeste visuellement l’oppression ; le jeu (Bande de filles) ou du mari (La Leçon de piano).
l’affaire Weinstein, les différentes prises 1930 et 1956 décrit une guerre des sexes sur des points de vue et des regards ; les activités Face à ces deux scènes, on peut se poser
de paroles sur le harcèlement sexuel, le viol, fond de patriarcat, en distinguant en particu- stéréotypées féminines... Cette scène aborde la question : pourquoi les personnages
les féminicides, on constate que le patriarcat lier trois grandes périodes chronologiques. l’un des enjeux du film, permettre masculins réagissent ainsi ? Cette violence
est toujours présent, malgré les lois contre Comme le résume Michelle Perrot dans à ces jeunes filles d’être des sujets, agissants, est-elle seulement celle d’un individu ?
les discriminations, pour la parité. la préface, dans le cinéma français d’avant- et non des spectatrices objectifiées soumises Ou plus largement d’une société qui veut
C’est l’objet du récent ouvrage de Carol guerre, règnent le père et le « couple inces- à un système patriarcal. contrôler le corps des femmes ?
Gilligan et Naomi Snider, qui analyse tueux » formé d’un homme d’âge mur Voir l’extrait en ligne : bit.ly/extraitmustang
les raisons de la persistance du patriarcat, et de stature patriarcale, et d’une femme (3) Échange. Proposer aux élèves de chercher,
en le définissant non pas comme un système, beaucoup plus jeune dont il entend rester (2) Analyse de films – Bande de filles (Céline dans leur culture personnelle (visuelle,
mais comme une force, qui s’applique « le seigneur et maître ». Le cinéma de l’Occu- Sciamma, 2014) et La Leçon de piano (Jane musicale, etc), des représentations du sys-
à des sujets et les modifie. pation « renverse la position respective Campion, 1992). Analyser les personnages tème patriarcal, en partageant les exemples
des sexes », la virilité est en crise et le patriar- féminins, leur évolution au cours de l’histoire, avec la classe et en s’interrogeant collective-
cat en berne, jusqu’au cinéma les moments d’inversion des rôles masculin ment : s’agit-il de le dénoncer ce système ?
de la Libération, véritable « remise en ordre et féminin (la scène d’amour dans Bande De le valoriser ? Par quels moyens ?
patriarcale ». de filles par exemple), ou de dénonciation
du système patriarcal (la scène du « mariage »
ou de vengeance dans La Leçon de piano).
Dans ces deux films, on pourra analyser
au niveau narratif et formel la position
des personnages féminins vis à vis
du patriarcat, leur évolution au cours
de l’histoire et les moments d’inversion
des rôles masculin et féminin. Dans les deux
films, le personnage principal féminin
se réapproprie son propre désir et transforme
16 17Queer Piste
pédagogique
Définition Au cinéma
Le terme queer fait partie de ces mots dont Le queer a une existence cinématographique
l’usage évolue. Introduit dans la langue dès les premiers films muets, au travers
anglaise au XVIe siècle, il signifie alors de personnages évoquant ou provocant
« bizarre », « étrange », « tordu ». Au début un « trouble dans le genre » pour reprendre
du XXe siècle, il acquiert une connotation le titre du célèbre ouvrage de Judith Butler,
sexuelle, devient une insulte et renvoie publié en 1990. En 1992, en pleine efferves-
à un « travers », en s’opposant au straight cence autour du mot et du mouvement queer,
(droit, « hétérosexuel » lorsqu’il s’agit la critique B. Ruby Rich invente le terme New Analyse de séquence - Certains l’aiment chaud
de sexualité). Mais le mot queer a été détourné Queer Cinema pour désigner une vague (Billy Wilder, 1959), scène de “mise au point”
et récupéré dans le contexte de la lutte contre de films centrés sur des thématiques (51: 09). Dans cette séquence Daphné
l’épidémie de sida, à la fin des années 1980. LGBTQ+. Grâce, notamment, au développe- et Joséphine se rendent compte de la pression
Inversant le stigmate, l’insulte devient ment du Festival de Sundance créé en 1985, sexuelle que subissent les femmes. Lors
étendard, et les groupes militants l’utilisent le cinéma indépendant américain a désormais de la séquence, les personnages oscillent d’un
désormais pour signifier le refus de s’inscrire une vitrine, et accueille des films présentant genre à l’autre, se mettant à la place d’une
dans l’hétéronormativité, mais aussi dans des minorités sexuelles, dans un cadre femme harcelée, puis d’un homme poursuivi
toutes normes de genre et de sexualité. économiquement viable, grâce à des cinéastes par un gang. Ils jouent aussi sur la fluidité
Il s’agit aussi d’envisager une conception comme Todd Haynes, Gus Van Sant ou Gregg du genre, proposant une véritable chorégra-
fluide de l’identité, du genre et de la sexualité. Araki. Au-delà des thèmes abordés, il s’agit phie queer, enlevant et remettant leur
En 1990, Teresa de Lauretis utilise pour aussi de proposer des lectures queer d’un perruque, leur robe, leur costume, modifiant
la première fois le terme de « théorie queer », cinéma a priori hétéronormé, comme le fait leur voix, passant ainsi d’un genre à l’autre.
pour proposer une « politique des diffé- Quentin Tarantino à propos de Top Gun (Tony Leur stratégie queer est par ailleurs validée
rences », utilisée pour contrer les effets Scott, 1986), le temps d’une scène du film au moment où Sugar entre dans la pièce, Photogrammes montrant la fluidité de genre
d’invisibilisation que générait alors l’expres- Sleep with me (le film de Rory Kelly est sorti alignant physiquement les personnages grâce des personnages masculins, qui s’harmo-
sion « gay and lesbian ». Ainsi, la théorie en 1994 et cette scène est présentée ici au cadrage et à l’harmonie de leurs robes. nisent à la pin-up hypersexualisée qu’est
queer a pour base une critique de la norme par Le ciné-club de M.Bobine : bit.ly/ Lorsque Joe enfile le costume de millionnaire, Sugar (Marylin Monroe), par le jeu des cos-
et du normatif, et donc des instruments extraitsleep). En France, en 2021, a été créé son identité de genre est queer dans le sens tumes. Les trois personnages incarnent
de régulation et des régimes disciplinaires qui le site Queer Cinema Club, organisé où il incorpore des éléments aussi bien à leurs façons des mascarades féminines (le
maintiennent et qui assurent la continuation par décennies, pays, thèmes et formats masculin (la casquette, le pantalon qu’il tient, mot revient d’ailleurs plusieurs fois dans
de cette norme. (https://apollinediaz.wixsite.com/queercine- son allure) que féminin (maquillage, robe, le film).
maclub) et qui collecte des « ressources bijoux).
et archives des cultures queer, trans et dyke Voir l’extrait en ligne : bit.ly/extraitcertain2
à l’écran ». On y trouve aussi bien des films
de réalisateurs reconnus (Gregg Araki, Maya
Deren, Wong Kar-Wai…) que des captations
de performances ou des vidéos expérimen-
tales et une bibliothèque.
18 19Sous les feux
de la rampe
Cette entrée du glossaire
propose un éclairage #MeToo Woke/wokisme Cancel Culture
sur certains sujets #Me too est né d’une colère, et d’une cam- Le terme woke est le passé simple du verbe Comme le « wokisme », la cancel culture
d’actualité. pagne de soutien aux victimes d’agressions
sexuelles dans les quartiers défavorisés, porté
anglais to wake qui signifie « se réveiller ».
La dimension politique et idéologique du mot
a des origines anglo-saxonnes et est l’une
des expressions les plus utilisées dans
par Tarana Burke, travailleuse sociale circule aux États-Unis depuis les années les médias anglophones en 2019, au point que
originaire de Harlem ayant elle aussi subi 1960, en particulier dans les milieux militants le dictionnaire de référence en langue anglaise
des violences sexuelles. Onze ans plus tard, afro-américains. Martin Luther King australienne (le dictionnaire Macquarie)
en écho à l’affaire Weinstein qui vient de faire exhortait déjà en 1965 les jeunes américains en a fait son « mot de l’année » 2019.
le tour de la planète, l’actrice Alyssa Milano à « rester éveillés ». On trouve même Pour justifier ce choix, le comité éditorial
poste sur Twitter le message : « « Si vous avez des occurrences de l’expression wide awake du dictionnaire rappelle qu’il s’agit de mettre
été victime de harcèlement ou d’agression (bien éveillés) chez les anti-esclavagistes en avant un mot qui « capture un aspect
sexuelle, écrivez “moi aussi” en réponse du XIXe siècle. Avec le mouvement Black important de l’esprit du temps, un phéno-
à ce tweet », suivi d’un second : MeToo. Lives Matter qui dénonce le racisme systé- mène tellement important qu’il porte un nom,
Des dizaines de milliers de messages suivent, mique et proteste contre les violences et qui est devenu, pour le meilleur ou pour
dénonçant les violences sexuelles dans tous policières, le terme se diffuse massivement le pire, une puissante force ».
les milieux, avec des variations nationales et son usage s’étend désormais à d’autres Car, en Australie comme en France, la cancel
(comme le #BalanceTonPorc en France). sphères militantes pour désigner le fait d’être culture provoque colère et débats.
Touchant à toutes les sphères, profession- conscient des injustices et des discriminations Concrètement, il s’agit « d’annuler », en poin-
nelles, familiales, amicales, le phénomène subies par les minorités ethniques, sexuelles, tant du doigt, en particulier sur les réseaux
s’internationalise et les récits personnels religieuses (etc) et des menaces globales sociaux, une personne (et par extension,
forment un « nous » collectif, que l’anthropo- comme le réchauffement climatique. une œuvre, un monument) qui aurait eu
logue Valérie Nahoum-Grappe décrit comme des propos ou des comportements inappro-
« un mouvement social féminin du XXIe priés. C’est le cas de l’auteur J.K. Rowling,
siècle, qui sait user des outils technologiques accusée de transphobie suite à un tweet,
de l’époque pour faire apparaître un point ou du film Autant en emporte le vent (accusé
de vue non pris en compte à la mesure de racisme et d’apologie de l’esclavage), retiré
de sa réalité massive et tragique ». provisoirement du catalogue de HBO Max
en 2020.
20 21Stéréotype Pistes
pédagogiques
(1) Analyse de séquence, analyse d’images (3) Analyse de séquence - Bande de filles
– Johnny Guitare (Nicholas Ray, 1954). (Céline Sciamma, 2016), la scène pré-géné-
Montrer comment le personnage de Vienna rique du film. Cette séquence joue avec
Définition Au cinéma
dans Johnny Guitare inverse les stéréotypes les stéréotypes de genre, en dévoilant
de genre. Le travail peut se faire à partir progressivement le fait que les joueurs
d’une sélection de photogrammes, de football américain (sport connoté comme
Le stéréotype est dès sa « naissance » marqué Ruth Amossy situe la prise de conscience ou de cet extrait : bit.ly/extraitjohnny hyper viril) sont en fait des filles. Le film joue
par l’ambivalence. du stéréotype dans la deuxième moitié À partir des photogrammes, on peut le contre-stéréotype à plusieurs égards,
À l’origine, le stéréotype est un outil d’impri- du XIXe siècle, en même temps que l’émer- par exemple analyser la façon dont Vienna en associant ce sport à des filles et en filmant
merie, une matrice stable faite à partir d’une gence d’une culture médiatique de masse, et ses partenaires masculins rejouent un groupe de filles en pleine activité sportive,
composition de caractères d’impression dont le cinéma fera bientôt partie. Stéréotype la posture du prince charmant et de la femme tout d’abord comme des adversaires, puis
amovibles. La stéréotypie permettait donc et médias sont donc intimement liés. Michel à sauver, en inversant le stéréotype : Vienna comme un groupe solidaire, rassemblé là
de produire des impressions massives, Foucault rappelle d’ailleurs qu’à l’instar est celle qui porte l’autre, elle surplombe pour le plaisir du sport.
rapidement. Mais le revers de cette efficacité de la famille, de l’école ou des tribunaux, son partenaire, le soutient. Dans l’extrait, est Voir l’extrait en ligne : bit.ly/3HbwT5l
est la dégradation de la qualité de l’impression les médias contribuent à l’imposition par ailleurs évoquée l’expression
au fur et à mesure des tirages. des normes qui structurent la société. « ils vécurent heureux pour toujours ».
Lorsqu’en 1922 le journaliste Walter Ainsi, les médias véhiculent et perpétuent Dans l’extrait, elle est celle qui est la plus
Lippman utilise pour la première fois le mot des stéréotypes, mais peuvent aussi jouer visible, grâce au costume et au cadrage (elle
« stéréotype » dans un sens figuré, avec, les modifier, exprimer les tensions qu’ils est filmée en plein centre, frontalement). Bibliographie sélective
on retrouve cette dualité entre « efficacité » sous-tendent. Les historiens du cinéma ont Elle est également celle qui mène à la fois
et « altération ». Pour Lippman, le stéréotype bien montré que, dès les premières vues le dialogue et l’action : lorsqu’elle se déplace, BILAT Loïse & HAVER Gianni, Le Héros était
désigne les images mentales (« les images animées du cinéma des premiers temps, la caméra la suit et la replace au centre une femme... Le Genre de l’aventure, Lausanne,
dans nos têtes ») qui nous permettent l’usage des stéréotypes par l’industrie du cadre. Elle n’hésite pas, en plus du dia- Antipode, 2011.
de simplifier la réalité face à la complexité du cinéma est massif. Dans les années 1970, logue, à venir contre Johnny, qui se retrouve BUTLER, Judith, Trouble dans le genre
de notre environnement. Ces images sont les théoriciennes féministes Molly Haskell coincé contre le mur. Elle maîtrise l’espace [Gender Trouble]. Le féminisme et la subver-
donc une condition nécessaire à la vie et Marjorie Rosen se sont intéressées et le corps de l’autre. sion de l’identité, Paris, La Découverte, 2006
en société, en étant une opération cognitive en particulier à la façon dont le cinéma [1990].
fonctionnelle et efficace, un outil indispen- classique hollywoodien attribue à la femme (2) Étude d’une bande-annonce - Breakfast LAURENTIS Teresa de, Théorie queer
sable pour construire du sens, classer des rôles prédéfinis, en la mettant en scène Club (John Hugues, 1985) Montrer comment et cultures populaires, Paris, La Dispute, 2007.
et organiser sa pensée. selon des types figés tournant autour la bande-annonce repose sur la construction MULVEY, Laura, Au-delà du plaisir visuel.
D’un autre côté, le stéréotype exprime de la classique tripartition de « la vierge, et la déconstruction des personnages en tant Féminisme, énigmes, cinéphilie, collection
et perpétue une image simplifiée, toute faite, la mère et la putain », dont les représentations que stéréotypes (analyse du vocabulaire, Formes Filmiques, éditions Mimésis, 2017.
réductrice, d’un groupe. Il peut donc aussi se déclinent en femme fatale, vieille fille, jeune des vêtements, des attitudes). Vous y trouverez notamment le texte
être vu comme un schéma de pensée fille naïve, épouse soumise et / ou agressive, Chaque personnage est filmé seul dans fondateur Plaisir Visuel et Cinéma Narratif,
simplificateur, qui contribuerait notamment gold digger, « poule » etc. Aujourd’hui encore, le cadre pendant que la voix le décrit d’un paru en 1975, également disponible sur le site
à légitimer les discriminations. des collectifs (AAFA – Actrices et acteurs mot : un surdoué, une fille à papa, un athlète, Débordements.fr: http://debordements.fr/
Les stéréotypes de genre assignent des rôles de France Associés) ou des stars (Meryl un révolté, une détraquée. À chaque person- Plaisir-visuel-et-cinema-narratif)
et des places distinctes aux hommes Streep, Maggie Gyllenhaal, Geena Davis, nage est attribué une attitude et / ou un acces- SELLIER Geneviève et BURCH Noël, La drôle
et aux femmes, ils fixent et rappellent Patricia Arquette) dénoncent les stéréotypes soire qui renforce le stéréotype. La suite de guerre des sexes du cinéma français,
des comportements « conformes » selon sexiste et âgiste dont sont victimes de la bande annonce les déjoue. Nathan, 1996.
son sexe. Les femmes auraient “naturelle- les femmes de plus de 50 ans, qui dispa- Voir l’extrait en ligne : bit.ly/3LONXBM SELLIER Geneviève, La Nouvelle Vague,
ment” une démarche chaloupée et une préfé- raissent des écrans. En 2012, Meryl Streep un cinéma au masculin singulier, CNRS
rence pour les matières littéraires alors que racontait : « L’année de mes 40 ans, j’ai reçu éditions, 2005.
les hommes seraient “naturellement” plus trois scénarios me proposant de jouer… SELLIER Geneviève, Le cinéma au prisme
courageux et doués en mathématiques… une sorcière. Et dès 35 ans, n’étant plus des rapports de sexe, Vrin, 2009.
considérées comme attirantes pour nos Revue Genre en séries : cinéma, télévision,
co-stars, nous sommes déjà sur la voie médias : https://journals.openedition.org/ges/
de la préretraite ». Site Le Genre et l’écran : https://www.genre-
ecran.net/
22 23Imprimé par la Ville de Besançon
Vous pouvez aussi lire