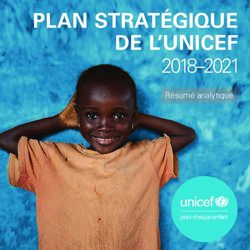ASSEMBLEE PLENIERE 23 MAI 2019 - COMPTE-RENDU MAI 2019 - Coalition Eau
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ASSEMBLEE PLENIERE 23 MAI 2019 COMPTE-RENDU MAI 2019 CONTACT Coalition Eau Tél. + 33 (0)1 70 91 92 37 www.coalition-eau.org 45 bis avenue de la Belle Gabrielle Email contact@coalition-eau.org 94736 Nogent-sur-Marne
L’Assemblée Plénière de la Coalition Eau a eu lieu le 23 mai 2019 de 9h à 13h dans les locaux du Gret,
à Nogent-sur-Marne.
Elle s’est déroulée en 2 temps, relatés ci-après :
Partie 1 : Activités stratégiques de la Coalition Eau
Partie 2 : Atelier d’échanges sur l’étude de la Coalition Eau sur la contribution des ONG
françaises à la coopération internationale pour l’eau et l’assainissement
Ont participé à l’Assemblée Plénière les membres suivants :
ACAD : Roland Hawswaid
ACF : Paul Reïssi
ADEDE : Henri Smets
AEFJN : Jean-Louis Marolleau
BlueEnergy : Michelle Tavernier
Dynam’Eau : Maxime Ghesquiere
EAST: Geneviève Lattès et Loic Monjour
Eau Sans Frontières : Philippe Jacq
Eau Vive : Morgane Anziani
GRDR : Bernadette Thomas
Gret : Thomas Le Jeune et Frédéric David
Initiative Développement : Mickaël Josse
Solidarité Eau Europe : Antonella Cagnolati
Secours Islamique France : Laura Le Floch et Eva Montbellet
Seves : Romain Desvalois
Solidarités International : Aude Lazzarini
Toilettes du monde : Marion Duval
Wikiwater : Benoît Flicoteaux
Ont participé à l’atelier d’échanges les organisations suivantes :
ACAD : Roland Hawswaid
ACF : Paul Reïssi
ADEDE : Henri Smets
AEFJN : Jean-Louis Marolleau
BlueEnergy : Michelle Tavernier
Dynam’Eau : Maxime Ghesquiere
East : Geneviève Lattès et Loïc Monjour
Eau Sans Frontières : Philippe Jacq
Eau Vive : Morgane Anziani
GRDR : Bernadette Thomas
Gret : Thomas Le Jeune et Frédéric David
Initiative Développement : Mickaël Josse
Solidarité Eau Europe : Antonella Cagnolati
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 2
23-05-2019Secours Islamique France : Laura Le Floch et Eva Montbellet Seves : Romain Desvalois Solidarités International : Aude Lazzarini Toilettes du monde : Marion Duval Wikiwater : Benoît Flicoteaux ADESAF : Floriane Crolas Aquassistance : Philippe Folliasson Croix Rouge Française : Cheikh Toure Electriciens sans frontières : Jean Pierre Cerdan Première Urgence Internationale : Timothée Le Guellec Compte-rendu de l’Assemblée plénière 3 23-05-2019
PARTIE 1 :
ACTIVITES STRATEGIQUES DE LA COALITION
EAU
I. Demandes d’adhésion
1. Demande d’adhésion de SEVES
Créée en 2007, l’ONG SEVES expérimente des modes de gestion innovants. L’ONG est composée
d’une équipe de 5 personnes. Il n’y a actuellement pas d’équipe terrain mais des partenariats de long
terme sont maintenus avec des ONG ou des bureaux d’étude locaux.
Les domaines de spécialisation de SEVES sont : l’organisation des services publics, le renforcement
de la maitrise d’ouvrage, la professionnalisation des exploitants, l’économie des services et la
planification, ainsi que des services plus techniques (hydrologie et planification des déchets).
SEVES souhaite adhérer à la Coalition Eau afin d’être en lien avec d’autres structures. Par ailleurs, il
s’agit d’une association tournée vers l’opérationnel et les projets terrain qui a fait le choix de ne pas
dégager de marge pour le plaidoyer. La Coalition Eau peut permettre de s’engager malgré tout sur du
plaidoyer, avec un partage d’expériences et d’expertise avec d’autres ONG.
L’Assemblée Plénière a validé l’adhésion de SEVES à la Coalition Eau.
2. Demande d’adhésion de Wikiwater
Wikiwater est association créée et lancée il y a 2 ans. L’activité centrale est une plateforme digitale
mettant à disposition des fiches sur l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène. La dynamique est surtout
tournée vers les réseaux sociaux et internet. Il y a plus de 3000 connexions par jour dans 197 pays
(même aux USA et en France car il existe également des enjeux dans ces pays et le site peut permettre
de trouver des solutions).
Le site existe depuis 2012 et a été rénové il y a 2 ans. Il bénéficie d’un soutien de la fondation EDF qui
a participé à la rénovation du site et d’un partenariat avec Google pour faire des publicités localisées
dans certains pays. Cette initiative a un coût assez faible car il y a peu de charges, mais demande
beaucoup de formations sur les solutions existantes dans le digital et sur internet.
Ce que l’on peut trouver sur le portail : 117 fiches sur les solutions liées à l’eau, solutions simples et peu
couteuses, pour des populations dans l’urgence, et qui n’ont pas de moyens importants.
L’Assemblée Plénière a validé l’adhésion de l’ONG Wikiwater à la Coalition Eau.
II. Chantiers stratégiques de la Coalition Eau
1. Politique de développement
Projet de loi sur le développement
La Loi d’orientation et de programmation pour le développement et la solidarité internationale (LOP-
DSI) est en cours de révision et doit intégrer les nouveaux cadres internationaux (Accord de Paris,
Agenda 2030 des Objectifs du Développement Durable, etc.)
Il y a une nouvelle dénomination de cette LOP-DSI qui intègre dans son titre « la lutte contre les
inégalités mondiales ».
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 4
23-05-2019Un premier draft de la loi a été réalisé par le MEAE. L’eau apparait bien dans les priorités thématiques.
La Coalition Eau a fait des propositions d’amendements pour renforcer cette partie sur l’eau car elle
était peu approfondie.
Il reste plusieurs points négatifs, notamment le fait qu’il n’y ait pas de programmation budgétaire, ce qui
était la demande principale des ONG. La loi devait traduire la trajectoire de l’Aide Publique au
Développement (APD) annoncée par Macron d’ici à 2022, mais celle-ci n’apparait pas dans le projet.
En outre, le calendrier est toujours incertain : la deuxième version du Projet de Loi, suite aux
commentaires et amendements de la société civile, n’est toujojurs pas disponible et l’examen du texte
à l’Assemblée Nationale a été repoussé à 2020, après une annonce du Premier Ministre lors son
discours de politique générale. La prochaine étape en termes de programmation budgétaire sera donc
le Projet de Loi de Finance 2020.
Stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement
Des commentaires ont été envoyés sur la dernière version de la partie 2 (orientations stratégiques).
C’est une partie assez succincte mais qui a intégré les messages de la Coalition Eau et ses
commentaires pour renforcer le texte.
Le questionnaire relatif à la phase 3 de la stratégie a été partagé par le Ministère de l’Europe et des
affaires étrangères (MEAE). La Coalition Eau est rapporteure de cette phase et a donc réalisé la
synthèse des contributions de la société civile. Celle-ci a été envoyée au Ministère.
Le MEAE a fixé une réunion le 28 mai pour la partie 3 de la stratégie. Il y a eu lors de cette réunion un
échange sur l’ensemble des synthèses de collèges, afin que le MEAE puisse prévoir un document de
synthèse global. Une première version de la stratégie est attendue avant l’été.
La stratégie s’oriente sur 3 priorités.
La Coalition Eau a fait part de plusieurs recommandations, notamment celle d’intégrer une priorité
d’action spécifique sur l’accès à l’EAH.
Concernant les moyens de mise en œuvre, plusieurs recommandations de la Coalition Eau sur l’APD
ont été reprises, même si tout n’est pas chiffré.
Nous ne sommes toujours pas assurés d’avoir un portage politique fort de cette stratégie ni qu’elle
devienne un cadre de référence de l’action de la France. Le document ne semble pas assez solide, et
il n’y a pas de ministre qui soutienne de manière forte le texte.
Il nous paraît important que le gouvernement réfléchisse à nouveau à cet enjeu de portage politique car
l’élaboration de la stratégie a demandé une forte mobilisation de nombreux acteurs. La Coalition Eau
s’est fortement mobilisée, rassemblant de nombreuses contributions des ONG membres et demandant
un temps de travail important. Il faut s’assurer que ce cadre soit la référence pour les opérateurs de
l’aide.
L’AFD a assuré que la stratégie du MEAE serait le cadre dans lequel elle élaborerait son propre cadre
d’intervention sectoriel (CIS). L’AFD a décalé son propre calendrier afin de pouvoir s’inscrire dans la
stratégie du MEAE (même si elle a déjà lancé la réflexion en interne pour élaborer son nouveau CIS).
APD pour l’eau et l’assainissement
Lors du dernier GT « Politique de Développement et Financements », la demande historique de la
Coalition Eau sur les dons bilatéraux pour l’EAH a été revue car celle-ci n’était plus assez ambitieuse
compte tenu de la révision de la trajectoire APD d’ici à 2022 et des demandes faites par les autres
secteurs essentiels.
La demande initiale était de 100 millions d’euros de dons par an (la moyenne actuelle étant environ 60
millions d’euros par an).
Différents scénarii ont été élaborés et proposés en lien avec le GT PDF allant entre 125 et 200 millions
d’euros. En parallèle, il y a eu une tentative de Coordination Sud pour créer plus de cohérence entre
les demandes sectorielles des ONG (éducation, genre, santé, etc.).
La demande révisée de la Coalition Eau est désormais que 50% de l’APD bilatérale se fasse sous forme
de dons ce qui équivaut à 400 millions euros. En effet, si l‘on souhaite être cohérent avec nos demandes
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 5
23-05-2019de ciblage et compte tenu des difficultés d’atteindre les PMA, il est nécessaire de demander que 50%
de l’APD soit des dons afin que 50% de l’APD soit dirigée vers les PMA. Cela reste raisonnable par
rapport aux autres demandes des secteurs.
2. Elections européennes : Campagne StandUp4Water
Avec ses partenaires européennes, le European Pact for Water, WaterAid et End Water Poverty, la
Coalition Eau a participé à l’élaboration d’un texte d’engagement pour lequel les candidat.es à l’élection
européenne ont été appelé.es à signer et un manifeste avec des explications précises des combats que
pourront mener les parlementaires européen.nes lors de leur mandat.
3 demandes centrales ont été présentées dans cet appel :
Faire de l’EAH une priorité de l’agenda politique de l’Union Européenne
Soutenir les investissements dans le secteur de l’EAH
Faire le lien entre l’EAH et les autres ODD
Objectif de la campagne :
- Identifier des champion.nes de l’eau et de l’assainissement au Parlement européen pour qu’ils et elles
portent nos combats au niveau européen
- Mobiliser les candidat.e.s sur le sujet et encourager une prise de conscience de la priorité qui doit être
mise sur les enjeux liés à l’EAH
- Créer des liens de travail étroit avec ces réseaux, pour porter les enjeux de plaidoyer au niveau
européen
Bilan : plus de 170 candidat.e.s ont signé l’appel en Europe dont 74 en France avec 3 têtes de liste
(Manon Aubry, Yannick Jadot, Ian Brossat).
3. Droit à l’eau
Chèque eau
Suite à l’annonce faite par le gouvernement, en clôture de la première phase des Assises de l’eau en
aout 2018, de sa volonté de généraliser le principe d’une tarification sociale de l’eau avec la création
d’un « chèque eau », sur le modèle du chèque énergie, les choses ont peu avancé.
Le chèque énergie a lui bien été lancé : 5 800 000 ménages vont le recevoir désormais, signifiant un
changement d’échelle important car seulement 500 000 ménages en bénéficiaient auparavant.
Cependant, concernant l’eau, la tarification sociale n’est pas encore légalisée pour les collectivités qui
seraient volontaires, hors expérimentations en cours dans le cadre de la loi Brottes. Ces
expérimentations menées dans une trentaine de villes sont toujours en cours, elles ont été prolongées
à 2021. Sans une décision législative prise avant avril 2021, tous les efforts mis en œuvre seront annulés
en matière de tarification sociale de l’eau avec un retour au système précédent. Il est aujourd’hui
incontournable de passer par le législatif.
Suivant la trajectoire actuelle, la France ne sera pas capable d’atteindre les cibles de l’ODD 6 car elle
n’est pas dans les délais de mise en oeuvre. Aujourd’hui, environ 3% de la population ne peut pas payer
son eau à un prix abordable, ce qui est en contradiction avec les cibles de l’Agenda 2030.
Si rien ne bouge on constatera qu’il y a davantage d’impayés qu’avant.
Plusieurs actions ont été menées par la Coalition Eau afin d’alerter sur les blocages et sur l’importance
de faire avancer les dispositifs de tarification sociale de l’eau :
- Rendez-vous avec la conseillère écologie du Premier Ministre
- Rendez-vous avec la conseillère eau du Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
- Rendez-vous avec la Direction Eau et Biodiversité
- Questions écrites déposées par plusieurs parlementaires
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 6
23-05-2019La réponse faite par le gouvernement à ces questions écrites permettra d’avoir une position écrite sur
laquelle nous pourrons rebondir par la suite.
Perspectives pour la suite :
- 19 juin : rendez-vous avec la députée Sophie Auconie qui a crée un groupe de travail sur la
tarification sociale, auquel a participé Henri Smets.
- Révision de la directive sur l’eau potable au niveau européen : suspendue du fait des élections
mais rependra une fois un nouveau commissaire nommé : la révision de la directive sur l’eau
potable comporte un article sur l’installation de points d’eau et la priorité à donner aux plus
vulnérables, en d’autres termes il s’agirait d’une obligation donnée aux Etats de garantir
l’installation de points d’eau.
Cette obligation n’existe pas en droit français, et le Sénat est contre l’installation de plus de points d’eau
dans les villages. Si les textes communautaires sont plus ambitieux, cela donnerait des leviers pour
faire pression sur le gouvernement français.
Etude Outre-Mer
Il existe ainsi un enjeu fort pour l’accès à l’eau et à l'assainissement en Outre-Mer si la France souhaite
atteindre les cibles de l’Objectif du Développement 6 Eau et Assainissement, comme elle s’y est
engagée (notamment pour atteindre le même niveau qu’en métropole, y compris dans les
établissements scolaires).
Un premier constat tend à montrer que les départements d’Outre-Mer et Mayotte ont tendance à se
développer sur un modèle métropolitain et prennent difficilement en considération les inégalités, laissant
une part de la population sans services de bases. Il y a un besoin d‘avoir une compréhension plus
précise des enjeux sur le territoire des Outre-mer et notamment sur le contexte de Mayotte (où 47%
des ménages n’ont pas de toilettes dans leur maison - chiffre INSEE 2017). Des initiatives existent mais
ne sont pas nécessairement portées ou défendues par les politiques locales, voire parfois même
enrayées.
Une étude a été lancée afin d’avoir une meilleure compréhension du contexte et des acteurs en jeu
d’une manière globale dans les Outre-Mer. L’un des objectifs de l’étude est d’identifier des pistes de
plaidoyer pour la Coalition Eau sur les droits à l’eau et à l’assainissement en Outre-Mer, et plus
spécifiquement pour Mayotte. Un budget de 8000€ a été affecté pour une consultante comprenant une
étude bibliographique globale et une phase de terrain pour analyser spécifiquement la situation à
Mayotte.
La consultante a été recrutée (Sophie Oddo) pour réaliser l’étude sur 4 mois entre juillet et octobre.
L’idée est d’avoir d’ici la fin d’année une vision de la situation et des pistes de plaidoyer notamment en
lien avec les ODD.
Campagne 2020 « Droit à l’Eau pour tous ! »
En 2020 se dérouleront à la fois les élections municipales (en mars) et l’anniversaire des 10 ans de la
reconnaissance par les Nations Unies des droits humains à l’eau potable et à l’assainissement.
Ces deux événements cumulés seront l’occasion d’une part, d’interpeller les pouvoirs publics et les élus
locaux et, d’autre part, de mobiliser le grand public sur les enjeux liés aux droits humains à l’eau potable
et à l’assainissement. C’est dans ce contexte que la Coalition Eau et France Libertés-Fondation Danielle
Mitterrand proposent de lancer une campagne de mobilisation collective et inter-associative pour
les droits à l’eau et à l’assainissement, en partenariat avec la Coordination Eau Ile de France,
Dynam’eau et d’autres organisations engagées sur les enjeux liés au droit à l’eau et à l'assainissement
et à sa mise en oeuvre effective, en France et à l’international.
Objectifs de la campagne :
- Interpeller les pouvoirs publics nationaux et les élus locaux sur les enjeux forts en matière
d’accès à l’eau et l’assainissement afin d’accélérer la mise en œuvre effective du droit humain
à l’eau potable et à l’assainissement en France et renforcer la coopération internationale pour
l’eau et l’assainissement.
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 7
23-05-2019- Sensibiliser et mobiliser les citoyens français sur la solidarité et les enjeux de l’eau et de
l’assainissement, en France et à l’international
Objectif transversal :
- Renforcer la dynamique associative sur l’eau et l’assainissement, et créer du lien entre les
acteurs (au niveau des territoires, entre national et local).
Plusieurs temps forts :
Conférence de presse de lancement, fin novembre 2019
Journée Mondiale des Toilettes, le 19 novembre 2019
Journée Mondiale de l’Eau, le 22 mars 2020
Elections municipales, mars 2020
10 ans de la reconnaissance des droits humains à l’eau et à l’assainissement, juillet 2020
La campagne doit permettre de faire apparaître le concept et les enjeux liés aux droits à l’eau et à
l'assainissement, mais aussi d’appréhender le sujet par différentes entrées/problématiques, dans une
démarche de sensibilisation/information : enjeux de santé, d’éducation, de nutrition, d’intégration et de
cohésion sociale, d’égalité des genres, de développement économique ou d’environnement.
Cette campagne est l’occasion de se réunir autour des enjeux de droits humains à l’eau et
l’assainissement par des prismes propres à chacune de nos organisations (lutte contre la précarité
sanitaire, droit au logement, protection des plus vulnérables, droits des migrants, solidarité
internationale, éducation au développement et à la solidarité internationale, etc.).
Une bannière commune déclinée aux niveaux local et national (visuel, slogan, messages portés
collectivement, site internet, événement inter associatif et fédérateur pour la Journée Mondiale de l’Eau).
Chaque organisation pourra garder la main sur sa propre visibilité et communication et proposer des
événements locaux en fonction de son propre agenda, en les inscrivant sous la bannière de la
campagne.
Chacun pourra réaliser ses activités et sa communication sur ses sujets et missions principales, tout en
les rattachant à la bannière commune “Droit à l’eau pour tous”, afin de mobiliser l’ensemble des publics
sensibles à ce sujet.
Une première reunión d’information a eu lieu le 11 juin à la Résidence de l’eau à Paris afin de présenter
ce projet aux organisations intéressées et partenaires, discuter des objectifs, du calendrier préparatoire
et des modalités de participation.
Si vous souhaitez vous engager dans la campagne, contacter edith.guiochon@coalition-
eau.org
4. Agenda 2030 du développement durable
Réunion ministérielle SWA
La réunion des Ministres de l’eau et de l’assainissement du Partenariat « Sanitation and Water for All »
(SWA) s’est tenue les 4 et 5 avril 2018 à San José, au Costa Rica, sur le thème « Ne laisser personne
de côté ». Cette réunion régulière constitue l’un des grands rassemblements politiques consacrés à
l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
Engagements nationaux et fiches-pays : une cinquantaine de Ministres y ont participé aux côtés de
partenaires d’organisations de la société civile, de bailleurs de fonds, de banques de développement,
d’institutions de recherche et d’enseignement, du secteur privé et d’autres agences.
Au cours du processus préparatoire, les 47 pays ont préparé des « fiches-pays » qui résument l’état
des lieux des enjeux nationaux (accès, financements, dispositifs institutionnels…), avec un focus sur
les inégalités, les priorités du pays, et – lorsque c’était possible – les engagements du gouvernement
et des partenaires (présentés à la réunion ministérielle). Ces fiches-pays peuvent constituer de
précieuses sources d’informations.
La mobilisation de la société civile : La Coalition Eau s’est impliquée au sein du collège société
civile pour mobiliser ses partenaires OSC dans les processus nationaux et a soutenu la participation de
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 8
23-05-2019son partenaire malien, Tabalaba Boureima, coordinateur de la Coalition Nationale pour l’Eau Potable et
l’Assainissement (CN-CIEPA) du Mali.
Les organisations de la société civile ont préparé des messages communs et ont ainsi appelé
l’ensemble des parties prenantes, notamment les gouvernements, à unir leurs efforts afin de placer
l’expression « pour tous » au cœur de la mise en œuvre de leurs stratégies en faveur de la réalisation
des ODD.
Suivi : le suivi des engagements des pays se fera en lien avec nos réseaux partenaires (une session
est prévue sur ce sujet lors de l’atelier de Dakar).
La prochaine réunion SWA sera la Réunion des Ministres des Finances en 2020. Il y a de forts enjeux
à créer davantage de liens entre Ministres du secteur EAH et Ministres des Finances et à renforcer les
messages de la société civile sur les financements.
Atelier avec les collectifs africains, 18-22 juin 2019, Sénégal
Cet atelier de renforcement et de partage d’expériences se situe dans la suite du travail effectué depuis
2008 avec les collectifs d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette dynamique prend de l’ampleur (10 pays
aujourd’hui) et intègre de plus en plus de partenaires : SWA, WSSCC, IRC, WIN, ACF etc.
L’atelier de 2019 est centré sur thème « En route pour Dakar 2021 : la mobilisation des OSC de la sous-
région. Accélérer les efforts pour l’atteinte de l’ODD 6 ». Lors de l’atelier de l’année dernière, un travail
avait été réalisé pour élaborer des stratégies de plaidoyer pour le contrôle citoyen pour l‘atteinte des
ODD. L’atelier permettra de voir où nous en sommes de ces stratégies, en s’appuyant sur des
événements forts du secteur.
L’objectif général de l’atelier est d’élaborer une stratégie de plaidoyer et de mobilisation sous-régionale
en vue du Forum Mondial de l’Eau (Dakar 2021) et au-delà, pour accélérer la mise en oeuvre de l’ODD
6.
L’atelier aura lieu du 18 au 22 juin avec 35 participant. Les collectifs participeront ainsi au “kick-off
meeting” du 9ème Forum Mondial de l’Eau (réunion de lancement du processus préparatoire).
Résultats attendus:
- Avoir un suivi sur ce qui a été fait du point de vue du plaidoyer pour l’ODD 6, du contrôle citoyen
et des stratégies de plaidoyer des pays et de la sous-région
- Permettre aux partenaires collectifs africains de participer au kick-off meeting du FME et
préparer des messages vis-à-vis du FME
- Poser les bases d’un programme commun de plaidoyer et de mobilisation au niveau sous-
régional
Kick off meeting du 9ème Forum Mondial de l’Eau
L’objectif de cette rencontre est de présenter le 9ème Forum Mondial de l’Eau (FME) qui sera organisé
par le Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau à Dakar en 2021. Le Sénégal semble vouloir faire table
rase du format traditionnel du FME avec les processus par types d’acteur. L’idée est d’avoir un cadre
renouvelé avec un processus multi acteurs autour de 4 thématiques. Il y a en outre une volonté de
mettre en avant des orientations politiques et citoyennes plus fortes du Forum (notamment, renforcer
les liens avec l’ONU et organiser le premier sommet des chefs d’Etat sur l’eau lors du Forum). La
Coalition Eau (secrétariat et plusieurs ONG membres) sera présente au Kick off meeting avec ses
partenaires.
5. Eau et Climat
Actualités et lancement d’un projet NDC
L’année passée, le Groupe de Travail Eau & Climat de la Coalition Eau avait révisé la stratégie climat
du collectif et avait décidé de moins investir les sommets climat (la Coatliion Eau ne s’est pas rendue à
la COP24 en Pologne mais a facilité la participation de partenaires) pour davantage s’impliquer sur la
mise en œuvre des engagements et le renforcement de compétences de acteurs (ONG et partenaires
terrain).
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 9
23-05-2019Dans ce cadre, la Coalition Eau, en partenariat avec le PFE et la Réseau Climat et Développement
réfléchit au lancement un projet d’étude et de plaidoyer sur les enjeux liés à l’eau dans les politiques
publiques de mise en œuvre des Contributions Déterminées au National dans 3 pays africains
(francophones).
III. Point financier
Programme 5 : 1er février 2018 – 31 janvier 2021
Budget prévisionnel : 1 049 611€
Point sur les ressources :
Bailleurs Montant (€) Part Etat
Agence Française de Développement 576 600 55% Acquis
Acquis (10.000) /
Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères 30 000 3%
à solliciter (20.000)
Agence Française pour la Biodiversité 132 000 13% Acquis
Acquis (20.000) /
Fonds privés (ONG, fondations...) 66 405 6%
à solliciter (46.405)
Valorisation partenaires privés 1606 0% Acquis
Contribution des ONG membres 33 000 3% Acquis
Valorisation des ONG membres 210 000 20% Acquis
TOTAL 1 049 611 100%
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 10
23-05-2019PARTIE 2 :
TEMPS D’ECHANGE : « La contribution des
ONG françaises à la coopération internationale
pour l’eau et l’assainissement »
Partie 1 : Restitution des résultats préliminaires de l’étude ONG à partir de
l’enquête et des entretiens
Début 2019, la Coalition Eau a lancé une étude intitulée « La contribution des ONG françaises à la
coopération internationale pour l’eau et l’assainissement ». L’enquête s’est adressée à l’ensemble des
ONG de coopération internationale ayant des actions dans le domaine de l’eau, l’assainissement, et
l’hygiène. 44 ONG ont répondu au questionnaire et des entretiens individuels ont été menés avec 17
ONG. Les réponses ont permis de dresser un état des lieux des actions et contributions des acteurs
associatifs du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH).
Le power point de restitution de l’étude est disponible ici, dans la version présentée lors de l’atelier
commun avec l’AFD et le PS Eau le 6 juin 2019.
En attendant le document d’analyse complet publié à la rentrée de septembre 2019, voici un résumé
des principaux constats de l’étude :
Les 44 ONG étudiées sont présentes dans 65 pays d’intervention parmi lesquels 71% des pays
les moins avancés et à faible revenu et 59% des pays à revenu intermédiaire tranche inférieure.
Pour la période 2015-2017, le montant global des financements obtenus par les ONG du panel
pour les projets Eau-Assainissement-Hygiène (EAH) s’élève à 328 142 686€, les trois
principales sources de financement étant l’Union Européenne, le système des Nations Unies
(UNICEF, etc.), et les bailleurs bilatéraux non français (DFID, USAID, etc.)
En 2017, les ONG d’urgence humanitaire ont reçu 77% des financements contre 23% pour les
ONG de développement notamment du fait de leur capacité à obtenir des financements
européens et multilatéraux, la première source de financement des ONG de développement
étant la coopération décentralisée pour 32% de leurs financements.
Cet état des lieux nous a permis d’élaborer plusieurs recommandations :
Simplifier et améliorer la transparence des procédures de candidature, de reporting et de
décaissement des projets et revoir la demande de cofinancement
Mieux prendre en charge les frais support, indispensables pour une cohérence dans les
interventions, pour le renforcement des capacités, mais aussi pour assurer le reporting et le
suivi-évaluation.
Augmenter les financements publics français pour les ONG dans le domaine de l’EAH
Mieux articuler les phases d’urgence et de développement via des mécanismes financiers
adaptés
Garantir des moyens d’action aux organisations intervenant dans les zones rouges
La discussion avec les participants a fait émerger les points suivants :
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 11
23-05-2019- Il est important de montrer l’effet de levier permis par la coopération décentralisée pour les ONG
de développement et le fait que ce type de financement permet de développer des approches
plus innovantes.
- Les bailleurs devraient augmenter les financements non-ciblés pour redonner plus de pouvoir
aux ONG sur leurs propres stratégies et favoriser l’innovation.
- Il serait utile d’avoir des mécanismes de financements sur des périodes plus longues (exemple
10 ans), avec un engagement sur une convention programme comportant des objectifs larges
avec une réactualisation progressive. Cela pourrait comprendre un engagement moral sur la
durée si le projet se passe bien (cf les mécanismes suisses existants).
- Il n’y a pas un mapping clair des bailleurs qui financent l’innovation.
- Certains pays où il y a des besoins ne sont pas pris en compte par l’AFD comme la Moldavie.
- On voit une tendance à la baisse des financements des coûts siège (discussion pour passer de
7% à 5%) alors que cela est en complète contradiction avec l’augmentation de la charge en
termes de reporting. Cela pousse à délaisser la qualité et l’innovation dans les projets.
- Les ONG font face à des contraintes fortes pour les zones rouges où des populations se
retrouvent confrontées à une double peine : incapacité des services publics à répondre à leurs
besoins, refus des bailleurs de soutenir des projets de développement dans ces zones.
Merci à toutes les organisations ayant participé à l’élaboration de cette étude.
Partie 2 : Approfondissement de 3 problématiques en groupes
Les travaux de groupe ont permis d’approfondir 3 enjeux :
- Comment améliorer la durabilité des actions des ONG ?
- Quel serait la forme idéale d’évaluation des projets ?
- Quel ciblage des projets pour mieux prendre en compte les plus vulnérables ?
Des restitutions ont été partagées :
1. Groupe Durabilité : comment améliorer la durabilité des actions des ONG ?
Qu’entend-on par durabilité ? Parle-t-on de durabilité du projet ou de durabilité des résultats ?
Le cadre logique par exemple est souvent centré sur des résultats en nombre de bénéficiaires
du projet.
Comment le résultat peut dépasser le territoire qui est celui d’un projet ? Il est important de
s’adapter au cadre sectoriel local, pour entrer dans le cadre des politiques publiques.
La concertation et le renforcement des acteurs sont essentiels, mais à quelle échelle ? Cela est
variable d’une association à l’autre. Il est important de renforcer les mécanismes de gestion à
l’échelle locale, d’appuyer les maitrises d’ouvrage. Les résultats post-projet peuvent être plus
importants si on fait plutôt de la formation. Le cadre logique est-il adapté pour ce type de projets
?
Faire passer à l’échelle les projets mis en place : au-delà d’une infrastructure pour un village, il
est possible de voir plus large à l’échelle de plusieurs villages.
Outre les aspects techniques de la durabilité, les aspects financiers sont majeurs : Le
financement du service est plus solide quand on ne subventionne pas les charges récurrentes
d’exploitation (car cela induit une distorsion pour la suite). Il faut donc fixer un tarif adapté et
prévoir des participations des habitants, de la commune ou de l’Etat aux charges récurrentes
afin de pérenniser les services. Le tarif doit faire prendre conscience du coût d’exploitation
qu’implique le service. Avant la réalisation d’un ouvrage, la question de la tarification et du
modèle de gestion doit être posée et fixée. C’est un préalable nécessaire à la réalisation.
Quelle est la durée idéale d’un projet : 4 ans ? 6 ans ? 10 ans ? Cela dépend de l’échelle à
laquelle on se place. Sur une région, une intervention est beaucoup plus longue que sur un
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 12
23-05-2019village. Et elle sera aussi plus longue si elle implique des infrastructures. Sur un petit village, en
4/5 ans, cela peut fonctionner. Il n’y a pas de recommandation fixe sur ce sujet.
Un suivi technique et financiers par l’ONG a-t-il vocation à exister ? ou bien doit-il être
directement pris en charge par des opérateurs locaux et financés par les tarifs du service ? Il
existe l’exemple des STEFI (structures de suivi technique et financier) qui permettent de faire
un suivi des résultats. Aujourd’hui il existe des pays dotés de STEFI qui sont intégralement
financés et qui sont en capacité de réaliser un suivi des projets, en envoyant des résultats
d’exploitation des services chaque année.
Dans le domaine de l’urgence, ce n’est pas évident de raisonner sur une durabilité finanicère
des services. Le coût des services ne se pose pas de la même manière. Comment assurer la
transition entre les deux phases, comment les pratiques d’urgence sont compatibles avec la
mise en place de services durables, quel consentement à payer et capacité à payer dans des
situations de pauvreté ?
2. Groupe Evaluation : quelle serait la forme idéale d’évaluation des projets ?
Qu’entend-on par évaluation ?
Redevabilité : Il ne s’agit pas seulement de celle du bailleur. Il s’agit aussi de la redevabilité
auprès du bénéficiaire qui est souvent oubliée.
Enseignements et amélioration de l’action :
Système de capitalisation des enseignements.
Diffusion dans un objectif de renforcement de capacités des acteurs du projet et des acteurs
qui peuvent graviter autour.
Comment évalue-t-on ?
Prévoir l’évaluation dès le départ et l’intégrer dans l’élaboration/rédaction du projet avec
une ligne de financement associée.
Prévoir des indicateurs, pour avoir une baseline d’indicateurs initiale.
Système de suivi-évaluation à mettre en place pour connecter l’action avec l’impact.
L’évaluation finale ne doit pas arriver trop tard après la fin du projet (car sinon on ne sait
pas ce qui est de l’impact du projet ou d’autres facteurs).
Une implication des parties prenantes et bénéficiaires dans l’évaluation est primordiale, à
la fois dans la conception du cahier des charges et dans celle du système évaluatif
Indicateurs :
Pas seulement quantitatifs ! très demandés par les bailleurs, il faut aussi prévoir du
qualitatif.
Harmonisation des indicateurs entre bailleurs pour faciliter l’action des opérateurs et pour
pouvoir justifier de son action sans faire trop de reporting.
Déclaration de Paris (efficacité de l’aide) en 2005 : pour une harmonisation des procédures
de rapportage auprès des bailleurs bilatéraux et multilatéraux.
Autres recommandations :
Faire des évaluations globales plus transversales.
Evaluer les actions des ONG comparativement à d’autres types d’acteurs. Une analyse
comparée de fonds européens a été réalisée : une étude au Burkina Faso montre l’efficacité
des investissements qui transitent par les ONG plutôt que par des acteurs privés ou publics.
Il est nécessaire d’introduire une recommandation sur l’efficacité et l’efficience des ONG.
Les ONG pourraient aussi se comparer à des acteurs privés. Là encore il y a une plus
grande efficience que des acteurs privés car il n’y a pas de rémunération des actionnaires.
Il est important d’inscrire les évaluations dans un processus plus large d’apprentissage
intégré.
3. Groupe Vulnérabilité : quel ciblage des projets pour mieux prendre en compte les plus
vulnérables ?
Qu’entendons-nous par les plus vulnérables ?
A l’échelle macro : les pays pauvres
A l’échelle locale : les plus vulnérables au sein d’une localité
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 13
23-05-2019 Identifier les plus vulnérables : sur quels critères ? quelles vulnérabilités prendre en compte ? Il
y a un problème d’invisibilisation des plus vulnérables et un besoin de recroiser les données
pour éviter les biais (faire du cross data checking, mais cela est difficile à faire).
Comment faire pour que le service connecte les plus vulnérables ?
Quelles modalités d’accès concernant la tarification ?
Quel accès physique ?
Besoin d’adapter le service à un panel de vulnérabilités très large.
Limiter la création de la vulnérabilité notamment par la destruction des services. Exemple : les
zones de conflit : protection humanitaire, respect du Droit international humanitaire.
Solutions adaptées aux plus vulnérables et dissémination d’une information adaptée aux plus
vulnérables (connaissances et dissémination connaissance – type Wikiwater).
Appui à la bonne gouvernance et principe de subsidiarité. Ancrage local : Partenariat avec des
ONG locales et co construction avec d’autres structures.
Inclusion des plus vulnérables sur l’ensemble du cycle de projet.
Il est parfois difficile de faire porter politiquement et localement des dispositifs qui incluent les
plus vulnérables. Les politiques s’intéressent peu à la tarification sociale, car ils sont trop
centrés sur des dispositifs généraux qui profitent à tout le monde. Le rôle du plaidoyer est
d’orienter les politiques vers des dispositifs adaptés à tous, y compris les plus vulnérables.
La question se pose aussi pour les populations marginalisées et discriminées volontairement :
cela s’inscrit dans une réflexion plus large sur les causes profondes des inégalités et des
injustices.
Compte-rendu de l’Assemblée plénière 14
23-05-2019Vous pouvez aussi lire