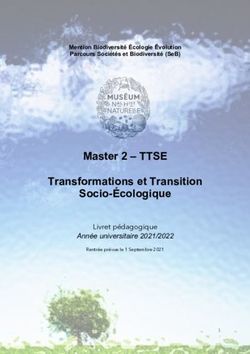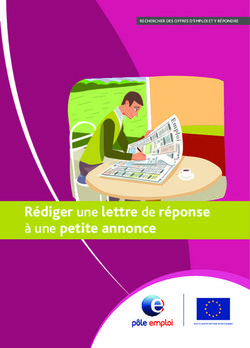CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-UQAT SUR LA BIODIVERSITÉ EN CONTEXTE MINIER - 27 & 28 AVRIL 2022
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-UQAT SUR LA BIODIVERSITÉ EN CONTEXTE MINIER 27 & 28 AVRIL 2022 CAHIER DU PARTICIPANT
Mission de la Chaire BCM
La mission de la Chaire est de générer et de diffuser des
connaissances sur la biodiversité nordique afin de développer
des stratégies visant à réduire l’empreinte écologique d’une
mine tout au long de son cycle de vie, et ce, dans un contexte
de perturbations multiples, y compris les changements
climatiques, et dans un souci d’inclusion à la fois des
connaissances scientifiques et traditionnelles.
Les objectifs
• Réduire l’empreinte écologique des mines sur la biodiversité
pendant leur cycle de vie complet
• Éviter le risque pour la biodiversité en développant des outils
pour la planification écologique
• Diminuer les impacts cumulatifs sur les services
écosystémiques fournis par la biodiversitéHoraire de la journée
27 avril 2022
Présentateur Titre
8h30 30 min. Accueil et arrivée des participants
9h 15 min. Nicole Fenton Mot de bienvenue - Portrait de la Chaire et retour sur l’année 2021
9h15 30 min. Xiangbo Yin Déterminer l’empreinte des mines à l’aide de la végétation et de la phyllosphère
9h45 5 min. Période de questions
Empreinte spatiale des polluants particulaires autour des mines actives et
9h50 20 min. Mélanie Jean
OBJECTIF 1
restaurées - croissance et bioaccumulation des bryophytes
10h10 5 min. Période de questions
10h15 30 min. Pause
Empreinte spatiale des mines sur les propriétés physico-chimiques et biologiques
10h45 20 min. Christine Martineau des sols, des sédiments et de l’eau
11h05 5 min. Période de questions
Impacts des mines sur la biodiversite: “modelisation des strategies visant à reduire
11h10 10 min. Kadiatou Soumah l’empreinte des mines sur le paysage environnant
11h20 5 min. Période de questions
Présentatrices invitées
11h25 20 min. Eleanor Berryman & Amy Cleaver Casa Berardi and Joutel dust monitoring program
Ressources naturelles Canada
11h45 5 min. Période de questions
Midi Dîner
Présentateur invité -
13h15 20 min. Frédéric Poisson - MELCC
La Chaire BCM et la DCE vers un horizon de projets !
13h35 10 min. Période de questions
13h45 20 min. Nils Ambec Importance régionale des parcs à résidus miniers pour la biodiversité des plantes
OBJECTIFS 1 & 3
14h05 5 min. Période de questions
Diminuer les impacts cumulatifs sur les services
14h10 20 min. Maxime Thomas écosystémiques fournis par la Biodiversité
14h30 5 min. Période de questions
14h35 30 min. Pause
Évaluer la diversité alpha et bêta d’espèces discrètes à l’aide de données
15h05 20 min. Carlos Cerrejón Lozano satellitaires à différentes résolutions spatiales
15h25 5 min. Période de questions
Présentatrice invitée
15h30 20 min. Laura Hjartarson (U. Laval)
Biological soil crusts at abandoned borrow pits, as a proxy for mine sites
15h50 5 min. Période de questions
15h50 Fin de la première journée de conférencesHoraire de la journée
28 avril 2022
Présentateur Titre
9h 20 min. Marc-Frédéric Indorf Projet de rechreche sur la végétation des tourbières jamésiennes
9h20 10 min. Période de questions
Présentatrice invitée Hydrophysiological and geochemical changes in disturbed sub-arctic patterned
9h30 20 min. Nicole Balliston peatlands induced by mine dewatering
9h50 10 min.
10h00 20 min. Mariano Feldman Bird assemblages and habitat characteristics in northern landscapes
OBJECTIF 2
10h20 5 min. Période de questions
Utilisation et importance des milieux humides par les autochtones et évaluation du
10h25 30 min. Éliane Grant stress chez l’orignal à proximité d’exploitations minières en Eeyou Istchee
10h55 5 min. Période de questions
11h00 30 min. Pause
Double regard sur les tourbières du Québec nordique :
11h30 20 min. Camilo Gomez Indice écologique multidimensionnel pour les tourbières
11h50 5 min. Période de questions
11h55 20 min. Julia Morarin Atlas de biodiversité : Écosystèmes des tourbières
12h15 5 min. Période de questions
12h20 Fin des conférences
13h00 Rencontre du comité d’orientationNom : Xiangbo Yin
i a n g b o Y i n Nationalité : chinoise
X Éducation :
• Étudiant au doctorat à l’Institut de
recherche sur les forêts de l’UQAT
• Maîtrise en botanique (bryologie);
Université normale chinoise de l’est;
• Baccalauréat en agriculture de la faculté
des sciences et d’ingénierie, Université agricole de
Chine.
Intérets de recherche : Passions :
• Taxonomie et écologie • Les voyages;
des bryophytes; • La photographie;
• Écologie microbienne; • Peinture traditionnelle
• Culture horticole. chinoise.
Résumé de la présentation de Xiangbo (présentation en anglais)
Les effets hors site des mines sur les communautés des sous-bois ont été
quantifiés en utilisant les plantes de sous-bois et les microbiomes de la
phyllosphère des mousses autour de six sites miniers. Nous avons constaté que
les effets hors site des mines affectaient la diversité des sous-bois et de la
phyllosphère. Les effets négatifs sur la diversité des sous-bois sont plus nombreux
à proximité des sites miniers en exploitation que des sites non exploités. Les
espèces de plantes de sous-bois des forêts à feuilles caduques et mixtes ont été
plus touchées que les espèces en forêts de conifères. Les types d’écosystèmes
n’ont pas affecté les effets hors site sur la diversité de la phyllosphère. Les effets
les plus forts ont généralement été observés à moins de 200 mètres des mines.
Étant donné les changements prévus dans les écosystèmes de la forêt boréale
avec l’empiètement des espèces à feuilles caduques sur les forêts de conifères
et la sensibilité accrue des forêts mixtes et à feuilles caduques, la zone affectée
par les effets hors site des mines pourrait augmenter à l’avenir. Nous suggérons
que les effets hors site soient inclus dans les évaluations écologiques.
N.b. La conférence de Xiangbo sera en anglais.é l a n i e Nom : Mélanie Jean
Dr e M n
Nationalité : canadienne
Éducation :
Je a • Post-doc, 2018-2020, Université du
Québec en Abitibi-Témiscamigue;
• Post-doc, 2017-2018, Northern
Arizona University;
• PhD, 2017, University of Saskatchewan;
• MSc, 2012, Université Laval;
• BSc, 2009, Université de Montréal.
Intérets de recherche :
• Écologie végétale; • Fixation de l’azote;
• Bryophytes; • Synamique des
• Interactions plantes-sol; communautés;
• forêt boréale; • Trait fonctionnels.
Résumé de la conférence de Mélanie
Les impacts indirects des mines sont encore peu connus, en particulier
dans la forêt boréale, et peuvent varier en fonction du cycle de vie de
la mine et de l’écosystème environnant. Nous visons à déterminer
l’empreinte spatiale des mines en 1) évaluant les concentrations de
base des métaux, 2) en évaluant comment le cycle de vie de la mine
et le type d’écosystème influencent l’étendue spatiale de la pollution,
3) en mesurant les impacts sur la croissance des mousses, et 4) en
comparant les concentrations mesurées dans différentes espèces
de mousses. Nous avons échantillonné autour de six mines à différents
stades, le long de transects de 100 m perpendiculaires au périmètre
de chaque mine et dans des parcelles témoins en 2018-2020. Les
concentrations de 25 éléments ont été (ou seront) mesurées sur 307
échantillons de la mousse Pleurozium schreberi, 34 Callicladium
haldanianum, et 28 sphaignes. La croissance annuelle a été mesurée
sur P. schreberi. Nos résultats préliminaires indiquent que des
concentrations de métaux plus élevées que dans les témoins ont été
trouvées jusqu’à environ 200 m de la bordure autour d’une mine active
et les concentrations sont plus faibles autour de la mine Joutel (fermée
depuis 1998) que de LaRonde (active), mais les tendances varient
dans l’espace. Nos résultats contribueront à réduire les impacts
environnementaux des activités minières dans la forêt boréale.e
Nom : Christine Martineau
h r i s t i n u
Nationalité : canadienne
C r t i n e a Christine Martineau est chercheure scientifique
M a spécialisée en microbiologie/écologie
microbienne au Centre de Foresterie des
Laurentides depuis 2018. Elle possède une
vaste expérience en biologie moléculaire et
génomique environnementale. Au fil des ans,
elle a étudié les communautés microbiennes dans
divers types d’environnements tels que les sols de
l’Arctique, la rhizosphère des plantes, les sols agricoles ou
les résidus miniers.
Résumé de la présentation de Christine
Les mines sont associées à des perturbation très locale et visible au
point d’implantation et à des perturbations moins visibles au-delà du
point d’implantation. L’objectif de cette étude menée en collaboration
par la Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte
minier et le Service Canadien des Forêts est d’évaluer l’impact des mines
sur les propriétés physico-chimiques et biologiques des sols, des
sédiments et de l’eau au-delà du point d’implantation. Après avoir
principalement travaillé en 2019 et 2020 sur les propriétés des sols,
l’année 2021 a été majoritairement consacrée à la finalisation des
protocoles d’échantillonnage et d’analyses de laboratoire pour l’eau et
les sédiments, la sélection de sites d’échantillonnage de ruisseaux et
rivières, et l’échantillonnage d’eau et de sédiments à proximité de 4 sites
miniers (Casa Berardi, Joutel, LaRonde, Akasaba). Deux des sites (Casa
Berardi et Joutel) ont été échantillonnés en juin et en septembre afin de
pouvoir évaluer la variabilité temporelle des différents paramètres
mesurés dans l’eau et les sédiments. Dans cette présentation, un résumé
des résultats obtenus à ce jour pour les sols ainsi qu’un survol de
l’avancement des travaux pour l’eau et les sédiments seront présentés.Nom : Kadiatou Soumah
Nationalité : guinéenne
u m a h Éducation :
i a t o u So • Étudiante en Maitrise en Genie mineral,
profil recherche (UQAT);
Kad • Diplomée en Sciences de
l’Environnement du CERE( Centre
d’Étude et de Recherche en Environnment)
de l’Université de Conakry;
• Licence 3 en Biologie (option écologie) de
l’Université de Conakry.
Résumé de la présentation de Kadiatou
Ce projet d’étude est une maitrise qui doit s’effectuer sur une période de deux ans.
Il consistera à proposer des modèles de mine géoréférencé ayant peu de dommages
sur la biodiversité végétale. Grace aux logiciels ArcGIS, des scenarios seront faits et
les interactions entre les différents composants du model seront évaluées s’il y’a
lieu.
Depuis 2018, plusieurs projet de recherche ont travaillé sur les impacts hors site des
opérations minières sur les écosystèmes dans six mines en Abitibi et dans la région
Nord du Québec au Canada à savoir : la mine Akasaba (future mine devant être
établie,), la mine Casa Berardi ( en opération depuis 1935), la mine Canadian Malartic
(en opération depuis 1934), la mine Laronde (opération depuis 1988), la mine Lapa
(en phase de restauration), la mine Joutel (fermée depuis 1998) . Les données
obtenues pendant cette étude ont été synthétisées et groupées en fonction de
plusieurs critères (l’abondance de espèces végétales sélectionnées, la distance de
répartition des espèces végétales autour des sites miniers…)
Dans ce projet de maitrise, nous utiliserons ces différentes données pour faire des
multiples scénarios géoréférencés dans Arc GIS, nous choisirons différents types
d’écosystèmes représentatifs de la région du Nord du Québec et de l’Abitibi et nous
intégrerons différents facteurs des sites miniers pour ensuite évaluer les interactions
en vue de proposer un modèle de mine avec peu de dommage sur la biodiversité
végétale.y m a n
B e r r
e a n o r e r
E l C l e a v
A m y
&
Conférencières invitées (présentation en anglais)
Résumé de la présentation d’Eleanor et d’Amy
Le changement climatique augmente le potentiel de mobilisation de la
poussière. En réponse, il est nécessaire d’améliorer : 1) la surveillance du dépôt
et du transport de la poussière ; et 2) notre compréhension des impacts de la
poussière des mines sur l’environnement. Les deux sites miniers étudiés sont
Casa Berardi, une mine d’or souterraine/à ciel ouvert en activité, et Joutel, une
mine d’or historique, tous deux situés dans des environnements ombrotrophes
sensibles aux apports de poussières. Des collecteurs passifs de dépôts secs
(Pas-DD) et des boîtes à poussière ont été installés dans des transects autour
des sites. Les Pas-DD étant une technique plus récente, l’analyse impliquera
la détermination de méthodes gravimétriques et minéralogiques appropriées.
Ce programme de recherche permettra de déterminer les sources de poussière
sur les sites miniers et d’identifier l’historique des dépôts de poussière. Pour
ce faire, il s’appuiera sur l’analyse géochimique, isotopique et minéralogique
des sources de poussière pour identifier les signatures de la source dans les
poussières capturées et dans les archives de poussière enregistrées dans les
carottes de tourbe. L’impact environnemental sera quantifié par l’évaluation
des contrôles minéralogiques sur le lessivage des poussières dans les eaux
de surface, leur impact sur la capacité de stockage du carbone de la tourbe,
ainsi que par la modélisation géochimique et de dispersion. Dans l’ensemble,
cette recherche améliorera notre compréhension des poussières de mines et
de leur impact sur les écosystèmes hôtes.Nom : Nils Ambec
A m b e c Nationalité : française
s
Je m’appelle Nils Ambec et suis étudiant en
N i l doctorat à l’UQAT depuis l’automne 2019. Je
travaille sur la diversité des plantes vasculaires
et des bryophytes dans les quelques habitats
qui contrastent à travers la forêt dominante
de l’Abitibi. Cette présentation portera plus
particulièrement sur les sites miniers désaffectés
et le sol extrêmement stressant qu’ils laissent aux plantes.
En tant que milieux ouverts, je les compare également à d’autres
milieux naturellement ouverts et dont le sol est naturellement
stressant pour les plantes comme les affleurements calcaires
et ultramafiques.
Résumé de la présentation de Nils
Depuis le début de l’industrialisation, soixante-quinze pour cent des écosystèmes de
la planète ont été modifiés en raison des activités anthropiques. Cependant, en créant
des habitats ouverts, ces activités peuvent également favoriser l’établissement de
certains groupes taxonomiques spécialisés. Les pâturages pour les orchidées et les
rapaces en sont un exemple courant. Les sites miniers peuvent avoir un effet ambivalent.
Avec des sols pollués, ils créent des conditions stressantes pour les organismes et
favorisent un petit nombre d’espèces spécialisées. Avec un gisement d’or de classe
mondiale, la région de l’Abitibi concentre un ensemble de mines en exploitation ou
fermées. La région est dominée par des forêts aménagées sur la vaste ceinture de
roches vertes de l’Abitibi, recouverte d’argile glaciolacustre. Par conséquent, les résidus
miniers créent un habitat rare à l’échelle régionale. Dans ce projet, nous avons comparé
les communautés végétales des résidus miniers à d’autres habitats naturels ouverts
avec des sols stressants tels que les roches ultramafiques et les affleurements
calcaires, avec des étangs de castors abandonnés comme contrôle. Nous émettons
l’hypothèse que (1) les communautés d’espèces sur les sites de résidus miniers ne
sont pas homogènes et (2) sont différentes des autres habitats stressants, principalement
en raison (3) de la géochimie qui détermine les assemblages d’espèces végétales.
Nos résultats valident les hypothèses (1) et (3) puisque les communautés de résidus
miniers ne sont pas toujours similaires, principalement à cause de la géochimie. Comme
les résidus miniers varient, certaines de leurs communautés ressemblent à des sites
naturels, principalement des affleurements calcaires, ce qui signifie que nous avons
rejeté l’hypothèse (2). Ces résultats permettent de mieux distinguer les résidus miniers
et, peut-être, d’adopter une meilleure approche lorsqu’il s’agit de les restaurer.s s o n
r i c P oi
F ré d é
Conférencier invité
À propos de Frédéric
Français de naissance pas encore tout à fait québécois.
Écologue au ministère de l’Environnement et à la Lutte contre les Changements
Climatiques.
Je travaille principalement sur l’analyse de l’organisation spatiale des
écosystèmes terrestres pour leur conservation et l’aménagement durable du
territoire.
Résumé de la présentation
La présentation porte sur les projets de la chaire que nous finançons et sur
nos projets qui sont en lien direct avec les recherches de la chaireNom : Maxime Thomas
o m a s Nationalité : française
e T h Éducation :
im
• Étudiant au doctorat à l’Institut de
M a x recherche sur les forêts de l’UQAT;
• Master en Biologie végétale (Plantes
et Société) – Tours (France);
• Licence en Biologie et Biochimie Chimie –
Tours et Saint-Etienne (France).
Résumé de la présentation de Maxime
La forêt boréale du Canada est soumise à de nombreuses perturbations
anthropiques et naturelles. Ces perturbations peuvent avoir des effets sur
l’écosystème mais aussi sur les communautés autochtones. En effet, les
communautés autochtones partagent un lien étroit avec leur territoire, et
dépendent de différentes espèces, appelées espèces culturelles clés, pour
la pratique de leurs activités traditionnelles. Le thé du Labrador et le bleuet
sont deux de ces espèces étudiées dans ce projet. Ce projet prend place
à l’ouest du Québec, dans les territoires traditionnels des communautés
de Pikogan, Nemaska et Mistissini. Dans ces territoires, l’effet des mines
et des lignes hydroélectriques est préoccupant pour les communautés, et
est donc évalué sur le thé du Labrador et le bleuet. L’effet des perturbations
sur ces espèces est étudié au niveau : i) de leur aire de répartition, ii) de
leur expression génétique, pour évaluer leur réponse interne aux
perturbations, et iii) de leur concentration en composés d’intérêt médicinal/
nutritionnel. Des résultats sont disponibles concernant les composés
médicinaux du thé du Labrador, indiquant que ceux-ci sont favorisées par
les perturbations ouvrant la canopée. Ce projet permettra de mieux
comprendre l’effet des perturbations sur les modes de vie autochtones
via l’angle des espèces culturelles clés.r r e j ó n Nom : Carlos Cerrejón Lozano
Nationalité : espagnole
o s C e Éducation :
C a r l • Étudiant au doctorat à l’Institut de
recherche sur les forêts de l’UQAT;
z a n o • MSc degree in Biodiversity and
o
Biology of Conservation – Sevilla;
L • BSc degree in Environmental Sciences.
Résumé de la présentation de Carlos
Les lichens sont des espèces écologiquement importantes mais sensibles
qui sont souvent négligées dans la planification de la conservation. La
télédétection peut permettre aux planificateurs de mieux comprendre
leurs patrons de biodiversité. Cette étude vise à décrire et à modéliser
la diversité alpha et la diversité bêta des lichens à l’aide de variables de
télédétection dans une région subarctique du nord du Québec. Les lichens
ont été échantillonnés dans tous les types d’habitats présents dans la
région. Alors qu’une grande richesse en lichens a été généralement
trouvée, ces parcelles plus riches en microhabitats abritaient souvent
plus d’espèces. Des différences dans la composition des espèces ont
été identifiées, étayées par des différences dans la composition des
microhabitats. Les modèles de Poisson expliquaient une fraction
significative de la variation de la richesse en lichens (jusqu’à 32%). Les
tests de Mantel ont fourni des estimations précises sur la relation entre
la diversité bêta et la distance spectrale, confirmant que des zones plus
différentes spectralement et donc environnementales ont tendance à
abriter différentes communautés de lichens. Cette étude contribue à
améliorer nos connaissances sur la biodiversité des lichens dans les
régions subarctiques et informe sur l’utilisation de la télédétection pour
comprendre leurs modèles de biodiversité.r s o n
j a r ta
u r a H
L a
Confériencière invitée (présentation en anglais)
Dans la recherche d’une méthode holistique et rentable de
revégétalisation des sites d’extraction du Nord, l’utilisation de
croûtes de sol biologiques (BSC) pour accélérer la succession
primaire est prometteuse. Les BSC sont des communautés
comprenant des lichens, des bryophytes et des bactéries, qui se
lient aux particules du sol pour former une croûte de surface. Grâce
à leurs fonctions écologiques pertinentes et à leur capacité à se
développer dans des environnements difficiles, les BSC sont bien
placées pour faciliter le rétablissement fonctionnel des écosystèmes
dégradés. Cependant, on sait très peu de choses sur les BSC dans
la forêt boréale du Québec. Des études de la végétation des BSC
s’établissant sur des bancs d’emprunt abandonnés, anciennement
utilisés pour la construction de routes, ont été menées afin de
caractériser les espèces de lichens et de bryophytes des BSC
s’établissant spontanément et d’identifier les facteurs
environnementaux régissant la distribution de ces communautés.
Le séquençage de l’ADNr 16S et du gène nifH a été réalisé pour
caractériser la diversité bactérienne sous un sol nu et trois types de
BSC situés sur des résidus miniers abandonnés. Les résultats
mettent en évidence la diversité des espèces de lichens et de
bryophytes présentes dans le BSC, comment ces espèces forment
des communautés distinctes façonnées par les variables abiotiques
et les propriétés physico-chimiques du sol.é r i c Nom : Marc-Frédéric Indorf
c - F r éd Nationalité : française
Éducation :
M a r Étudiant post-doctoral à l’Institut de
recherche sur les forêts de l’UQAT
d o r f Ayant des intérêts pour les régions
In
nordiques et les sphaignes, Marc-
Frédéric Indorf a tout naturellement trouvé un
point de convergence dans son projet de doctorat
sur les communautés végétales des tourbières du
territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Mais avant
son arrivée en Abitibi, il a d’abord passé son
enfance sur l’élevage familial de vaches laitières
aux USA, puis fait carrière de musicien en France.
Résumé de la présentation de Marc-Frédéric
Dans un contexte de changements climatiques et d’activités anthropiques
(principalement minières et hydroélectriques) au sein du territoire d’Eeyou Istchee
Baie-James, il y a besoin de mieux connaître les communautés végétales et leurs
interactions avec ces changements. En raison de la forte présence de tourbières
dans les paysages du territoire (14-50%), des communautés de tourbières non
perturbées ont été sélectionnées le long d’un transect de 1000 km pour étudier les
processus d’assemblage. Les hypothèses à différentes échelles spatiales et à travers
différents groupes taxinomiques ont été testées à l’aide d’une approche
spatiohiérarchique innovante, combinant des outils d’ordination, de clustering,
d’analyse des espèces indicatrices et de randomisation (des tests d’hypothèses
nulles). De façon inattendue, l’importance des facteurs environnementaux à l’échelle
régionale a été écartée et les résultats ont souligné l’importance des processus
stochastiques ou une interaction entre facteurs opposés (compétition ou filtrage
environnemental contre facilitation ou dispersion). Des facteurs à l’échelle territoriale
(e.g. climat et physiographie) ont été prouvés importants pour la création de groupes
d’espèces régionaux de trachéophytes, sphaignes et lichens, mais pas pour les
bryophytes ni les hépatiques. À plus petite échelle, l’importance des facteurs
convergents (e.g. facilitation) a été démontrée. Cette étude, qui participe aussi à
établir une base de connaissances sur les communautés végétales des tourbières
jamésiennes, montre que chaque groupe taxinomique s’organise différemment en
fonction de l’échelle et que les facteurs environnementaux ont peu d’effet ou que
leurs effets pourraient être confondus avec d’autres niveaux d’échelle ou facteurs.
Ces résultats sur les réponses des différentes communautés et groupes taxinomiques
aux facteurs d’assemblage aident à améliorer les connaissances sur les capacités de
résilience ou de résistance de ces communautés à l’avenir proche.ll i s t o n
le B a
N i c o
Conférencière invitée
Résumé de la présentation de Nicole (présentation en anglais)
Les tourbières oligotrophes et les tourbières minérotrophes des basses terres de la baie
d’Hudson (HBL), principalement des terres traditionnelles des Omushkegowuk, sont des
réserves de carbone d’importance mondiale, des éléments importants de stockage et de
régulation de l’eau, et revêtent une importance traditionnelle et écologique. À l’heure actuelle,
la région HBL est confrontée à la double menace des opérations d’extraction des ressources
et de l’augmentation des températures due au changement climatique, qui peuvent toutes
deux réduire la disponibilité de l’eau. Malgré cela, les études visant à caractériser les effets de
la réduction de la disponibilité de l’eau sur la structure et la fonction hydrologiques des
complexes de tourbières des HBL sont extrêmement limitées. De telles informations sont
nécessaires pour mieux comprendre la trajectoire de ces systèmes dans le cadre de scénarios
de perturbation futurs. À cette fin, des données hydrologiques (c.-à-d. le débit des cours d’eau
et le niveau des eaux souterraines), météorologiques (c.-à-d. les précipitations, l’épaisseur de
la neige, l’évapotranspiration et la température) et hydrogéologiques/géochimiques (c.-à-d. des
échantillons d’eau interstitielle, la profondeur de la tourbe et l’élévation de la surface) ont été
recueillies sur un transect de 1,5 km dans le rayon d’assèchement de la mine de diamants
Victor de De Beers, au cours des 12 années de vie de la mine. Au cours de la période d’étude,
l’assèchement a provoqué d’importantes pertes d’eau vers le bas qui ont fait baisser les nappes
phréatiques au-delà de la plage de variabilité naturelle, épuisant ainsi le stockage de l’eau.
Parmi les effets notables, citons la réduction de la connectivité hydrologique (50 % moins
fréquente en moyenne), la réduction du débit des affluents touchés, l’affaissement à l’échelle
du paysage (14 cm en moyenne) et la perturbation des voies d’écoulement souterraines qui
ont limité l’apport de solutés importants sur le plan écologique à la surface des tourbières en
aval. Les conditions altérées ont le potentiel de réduire de façon permanente la connectivité
des tourbières et de déplacer les fens appauvris en solutés vers des tourbières pauvres en
nutriments, cependant, l’état d’équillibrium de ces tourbières est actuellement inconnu. Les
recherches futures devraient se concentrer sur l’application des réponses aux perturbations à
différents endroits et à différentes échelles du complexe de tourbières afin de mieux comprendre
les effets cumulatifs de ces perturbations anthropiques sur la trajectoire de ces systèmes.Nom : Mariano Feldman
Nationalité : argentine
d m a n Éducation :
l
Candidat au doctorat en sciences de
o F e l’environnement à l’Institut de recherche
a r i a n sur les forêts de l’UQAT
Passions : Soccer, jouer de la guitare,
M randonnée dans la nature, observation,
observation de la faune
Résumé de la présentation de Mariano
Les milieux humides des écosystèmes boréaux jouent un rôle essentiel
tout au long de la saison de reproduction pour les communautés d’oiseaux.
Cependant, les milieux humides souffrent d’impacts globaux en raison des
conversions de sols par l’homme et des pressions du changement
climatique. Nous avons étudié si l’occupation des espèces d’oiseaux et
des attributs au sein de la communauté différaient entre les étangs à
castors et de tourbières de la baie James d’Eeyou Istchee en 2018 et 2019.
Nous avons évalué les effets sur l’occupation des oiseaux en fonction de
la présence de l’écureuil roux (un indicateur de prédation des nids), du
couvert forestier entourant les étangs et du gradient latitudinal. Nous avons
détecté 96 espèces qui ont été regroupées selon l’état de succession de
la forêt : espèces de début de succession, espèces de fin de succession,
généralistes et espèces de zones humides. Les étangs de castors sont
plus riches que les étangs de tourbières, ce qui est principalement dû aux
espèces de début de succession. L’écureuil roux a eu une influence négative
sur la richesse de la communauté. Les espèces de fin de succession ont
réagi positivement au couvert forestier entourant les étangs. Nos résultats
soulignent les avantages de la modification de l’habitat par les castors
sur les communautés d’oiseaux ainsi que les effets négatifs de la présence
de l’écureuil roux. Ces informations permettent de mieux comprendre les
communautés d’oiseaux pour aider à établir des priorités en matière de
conservation des zones humides régionales.Nom : Éliane Grant
Eliane Grant vit en Eeyou Istchee et est
r a n t membre de la communauté de Waswanipi.
Elle est d’abord maman, puis étudiante à
a n e G la maîtrise en écologie à l’UQAT, biologiste
de la faune au département des
É l i ressources naturelles de la Première
Nation Crie de Waswanipi et chargée
de cours à l’école d’études autochtones.
Résumé de la présentation d’Éliane
Le territoire, utilisé depuis des générations par les Autochtones, est un
lieu de transmission des connaissances, de pratique des activités de
subsistance et de recueillement. En plus des entrevues visant à
documenter l’importance des milieux humides pour la pratique d’activités
traditionnelles pour les membres des Premières Nations d’Eeyou Istchee,
un deuxième volet biologique permettra d’évaluer le stress chez l’orignal
(Alces americanus) puisque le stress chronique peut entraîner des
répercussions sur sa santé générale. Les milieux humides ne sont pas
seulement centraux dans la pratique d’activités traditionnelles pour les
Autochtones, mais sont également essentiels pour la survie de l’orignal.
Avec ce projet, c’est l’occasion de favoriser les échanges entre les
communautés eeyou de Nemaska, Mistissini et la communauté anicinape
de Pikogan ainsi que des compagnies exploitantes de ressource naturelles
de la région, tout en espérant fournir des réponses aux questions
soulevées par les membres des Premières Nations.Nom : Camilo Gomez
Nationalité : colombienne
om e z Camilo Gomez est né dans les montagnes andines
G
d’Amérique du Sud, où il a étudié l’anthropologie à
li o
l’Universidad de Los Andes à Bogota, en Colombie. Il
a m
est également titulaire d’un doctorat en anthropologie,
C axé sur la biodiversité, les services écosystémiques
et la durabilité, de l’Université McGill. Avec plus de dix
ans d’expérience, le travail de Camilo a combiné les
connaissances indigènes et scientifiques pour encourager la
collaboration entre les organisations indigènes de base, les agences
gouvernementales et le monde universitaire. Aujourd’hui, il est
chercheur postdoctoral à l’Institut de recherche sur les forêts.
Résumé de la présentation de Camilo (présentation en anglais)
L’immense valeur en termes de stabilité climatique, de biodiversité, de filtration de
l’eau et de contrôle de l’érosion des quelque 11,6 millions d’hectares de tourbières
du Québec peut être calculée grâce aux travaux de différents auteurs. Cependant,
même si la plupart de ces écosystèmes vitaux de tourbières se trouvent dans les
territoires des Premières Nations de la région de la Baie James, peu d’auteurs ont
exploré les valeurs socioculturelles et la gestion environnementale que ces
communautés ont placées depuis des générations sur ces terres. Ce manque
d’information est un problème car cette région fait face à des changements rapides
dus à des facteurs anthropogéniques comme des projets de développement industriel
qui peuvent avoir un impact sur le fragile équilibre socio-écologique des tourbières :
la stabilité environnementale et le bien-être des différentes communautés fauniques
qui habitent ces territoires. Nous soutenons que les impacts négatifs pourraient être
évités, atténués et compensés de manière adéquate si les plans de développement
tiennent compte de la relation socio-écologique dans les tourbières en combinant
les données scientifiques et les connaissances indigènes. Après quatre années de
travail coopératif avec les communautés de Mistissini, Nemaska et Pikogan, nous
sommes en train d’élaborer un outil permettant de classer les tourbières en fonction
de la valeur de la conservation de la biodiversité et des priorités des Premières nations.
Cet outil, appelé Indice de richesse écologique multidimensionnelle pour les tourbières,
MERIP, combine des méthodologies utilisées à la fois dans les sciences sociales et
naturelles pour transmettre des informations qui peuvent être facilement utilisées
pour une planification, une surveillance, une prise de décision et une réhabilitation
environnementale adéquates.Nom : Julia Morarin
Julia Morarin est détentrice d’un master en
n
archéobiologie et paléoenvironnement (Université
or a r i de Montpellier, France), ainsi que d’une maîtrise en
Études Autochtones (UQAT). Nourrie par une
u l i a M curiosité sans fin et passionnée par les arts et
les sciences, Julia combine aujourd’hui ces
J
univers à travers le spectre de la vulgarisation
scientifique.
Le projet Atlas de biodiversité : les milieux humides a
pour objectif de rendre accessible aux membres des
communautés participantes (Pikogan, Nemaska et Mistissini)
et au grand public, les données récoltées par les étudiant.e.s
de l’UQAT sur le territoire.
Résumé de la présentation de Julia
Les tourbières, en raison leur richesse écologique, font partie des écosystèmes
les plus importants dans le nord du Québec. Malgré leur importance, en termes
de dynamique écologique et de biodiversité, les tourbières sont encore mal
connues. C’est pourquoi, durant les quatre dernières années, des étudiants de
l’UQAT ont mené des projets de recherches sur le territoire en collaboration
avec les communautés Autochtones de Pikogan (Abitibi-Témiscamingue),
Nemaska et Mistissini (Eeyou Istchee).
Ces études ont pour objectif de caractériser et classifier les milieux en fonction
des différents types d’organismes issus des règnes animal et végétal. Aujourd’hui,
les résultats de ces études sont disponibles sous forme de tableaux de données.
Un des fondements de la recherche avec, par et pour les Autochtones est le
retour des données aux communautés. Et bien que le retour des données
numérisées soit important pour les communautés, il ne s’agit pas d’un format
apte à l’utilisation des résultats pour tous les membres des communautés qui
s’intéressent et/ou qui souhaitent connaître et avoir accès aux résultats de ces
recherches.
Pour pallier ce manque, nous proposons de développer des Atlas de biodiversité
pour les trois communautés citées précédemment. Enfin, en tenant compte
que l’objectif global du projet inclut plusieurs façons de voir et de comprendre
la biodiversité, nous aimerions mettre l’accent sur l’échange et l’intégration des
connaissances avec les personnes et les organismes des communautés qui
souhaitent participer.MERCI À TOUS LES PARTENAIRES DE LA
CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG – UQAT SUR LA
BIODIVERSITÉ EN CONTEXTE MINIERVous pouvez aussi lire