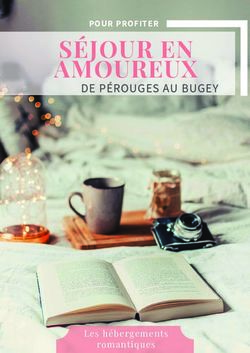CHEZ SOI ET PRÈS DE CHEZ SOI - LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES - Festival citoyen
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
QUESTION 2
—
CHEZ SOI ET PRÈS DE CHEZ SOI,
COMMENT INVENTER UN "CHEZ
SOI" QUI AVANCE AVEC SOI ?
De quoi parle-t-on ?
La question des lieux et espaces de vie des personnes vieillissantes est un des enjeux
au cœur de la notion de longévité que peuvent accompagner les villes et les métropoles.
La plupart des enquêtes le confirme : près de 90 % des français déclarent souhaiter vieillir
"chez eux". Mais qu'est-ce que recouvre ce "chez soi" qui nous est si cher tout au long
de la vie, et qui semble devenir encore plus précieux avec l'avancée en âge ?
“Chez soi”, c'est-à-dire ?
• Au delà du "bâti", le chez-soi est vécu comme un refuge, garant de liberté, de contrôle,
de sécurité mais aussi comme un espace où l'intimité peut "prendre place". Le terme
de chez-soi ne désigne alors pas seulement l’adresse physique (le domicile) ou le cadre
bâti mais plutôt la manière de se l’approprier et de l’investir, d'en faire son "territoire".
Le lieu de vie devient ainsi le support et l’expression de l’identité de l’habitant (Villela-
Petit, 1989), un peu comme une seconde peau. À la localisation géographique s’ajoutent
alors les cultures, les émotions (Mallet, 2004). D'après le sociologue Bernard Ennuyer01,
la notion de “chez soi”, qui s'appuie notamment sur l'opposition entre intérieur
et extérieur, et qu'il prolonge à travers l'idée de "fort intérieur", (au sens d’un endroit
fortifié, d’un château fort), désigne "le lieu à partir duquel il est possible pour un être
de devenir soi". On fait corps avec son domicile, on peut même dire qu’on fait "corps et
âme" avec ce dernier, ce qui renvoie aux "dimensions physiques et psychiques du chez
soi"02.
• La notion de chez soi doit donc être appréhendée sous ses différentes dimensions :
celle de la personne, celle de l’espace et celle des objets, chacune étant porteuse d'une
signification et d'une forme d'ouverture qui lui est propre. Sur la base d’une proposition
de Jean-Paul Filiod03, le chez-soi est envisagé de la manière suivante :
- un chez-soi social : porteur de la culture domestique et matérialisé par des espaces
et des objets, appréhendable et ouvert à tous ceux à qui l’on ouvre les portes
de son chez-soi,
- un chez-soi discret : composé des significations partagées par l’ensemble des
personnes partageant un même espace (couple, famille, etc.), il recouvre des
dimensions aussi matérielles que symboliques. Pour l'appréhender, une personne
extérieure doit multiplier les médiations, témoigner et faire l’expérience de la subtilité
et de l’attention,
- un chez-soi secret, qui n’appartient qu’à la personne et est donc inaccessible aux
autres,
01 Bernard Ennuyer, Op cit.
02 Bernard Ennuyer, Op cit.
03 D
éfinition issue d'un groupe de travail avec Leroy Merlin Source composé de Marie-Reine Coudsi, Pascal Dreyer,
Bernard Ennuyer, Bertrand Quentin, Jean-Paul Filiod, Camille Souvorof, Philippe Sachetti.
P / 49
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019• Pris sous cet angle, le souhait de rester vieillir chez soi revêt alors une toute autre
QUESTION 2 dimension. Vieillir dans un lieu de vie qui me ressemble, dans lequel je me sens bien,
— je suis “chez moi”, cela ne signifie pas seulement continuer à vivre dans le même espace
Chez soi et près de physique au fur et à mesure de l'avancée en âge, mais bien de rester “maître chez moi”.
chez soi, comment Or, s'il s'avère souvent que si la dimension “matérielle” du maintien à domicile est assez
inventer un "chez soi" facilement gagnée, il en est loin d'être de même pour la dimension plus symbolique de
qui avance avec soi ? ce souhait communément partagé. En effet, les besoins spécifiques liés au maintien à
domicile des personnes âgées - qui se traduisent d'ailleurs souvent par des conséquences
d'abord matérielles (équipements et aménagements spécifiques, etc.) - génèrent dans
le même temps une perte de maîtrise de leur environnement domestique immédiat :
multiplications des intervenants, nombreuses prises de décisions “pour” la personne
mais sans concertation avec elle ... Bref, nombre de personnes âgées qui continuent
effectivement à vivre à leur domicile ne s'estiment plus “maîtres” chez elles.
• Enfin, au delà du caractère pluri-dimensionnel de cette notion de “chez soi”, il faut
également prendre en compte les différentes échelles auxquelles elle prend sens.
En effet, se sentir chez soi ne se résume pas qu'au domicile. Cette notion d'habiter
se retrouve également dans le quartier dans lequel je déploie mes habitudes de vie
sociale, mes repères et dans lequel “je suis investi humainement, émotionnellement
et spatialement”. Le quartier devient alors une extension du domicile04, offrant des
opportunités de rencontres, de convivialité et d'échanges, un espace de cohabitation
entre générations. Plus largement, cette notion d'habiter se ressent à l'échelle de son
territoire comme un “ensemble de lieux familiers et importants de la ville ou de la
Métropole qui constituent un territoire de vie”05 et complètent le parcours de vie de la
personne vieillissante.
• “L'habitat au sens du territoire de l'être humain, au sens animal, se complète de zones,
d'espaces complémentaires au sein de la Métropole. Elles sont nécessaires pour l'accès
à certains services primordiaux, notamment pour poursuivre ses activités”06 de façon
à rester en lien avec son territoire, sa ville dans ses aspects accessibles et aussi désirés
(repères agréables, souvenirs, etc.). Le territoire devient alors une troisième échelle
spatiale clé du parcours de vie de la personne vieillissante où l'on accepte de se rendre
même loin de son domicile pour une finalité attendue et souhaitée.
Ces trois échelles - domicile, quartier, territoire - sont à lier et à harmoniser pour une
meilleure inclusion des générations entre elles et une prise en compte des besoins
spécifiques de la personne vieillissante. C'est une invitation à prendre en compte tout
l'environnement pour tendre vers un “urbanisme de la sollicitude”, qui prend soin des
personnes et permet de se sentir chez soi dans son domicile, mais aussi dans son
quartier et à l'échelle de son territoire.
04 Saisine de Gaël Guilloux, Président et Cofondateur “Les Bolders” , Rapport “Vivre avec les autres générations”.
05 Saisine de Gaël Guilloux, Op cit.
06 Saisine de Gaël Guilloux, Op cit.
P / 50
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019POUR MIEUX EN PARLER QUESTION 2
—
Chez soi et près de
L'habitat accessible et adapté au cœur des enjeux chez soi, comment
du vieillissement de la population. inventer un "chez soi"
qui avance avec soi ?
Le Plan Local de l’Habitat élaboré par et pour la métropole nantaise, vise à accompagner
les besoins spécifiques de la population vieillissante en matière d’habitat à travers
le développement d’une offre de logements diversifiée, accessible et adaptée :
• Aux attentes des personnes âgées : la majorité de personnes âgées vit à domicile (soit
94 %) alors que l’âge d’entrée en EHPAD est de 85 ans et 2 mois (DREES – 2015) et les 3/4
des résidents des EHPAD sont des femmes.
• Au niveau de ressources des personnes âgées, en particulier les plus modestes.
• Au niveau de dépendance et à sa nature (physique / cognitive).
Deux enjeux principaux ont été identifiés sur le territoire :
• La satisfaction de la demande des ménages les plus modestes : accessibilité financière
de l’offre.
• La prise en charge de la dépendance concernera 16 200 personnes en 2030, soit près de
9 % de la population métropolitaine des plus de 60 ans07.
En 2015, sur 42 000 ménages vivant sous le seuil de pauvreté dans la Métropole
(cf. p. 28-29), 9 000 étaient âgées de plus de 60 ans (soit 21 %). On observe également
une progression importante du nombre de personnes âgées dans le parc social de
la Métropole.
EN 2015,
74,1 % DES MÉNAGES SUR NANTES MÉTROPOLE
sont propriétaires
de leur logement chez 42 000 MÉNAGES PAUVRES
les 65 ans et + dont
ÉTAIENT ÂGÉS DE PLUS
9 000 DE 60 ANS (SOIT 21 %)
Source : Insee
C'EST LA PROPORTION
8% DE PERSONNES DÉPENDANTES
ÂGE MOYEN
D'ENTRÉE EN EPHAD BÉNÉFICIAIRES
DE L'APA
85 ans et 2 mois (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
par rapport à la population
RETRAITÉE TOTALE
Source : Insee (2012)
Source : DRESS (2015)
07 Données issues du Plan Local de l’Habitat Nantes Métropole et des statistiques générales de l'Insee.
P / 51
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019Afin de répondre à cet enjeu de parcours résidentiel, l'offre de logements et
QUESTION 2 d'hébergements dite intermédiaire et de l'habitat avec services propose 6 grandes
— catégories (recensement de l'offre sur la métropole nantaise). 08
Chez soi et près de
chez soi, comment
inventer un "chez soi" Panorama de l'offre d'habitat à destination des personnes âgées
qui avance avec soi ?
Initiative privée Initiative Domicile Village
à but non publique service retraite Résidence
lucratif service
Résidence service
privée à but lucratif
Accueil familial
Résidence autonomie
Cohabitation
intergénérationnelle Habitat Habitat
participatif regroupé Domicile collectif
(EHPA*)
Habitat partagé Non institutionnel
ou cohabitation Habitat
Autres regroupé
Institutionnel ou
formes Établissements médico-
d’habiter sociaux non Établissement
Habitat médicalisés de soins de
intermédiaire longue durée
EHPAD**
privé
Habitat Établissement
ordinaire médico-sociaux EHPAD**
public
médicalisés
* Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
** Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
08 Saisine Auran 2018 : l'Habitat des seniors : généraliser une offre avec services abordable.
P / 52
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019Recensement de l'offre d'habitat à destination
des personnes âgées sur Nantes Métropole
CATÉGORIES HABITAT HABITAT HABITAT AUTRES FORMES HABITAT ÉTABLISSEMENTS
ORDINAIRE REGROUPÉ NON PARTICIPATIF D'HABITER REGROUPÉ MEDICO-SOCIAUX
“ADAPTÉ” INSTITUTIONNEL INSTITUTIONNEL MÉDICALISÉS
OU (EHPAD)
ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX
NON MÉDICALISÉS
OFFRE 60 783 logements 1 331 logements Aucun connu Non recensé 782 logements 5 588 places
MÉTROPOLITAINE occupés par - Domiciles services à ce jour - Habitat partagé - Domicile collectif EHPAD
des ménages - Villages retraites ou cohabitation (EHPA de petite
dont le référent - Résidences services - Cohabitation capacité)
à 65 ans et plus intergénérationnelle - Résidence
- Accueil familial Autonomie
SOURCE / Auran - 2018.
L'offre d'habitat dit intermédiaire est diversifiée mais constitue une part assez faible
de l'offre globale sur la Métropole : elle représente 3 % des logements et hébergements
occupés par des personnes âgées09. Dans le même temps, des formes d'habitats
innovantes émergent sur le territoire national et ailleurs : habitat collectif dédié aux
seniors, habitat participatif, habitat intergénérationnel, etc.
En voici quelques unes :
• Les projets BIMBY “Build in My Back Yard” (littéralement, construire dans mon fond
de parcelle) : il s'agit de développer la capacité des acteurs de l'urbain (habitants,
techniciens, élus) à mobiliser le foncier des zones pavillonnaires existantes pour
contribuer au renouvellement et à la densification progressive de ces quartiers, en
associant à la démarche les principaux concernés et en prenant en compte la spécificité
de leur besoins en fonction de leur trajectoire de vie.
Pour en savoir plus : bimby.fr/home
• La maison des Babayagas à Montreuil (93) est une alternative au maintien à domicile à
travers la création d'un lieu de vie pensé par et pour les femmes âgées de 60 à 80 ans.
Ce concept revendique apporter une réponse à l'arrivée des "baby-boomers" et fait
le pari que les personnes peuvent elles-mêmes, individuellement et collectivement,
prendre en charge leur vie dans un espace ouvert sur la ville et la société.
Pour en savoir plus : www.lamaisondesbabayagas.eu
• Les maisons Abbeyfield s’appuient sur un concept anglo-saxon datant de 1956.
Uniquement présentes en Belgique, il s'agit d'habitats groupés de taille familiale avec
des appartements individuels pour seniors. Le principe étant que chaque habitant
participe activement à l'organisation de la maison en se répartissant les tâches et les
responsabilités, tout en conservant autonomie et indépendance.
Pour en savoir plus : www.abbeyfield.be/fr
• En projet, une maison de retraite LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres)
à Paris, initiée par Stéphane Sauvé, ancien directeur d'EHPAD, pour répondre
à l'isolement dont souffrent 51 % des seniors LGBT dû à un fort taux de célibat et
d'exclusion sociale. Les maisons de retraite "gay-friendly” existent depuis des
années aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Scandinavie. Elles se répandent
aujourd'hui dans toute l'Europe.
09 Auran, op. Cit.
P / 53
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019QUESTION 2 Hébergements occupés par les personnes âgées (65 ans et plus)
—
Chez soi et près de
chez soi, comment
inventer un "chez soi"
qui avance avec soi ?
EHPAD
5 588 8,17 %
Habitat 3,00 %
intermédiaire
2 055
88,83 % Habitat ordinaire
60 783
SOURCE / Auran - 2018.
Sur la métropole nantaise, les personnes âgées conservent dans leur majorité un
logement ordinaire (89 % des 65 ans et plus).
Un parc social métropolitain fortement mobilisé
13 % des ménages dont la personne de référence a 65 ans et plus sont locataires du parc
social. Une forte demande de logement social est à noter pour les demandes de mutation et
pour les demandeurs entre 55 et 74 ans (probablement liée à de nouvelles ruptures dans le
parcours de vie : licenciement, divorces, retraites, etc.). Cela pose la question de la possibilité
d’une poursuite du parcours résidentiel au sein du parc social pour ces ménages âgés10.
Nombre de demandes de logement social pour une attribution
au sein de Nantes Métropole
(demandes en cours au 1er janvier 2018 et attributions années 2017)
10,0
9,0 8,6
8,1
8,0
7,3
7
7,0 6,3
5,6 5,7 5,8
6,0
5,0 4,6
4,1
4,0 3,5 3,6
3,0
2,0
1,0
-
Moins de 55 ans 55 - 64 ans 65 - 74 ans 75 ans et plus
Ensemble des demandes Demandes externes Demandes de mutation
SOURCE / C.R.E.H.A. Ouest. Fichier de la Demande Locative Sociale.
NB : les demandes externes concernent les personnes qui ne résident pas (encore) dans le parc social et les demandes de mutation
correspondent à un changement de logement social qui n'est plus adapté aux besoins du locataire.
10 L
es plafonds de ressources pour l'accès au parc social pour une personne seule : entre 11 167 € et 27 515 € selon
les types de financement de la construction du logement.
P / 54
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019Peu de travaux d’adaptation “préventifs”
QUESTION 2
Dans le sondage réalisé en mai 2018 par Viavoice11, 15 % des personnes sondées —
indiquaient avoir aménagé leur logement pour l'adapter aux besoins liés à l'âge. Chez soi et près de
D’après une enquête de la DREES, en 2014, en France comme en Loire-Atlantique, chez soi, comment
10 % des personnes de 60 ans et plus utilisent des équipements ou aménagements inventer un "chez soi"
de leur logement (barre d'appui, douche adaptée, élargissement des portes, etc.) qui avance avec soi ?
du fait d’un problème de santé, d’un handicap ou de leur âge, les femmes davantage
que les hommes (12 % contre 8 % en Loire-Atlantique), et les personnes de 75 ans et plus
davantage que les 60 - 74 ans (20 % contre 5 % en Loire-Atlantique)12.
Par ailleurs, dans le parc social, l’ensemble des organismes HLM du territoire
métropolitain conduisent des travaux d’adaptation selon les besoins des locataires.
C’est notamment le cas des logements bleus, une offre de logements adaptés sur
la Métropole développée par Nantes Métropole Habitat et la Ville de Nantes. La
spécificité des logements bleus est d’associer travaux d’adaptation des logements
et veille sociale permettant aux personnes de bien vieillir à domicile. LogiOuest
a également développé une offre de logements labellisés Habitat Senior Services.
Et les bailleurs Loire-Atlantique Habitation et SAMO disposent également de logements
dédiés. Au total, on identifierait environ 2 000 logements adaptés ou dédiés aux
personnes âgées au sein du parc social métropolitain13.
De nouveaux outils qui s'installent à domicile
Zoom : les innovations techniques et technologiques,
assistance ou surveillance ?
Face à l’allongement de la durée de la vie et à la problématique du maintien à domicile, la silver économie
développe un nombre important de nouveaux produits et/ou services afin de répondre aux besoins émergents
des seniors. Ainsi, apparaissent sur le marché des cannes et des montres connectées, des piluliers intelligents,
une téléassistance plus numérique, etc. Tout un ensemble d’objets qui vient questionner le pouvoir d’agir et de
choisir de chaque utilisateur à la fois parce qu’il en est le public cible souvent avoir participé à la conception
de ces dispositifs, mais également parce que dans la plupart des cas, ces objets pénètrent le quotidien par
l’intermédiaire de la famille ou des services d'aide à la personne. Ces technologies permettent une assistance
voire une surveillance du sujet âgé en cas de chute par exemple, et fournissent un “tableau de bord” de la santé
journalière ; cette compilation de données est transmise directement, par sms ou mail, aux proches ou aux
services d’aide afin de calibrer les interventions au domicile. Dès lors, ces innovations peuvent questionner
l’avenir des auxiliaires de vie mais également la notion de situation subie ou choisie de la personne concernée
lorsque l’acquisition est sollicitée par les proches, ainsi que l'usage qui est fait des données collectives.
11 Julie Le Bolzer, “Vieillissement: les Français sont confiants face à l'avancée en âge”, Les Echos, mai 2018.
12 DREES, Enquête vie quotidienne et santé 2014, 2016.
13 Recensement réalisé par l'Auran, 2015.
P / 55
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019QUESTION 2 Les objets connectés au domicile
—
Chez soi et près de
chez soi, comment
inventer un "chez soi" BORNES DÉTECTEURS
D’APPEL DE CHUTE
qui avance avec soi ?
DÉTECTEURS
DE FLAMMES
PILULIERS
CONNECTÉS
ROBOTS
SOURCE / https://www.ocirp.fr/sites/default/files/ocirp_livre-lage-de-lautonomie.pdf p.25.
P / 56
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019Vers des “quartiers favorables aux seniors”
QUESTION 2
Comment tenir compte des évolutions cognitives, physiques, sensorielles et sociales des —
individus dans l'urbanisme ? Comment créer un espace de vie rassurant, confortable, et Chez soi et près de
ainsi diminuer un sentiment d’insécurité, de stress pouvant jouer sur les décisions des chez soi, comment
individus de sortir de chez soi, de poursuivre des activités, etc. ? Comment prévenir le inventer un "chez soi"
renoncement à la mobilité, facteur d’isolement et de repli ? qui avance avec soi ?
Afin d’aider la Métropole à mieux identifier et prendre en compte ces enjeux, l’Auran
a proposé de consolider la notion de quartiers “seniors-friendly” (littéralement,
“quartiers favorables aux seniors”), qui permet d’identifier des quartiers particulièrement
adaptés aux besoins spécifiques des seniors. Ces quartiers reposent sur un
référentiel de critères, (qui s’appuient sur des données de la TAN, des bases SIREN
et de l’Observatoire des Loyers Commerciaux de la CCI), associant la notion de distance
et de temps de parcours piéton ainsi qu’un repérage des services essentiels et de leur
localisation (commerces alimentaires ; gares ferroviaires et arrêts du réseau structurant -
tramway, busway, chronobus ; services pour se soigner - médecins généralistes
et pharmacies).
Selon l’Auran, 40 000 personnes de plus de 65 ans résident au sein de ces secteurs14.
De fait, la plus grande part des seniors de la métropole nantaise vit en dehors de ces
périmètres.
Ces quartiers présentent, dans l’environnement des individus, une configuration
favorable et susceptible de répondre aux difficultés de déplacements qui peuvent être
de quatre ordres :
•L
es difficultés physiques, dues à une fragilisation progressive du corps humain qui
peut par exemple engendrer des troubles de l’équilibre ou encore un ralentissement de
la vitesse de marche. Ainsi, cette typologie de difficultés représente la première source
d’insécurité et d’inconfort.
•L
es difficultés cognitives, qui se traduisent couramment chez les sujets âgés par des
pertes ponctuelles de la mémoire, des troubles de concentration, une compréhension
moins rapide (trouver un arrêt de bus, lire un plan, etc.) ou encore une diminution des
capacités de réaction, d’anticipation. L’ensemble de ses évolutions cognitives peuvent
entraîner des modifications des repères spatiaux.
•L
es difficultés sensorielles telles que la perte progressive de l’ouïe ou de la vue génèrent
une baisse de la perception du danger dans l’espace public, mais également dans
l’environnement social.
•L
es difficultés sociales, qui s’ancrent, au-delà de la mobilité, dans un rapport social
et sociologique à l’environnement de l’individu. Par exemple, les modifications du
quartier, les commerces, les lieux de sociabilité peuvent devenir un facteur de contrainte
et modifier considérablement les déplacements des personnes âgées ; mais également
un besoin de lien social grandissant avec l’âge. Ainsi, un espace public de qualité doit
penser à offrir des opportunités de rencontres.
Aussi, une Métropole de la longévité anticipe la place des seniors dans l’espace public
et l’aménage afin qu’il reste le plus praticable possible et accessible à tous les usagers.
14 Estimation basée sur des données de populations carroyées de l'Insee, 2013.
P / 57
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019Accessibilité aux services essentiels : les secteurs “seniors friendly”
Grandchamps-
des-Fontaines Saint-Mars-
du-Désert
Malville
Sucé-sur-Erdre
Le Temple-
de-Bretagne
Le Cellier
Vigneux-de-Bretagne
Bouée Treillières La Chapelle-
sur-Erdre
Cordemais
Mauves-
Carquefou sur-Loire
Orvault
Sautron Thouaré- Divatte-
sur-Loire sur-Loire
Saint-Etienne-de-Montluc
Sainte-Luce-
Frossay sur-Loire
Nantes
Saint-Julien-
de-Concelles
Couëron
Saint-Herblain
Le Loroux-
Vue Bottereau
Le Pellerin
Indre Basse-
Saint-Jean- Goulaine
de-Boiseau Saint-Sébastien-
Cheix-en-Retz sur-Loire Haute-Goulaine
La Montagne
Rouans
Brains
Bouguenais Rezé
La Chapelle-
Heulin
Chaumes-
en-Retz La Haie-
Port-Saint-Père Vertou Fouassière
Bouaye
Saint-Léger-
les-Vignes Le Pallet
Saint-Aignan- Les Sorinières Saint-Fiacre-
Grandlieu sur-Maine
Pont-
Saint-Martin
Saint-Hilaire- Sainte-Pazanne
de-Chaléons Saint-Mars- Maisdon-
Château- sur-Sèvre
de-Coutais Le Bignon
Saint-Philbert- Thébaud
La Chevrolière 0 1 2 3 km
de-Grandlieu
Accessibilité aux services essentiels Accessibilité aux services essentiels
Tout à moins de 5 minutes Voirie principale
Tout à moins de 10 minutes Voirie secondaire
Tout à moins de 15 minutes Tramway et Busway
Chronobus
Secteur n’offrant pas tout le panel de services Voies ferrées
SOURCE / Olc-cc 2018 / Siren 2018 / TAN 2017 / SNCF - Réalisation : Auran - Juin 2018.
P / 58
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019Parlons-en QUESTION 2
—
Inventez un “chez-soi” qui avance avec soi, c'est aussi s'interroger sur : Chez soi et près de
• Quelles transitions des modes d’habiter ? À quelles évolutions de mes besoins et de chez soi, comment
mon mode de vie doit répondre mon logement ? inventer un "chez soi"
qui avance avec soi ?
• Quels leviers et opportunités pour inventer collectivement de nouveaux modes de vie
de l’habiter (abandon, poursuite ou évolution des activités / nouveaux types d’habitats
intermédiaires) ?
• Quelle accessibilité financière de ces nouvelles formes d'habitat ?
• Vers un urbanisme de la “sollicitude” : ou comment tenir compte des évolutions des
capacités des individus dans l'aménagement urbain ?
• Maître “chez soi” : comment garantir la liberté de décision des plus âgés sur leur
environnement ?
• Innovations techniques/technologiques (essor de la domotique, robotique, Data, etc.) :
pour rassurer qui et à quel prix ?
• Les conditions du maintien à domicile : quel niveau de service, pour qui et par qui ?
Comment garantir l'équité face aux coûts engendrés par le maintien à domicile ?
• Quelles fonctions de proximité : vers une cohabitation des générations.
Pour aller plus loin
• Nantes Métropole, “La charte d’aménagement des espaces publics de Nantes Métropole”,
Guide Accessibilité Piétons, 2013.
• Auran, “Pour des espaces “seniors-friendly” qui profitent à tous”, contribution au 3e
grand débat, 2018 (disponible sur le site internet du grand débat).
uran, “Revenus et patrimoine”, contribution au 3e grand débat, 2018 (disponible
•A
sur le site internet du grand débat).
• Bernard Ennuyer, “La culture du domicile”, Leroy Merlin Sources, 2014.
• Pascal Dreyer et Bernard Ennuyer (dir.), “Le chez-soi à l’épreuve des pratiques
professionnelles, acteurs de l’habitat et de l’aide à domicile”, Chroniques sociales, 2017.
• Roger Dadoun, “Chez soi : c'est quoi ? Est-ce rester coi, ou fouiller plus profond son moi ?”
in “Le chez-soi à l’épreuve des pratiques professionnelles”, Chroniques sociales, 2017.
• Gaël Guilloux, la notion d’habiter, contribution au 3e grand débat, 2018 (disponible sur
le site internet du grand débat).
• Association Hal’âge, “L’habitat participatif, citoyen, solidaire pour vieillir autrement vu”,
projet en collaboration avec AG2R, 2015.
• Mélissa Petit, “L’aménagement du logement des jeunes retraités”, les chantiers Leroy
Merlin source, Mars 2018.
• Marie Delsalle et Pierre Rapey, “J’y suis, j’y reste”, film documentaire, Leroy Merlin, 2012.
Synopsis : recherche psychosociale sur les motivations des personnes âgées à rester
chez elles.
• Mona Chollet, “Chez soi. Une odyssée de l'espace domestique”, Zones, 2015.
P / 59
LONGÉVITÉ, OUVRONS LES POSSIBLES / Le document socle / Janvier 2019Vous pouvez aussi lire