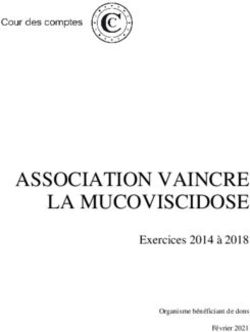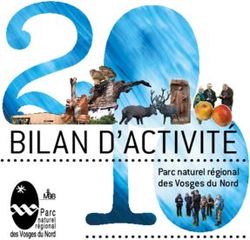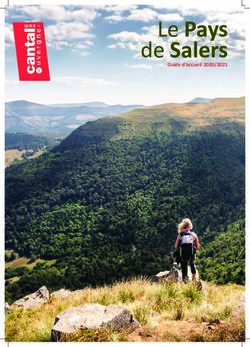Etat des lieux de la ressource hydrique en Italie - Office ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Janvier 2005
Service Scientifique Ambassade de France en Italie
Etat des lieux de la ressource
hydrique en Italie
Ce rapport met en avant les nombreux problèmes liés à l’eau en Italie, qu’elle soit douce ou marine, qu’elle
se rapporte aux fleuves ou aux nappes souterraines. En effet, avec une ressource abondante, l’Italie ne
devrait pas souffrir de crise hydrique, mais la situation est pourtant préoccupante. Une partie non
négligeable de la population nationale, essentiellement localisée dans le Sud de l’Italie, n’a pas un accès
régulier à l’eau potable, et loin de la sécheresse ou de la faible pluviométrie, la cause est surtout liée aux
infrastructures en mauvais état et à leur gestion désastreuse.
Auteurs : Maëla JAOUEN, Volontaire International
Jean FAVERO, Conseiller Scientifique
Janvier 2005
-1-Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Janvier 2005
SOMMAIRE
Remerciements ................................................................................................................................ 4
Introduction ....................................................................................................................................... 5
1. Situation mondiale ........................................................................................................................ 6
1.1. Journée Mondiale sur l’Eau.................................................................................................... 6
1.2. L’ eau mondiale...................................................................................................................... 6
1.3. Les problèmes liées à l’eau.................................................................................................... 6
2. L’eau dans la zone Méditerranée et en Italie ................................................................................ 8
2.1. Etat des lieux ......................................................................................................................... 8
2.2. Les politiques mises en œuvre .............................................................................................. 9
2.3. La situation générale italienne ............................................................................................. 10
2.4. Les ressources hydriques italiennes .................................................................................... 10
2.5. Disponibilités et usages en Italie.......................................................................................... 11
3. Les difficultés du système hydrique italien.................................................................................. 13
3.1. Le réseau hydrique : sources abondantes, gestion fragmentée .......................................... 13
3.2. Les gaspillages .................................................................................................................... 14
4. Environnement législatif et gestion de l’eau................................................................................ 16
4.1. Historique de la politique italienne sur l’eau......................................................................... 16
4.2. Les nouvelles normes italiennes .......................................................................................... 19
4.3. La directive cadre européenne sur l’eau 60/2000/CE .......................................................... 23
4.4. Etat d’application des lois en Italie ....................................................................................... 24
5. Qualité, pollutions et dépuration des eaux.................................................................................. 25
5.1. Normes qualité ..................................................................................................................... 25
5.2. La pollution des eaux en Italie : généralités ......................................................................... 26
5.3. Le traitement des eaux ........................................................................................................ 28
6. Etat de santé des différents corps hydriques en Italie ................................................................ 31
6.1. Les eaux marines et côtières ............................................................................................... 31
6.2. Les eaux douces .................................................................................................................. 36
7. Situations spécifiques et critiques............................................................................................... 44
7.1. L’agriculture et l’irrigation ..................................................................................................... 44
7.2. Les eaux minérales .............................................................................................................. 46
7.3. Le cas Milan ......................................................................................................................... 47
7.4. Le « manque d’eau » du Mezzogiorno................................................................................. 48
8. Les innovations dans le domaine de l’eau .................................................................................. 50
8.1. L’innovation dans le traitement des eaux usées .................................................................. 50
8.2. Innovations dans la gestion et dans le contrôle des ressources.......................................... 52
8.3. Quelques noms de programmes et innovations dans le domaine de l’eau.......................... 53
Informations générales et techniques : ....................................................................................... 57
Législation :................................................................................................................................. 57
Recherches et Instituts :.............................................................................................................. 58
-3-Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Janvier 2005
Remerciements
Merci à :
Madame Irene DI GIROLAMO, docteur et coordinatrice technique au sein de la section “protection
des eaux et des écosystèmes marins et côtiers” du Ministère de l’Environnement ;
Monsieur Rosario LEMBO, secrétaire général du Comité Italien pour un Contrat Mondial sur l’Eau ;
Monsieur Giorgio ZAMPETTI, docteur au Service Scientifique du siège national de la Legambiente
à Rome;
Monsieur Stefano CIAFANI, docteur au Service Scientifique du siège national de la Legambiente à
Rome;
-4-Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Janvier 2005
INTRODUCTION
Un an après l’Année Internationale de l’Eau déclarée par les Nations Unies, et
alors que les éditions annuelles de la Journée Mondiale sur l’Eau se suivent en
continuant pourtant de passer inaperçues, il est apparu nécessaire de présenter
la situation de l’eau en Italie, tant au niveau de sa qualité que de ses ressources
et de sa distribution. Le présent rapport a donc pour fonction d’effectuer un état
des lieux non exhaustif de la ressource hydrique en Italie, très en retard dans
l’application des lois sur la qualité, dans les moyens de gestion du patrimoine
hydrique et dans la dépuration de ces eaux.
Ce rapport met en avant les nombreux problèmes liés à l’eau en Italie, qu’elle
soir douce ou marine, qu’elle se rapporte aux fleuves ou aux nappes
souterraines. En effet, l’Italie, avec ses 3052 m3 théoriques par personne et par
année, ne devrait pas souffrir de crise hydrique. Cependant, la situation est
préoccupante. Malgré un potentiel abondant, une partie non négligeable de la
population nationale, essentiellement localisée dans le Sud de l’Italie, n’a pas un
accès régulier à l’eau potable.
Plus que celle de la sécheresse, des changements climatiques et du progressif
dessèchement de quelques zones méridionales et insulaires, la faute revient
essentiellement aux carences structurelles et de gestion du système de l’eau
nationale : corrosion des infrastructures anciennes, problèmes liés à la gestion
des ressources et des réseaux, gaspillages, affaires et intérêts personnels en
jeu,… sont à la base des difficultés du système hydrique italien dont les premiers
touchés sont les consommateurs.
-5-Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Janvier 2005
1. Situation mondiale
1.1. Journée Mondiale sur l’Eau
La Journée Mondiale sur l’Eau a pour but d’alarmer et d’avertir les Etats sur l’urgence hydrique et
sur le fait que « l’or bleu » du 3ème millénaire doit constituer l’un des thèmes principaux lors des
prochaines rencontres internationales environnementales, sociales et économiques.
Le problème, s’il est mondial, est surtout concentré sur quelques régions de la planète pénalisées
géographiquement, déjà touchées par le problème de la désertification croissante et de
l’augmentation des zones arides.
Ainsi, chaque année, 6000 enfants meurent de soif, par manque réel d’eau. C’est ce même
nombre de personnes qui meurent, mais cette fois-ci par jour, des suites de maladies dues au
manque d’eau potable. De même, quelques centaines de millions de personnes dans le monde
sont infectées, à la suite d’un usage d’eau contaminée et de conditions sanitaires précaires (80%
des maladies des pays en développement en sont la conséquence). Ces chiffres déjà excessifs
risquent pourtant d’augmenter. En 2025, en effet, face à une demande d’eau potable dont
l’augmentation est évaluée à 70%, 3 milliards d’hommes et de femmes seront exclus de l’accès à
une eau saine.
Selon l’UNEP, le Programme pour l’Environnement des Nations Unies, actuellement, 1/3 de la
population mondiale vit dans des conditions de stress ou de crise hydrique (on parle de stress
hydrique lorsque la disponibilité d’eau globale, par habitant et par an, dans un pays, est comprise
entre 1000 et 1700 m3 ; sous 1000 m3, on parle de crise hydrique). Les conditions critiques
concernent l’Afrique et l’Asie Occidentale, mais la croissance démographique et industrielle a
causé une aggravation de la situation également dans d’autres zones, comme en Chine, en Inde
ou en Indonésie. L'Asie souffre en effet du taux de population disposant d'eau potable le plus faible
au monde, ses villes comptant parmi les plus polluées de la planète et son habitat naturel parmi
les plus menacés.
"L'eau potable reste la question la plus grave et la plus critique du XXIe siècle", avertit Klaus
Toepfer, le directeur de l’UNEP.
1.2. L’ eau mondiale
Le volume total d’eau sur terre est de 1,4 milliard de km3.
Le volume des ressources en eau douce est de 35 millions de km3, soit 2,5% du total. De ces
ressources en eaux douces, 24 millions de km3 (soit 68,9%) se trouve sous forme de glaces et de
neiges éternelles dans les régions de montagne, en Antarctique et en Arctique.
8 millions de km3 (soit 30% des ressources globale en eau douce) est située sous terre. Ce volume
correspond à 97% de l’eau potentiellement utilisable par les hommes.
L’eau douce des fleuves et des lacs correspond à un volume de 105 000 km3, soit 0,3% du total de
l’eau douce mondiale.
Enfin, l’eau douce disponible pour les écosystèmes et pour les hommes est de 200 000 km3 d’eau,
ce qui concerne 1% de toutes les ressources en eau douce et seulement 0,01% de toute l’eau de
la terre.
1.3. Les problèmes liées à l’eau
-6-Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Novembre 2004
La consommation d’eau douce a été multipliée par 6 entre 1900 et 1995, et a doublé depuis 1960 :
le problème de sa potabilité devient la question la plus importante pour les prochaines années afin
de permettre l’accès à une eau saine pour tous.
Entre autres, il est nécessaire d’intervenir immédiatement sur la pollution de la nappe phréatique,
généralement irréversible puisque son temps moyen de renouvellement complet est de 1400 ans
contre 20 jours seulement pour les fleuves. Exploiter la nappe aquifère aujourd’hui signifie
diminuer l’accès à l’eau pour les générations futures. Pourtant, son exploitation excessive est
répandue : plus de 95 % de la population rurale des Etats Unis extraient leur eau potable de la
nappe phréatique ; en Asie, 30 % de la consommation globale dépendent de l’eau souterraine
alors que certaines grandes villes comme Mexico, Lima ou Jakarta utilisent à 100 % l’eau de la
nappe phréatique.
Outre la pollution de la nappe, la plus grande menace pour cette « eau fossile » est également
représentée par l’irrigation agricole, qui correspond globalement à 70 % des prélèvements des
puits ou des fleuves. Le danger dans l’utilisation de la nappe phréatique pour l’agriculture est sa
pollution, souvent irréversible, par des agents chimiques qui s’accumulent.
Dans quelques régions indiennes, comme le Bengale, on trouve des concentrations d’insecticides
importantes, de l’ordre de 4500 µg/l, c’est à dire 1000 fois supérieures aux valeurs limites de
sécurité. Les nitrates également, suspectés de transformations capables de provoquer des
tumeurs de l’appareil digestif, envahissent les eaux souterraines : au Danemark, les
concentrations ont triplé en 60 ans ; plus de 15 % des échantillons d’eau des nappes superficielles
des Etats Unis présentent des quantités (10 mg/l) capables de provoquer la cyanose, et enfin,
autre exemple inquiétant, dans le Yucatan, une région forestière du Mexique, plus de la moitié des
puits forés enregistrent des concentrations supérieures à 45 mg/l.
L'approche des problèmes liés aux ressources en eau dans le monde impose une réflexion sur la
rareté et sur la mauvaise gestion de l'eau caractérisant de vastes zones de toute la Méditerranée,
où la quantité et la qualité de l'eau constituent les facteurs qui déterminent le niveau de
développement, et définissent le standard de vie.
-7-Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Janvier 2005
2. L’eau dans la zone Méditerranée et en Italie
2.1. Etat des lieux
De nombreuses recherches menées dans les régions les plus affectées par la pénurie en eau
(Afrique du Nord, Proche Orient et les pays européens méditerranéens) ont mis en évidence
l'existence de problématiques communes conditionnées par de graves déséquilibres dans le
régime des eaux superficielles et des nappes souterraines, entraînant de plus en plus de
retombées négatives sur le secteur agricole, entre autres.
La présence d’eau limitée et répartie d’une manière très irrégulière dans les pays méditerranéens,
aussi bien dans le temps que dans l’espace, a soumis l’eau à des pressions croissantes, liées à la
croissance démographique, au développement et à l’augmentation de l’irrigation.
Dans ce contexte, il apparaît important de souligner les points cruciaux suivants :
- les sources naturelles d’eau sont réparties très irrégulièrement entre les pays : 72% de la
disponibilité se trouve dans les pays du Nord de la Méditerranée, 23% de l’Est et 5 %
seulement du Sud. Certains pays ou territoire comme la Syrie, Israël, la Palestine, l’Egypte,
se trouvent dans une situation de forte dépendance envers d’autres pays en amont des
bassins hydriques
- sur 12 pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, huit pays exploitent déjà chaque année
plus de 50% de leurs ressources hydriques renouvelables
- deux pays exploitent plus de leur disponibilité de ressources renouvelables (l’Autorité
Palestinienne et la Libye)
- en 2025, selon l’évolution qui semble prévaloir, 10 pays sur 12 consommeront plus de 50%
des ressources hydriques renouvelables et parmi eux huit plus de 100% des leurs
ressources renouvelables. Dans cette situation de disponibilité limitée, quelques pays ont
eu recours à l’exploitation de la nappe phréatique dite fossile, non renouvelable. La
dégradation dans ce cas irréversible des écosystèmes, des aquifères et les infiltrations
d’eau salée deviennent toujours plus fréquentes.
Actuellement, dans le bassin méditerranéen sont utilisés environ 300 milliards de m3 d’eau douce.
Cette demande en ressource hydrique, composée de la consommation mais également des pertes
dans les aqueducs et dans les réseaux de distribution, a doublé en un siècle et a augmenté de
60% au cours de 25 dernières années. Sont également à souligner les fortes disparités entre les
pays de la zone méditerranéenne, avec des consommations allant selon les états, de 100 m3 par
an et par habitant à plus de 1000 m3.
L’exploitation excessive dans la région des nappes hydriques souterraines et le recours aux
ressources hydriques fossiles (qui donc ne sont pas alimentées de nouveau par le cycle
hydrologique) mènent à une situation non durable dans le temps. De plus, l’ensablement des
collecteurs et des bassins artificiels est à l’origine d’une réduction croissante des réserves
hydriques avec des pertes annuelles de capacité utile entre 2 et 3 %.
L’impact sur l’environnement est également catastrophique dans certaines zones de la région
méditerranéenne. En effet, l’exploitation des aquifères côtiers a déjà provoqué de nombreuses
infiltrations d’eau salée, souvent irréversibles. Plus de la moitié des zones humides
méditerranéennes ont déjà disparu avec un impact dramatique sur les écosystèmes. La pollution
croissante conduit également à la dégradation des sources hydriques et engendre des coûts
croissants pour assurer la production d’eau potable : de ce fait, le coût de la gestion des
-8-Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Novembre 2004
ressources hydriques augmente. La ressource hydrique limitée ne permet plus d’assurer la
sécurité alimentaire de la région, malgré une croissance soutenue de la production céréalière.
2.2. Les politiques mises en œuvre
Au cours des dernières années, on a assisté à des changements remarquables dans l'approche de
l'étude sur la disponibilité de la ressource en eau dans les pays méditerranéens. Des études de
faisabilité dans ces régions ont été engagées dans le but de définir des politiques répondant à
l'augmentation des besoins en eau de la population et à la nécessité de soutenir le processus de
développement économique de toute la région.
Ces politiques doivent premièrement tenir compte de l'augmentation de la demande en eau,
surtout dans les pays des rives Sud et Est de la Méditerranée, qui ont en commun la croissance
démographique et des phénomènes d'urbanisation non contrôlés, impliquant une forte
augmentation de la demande et, par conséquent, une exploitation des ressources en eau qui
dépasse la capacité naturelle de renouvellement des nappes.
Elles doivent également respecter les standards qualitatifs de l'eau et l'ensemble de l'écosystème,
dans la conscience que l'environnement constitue un patrimoine commun qui n'a pas de frontière.
Dans ce contexte, une révision des politiques de développement s'impose afin de pouvoir estimer
l'impact environnemental des projets lancés dans les pays en voie de développement, et accorder
des formes spécifiques de soutien économique aux pays qui adaptent leurs politiques aux
principes du développement durable.
Il est également important de considérer la mobilisation des capitaux, nationaux et internationaux,
nécessaires pour la construction des grands ouvrages d'adduction et pour le transport des grandes
masses d'eau indispensables à satisfaire les besoins en eau de la population.
En 1995, la rencontre européenne communément connue sous le nom de Forum de Barcelone, a
défini l'eau comme une "question prioritaire pour tous les partenaires méditerranéens". Ainsi, la
politique de gestion des ressources en eau prendra de plus en plus d'importance en considération
de la croissante rareté et du gaspillage continu de l'eau qui aujourd'hui intéressent ce secteur.
L'exploitation ultérieure et non contrôlée de la ressource en eau, conséquence de l'augmentation
de la pression de la population sur les zones urbaines, impose la réalisation d'un modèle de
développement indivisible de la sauvegarde de l'environnement naturel.
La forte demande de coopération en provenance des pays de la Rive Sud s'est traduite dans le
lancement du Plan d'Action pour la Méditerranée et dans l'élaboration du concept de "Identité
Méditerranéenne".
A l'occasion de la Conférence Méditerranéenne de l'Eau, qui a eu lieu à Rome en octobre 1992, le
renforcement, l’intensification et le développement de la coopération régionale en matière de
gestion des ressources en eau a été mise en avant et la conférence a accordé la priorité à la
recherche, aux transferts de technologie et de savoir faire.
La tâche de la recherche, de la conception et de la diffusion de la base de données concernant les
expériences acquises en matière de gestion des ressources en eau à l'échelle méditerranéenne, a
été confiée aux entreprises, aux centres d'études et aux organisations non gouvernementales,
dans le but de formuler des propositions d'intervention dans lesquelles la recherche appliquée et
l'expérimentation convergent.
Enfin, la Conférence Euro-méditerranéenne de Marseille de 1996 sur la gestion locale de l'eau,
adoptée par les 27 Pays du Partenariat Euro-méditerranéen, organisée conjointement par le
Gouvernement français et par la Commission de l'Union Européenne, a décrété la création du
"Système Euro-méditerranéen d'information sur la connaissance dans le domaine de l'eau"
(SEMIDE).
Au cours de cette rencontre, l'Italie a été chargée, avec un nombre restreint de pays, de rédiger un
plan d'action, en synthèse SEMIDE, afin de faire connaître les moyens de gérer l'eau de façon
efficace en Méditerranée.
-9-Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Novembre 2004
Même si ce rôle de premier plan que l'Italie a acquis et qu'elle partage avec la France et l'Espagne
réaffirme la mise en oeuvre de systèmes de coopération à l'échelle méditerranéenne, la situation
nationale présente de nombreuses difficultés.
2.3. La situation générale italienne
Le Rapport National sur l’Eau, dossier rédigé en 2002 par l’économiste Riccardo Petrella et le
Comité Italien pour le Contrat Mondial sur l’Eau, a mis en évidence les nombreux problèmes posés
par le système hydrique national italien.
Les difficultés principales ont été présentées en 8 points :
- la pauvreté des connaissances adéquates et des mises à jour concernant la qualité des eaux,
les relevés des cours d’eau souterrains, la pollution ; connaissance limitée de l’état des égouts.
- Un tiers des italiens n’a pas accès régulier et suffisant à l’eau potable alors que l’Italie est le
pays européen qui connaît la consommation la plus élevée par habitant (78 m3 d’eau
potable/an/habitant)
- Seuls 40 % des italiens boivent l’eau du robinet, mais ils sont les premiers consommateurs
d’eaux minérales au monde alors que ces dernières sont 3000 fois plus chères que l’eau
courante et moins saines.
- La dégradation du patrimoine hydrique ne cesse de s’aggraver : 30 % des habitants vivent
dans des grandes villes privées de systèmes de dépuration ; de plus, rares sont les villes
méridionales où la dépuration dépasse les 25 %.
- Les gaspillages sont dus au manque d’entretien du système hydrique : 30 % en moyenne des
eaux se perdent dans les conduites (50 % dans certaines zones). Le gaspillage domestique est
également très élevé.
- La politique a laissé s’installer une grande fragmentation dans la gestion de l’eau (8000 gérants
différents) et la loi Galli (N° 36/1994), qui tenta it de rendre plus efficace la cession des
ressources hydriques, présente de grands retards. Au lieu de cela, les politiques ont fait le
choix de la privatisation.
- Les conflits locaux se multiplient et s’intensifient, marqués par des tensions autour de la
privatisation du capital des sociétés publiques, et des protestations contre des projets de
tunnels et décharges polluants.
- Le poids de l’Italie sur la politique européenne, méditerranéenne et mondiale sur l’eau est
quasiment nul. Elle est absente des 4 grandes institutions qui tracent les orientations et les
choix prioritaires de la politique mondiale sur l’eau (World Water Coucil, Global Water
Partnership, World Commission in Water, World Water Assessment Programme).
2.4. Les ressources hydriques italiennes
L’Italie est un pays potentiellement très riche en eau. Avec ses 175 012 millions de m3 annuels,
elle arrive en seconde place des pays de l’Union Européenne, après la France, concernant la
quantité de ressources en eau théoriquement disponible. En calculant les flux de pluie, l’afflux
superficiel et le cumul dans la nappe souterraine, chaque italien pourrait compter sur 3052 m3
annuel, une quantité en dessous de la moyenne européenne (4035 m3) mais bien au delà de celle
qui définit le stress hydrique.
Si on passe de la disponibilité théorique à la quantité effective (en éliminant les pertes naturelles et
en considérant les moyens de captage à disponibilité), on atteint 56 012 millions de m3, une
quantité qui place l’Italie seconde derrière l’Allemagne dans l’Union Européenne, et qui donne aux
italiens la première place dans l’U.E. en terme de disponibilité par personne, avec 980,3 m3 annuel
contre une moyenne européenne de 612 m3 (647 pour la France et 719 pour l’Allemagne, données
issues du Rapport du Ministère de l’Environnement italien).
Cette disponibilité, cependant, n’est pas homogène sur le territoire national. Il suffit d’étudier les
estimations de la CNA (Conférence Nationale sur l’Eau) au cours des deux dernières campagnes
d’études menées en 1971 et 1989 pour visualiser la nette différence entre les divers
- 10 -Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Novembre 2004
compartiments hydrographiques, avec de grandes disponibilités au Nord de l’Italie et des
pourcentages plus réduits dans le reste du territoire national.
Des 296 milliards de m3 annuel de pluie, réduits à 164 milliards potentiels à cause des
phénomènes naturels d’évaporation et d’évapotranspiration, et réduits de nouveau à 52 milliards
de ressources effectivement utilisables par les pertes et les difficultés de captage, le Nord de
l’Italie peut compter sur presque 34 milliards de m3 (c’est à dire 65 % des disponibilités), bien plus
que les autres zones de Centre de l’Italie (15 %), du Sud (12 %) et des Iles (8 %).
Ces données concernent en grande partie l’eau de surface (au Sud et dans les Iles, surtout les
lacs artificiels), mais la quantité d’eau souterraine est importante (environ 11 milliards de m3,
supérieurs à la moyenne européenne).
Il est évident que les changements climatiques en cours risquent d’avoir une incidence sur la
disponibilité de la ressource en eau. Les prévisions parlent d’une aggravation de la sécheresse et
de la progressive désertification de quelques régions italiennes insulaires et méridionales, en
opposition avec la « tropicalisation » des régions du centre septentrional, où une augmentation des
pluies risque d’apparaître. Et si les effets de la désertification du Sud sur la disponibilité de l’eau
sont facilement imaginables, il ne faut pas éluder le problème lié à l’augmentation de la pluviosité
dans d’autres régions : vu la configuration particulière du territoire national, avec de nombreuses
pentes, accentuée par la sédimentation du lit des fleuves et par la réduction des zones forestières,
des pluies plus violentes ne pourront pas être mieux absorbées, mais créeront un afflux d’eau plus
rapide vers la mer.
2.5. Disponibilités et usages en Italie
La disponibilité hétérogène crée également des situations critiques au niveau des prélèvements,
qui déjà en Italie sont supérieurs à la moyenne de l’Union Européenne.
Le Nord de l’Italie, où l’on enregistre les prélèvements les plus importants en termes absolus,
utilise 78 % des ressources disponibles. L’utilisation dans les régions centrales, où les
prélèvements sont de 52 % de la disponibilité locale, sont plus raisonnables ; la situation des
régions méridionales est en revanche critique avec des prélèvements correspondants à 96 % des
disponibilités locales.
Parmi les secteurs concernés, la plus grande partie des prélèvements est effectuée par
l’agriculture, suivie de l’industrie, des usages civils, de l’énergie (essentiellement au Nord), et, plus
limité, de l’usage pour le tourisme.
L’agriculture est donc le secteur qui requiert les quantités d’eau les plus importantes. Au niveau
national, plus de 50 % des ressources sont destinées aux irrigations, surtout dans le Sud et dans
les Iles (dans le Centre de l’Italie, les prélèvements pour l’irrigation se limitent à 40 %). Malgré les
quantités prélevées pour l’irrigation, le système est bien loin d’être parfait, bien au contraire, car la
productivité de l’eau (rapport entre la quantité produite et la quantité d’eau utilisée) dans
l’agriculture italienne est parmi les plus basses de l’Union Européenne. En outre, l’irrigation utilise
souvent l’eau de la nappe souterraine, dont la pollution se fait de plus en plus importante, du fait
de l’utilisation abusive de fertilisants et pesticides. La logique industrielle qui s’applique désormais
à l’agriculture avec des usages irresponsables et non renouvelables des éléments naturels, sols et
eaux avant tout, est également à mettre en cause.
L’industrie effectue quant à elle des prélèvements de l’ordre de 20 à 30 % du total, concentrés
particulièrement au Nord de l’Italie comme par exemple l’usage de l’eau pour l’énergie.
Les prélèvements destinés aux usages domestiques concernent environ 10 à 20 % des
prélèvements totaux. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a évalué à 50 litres par jour et
par habitant le besoin essentiel en eau pour l’usage domestique. Les italiens, avec 278 litres d’eau
en moyenne par jour et par habitant (l/j/hab.), sont bien au dessus de ces évaluations et sont
même en tête des nations européennes (mais à l’intérieur du pays, les consommations diffèrent
- 11 -Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Novembre 2004
également selon les régions : 323 l/j/hab. pour l’Italie du Nord occidental et 214 l/j/hab. pour l’Italie
méridionale).
On considère que seuls 2 à 3 % de cette quantité sont utilisés pour boire et pour l’alimentation, le
reste étant absorbé à 30 % par la vaisselle et nettoyage des habitations, 30 % par les machines à
laver, et le reste pour la salle de bains, la douche, lavage de voiture,…
Il apparaît donc comme nécessaire de créer un double réseau, qui permettrait de réserver l’eau
potable aux utilisations délicates tandis que l’usage extra-domestique serait une eau non-traitée.
L’eau pour les usages domestiques provient en grande partie des nappes souterraines (environ 85
% du total), en général moins polluées que les superficielles et donc, nécessitant moins de
traitements. Au Sud et dans les Iles, l’utilisation des bassins artificiels est importante, puisqu’en
sont issus 15 à 25 % de l’eau potable.
En revanche, sont presque absents les procédés de dessalement de l’eau de mer, qui sont
pourtant employés pour fournir de l’eau dans d’autres pays méditerranéens comme l’Espagne,
Malte ou Chypre.
- 12 -Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Janvier 2005
3. Les difficultés du système hydrique italien
Le système hydrique italien présente des lacunes sur différents points : l’organisation et
l’infrastructure du service, les aspects sanitaires et l’impact sur l’environnement.
L’âge moyen du réseau d’adduction est de 35 ans, de celui de la distribution 34 ans, des réservoirs
25 ans. Les installations de traitement des eaux de grande dimension ont une moyenne d’âge de
25 ans, ceux de petite taille de 15 ans : au total 70% de l’eau est traitée dont 60% par le chlore,
l’ozone ou par les UV.
3.1. Le réseau hydrique : sources abondantes, gestion fragmentée
L’eau en Italie est particulièrement abondante, mais difficilement captable sans l’utilisation de
moyens importants de pompage et d’infrastructures.
La distinction entre Nord et Sud et l’hétérogénéité du système hydrique, comme nous l’avons vu
précédemment, est une caractéristique italienne concernant l’utilisation de l’eau. Ainsi, au Nord de
l’Italie, les Alpes sont une source continuelle d’eau, sans période de manque d’approvisionnement,
et les réseaux de distribution des eaux sont surtout gérés au niveau communal ou intercommunal.
L’eau fournie provient surtout des nappes phréatiques, des rivières et dans quelques rares cas,
des eaux superficielles. Par exemple, à Côme, l’eau du lac est depuis peu utilisée.
Au Centre de l’Italie, les Apennins sont une source discontinue, les réseaux de distribution sont
gérés au niveau communal et l’eau fournie provient soit des nappes superficielles, soit des rivières.
Enfin, au Sud, les Apennins sont également une source discontinue et il apparaît des périodes de
manque d’eau.
La gestion est effectuée par des sociétés importantes, et dans quelques cas isolés par les
communes qui s’en remettent au privé. L’eau fournie a surtout pour origine les nappes
superficielles, et est captée et distribuée par le biais de travaux de grande envergure (bassins
artificiels, conduites, réseaux de distribution,…).
Les problèmes principaux liés au réseau hydrique italien peuvent être résumés ainsi :
- décalage entre le cadre administratif et les aspects environnementaux
- forte fragmentation du système et absence d’une connaissance complète de la situation
- problèmes d’entretien, absents ou trop rares
- problèmes de pompage et d’approvisionnement en relation avec les changements climatiques
- problèmes qualitatifs de plus en plus importants à cause du manque de systèmes de
dépuration efficaces
Le décalage entre le cadre législatif qui gère les normes et l’aspect environnemental lié à
l’utilisation de l’eau est en effet important. La loi dite Galli, votée en 1994 (voir plus loin) et en
particulier ses parties relatives à l’institution de ATO (Ambiti Territoriali Ottimali, domaines
territoriaux optimaux), avaient pour objectif de lier les deux aspects. Malheureusement, peu de
directives ont été activées par les régions et l’intérêt des politiques locales envers cette loi semble
limité.
Ensuite, la fragmentation du réseau italien est excessive. Les secteurs de la distribution de l’eau,
de la collecte des eaux usées et de la dépuration sont caractérisés par un extrême morcellement
des opérateurs : 5500 pour la distribution d’eau potable, 7000 pour la collecte des eaux usées et
2000 pour la dépuration. Environ 50 % des volumes distribués sont gérés par des régies
municipales et des sociétés publiques de grande dimension, le reste l’étant par des sociétés
communales de petite taille. Ainsi, ces presque 15000 opérateurs sont dirigés par de nombreux
- 13 -Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Novembre 2004
gestionnaires dont les responsabilités ne sont pas évaluées correctement. De plus, il manque un
cadre informatif unique qui permettrait de connaître et de définir les potentialités réelles du
système actuel, ce qui devait être garanti par la loi Galli.
Les problèmes liés à l’entretien sont également trop présents. Le réseau hydrique italien présente
de grandes lacunes et des déficiences, du fait des faibles investissements dans sa rénovation ou
sa mise aux normes. La situation s’est donc dégradée et les innovations, surtout dans le domaine
de la dépuration, sont nulles.
Les difficultés qui apparaissent sur le réseau sont donc liées au manque d’entretien effectué et
cette situation critique engendre des dommages supplémentaires aux infrastructures,
compromettant indirectement le système hydrogéologique.
3.2. Les gaspillages
Le gaspillage de l’eau en Italie est un problème récurrent, tout aussi important que celui de la
qualité des réseaux d’approvisionnement. En effet, la « Relation sur l’Etat de l’Environnement en
2001 », effectuée à la demande du Ministère de l’Environnement, a quantifié à plus de 30 % les
pertes d’eaux dans les conduites du réseau hydrique italien. Dans certaines zones, surtout au Sud,
le pourcentage atteint 50 %, alors que la moyenne européenne avoisine les 10 %. Ces chiffres
placent l’Italie en tête de la classification des gaspilleurs d’eau dans les pays européens.
La cause de ces gaspillages est indiscutablement structurelle. Le réseau hydrique italien
nécessiterait en effet des adaptations et des investissements considérables afin d’améliorer le
système d’adduction et de distribution, les installations de traitement et les réseaux d’égouts (dont
les carences provoquent la pollution des eaux superficielles et souterraines), et la formation de
personnel technique.
La loi Galli (L.36/94) qui réglemente le système hydrique, prévoit que l’économie de la ressource
en eau passe principalement par la restructuration et la progressive rénovation des réseaux
existants qui présentent des pertes importantes.
Pour le seul cas de l’Italie du Sud, les estimations de la « Surveillance sur l’Utilisation des
Ressources Hydriques» portent à une économie de 50 millions d’euro si les gaspillages dans le
réseau étaient réduits. Pourtant, malgré un progressif et inquiétant vieillissement des
infrastructures hydriques italiennes, les investissements pour les travaux hydriques ont diminué,
entre 1985 et 1998, de 2/3. Il ne faut donc pas être surpris que les gaspillages d’eau aient
augmenté ces dernières années, passant de 17 % en 1975 aux actuels 30 % de pertes.
Selon les données fournies par l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement
Economique), l’Italie se place dans les mauvaises places de l’Union Européenne, en ce qui
concerne son réseau hydrique.
Ainsi, :
- l’Italie est le pays de l’Union Européenne qui prélève la plus grande quantité d’eau par
habitant : 980 m3 à l’année par habitant, le double de la Grèce, et bien plus que l’Espagne
(890) et la France (700) (pour comparaison, les prélèvements effectués aux Etats Unis sont de
1870 m3 à l’année et 200 en Grande Bretagne).
- l’Italie est au premier poste en ce qui concerne les prélèvements pour usage domestique (278
l/hab/jour), bien plus que la France (156) ou que l’Autriche (162)
- l’Italie est le second pays en Europe concernant le rapport entre eau prélevée et disponibilité
des ressources (avec 32%, après la Belgique)
- concernant l’usage industriel, l’Italie a l’un des plus mauvais indice de consommation d’eau par
unité produite : en Europe, avec 1 m3 d’eau, on produit en moyenne des biens pour une valeur
de 96 euro, en Italie la valeur est de 41 euro/m3 contre 120 euro en Allemagne et 200 en
Hollande
- enfin, pour l’agriculture, l’Italie consomme entre 50 et 60% du total des prélèvements et est l’un
des pays européens dont la consommation d’eau par hectare irrigué est la plus élevée.
- 14 -Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Novembre 2004
Il ne faut pas non plus oublier qu’aujourd’hui encore, beaucoup de zones en Italie souffrent, surtout
durant l’été, de graves carences hydriques.
Dans le Sud, plus de la moitié de la population n’a pas assez d’eau pendant au moins un trimestre
de l’année, et cela n’est pas dû à un simple problème de disponibilité, mais surtout à un usage
irrationnel de la ressource et à une mauvaise gestion. Il suffit de considérer les mauvaises
utilisations des ressources prélevées, en particulier par des systèmes d’irrigations peu efficaces,
ou au gaspillage dérivant des pertes dans les conduites pour comprendre l’impact négatif
engendré sur les disponibilités effectives.
Ainsi, l’inadéquation du système hydrique (mais également l’hétérogénéité de la disponibilité des
ressources) explique que, malgré une grande disponibilité sur le territoire, l’eau potable reste un
bien rare dans beaucoup de zones du pays. Ce problème touche surtout l’Italie méridionale et
insulaire (voir dans les situations spécifiques plus loin).
- 15 -Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Janvier 2005
4. Environnement législatif et gestion de l’eau
4.1. Historique de la politique italienne sur l’eau
La norme italienne concernant l’eau est restée, jusqu’au décret législatif 152/99, substantiellement
articulée sur la base de quatre dispositions législatives :
- décret du 11 décembre 1933, n° 1775
- loi du 10 mai 1976, n°319 (loi Merli)
- loi du 18 mai 1989, n°183 (loi sur la protection des sols)
- loi du 5 janvier 1994, n°36 (loi Galli)
Le décret 1775/1933 représente un acte important de la norme sur les différentes utilisations de la
ressource hydrique. Il a le mérite d’avoir commencé à affirmer le principe de nature publique de
l’eau et la nécessité de l’intervention de l’administration publique dans la régulation des travaux de
conception afin de garantir les intérêts collectifs.
Cependant, la vision globale du décret était de considérer l’eau comme une ressource illimitée à
défendre, et dans le même temps, à exploiter à travers la réalisation d’infrastructures et de
conditions juridiques adéquates. Ce décret n’était donc pas pensé comme un moyen de
surveillance de la ressource et ne tenait pas compte, par exemple, de la nécessité d’économiser
l’eau ou de la restituer non polluée.
4.1.1. Loi 319/1976 (Loi Merli) : Norme pour la protection des eaux face à la
pollution
La loi 319/1976, aujourd’hui substituée par le décret législatif 152/99 a constitué la première norme
italienne sur la pollution et l’assainissement des corps hydriques. Les principes, les finalités et les
instruments de la loi concernaient fondamentalement :
- la protection des eaux face aux phénomènes de pollution dus au fort peuplement du territoire
- le cas des rejets, quelque soit leur type, dans toutes les eaux superficielles et souterraines,
internes et marines
- les critères généraux pour l’utilisation des eaux en matière d’implantations
- l’organisation des services publiques des aqueducs, égouts et dépuration
De plus, la loi établissait les critères pour la rédaction d’un Plan Général d’Assainissement des
Eaux par les régions, dans lequel seraient précisées les caractéristiques quantitatives et qualitative
des corps hydriques, à la suite d’un monitorage systématique des eaux, ainsi que les actions et les
interventions d’assainissement nécessaires pour l’amélioration ou la prévention des situations de
dégradation.
4.1.2. Décret Ministériel 470/82 : actualisation de la directive européenne n°76/160
relative à la qualité des eaux de baignade
Le décret a comme objet les exigences chimiques, physiques et microbiologiques des eaux de
baignade. De plus, y sont spécifiés les modalités des contrôles et les interventions à effectuer
dans le cas où seraient rencontrées des valeurs supérieures aux limites fixées par le décret même.
Dans le tableau 1 ci-dessous sont reportées les valeurs limites de quelques paramètres retenus
comme indicateurs principaux de l’état de pollution des eaux. Sont également indiquées la
fréquence d’échantillonnage et la méthode d’analyse ou d’inspection.
Précisons que l’unité Ufc/l correspond à l’unité formant colonies par litre, soit la quantité de
bactéries par litre.
- 16 -Etat des lieux des ressources hydriques en Italie - Novembre 2004
Tableau 1 : paramètres les plus importants et valeurs limites pour la qualité des eaux de baignade
Paramètre Unité de mesure Valeur limite
Coliformes totaux UFC/100 ml 2000
Coliformes fécaux UFC/100 ml 100
Streptocoques fécaux UFC/100 ml 100
PH 6-9
Oxygène dissous % de saturation 70-120
4.1.3. Loi 183/89 : Norme pour le réaménagement organisationnel et fonctionnel de
la protection des sols
La loi 183/1989 a pour objectif d’assurer la défense du sol, l’assainissement des eaux, la
jouissance et la gestion du patrimoine hydrique dans les différentes utilisations, en relation à un
développement économique et social rationnel, ainsi que la protection des aspects
environnementaux qui y sont liés. La loi a introduit le concept de bassin hydrographique, défini
comme « le territoire dans lequel les eaux pluviales ou de fonte des glaces, se récupèrent dans un
cours d’eau déterminé directement, ou par le biais des affluents, ainsi que le territoire qui peut être
inondé par ce même cours d’eau ». L’instrument mis en place pour la réalisation des objectifs est
le Plan de Bassin, auquel sont associées connaissances, normes et techniques d’intervention. A
travers ce plan sont planifiées et programmées les actions et les normes d’utilisation en faveur de
la conservation, de la défense et de la valorisation du sol et de l’utilisation correcte des eaux. Les
dispositions de Plan de Bassin ont des caractères contraignants pour les administrations et les
organismes publiques ainsi que pour les sujets privés.
Malheureusement, en 1999, la loi 183 n’avait pas encore porté ses fruits, à cause de la faible
structure administrative, et d’une incapacité institutionnelle à coordonner les actions auprès des
régions et les préoccupations fédéralistes.
L’intégration de ces lois aurait pourtant dû garantir une approche globale au thème de l’eau mais
cet objectif a été manqué, aussi bien du fait de l’inapplication de normes claires que du manque de
volonté pour arriver à une vision globale des problèmes.
La 36/1994, dite Loi Galli, avait donc pour but d’apporter des solutions aux problèmes non résolus
par les lois précédentes.
4.1.4. Loi Galli de 1994 et les ATO
4.1.4.1. La loi Galli
Le principe clé exprimé par la loi est le concept d’utilisation durable de la ressource hydrique :
« toutes les eaux superficielles et souterraines sont publiques et constituent une ressource qui est
sauvegardée et utilisée selon des critères de solidarité ». Les différents usages de l’eau doivent
être orientés vers l’économie et le renouvellement des ressources pour ne pas condamner le
patrimoine hydrique, la viabilité de l’environnement, l’agriculture, la faune et la flore aquatique, les
procédés géomorphologiques et les équilibres hydrogéologiques. L’utilisation de l’eau pour la
consommation humaine est prioritaire sur les autres usages. Au cours des périodes de
sécheresse, et de toutes manières dans les cas de ressource hydrique insuffisante, la priorité pour
l’usage agricole doit être assurée, après celle de la consommation humaine.
Basée sur la gestion de la ressource hydrique, la loi Galli définit surtout des critères pour
l’organisation de structures de gestion des eaux, en considérant de manière globale l’ensemble du
cycle, de l’approvisionnement à la dépuration.
La réorganisation des services hydriques proposée par la loi passe ainsi par les Domaines
Territoriaux Optimaux (Autorità Territoriale Ottimale, dits ATO). Ceux-ci ont été définis selon des
- 17 -Vous pouvez aussi lire