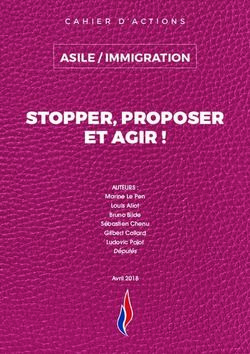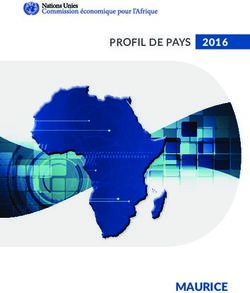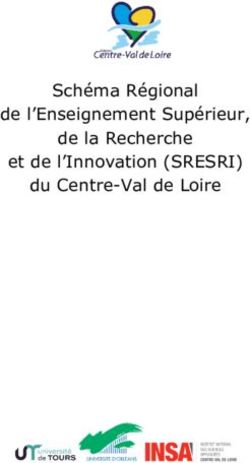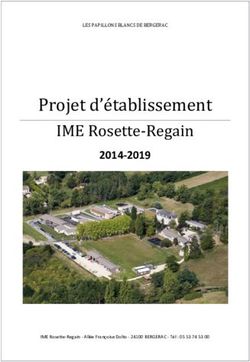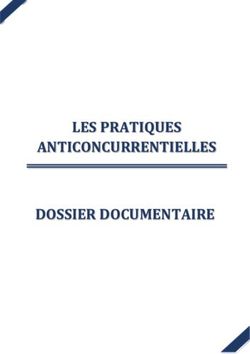Guide pratique de Sécurité Routière - Un outil pour l'action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Guide pratique de Sécurité Routière Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
© Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Global
Road Safety Partnership
L’Agenda mondial de la Fédération Toutes les parties de cette publication peuvent être citées, copiées, traduites dans d’autres
langues ou adaptées aux besoins locaux sans un accord préalable de la Fédération
internationale (2006-2010) internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à condition de citer
clairement le nom de la présente publication.
Au cours des cinq prochaines années, la Fédération internationale œuvrera, Les cartes figurant dans cette publication n’impliquent aucun jugement de la part de la
Fédération ou des Sociétés nationales concernant le statut juridique des territoires concernés
collectivement, à la réalisation des objectifs et priorités suivants : ou de leurs autorités.
Photo de couverture : Daniel Cima/Croix-Rouge américaine
Nos objectifs
ISBN : 978-2-940395-02-6
Objectif 1 : Réduire l’impact des catastrophes, notamment le nombre
de morts et de blessés.
Objectif 2 : Réduire le nombre des morts et des malades et atténuer les
effets des maladies et des urgences de santé publique.
Ce guide pratique a été préparé et rédigé par Gérard Lautrédou, membre de la Croix-Rouge
Objectif 3 : Accroître la capacité des communautés locales, de la société française, conseiller du Partenariat mondial pour la sécurité routière (GRSP en anglais) et
référent technique sécurité routière pour la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du
civile et de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge de faire face aux Croissant-Rouge.
situations de vulnérabilité les plus urgentes.
Nous remercions chaleureusement les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Objectif 4 : Promouvoir le respect de la diversité et de la dignité Rouge qui ont répondu à notre enquête sécurité routière, contribuant ainsi à la richesse
humaine, et réduire l’intolérance, la discrimination et l’exclusion sociale. d’information de ce guide.
Nous tenons à saluer particulièrement l’équipe de publication du secrétariat de la Fédération
Nos priorités pour leur élégante mise en page ainsi que les organisations qui nous ont permis d’utiliser leurs
schémas, dessins ou couvertures de publications : l’Organisation mondiale de la santé, la
Améliorer notre capacité d’intervention locale, régionale et Banque mondiale et la Fondation de la Fédération internationale de l’automobile.
internationale en cas de catastrophe et d’urgence de santé publique.
Intensifier notre action auprès des communautés vulnérables dans les
domaines de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et
de la réduction des risques de catastrophes.
Développer considérablement nos programmes et notre travail de 2007
sensibilisation en matière de lutte contre le VIH/sida.
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Renforcer notre action de sensibilisation sur les questions humanitaires
Case postale 372
prioritaires, en particulier la lutte contre l’intolérance, la stigmatisation CH-1211 Genève 19
et la discrimination, ainsi que les efforts visant à réduire les risques liés Suisse
aux catastrophes. Téléphone : +41 22 730 42 22
Télécopie : +41 22 733 03 95
Courriel : secretariat@ifrc.org
Site Internet : www.ifrc.orgGuide pratique de Sécurité Routière
1
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Sommaire
1. Introduction 2 9. La mobilisation des décideurs 22
2. Résumé 3 Au niveau mondial 22
Des guides de bonnes pratiques pour la planète 22
3. Les débuts de l’insécurité sur la route 4
Activer les coopérations internationales 23
Les années soixante et 70 en Occident 4
Au niveau national 23
Aujourd’hui dans les pays à revenu faible et moyen 5
10. La sensibilisation du grand public 25
4. L’ampleur de l’insécurité routière dans le monde 6
Des campagnes massives et répétées 25
La reconnaissance du problème 6
Des campagnes pédagogiques
Des tendances alarmantes 6
pour préparer la population à la loi 25
Le coût très élevé des accidents de la route 7
Des campagnes qui s’accompagnent
5. Comprendre l’insécurité routière et les mesures à prendre 8 d’une action des forces de l’ordre 26
Le véhicule 9 Les autres moyens de sensibilisation du grand public 26
L’environnement routier 9
11. Le contrôle et la sanction 28
Le comportement humain 10
Les conditions du contrôle et de la sanction 28
Les quatre facteurs de risque majeurs 10
Le rôle fondamental des forces de l’ordre 28
Modifier le comportement de l’usager 12
Gérer l’après-accident 12 12. L’éducation des jeunes et le permis de conduire 30
Les mesures à prendre pour améliorer la situation routière 13 L’éducation des jeunes 30
L’étape du permis de conduire 30
6. Évaluer la situation routière 14
La collecte des données sur les accidents 14 13. Les secours d’urgence et le secourisme
Manque de données et sous-estimation du nombre réel de victimes 14 au service des usagers de la route 33
La mortalité routière par pays 14 Des secours d’urgence à améliorer 33
La mortalité routière selon les régions 16 Développer le secourisme routier 34
Agir, de toute façon 18 14. Promouvoir une culture de la sécurité routière
7. L’organisation de la sécurité routière 19 au sein des organisations 38
Un mode d’organisation qui a fait ses preuves 19
15. Les partenariats en faveur de la sécurité routière 41
8. Le financement de la sécurité routière 21
Des financements insuffisants et instables 21 16. Conclusion et recommandations
Des solutions existent 21 pour les Sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge 43Guide pratique de Sécurité Routière
2
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
1.
Introduction
Ce guide pratique de sécurité routière est le fruit d’une coopération entre le Se- Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont le but principal est de limiter les souf-
crétariat de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du frances humaines, notamment celles des plus vulnérables qui sont les premières
Croissant-Rouge et le Partenariat mondial pour la sécurité routière (le GRSP victimes des accidents de la route.
pour Global Road Safety Partnership en anglais).
L’enjeu fondamental de la sécurité routière est bel et bien de changer le compor-
Il a pour objet de présenter de manière synthétique les problèmes et les solutions tement des usagers, à qui il faut donner un cadre pour que la route soit un espace
liés à l’insécurité sur la route dans le monde. public partagé et civique plutôt qu’un lieu de violence. C’est le postulat et le mes-
sage fort que veut illustrer ce guide pratique de sécurité routière. Les solutions
Il décrit également l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois- existent, et nous avons l’obligation morale de tout mettre en œuvre pour qu’elles
sant-Rouge dans le domaine de la sécurité routière et leur propose des recom- s’appliquent, d’autant plus qu’elles sont économiquement rentables.
mandations pour la renforcer : 20 actions Croix-Rouge/Croissant-Rouge de
sécurité routière seront présentées dans ce guide pratique. C’est un document Nous souhaitons que ce guide pratique participe à la prise de conscience du
dédié à l’action et, comme nous le verrons, il y a urgence à agir ! véritable fléau mondial que constitue l’insécurité sur la route et qu’il donne envie
à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge de s’investir encore davantage pour amé-
Sur les 185 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge inter- liorer la situation dans chaque pays.
rogées au sujet de leur action en matière de sécurité routière, 140 ont répondu à
notre enquête. Les trois quarts des Sociétés nationales nous ont apporté leur té-
moignage. Leurs pays représentent 90 % de la population mondiale. Voilà pour-
quoi leur action, qui concerne l’année 2005, sera décrite sur fond de cartes du
monde. Ce format très visuel permet de savoir rapidement qui fait quoi et où et
peut dès lors encourager les Sociétés nationales à communiquer entre elles pour
s’échanger leurs expériences.
Ibrahim Osman David Silcock
Les Sociétés nationales sont déjà actives sur le terrain de la prévention routière : Secrétaire général adjoint Directeur exécutif
elles mobilisent les décideurs, sensibilisent le grand public et les jeunes et ensei- Fédération internationale Partenariat mondial
gnent le secourisme. Nombreuses également sont celles qui interviennent dans les des Sociétés de la Croix-Rouge pour la sécurité routière
secours d’urgence. Ces activités s’intègrent parfaitement dans le mandat de la et du Croissant-RougeGuide pratique de Sécurité Routière
3
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
2.
Résumé
Ce guide pratique est organisé par thème en reprenant l’ensemble des sujets Les sections 6 à 8 abordent les notions d’évaluation de la situation routière,
fondamentaux de la sécurité routière. Il rassemble les principales connaissances d’organisation et de financement, piliers fondamentaux d’une bonne politique
de bases et les bonnes pratiques actuelles. Il propose à chaque fin de section (à de sécurité routière et condition de l’action. Nous avons essayé d’apporter au
partir de la section 6) des actions concrètes pour les Sociétés Croix-Rouge et lecteur et membre de la famille Croix-Rouge/Croissant-Rouge les arguments
Croissant-Rouge. Ce sont en tout 20 recommandations qui sont présentées sous essentiels qui lui permettront de saisir les enjeux organisationnels de la sécurité
la dénomination Actions Croix-Rouge/Croissant-Rouge. On en trouvera une routière et de se positionner en tant qu’acteur pour défendre et promouvoir les
synthèse à la fin de ce guide (page 44). bonnes pratiques en la matière.
Huit cartes du monde sont présentées : les deux premières tentent de décrire la Les sections 9 à 15 traitent de l’action de terrain à proprement parler, qui
mortalité routière par pays et par continent, les six cartes suivantes proviennent consiste notamment à mobiliser les décideurs, sensibiliser la population, améliorer
d’une large consultation mondiale des Sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge. l’application des règles routières, éduquer les jeunes, renforcer les secours
Elles décrivent les activités menées par pays et par thème et donnent une image d’urgence et le secourisme routier, promouvoir une culture de sécurité routière au
globale de l’implication des Sociétés nationales en matière de sécurité sein des organisations et favoriser les partenariats. Sur chacun des sujets nous
routière. aidons à comprendre les problématiques, éclairons sur les pratiques qui marchent
et offrons des propositions d’action pour les Sociétés Croix-Rouge et Croissant-
Les sections 3 à 5 sont consacrées à l’insécurité sur la route dans le monde, sa Rouge. Sont intégrées dans ces sections les cartes qui décrivent l’investissement
genèse, son ampleur, les causes majeures et les solutions que la société peut y actuel de la famille Croix-Rouge/Croissant-Rouge qu’il faut saluer et encourager.
apporter. Il s’agit de donner aux membres de la famille Croix-Rouge/Croissant-
Rouge des éléments généraux de compréhension et d’analyse d’un La section 16 conclut ce guide et résume les recommandations proposées à la
phénomène majeur de santé publique en pleine croissance qui tue chaque famille Croix-Rouge/Croissant-Rouge pour lui permettre de participer encore
année 1,2 millions de personnes et en blesse près de 50 millions, soit autant que plus à l’amélioration de la situation sur les routes du globe.
les grandes pandémies comme la tuberculose et le paludisme.Guide pratique de Sécurité Routière
4
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
3.
Les débuts de l’insécurité sur la route
Nous sommes tous des usagers de la route et, depuis l’enfance, celle-ci est syno- Nombre de personnes tuées sur les routes chaque année,
nyme de découverte et de liberté. Prendre la route, d’une façon ou d’une autre, en France (1956-2005)
c’est communiquer, voir d’autres horizons, d’autres gens et souvent d’autres cul-
tures. C’est aussi plus trivialement le moyen de se déplacer pour aller au travail
et transporter des marchandises nécessaires à l’économie.
La route permet également de désenclaver des régions jusqu’alors très isolées, sur-
tout en milieu rural. Mobilité et développement sont évidemment intimement
liés. La route assure 90 % du transport dans le monde.
Les années 60 et 70 en Occident
À l’exception de l’Amérique du nord, où le phénomène a commencé plus tôt, la
motorisation massive des transports routiers débute à la fin des années 50 avec la
démocratisation de la voiture dans les pays occidentaux. Elle s’accompagne d’une
forte croissance du parc de véhicules et d’une montée en flèche du nombre d’ac-
Source : Fondation de la Fédération internationale de l’automobile
cidents graves.
Au début des années 70, l’hécatombe routière atteint des sommets en Occident,
où l’on compte quelque 35 morts pour 100 000 habitants par an, et la tendance
continue de s’aggraver. C’est à cette période que se manifestent les premières réac-
tions de révolte contre la fatalité du drame humain que provoque la route et le
silence qui l’entoure.
Il aura fallu plus de dix ans pour se rendre compte en Occident qu’on ne pouvait
pas accepter passivement cette tragédie quotidienne et que l’usage de la route de-
vait être plus encadré ; dix ans pour commencer à comprendre que la plupart desGuide pratique de Sécurité Routière
5
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
accidents de la route étaient dus à quatre facteurs majeurs : le non-port de la cein- taxis y grossissent à vue d’œil. La motocyclette devient le mode de transport fa-
ture, le non-port du casque, la vitesse et l’alcool au volant. milial en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest.
Poussés par des associations de victimes, les médias et des personnalités publiques, Le phénomène de la motorisation se développe donc rapidement et surprend par
les responsables politiques occidentaux réagissent vers le milieu des années 70 et la violence routière qu’il engendre, qui ne fera qu’empirer si l’on ne prend pas des
adoptent les premières lois sur le port de la ceinture et la limitation de la vitesse, mesures fermes et coordonnées au niveau national et international.
lois qu’ils font appliquer. Le résultat est époustouflant, comme le montre la
courbe de la mortalité routière en France depuis 1956, qui est significative de la
tendance observée à cette époque dans les pays d’Europe de l’ouest. Non seule-
ment la mortalité cesse de croître mais elle diminue dans les mois qui suivent
l’application de ces deux mesures.
À des rythmes différents, des Directions de la sécurité routière se créent un peu
partout, disposent de moyens et coordonnent l’ensemble des services de l’État
autour d’un même objectif : réduire la fréquence et la gravité des accidents de la
route. L’obligation du port du casque et la limitation de l’alcool au volant vien-
dront plus tard et s’avéreront également extrêmement efficaces.
Ce que cette courbe montre aussi, c’est qu’il aura fallu 30 ans à la France pour re-
venir, en 1990, au niveau de mortalité routière enregistré en 1960. La sécurité
routière est un effort de longue haleine. C’est pourquoi il faut s’y prendre le plus
tôt possible car le problème ne fait que s’aggraver d’année en année à mesure que
croissent le parc de véhicules et le nombre des usagers de la route en général.
Aujourd’hui dans les pays à revenu faible et moyen
Ce qui s’est passé dans les années 60 en Occident est en train de se reproduire de-
Thierry Prat/www.thierryprat.com
puis une dizaine d’années dans les pays à revenu faible et moyen : croissance ra-
pide du parc de véhicules motorisés sur des routes fréquentées par une grande
diversité d’usagers, notamment par de jeunes piétons, de plus en plus nombreux,
qui sont les premières victimes de la route. La voiture individuelle n’y est pas en-
core majoritaire mais cela viendra vite. Les flottes de camions, de minibus et deGuide pratique de Sécurité Routière
6
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
4.
L’ampleur de l’insécurité sur la route dans le monde
La reconnaissance du problème
La prise de conscience de la violence routière dans le monde est finalement toute
récente et vient en partie de la publication, en 2004, du Rapport mondial sur la
prévention des traumatismes dus aux accidents de la route coproduit par la Banque
mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce rapport, traduit en
6 langues, donne la mesure de l’ampleur de la crise et propose des recommanda-
tions concrètes, basées sur les réussites en cours.
Trois mille personnes, dont 500 enfants, sont tuées chaque jour sur les routes de
notre planète. Plus de huit décès sur dix surviennent dans les pays à revenu fai-
ble ou moyen. Cela représente 1,2 million de décès par an, auxquels s’ajoutent
près de 50 millions de blessés graves dont beaucoup resteront handicapés à vie.
Notons que ces chiffres, même s’ils parlent d’eux-mêmes, sont largement sous-es-
timés.
Source : OMS/Banque mondiale – rapport mondial 2004
Des tendances alarmantes
Les tendances actuelles, clairement illustrées dans le Rapport mondial, permet-
tent de prévoir que les décès dus aux accidents de la route vont augmenter glo-
balement de 60 % d’ici à 2020, c’est-à-dire demain.
Alors qu’ils devraient continuer de baisser de 20 % dans les pays occidentaux, on
peut s’attendre, si rien n’est fait rapidement, à une augmentation de 80 % du
nombre de décès dans les pays à revenu faible et moyen.Guide pratique de Sécurité Routière
7
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Thierry Prat/www.thierryprat.com
Aujourd’hui déjà, les accidents de la route font autant de victimes que les grandes
pandémies telles que le paludisme et la tuberculose. Ils constituent la première
cause de mortalité des jeunes de 10 à 45 ans dans le monde, sauf dans les pays les
plus fortement touchés par le VIH/sida. C’est dire l’ampleur du problème et l’ur-
gence d’une action énergique.
Le coût très élevé des accidents de la route
Dans les pays en développement, le coût des accidents de la route est évalué à 1 %
du PNB, sans parler évidemment des drames humains qui ne sont pas quanti-
fiables.
Un pour cent du PNB, c’est tout simplement l’équivalent de l’aide publique au
développement reçue par chaque pays qui part en fumée sur la route. Cette si-
tuation est d’autant plus intolérable que les sommes engagées pour mener des ac-
tions de sécurité routière sont très vite amorties et même, le plus souvent,
rapportent de l’argent.
La sécurité routière est sans aucun doute un des domaines où l’intervention de
l’État est très rentable. Investir dans la sécurité routière, c’est faire des économies
tout en protégeant sa population et les générations futures.
Thierry Prat/Corbis Sygma
Il ne s’agit donc pas d’empoisonner les usagers de la route par des contraintes ad-
ministratives inutiles, mais plutôt de replacer l’homme et le respect de la vie, à la-
quelle nous tenons tous, au centre de cet espace commun qu’il nous faut partager.Guide pratique de Sécurité Routière
8
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
5.
Comprendre l’insécurité sur la route et les mesures à prendre
Les pays qui, depuis 30 ans, ont durablement inversé la tendance de la mortalité semble des secteurs concernés et disposant d’un budget propre. Les causes d’ac-
routière ont tous connu une prise de conscience des responsables politiques. cident sont souvent multiples et proviennent de trois facteurs, quel que soit le
Sans elle, rien n’aurait pu être fait. Cette prise de conscience peut se résumer ainsi : contexte du pays : le véhicule (qui est en cause dans 5 à 10 % des accidents), l’in-
■ les accidents ne sont pas une fatalité liée au développement économique et frastructure routière (10 à 20 % des accidents lui sont imputables) et le com-
coûtent très cher à la société (en vies et en argent) ; portement de l’usager (responsable, au moins en partie, dans 80 à 90 % des cas).
■ le comportement humain en est la principale cause ;
■ il existe, pour y remédier, des solutions techniquement simples et éprouvées, Il est important de considérer le véhicule/la route/l’usager comme un système in-
dont le coût est dérisoire au regard des bénéfices. terdépendant. La sécurisation des véhicules et de l’environnement routier doit
réduire au maximum les conséquences de l’erreur et de la négligence humaine.
Elle s’est très vite traduite par la création d’organismes publics chargés de la sé-
curité routière, en mesure de proposer un plan d’action coordonné avec l’en-
Matrice de Haddon
Phases Humain Véhicules et équipement Environnement
Source : OMS/Banque mondiale – rapport mondial 2004
Avant l’accident Prévention Information Aptitude à rouler Aménagement routier
des accidents Attitudes Éclairage Limites de vitesse
Diminution des facultés Freins Aménagements piétons
Application de la loi Maniement
Gestion de la vitesse
Accident Prévention Utilisation de moyens de contention Ceintures Accotements résistants
des traumatismes en cas Diminution des facultés Autres dispositifs de sécurité
d’accident Conception de protection
en cas d’accident
Après l’accident Maintien en vie Notion de secourisme Facilité d’accès Équipement de secours
Accès à des médecins Risque de feu Congestion
Cette matrice illustre l’interaction entre les trois facteurs (humain, véhicule et infrastructure) au cours des trois phases d’un accident : avant, pendant et
après le choc.Guide pratique de Sécurité Routière
9
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le véhicule Il a été démontré que certaines améliorations permettaient, à faible coût, d’abais-
ser sensiblement la mortalité routière. Il s’agit de la séparation des différents types
Les véhicules récents sont très performants sur le plan de la sécurité. Les construc- de circulation, de l’amélioration de la signalisation horizontale et verticale, de
teurs de véhicules s’accordent à dire que les prochaines évolutions techniques l’aménagement de voies plus sûres pour les piétons et les deux-roues, de la
mettront du temps pour offrir un niveau de sécurité bien supérieur à celui d’au- construction de trottoirs et de passages piétons plus reconnaissables et de la li-
jourd’hui. Le contrôle technique des véhicules est quasi obligatoire dans tous les mitation des vitesses de circulation (par l’installation de ralentisseurs, de bandes
pays occidentaux, où il est réellement effectué et donne lieu à un suivi. rugueuses et de ronds-points).
Il est clair qu’un effort important doit être fait dans les pays à revenu faible et Sur les routes existantes, ces travaux d’aménagement doivent se faire en priorité
moyen pour rajeunir et entretenir la flotte des véhicules. C’est le cas notamment sur les tronçons les plus dangereux, particulièrement aux entrées et sorties d’ag-
des véhicules commerciaux comme les taxis, les bus et les camions qui représentent glomérations et aux endroits très passants (marchés, écoles etc.).
en moyenne 50 % du parc de ces pays et pour lesquels il faut instaurer en priorité
un contrôle technique réel et indépendant. Ce contrôle doit être intransigeant sur Ces travaux d’aménagement doivent également faire partie intégrante de la
les fonctions vitales du véhicule : le freinage, les amortisseurs et l’éclairage. conception des nouvelles routes afin que celles-ci ne deviennent pas purement et
simplement le lieu d’accidents supplémentaires. Il est indispensable que les bud-
Autre sujet de préoccupation dans les pays à revenu faible et moyen : le charge- gets de construction des routes futures incluent impérativement un volet sécurité,
ment excessif des véhicules commerciaux transportant des marchandises ou des
personnes (ou les deux à la fois, comme c’est souvent le cas). Il est impératif de
réglementer les charges maximales et de les contrôler. Le développement du sec-
teur des transports publics et commerciaux est une des meilleures façons d’éviter
les surcharges.
La qualité du véhicule est donc un élément important mais, contrairement à une
idée reçue, elle arrive au troisième rang seulement des causes d’accident. En se-
conde position vient la route elle-même.
Daniel Cima/Croix-Rouge américaine
L’environnement routier
L’infrastructure routière, comprise dans son ensemble (le revêtement, la signali-
sation et l’aménagement), joue aussi un rôle important pour la sécurité. L’amé-
nagement des routes doit prendre en compte les prises de risque et erreurs
humaines et tenter de les minimiser.Guide pratique de Sécurité Routière
10
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
ce qui est loin d’être le cas partout dans le monde. Les guides pratiques tech- Nous avons délibérément décidé, pour ne pas alourdir le contenu du document,
niques existent et il n’y a rien à inventer en la matière, même si le domaine reste de nous concentrer sur les quatre facteurs de risque majeurs car ils sont les plus
perfectible. meurtriers.
Si, les infrastructures routières insuffisamment sécurisées sont un facteur non né-
gligeable d’accidents, elles n’en sont pas la cause majeure.
Les quatre facteurs de risque majeurs
Le comportement humain
C’est le comportement de l’usager de la route qui est, en fait, la cause principale
des accidents. Parmi les nombreux facteurs de risque, on en distingue principa-
lement quatre :
1 le non-port de la ceinture
2 le non-port du casque
3 la conduite à une vitesse excessive ou inadaptée à l’environnement
4 la conduite sous l’emprise de l’alcool
Chacun de ces facteurs majeurs est impliqué dans 30 à 50 % des accidents mor-
tels ou invalidants, quel que soit le pays, ce qui leur donne un caractère universel. Manuel sur le port de la ceinture/Fondation de la Fédération internationale automobile
Les pays qui ont mis en place des plans d’action ciblés pour lutter contre l’un au
moins de ces facteurs de risque ont tous vu la mortalité diminuer de 20 à 40 % en Le port de la ceinture, tout d’abord, réduit de 50 % le risque de décès ou de trau-
quelques années, alors même que celle-ci ne cessait auparavant de monter en flèche. matisme grave en cas de choc. C’est la mesure prioritaire la plus efficace et la plus
facile à mettre en œuvre pour sauver les passagers d’un véhicule à quatre roues
Il existe bien sûr d’autres facteurs de risque non négligeables comme la fatigue au lorsque l’accident survient. C’est un geste simple et peu contraignant, en quelque
volant (qui touche beaucoup le transport commercial longue distance), l’usage du sorte une habitude à prendre.
téléphone portable, la prise de stupéfiants en conduisant, le non-respect des dis-
tances de sécurité et aussi le manque de correction visuelle des conducteurs. Aujourd’hui, la quasi-totalité des véhicules dispose du système standardisé de re-
Aucun d’eux ne doit être négligé. tenue ; il n’y a donc pas d’investissement supplémentaire à faire pour l’usager. Le
contrôle du port de la ceinture est aisé et ne demande pas d’équipement ni de for-
Il y a aussi évidemment les règles de base du code de la route que les usagers doi- mation spécifique aux forces de police. Il faut certainement procéder par étape,
vent respecter comme les règles de priorité et de dépassement, les feux rouges, les obtenir dans un premier temps le port de la ceinture à l’avant, puis à l’arrière, y
sens interdits. compris l’usage des dispositifs de retenue pour les enfants.Guide pratique de Sécurité Routière
11
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Notons que le système d’airbag ne Le port de la ceinture et du casque est obligatoire dans pratiquement tous les
se substitue pas à la ceinture, mais pays du monde, mais l’application effective de la loi laisse à désirer dans environ
ne fait que la compléter. 70 % des pays.
Le port du casque réduit de 70 % le La limitation de la vitesse est également nécessaire si l’on veut réduire fortement
risque de traumatismes crâniens, qui la mortalité routière, tout particulièrement celle des jeunes piétons qui représen-
Organisée par la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge du Viet Nam
aboutissent dans la grande majorité tent 50 % des victimes de la route dans les pays à revenu faible et moyen.
des cas à la mort ou à des infirmités
mentales. C’est une priorité, surtout Comme relevé plus haut,
Photo de campagne de promotion du port du casque
en Asie du Sud-Est et en Afrique de les aménagements de l’in-
l’Ouest, où la flotte de motocy- frastructure sont fonda-
clettes peut atteindre jusqu’à 75 % mentaux pour obliger le
du parc des véhicules dans certains conducteur à ralentir à
pays. certains endroits. À
condition d’être bien si-
Le port du casque est moins facile à gnalé, le dos-d’âne est
faire respecter que le port de la cein- l’une des mesures les plus
ture. En effet, il faut que les usagers efficaces et rentables en
achètent un casque, dont le prix minimum tourne autour de dix dollars US et matière de sécurité rou-
Thierry Prat/wwwthierryprat.com
dont la qualité doit être certifiée par une norme nationale. Des aides du gouver- tière.
nement, comme une détaxe sur le prix des casques, sont à envisager dans les pays
à faible revenu. Inciter les vendeurs de motos à commercialiser le casque avec la Ensuite, il faut agir sur le
motocyclette est une initiative également intéressante. comportement de l’usa-
ger et le convaincre que la
La contrainte de chaleur est réelle dans nombre de pays, d’où l’intérêt de casques vitesse est un risque. Là
dits tropicaux encore trop peu disponibles. Il y a ensuite beaucoup de prétextes aussi, les arguments scientifiques existent. Il faut les rappeler massivement, tout
invoqués par la population pour ne pas mettre le casque : « Ça empêche de voir, en encourageant un mode de conduite plus serein.
d’entendre, c’est moche, ça décoiffe, etc. ».
Des limites de vitesse existent dans la plupart des pays mais sont mal connues de
Comme pour les autres facteurs de risque, il faut en revenir aux arguments scien- la population dans les pays à revenu faible et moyen. Ce qu’on apprend à l’auto-
tifiques qui prouvent la nécessité de porter un casque et les communiquer mas- école, quand on y passe, est très vite oublié si les panneaux de signalisation ne le
sivement à la population avant d’en rendre le port obligatoire. rappellent pas et si peu de contrôles sont effectués par la police.Guide pratique de Sécurité Routière
12
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le contrôle de la vitesse, à la différence du contrôle du port de la ceinture, de- plement du temps : deux heures sont nécessaires pour éliminer les effets dus à
mande un investissement. Les sommes à engager pour former et équiper les forces l’absorption d’un verre de bière de 25 cl.
de l’ordre de radars mobiles et/ou fixes ne sont pas anodines, mais elles sont vite
amorties car les amendes rapportent (si le système de collecte des amendes fonc- Il est important de rappeler ces repères car la majorité de la population mondiale
tionne, bien évidemment). ne sait pas ce que représente 0,5 gramme d’alcool par litre de sang, comment on
parvient à ce taux et combien de temps on y reste.
L’alcool au volant, enfin, est responsable, selon les pays, de 30 à 50 % des acci-
dents mortels et gravement invalidants. La limite maximale autorisée au-delà de La prise de risque du conducteur et le manque de réflexes augmentent de façon
laquelle le conducteur s’expose à des sanctions dans la plupart des pays occiden- exponentielle à chaque verre supplémentaire. Plus de la moitié de la planète ne
taux est de 0,5 gramme d’alcool par litre de sang. Les études scientifiques ont dé- dispose pas de loi fixant clairement un taux maximal d’alcoolémie pour conduire
montré que déjà à partir de ce taux maximum autorisé on prend 2 fois plus de un véhicule et réprimant les infractions. C’est la première étape à franchir. Cela
risque que si on n’avait pas bu d’alcool. étant dit, le meilleur conseil reste de ne pas boire du tout avant de conduire.
Quand la loi existe, elle est très rarement appliquée dans les pays à revenu faible
et moyen car elle est mal connue de la population et reste, de toute façon, très in-
suffisamment appliquée par les forces de l’ordre, voire pas du tout. La plupart du
temps d’ailleurs, celles-ci ne disposent pas d’alcootest pour contrôler les conduc-
teurs. On le sait bien : une loi routière sans moyens de contrôle est inutile.
Modifier le comportement de l’usager
On peut modifier le comportement de l’usager de diverses manières. Il y a les actions
à court terme, à mettre en place dans l’immédiat, et les actions à long terme, non
Mike Winnett
moins importantes mais dont les effets concrets mettent du temps à se faire sentir.
La mise en place de campagnes massives d’information, de contrôles et de sanctions
Bien que la réaction à l’alcool varie sensiblement selon les personnes, cela repré- liés aux facteurs de risque majeurs fait partie des actions à court terme. La combi-
sente environ deux verres de bière de 25 centilitres ou deux verres de whisky (ou naison de campagnes et de contrôles renforce considérablement l’impact sur le
d’un autre alcool à 40°) de 3 centilitres. Chez les femmes, les jeunes, les personnes comportement de l’usager.
âgées ou menues, la limite de 0,5 g/l peut être atteinte en consommant des quan-
tités inférieures à celles indiquées. Boire du café, de l’eau ou bien manger ne fait À long terme, il s’agit de renforcer l’apprentissage de la route en milieu scolaire
pas baisser le taux d’alcoolémie. Il n’existe pas d’astuce magique. Il faut tout sim- et d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé par les auto-écoles.Guide pratique de Sécurité Routière
13
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Gérer l’après-accident
La dernière mesure, et non des moindres, concerne la gestion de l’après accident. Nous reviendrons plus longuement sur tous ces différents thèmes tout au long de ce
Nous quittons la prévention pour entrer dans le domaine curatif. Il s’agit d’amé- guide pratique.
liorer les secours d’urgence et la prise en charge hospitalière, sans omettre la réa-
daptation des personnes handicapées.
Les mesures à prendre
pour améliorer la situation routière
Cinq actions d’urgence
■ Accroître la prise de conscience nationale du problème de l’insécurité sur la route, en priorité celle des décideurs
■ Disposer d’un système de collecte des données et d’une analyse de la situation (causes et lieux à risque)
■ Créer dans les instances publiques un organisme directeur de la sécurité routière en mesure d’élaborer et d’exé-
cuter un plan d’action coordonné
■ Lutter contre les quatre facteurs de risque majeurs par des campagnes massives de sensibilisation assorties d’un
système de contrôles et de sanctions
■ Encourager l’implication des milieux privés et associatifs nationaux
Cinq actions de longue durée
■ Améliorer l’état du parc de véhicules
■ Systématiser les aménagements sécurisés dans le réseau routier actuel et futur
■ Améliorer l’éducation routière en milieu scolaire et la qualité des procédures d’obtention du permis de conduire
■ Améliorer les secours d’urgence et la prise en charge des victimes et du handicap
■ Encourager la coopération internationaleGuide pratique de Sécurité Routière
14
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
6.
Évaluer la situation routière
Il n’est pas toujours facile d’apprécier la situation routière dans son pays, encore fiches standards de collecte des données sur presque tous les continents ; il suffit
moins de la comparer à celle d’autres pays. de se les échanger entre pays. Des logiciels, simples d’utilisation, permettent aussi
d’informatiser le traitement et l’analyse des données.
La collecte des données sur les accidents
En théorie, il faudrait savoir où et quand ont lieu les accidents, qui sont les per-
Manque de données et sous-estimation
sonnes impliquées avec quels types de véhicules, quelles sont les circonstances et du nombre réel de victimes
les causes de l’accident et, enfin, quels sont les dégâts matériels et humains. Dans les pays où le traçage des victimes à l’hôpital n’est pas mis en place, la mor-
talité est sous-estimée, la différence pouvant aller parfois jusqu’à 200 %. Les don-
Ces données sont essentielles car, sans elles, il est difficile de comprendre la si- nées sur la mortalité doivent tenir compte à la fois des décès survenus sur le lieu
tuation sur le terrain, de convaincre les pouvoirs politiques d’envisager des me- de l’accident et de ceux qui ont lieu à l’hôpital, ce qui n’est pas le cas dans la
sures à prendre et d’en évaluer les effets. quasi-totalité des pays à revenu faible et moyen, c’est-à-dire 80 % de la planète.
Les forces de l’ordre, dont le rôle est de constater officiellement l’accident sur Il est des pays qui ont un système fiable de collecte des données sur les accidents
place en établissant un procès-verbal constituent la première et la principale de la route, d’autres qui ne considèrent que les dommages causés sur les lieux de
source d’information concernant les accidents de la route. Il est essentiel qu’elles l’accident, d’autres enfin qui ne disposent pas de données centralisées exploitables.
aient accès aux informations concernant les blessés graves qui séjournent à l’hô- C’est ce qui rend la comparaison entre les pays difficiles, voire impossible pour
pital pour connaître leur état médical après l’accident. l’instant au niveau mondial. Cela étant dit, contentons-nous des chiffres dont
nous disposons et essayons quand même d’y voir un peu plus clair.
Ce suivi post-accident permet de faire un constat complet des conséquences de
chaque accident, de ne pas oublier les personnes qui décèdent à l’hôpital et de
comptabiliser celles qui restent invalides. La période de suivi varie selon les pays
La mortalité routière par pays
de zéro jour, là où il n’est pas fait, à 30 jours. Ce traçage est fondamental pour ap- Il faut prendre en compte plusieurs indicateurs à la fois (et leur évolution dans le
précier l’ampleur du problème. temps) pour évaluer l’insécurité sur les routes d’un pays. On retient principale-
ment la taille et le type du réseau routier, le type et le nombre de véhicules, le
L’expérience montre que le plus simple est de donner à la police la maîtrise du re- nombre d’habitants, le nombre d’accidents, de blessés (légers et graves) et enfin
cueil des statistiques concernant les accidentés. Notons également qu’il existe des le nombre de morts.Carte N° 1 :
La mortalité routière en 2004
Guide pratique de Sécurité Routière par pays pour 100 000 habitants 15
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Pour certains pays, les statistiques de la mortalité
dont nous disposons ne concernent que les années
antérieures à 2004. Plutôt que de laisser ces pays,
qui représentent une zone relativement étendue,
en gris, nous avons préféré retenir le chiffre de l’année
la plus proche de 2004 (à partir de 2000).
GROENLAND
(DANEMARK)
ALASKA
(É.-U.) ISLANDE
SUÈDE FINLANDE FÉDÉRATION DE RUSSIE
NORVÈGE
ESTONIE
ROYAUME-UNI DANEMARK LETTONIE
CANADA LITUANIE
PAYS-BAS POLOGNE BÉLARUS
IRLANDE BELGIQUE ALLEMAGNE
RÉP. TCHÈQUE UKRAINE KAZAKHSTAN
LUXEMBOURG LIECHSTENSTEINSLOVAQUIE
SUISSE AUTRICHEHONGRIE MOLDOVA MONGOLIE
SLOVÉNIE CROATIE
FRANCE BOSNIE- ROUMANIE
HERZÉGOVINE
ALLEMAGNE POLOGNE ITALIE
SERBIE ET
MONTÉNÉGRO BULGARIE GÉORGIE OUZBÉKISTAN
MACÉDOINE KIRGHIZISTAN RÉP. POP.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RÉP. TCHÈQUE PORTUGAL ESPAGNE ALBANIE (EX. RÉP. YOUG.)
ARMÉNIE AZERBAÏDJAN
SLOVAQUIE TURQUIE TURKMÉNISTAN TADJIKISTAN DÉM. DE CORÉE
LIECHSTENSTEIN
AUTRICHE GRÈCE
SUISSE HONGRIE CHYPRE SYRIE CHINE RÉP. DE CORÉE
SLOVÉNIE MALTE LIBAN IRAN AFGHANISTAN
CROATIE ROUMANIE TUNISIE IRAK
MAROC PALESTINE JAPON
BOSNIE- SERBIE ET
HERZÉGOVINE MONTÉNÉGRO ISRAËL JORDANIE
MONACO ALGÉRIE KOWEÏT
ITALIE MACÉDOINE JAMAHIRIYA PAKISTAN NÉPAL BHOUTAN
(EX. RÉP. YOUG.) ARABE BAHREÏN
LES BAHAMAS LIBYENNE ÉGYPTE
MEXIQUE QATAR ÉMIRATS BANGLADESH
ARABIE ARABES UNIS INDE RÉPUBLIQUE
CUBA RÉPUBLIQUE ALBANIE DÉMOCRATIQUE
GRÈCE MAURITANIE SAOUDITE MYANMAR POPULAIRE LAO
HAÏTI DOMINICAINE MALI NIGER OMAN
BÉLIZE JAMAÏQUE ST.-KITTS-ET-NEVIS ANTIGUA-ET-BARBUDA
HONDURAS DOMINIQUE CAP-VERT SÉNÉGAL TCHAD ÉRYTHRÉE YÉMEN THAÏLANDE ÎLES
GUATEMALA SAINTE-LUCIE SOUDAN MARSHALL
ST.-VINCENT-ET-LES GRENADINES BARBADE GAMBIE BURKINA
EL SALVADOR NICARAGUA GRENADE FASO DJIBOUTI CAMBODGE PHILIPPINES
GUINÉE-BISSAU GUINÉE
TRINITÉ-ET-TOBAGO NIGERIA SOMALIE VIET NAM
COSTA RICA SIERRA LEONE CÔTE
VENEZUELA GUYANA D'IVOIRE BÉNIN RÉPUBLIQUE ÉTHIOPIE SRI LANKA
SURINAME CENTRAFRICAINE BRUNÉÏ ÉTATS FÉDÉRÉS
PANAMA GUYANE FRANÇAISE LIBÉRIA GHANA MALDIVES PALAOS DE MICRONÉSIE
COLOMBIE TOGO CAMEROUN
MALAISIE
ÎLES GALAPAGOS GUINÉE ÉQUAT. OUGANDA KIRIBATI
(ÉQUATEUR) RÉP. DU KENYA
ÉQUATEUR SÁO TOMÉ-ET- GABON CONGO RWANDA SINGAPOUR
PRINCIPE SEYCHELLES NAURU
RÉP. DÉM. BURUNDI PAPOUASIE-
DU CONGO INDONÉSIE NOUVELLE-GUINÉE
TANZANIE
BRÉSIL COMORES TIMOR LESTE TUVALU
ÎLES
PÉROU ANGOLA MALAWI SALOMON
ZAMBIE
TONGA
MOZAMBIQUE VANUATU FIDJI
BOLIVIE
NAMIBIE ZIMBABWE MAURICE
MADAGASCAR
BOTSWANA RÉUNION
(FRANCE) NOUVELLE-CALÉDONIE
AUSTRALIE (FRANCE)
SWAZILAND
LESOTHO
AFRIQUE DU SUD
CHILI URUGUAY
ARGENTINE
NOUVELLE-ZÉLANDE
ÎLES MALOUINES
(ROYAUME-UNI) Non 5 - 9 : 25 % 15 -19 : 5 %
communiqué : 35 % 0 5000 km
1-4:6% 10 - 14 : 22 % 20 et + : 7 %
Frontières et situation du monde arrêtée à mai 2006Guide pratique de Sécurité Routière
16
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Dans le cadre de ce guide, nous nous limiterons à essayer de quantifier la mortalité
routière, qui est l’un des indicateurs, mais pas le seul.
La carte N° 1 (page 15), établie à partir de données provenant de la Fédération rou-
tière internationale et de l’Organisation mondiale de la Santé, illustre le nombre de
morts sur la route en 2004 pour 100 000 habitants selon les pays.Comme on le
voit, il y a encore de nombreux pays, très précisément 66, qui ne communiquent
pas de données statistiques sur les accidents de la route aux deux principales insti-
tutions mondiales chargées de les recueillir et disposant de nombreux réseaux locaux
à cette fin. Il arrive parfois que la demande d’information ne parvienne pas au ser-
vice compétent, mais la plupart du temps si ces pays ne communiquent pas de don-
nées, c’est qu’elles n’y sont ni rassemblées ni traitées. Il est évidemment pour eux
prioritaire de combler cette lacune.
Les pays où l’on meurt le moins sur la route sont ceux dont la morta-
lité pour 100 000 habitants oscille entre 5 et 9. Ce sont principalement les pays
fortement motorisés qui ont mis en place depuis 10 à 30 ans des politiques vigou-
reuses de sécurité routière et où la mortalité diminue chaque année. L’enjeu majeur
pour ces pays est de maintenir cette tendance à la baisse, ce qui demande des efforts
soutenus dans le temps. Ce groupe est également hétérogène car il comprend aussi
des pays où les statistiques sont bien en deçà de la réalité.
Les pays qui comptent entre 1 et 4 décès pour 100 000 habitants ont clairement un
problème de collecte des données car aucun des pays les plus performants en ma-
tière de sécurité routière n’enregistre des taux aussi bas. Les pays comptant entre 10
Reuters/Howard Burditt, courtesy www.alertnet.org
et 14 décès pour 100 000 habitants font partie des pays où les routes sont très dan-
gereuses et où, à quelques exceptions près, elles le seront de plus en plus, les statis-
tiques sous-estimant souvent gravement la réalité.
Dans les pays qui comptent plus de 15 morts pour 100 000 habitants, sous-esti-
mation ou pas, la mortalité sur la route atteint des niveaux alarmants. Dans la ma-
jorité des cas, si aucune action n’est entreprise, la situation ira en se dégradant au
même rythme que l’accroissement du parc de véhicules motorisés.Carte n° 2 :
Taux de mortalité,
Guide pratique de Sécurité Routière pour 100 000 habitants, 2002 17
Un outil pour l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Source : OMS/Banque mondiale – rapport mondial 2004
0 5000 km
11,0 - 12,0 12,1 - 16,2 16,3, - 19,0 19,1 - 28,3
Frontières et situation du monde arrêtée à mai 2006Vous pouvez aussi lire