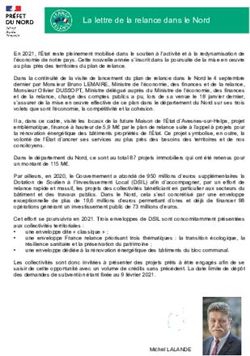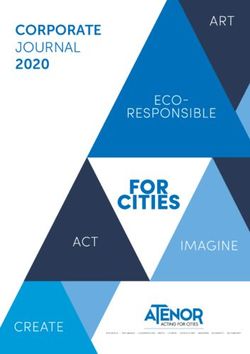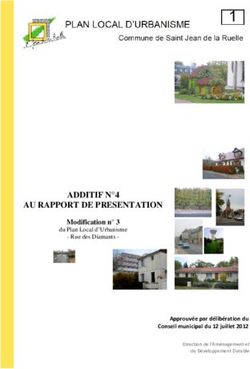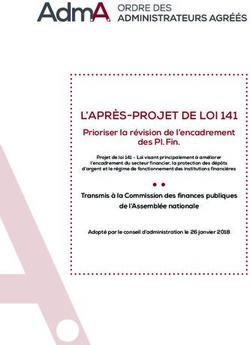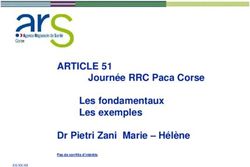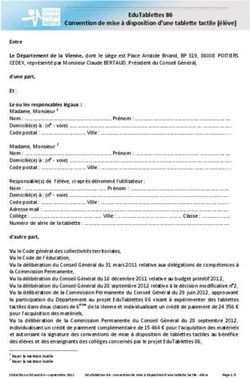HEBMA Aménagements Hydrauliques et Environnementaux du Bassin de la Meuse Amont - Réunion du comité de pilotage
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
HEBMA
Aménagements Hydrauliques et
Environnementaux du Bassin de la Meuse
Amont
Réunion du comité de pilotage :
27 février 2014 à Domrémy-la-Pucelle
Objet : présentation du diagnostic et des solutions d’aménagementPRESENTS
Organisme Nom Prés. Diff. E-mail
Georges COLAS georgescolas2@orange.fr
A.N.V.I. X X
Christian PETELOT
AAPPMA Rémi BAILLE X X aappma.neufchateau@gmail.com
Neufchâteau Michel MARTIN X X martinbazoilles@wanadoo.fr
AAPPMA Bourmont Mario PUTANO-BISTI X X mario.putano-bisti@orange.fr
Agence de l'eau Rhin-
Philippe RUSSO X X philippe.russo@eau-rhin-meuse.fr
Meuse
Blandine BONNE
Chambre
Jean-Louis FLAMMARION
d'Agriculture de X X bbonne@haute-marne.chambagri.fr
Cyril MOUSSU
Haute-Marne
Denis THIEBAUT
Chambre Romuald BOGUENET X X
Romuald.Boguenet@Vosges.Chambagri.Fr
d'Agriculture des Roland FOND X
Fructidor-rebeuville@wanadoo.fr
Vosges Michel LALLEMAND X X
Communauté de
Jean-Luc MUNIERE
communes des X X lesmarchesdelorraine@orange.fr
Fanny BECKER
Marches de Lorraine
Communauté de
Anne MUNDING a.munding@paysdeneufchateau.com
communes du bassin X X
Daniel COINCE danielcoince@packsurfwifi.com
de Neufchâteau
Commune de Michel BARRET
X X communederobecourt@orange.fr
Robécourt Jean Paul KOEHLER
Conseil général de André DEGUIS andre.deguis@orange.fr
X X
Haute-Marne Denis LALEVEE denis.lalevee@haute-marne.fr
Conseil général des
Claude PHILIPPE X X Mairie.harmonville@orange.fr
Vosges
Conseil Régional de
Stéphanie FALLOT X sfallot@cr-champagne-ardenne.fr
Champagne-Ardenne
Conseil Régional de
Nassera DEROUECHE X Nassera.Deroueche@lorraine.eu
Lorraine
Conservatoire
d'espaces naturels de Guillaume GENESTE X ggeneste@cen-champagne-ardenne.org
Champagne-Ardenne
Conservatoire
d'espaces naturels de Cathy GRUBER X c.gruber@cren-lorraine.fr
Lorraine
DDT 52 Sylvain ROLLET X sylvain.rollet@haute-marne.gouv.fr
DDT 88 Hélène BILQUEZ X X helene.bilquez@vosges.gouv.fr
DREAL Champagne- Christine.ries@developpement-
Christine RIES X X
Ardenne durable.gouv.fr
X
DREAL Lorraine Hervé RICHARD herve.richard@developpement-
X X
durable.gouv.fr
Xavier CARON xavier.caron@epama.fr
EPAMA X X
Barbora TOMISOVA barbora.tomisova@epama.fr
FD Pêche 52 Martial GIL X X martial.gil.fede52@wanadoo.fr
FD Pêche 88 Anicet HURIOT X anicet.huriot@peche88.fr
HYDRETUDES Christophe MICHALLON X X christophe.michallon@hydretudes.com
Lorraine Association
Guillaume LEBLANC X X lorraine_association_nature@yahoo.fr
Nature
CR COPIL 27/02/2013 2/7ONEMA
Direction inter- Marc COLLAS X X Marc.collas@onema.fr
régionale du Nord-Est
Préfecture de la
Jean-Paul CELET X
Haute-Marne
Préfecture des Vosges Gilbert PAYET X
Syndicat
intercommunal
Jean-Pierre BOTTAZZINI X mairie.saintthiebault@wanadoo.fr
d’aménagements de
la vallée de la Meuse
Syndicat
intercommunal
François CHAPITEL X X francois.chapitel@orange.fr
d'aménagement de la
vallée du Mouzon
Syndicat
intercommunal de Thierry RENAUDEAU
X X syndicat.vair.vraine@gmail.com
réhabilitation du Vair Guy POIROT
et de la Vraine
Cécile LLOVEL cecile.llovel@genivar.com
WSP France X X
Rémi LABEDADE remi.labedade@genivar.com
ANNEXES
support de présentation de la réunion
GRILLE DE REVISION
VERSION DATE MODIFICATIONS / REMARQUES
Version 1 11/03/2014 Rédaction R. LABEDADE / C. LLOVEL
Version 2 14/03/2013 Prise en compte des remarques de l’EPAMA
Version 3 17/03/2013 Prise en compte de remarques de l’EPAMA
CR COPIL 27/02/2013 3/7Procès verbal
I. ORDRE DU JOUR
Principaux points à l’ordre du jour :
Rappel des objectifs du projet HEBMA et avancement
Présentation des propositions d’aménagements environnementaux
Présentation des propositions d’aménagements hydrauliques
Discussion
II. POINTS ABORDES
II.1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET AVANCEMENT
En préambule, l’EPAMA présente le projet et l’objectif du Comité de pilotage. Il ajoute qu’à la fin de la phase DIA, une
phase de concertation sera organisée par l’EPAMA pour discuter des solutions d’aménagements à retenir. Cette
concertation aura lieu au cours des mois de mars et avril.
En complément, le Maître d’œuvre rappelle brièvement les principaux éléments du diagnostic :
l’état des lieux hydraulique qui a conduit à la modélisation hydraulique des principaux cours d’eau de la zone
d’étude (environ 180 km au total) ;
l’état des lieux environnemental qui, par le biais d’investigations, a permis de caractériser l’état du bassin.
L’état de celui-ci apparaît en deçà des attentes, en particulier du fait de sa position en tête de bassin. Cela
justifie la nécessité de réaliser des aménagements ambitieux pour améliorer la situation globale d’un point de
vue environnemental.
Sont rappelés les différents types d’aménagements (à but hydraulique et /ou environnemental) à l’étude, ainsi que la
démarche retenue :
84 sites identifiés dans le marché. Certains sites ont été rajoutés suite à la concertation, ou à des propositions
du maître d’œuvre ;
proposition d’au moins trois solutions d’aménagement par site ;
estimation de l’impact hydraulique, environnemental et des coûts de chaque solution d’aménagement.
II.2. PROPOSITION D’AMENAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Pour chaque type d’aménagement, le maître d’œuvre décrit la méthode adoptée et l’illustre par un exemple. Les
exemples suivants ont été abordés :
lit d’étiage : la Meuse à Goncourt,
aménagement de seuil : la pisciculture de Sionne sur la Saônelle,
réhabilitation d’annexes hydrauliques : la noue de Pagny,
création de zones humides : le Mouzon à Sartes,
reméandrage : la Meuse à Quinquengrogne,
diversification des écoulements : la Meuse à Coussey,
réduction de section du lit mineur : l’Anger entre Malaincourt et Gendreville.
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse rappelle que des directives européennes demandent à atteindre un bon état des eaux à
courte échéance. Pour cela, un entretien classique ne suffit pas et cela justifie la mise en place du projet.
D’autre part, l’Agence de l’Eau regrette que les solutions ambitieuses puissent apparaître comme dissuasives du fait de
CR COPIL 27/02/2013 4/7leurs coûts élevés. Les effets positifs attendus des aménagements doivent davantage être mis en avant.
Un intervenant évoque la problématique d’acquisition foncière pour la réalisation des solutions (en particulier pour les
reméandrages). L’EPAMA précise que l’objectif est de trouver un accord par concertation avec les personnes
concernées.
A la question de savoir si la différence des types de sols à l’échelle de la région avait été prise en compte, le maître
d’œuvre explicite la démarche suivie concernant la géologie et la géotechnique. Une analyse générale des cartes
géologiques du territoire a été effectuée, et a été complétée localement par des investigations géotechniques au droit
de certains seuils. Dans la suite du projet, d’autres investigations géotechniques seront réalisées au droit des
aménagements les plus sensibles (une fois les solutions retenues).
Le maire d’Harchéchamp demande à ce que les solutions proposées sur la commune d’Harchéchamp soient
explicitées.
Le maître d’œuvre répond en expliquant que la commune d’Harchéchamp est concernée par des aménagements
environnementaux (aménagement de seuil, création de lit d’étiage) et de travaux hydrauliques pour protection contre
les inondations. En l’occurrence, l’objectif est de concilier la protection du village avec l’amélioration de l’état
écologique du cours d’eau. Les solutions envisagées sont :
Création d’un mur de protection en rive droite. Le maire rappelle son opposition à un tel projet. Cette
solution a quand même été étudiée puisqu’il s’agit de la solution la plus optimale du point de vue
hydraulique, même si elle n’est pas acceptable localement.
Création d’un chenal dans le terrain en rive gauche.
Arasement du seuil à l’aval du village et décaissement du terrain en rive gauche. Le maître d’œuvre indique
que le décaissement du terrain en rive gauche est intéressant d’un point de vue hydraulique, mais que cette
solution nécessite l’aménagement du seuil à l’aval. En complément de l’aménagement du seuil, le lit mineur
serait repris dans l’intégralité de la traversée du village (création d’un lit mineur réduit pour pallier à la baisse
de niveau).
Un interlocuteur demande si l’efficacité des solutions proposées est prouvée. L’Agence de l’Eau répond que les types
d’aménagements présentés ont déjà été mis en œuvre et qu’ils présentent des retours d’expérience positifs.
L’adaptation locale de ces solutions est nécessaire par la suite.
Une question est posée sur le coût estimé de l’entretien. Le maître d’œuvre précise qu’il s’agit seulement d’un
pourcentage à l’état actuel du projet, mais ce coût sera ensuite précisé et optimisé.
II.3. PROPOSITION D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
L’objectif des aménagements hydrauliques est d’améliorer la situation localement, sans la dégrader localement et
globalement.
Le maître d’œuvre présente rapidement les différents types d’aménagements hydrauliques (travaux de protection
localisée, création de zones de surstockage) et les sites retenus.
Sept scénarios d’aménagement globaux (c'est-à-dire à l’échelle du bassin versant), ont été étudiés. Ces scénarios ont
été élaborés par discussion entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les partenaires techniques du projet, ainsi
que suite à différents ateliers de concertation.
Les principes retenus sont les suivants :
Etude de la combinaison des zones de surstockage, avec et sans travaux de protection localisée
Zone de surstockage du Vair non prise en compte (intérêt hydraulique à l’aval réduit, et impact important sur
des enjeux à l’amont). En contrepartie, les travaux de protection localisée sur le Vair (Harchéchamp et
Moncel) sont pris en compte.
Pour les protections localisées, il a été considéré les protections les plus efficaces, donc de type endiguement
lorsque cela était possible techniquement.
CR COPIL 27/02/2013 5/7Le maître d’œuvre décrit les sept scénarios, et présente pour chaque scénario : les abaissements éventuels de la ligne
d’eau à l’aval, les impacts négatifs sur les enjeux engendrés par les zones de surstockage, et le coût estimé.
Le propriétaire de la ferme des Maleux s’oppose aux scénarios qui prévoient un impact sur la ferme. Le maître d’œuvre
précise qu’une protection de la ferme est incluse dans chaque scénario si besoin.
Pour comparer l’intérêt économique de chaque scénario, une Analyse Coût Bénéfice (ACB) a été réalisée. Elle permet
de comparer le coût des scénarios avec les bénéfices attendus.
L’EPAMA précise que l’ACB porte uniquement sur l’aspect économique. D’autres aspects (psychologique, social…)
pourront être pris en compte et intégrés ultérieurement. De plus les dommages intangibles (c’est-à-dire difficilement
monétarisables, comme traumatismes psychologiques, impacts sur l’environnement etc.) et les dommages indirects
(coût de relogement des sinistrés, de dysfonctionnement des services publics etc.) ne sont pas pris en compte.
Au vu des hypothèses fortes utilisées lors des calculs, les résultats sont à utiliser plus en relatif, pour comparer les
différents scénarios, qu’en absolu.
Un intervenant s’interroge sur le coût important des scénarios (de 8,5 à près de 18 millions d’euros). Le maître
d’œuvre explique brièvement que les incertitudes existant au stade actuel de l’étude expliquent que le chiffrage soit
élevé. En particulier, il est précisé que tous les aménagements ont été chiffrés séparément. Une fois que les choix de
solution seront effectués, une stratégie globale de chantier sera mise en place ce qui permettra une optimisation des
coûts. En outre, les chiffrages prévoient des mises en œuvre réduisant au maximum l’impact sur les riverains et
l’environnement (piste d’accès, détournement des eaux…). Ces hypothèses ont un impact important sur le chiffrage.
Des solutions plus modestes pourront être mises en œuvre par concertation avec les services de l’Etat et les
organismes concernés.
Monsieur le conseiller général des Vosges ajoute à titre de comparaison que le seul déplacement de la maison de
retraite de Neufchâteau a coûté environ 15 millions d’euros.
Le maire de Rebeuville demande pourquoi des solutions de protection plus individuelles n’ont pas été étudiées
(rehausse du plancher des habitations par exemple). Des subventions pourraient par exemple être proposées pour
favoriser ce type de travaux.
Le maître d’œuvre répond que le projet a pour objectif une réduction de vulnérabilité à l’échelle globale. Des
protections individuelles peuvent être envisagées par le biais des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti en
zone inondable.
Un intervenant s’interroge sur l’impact du drainage des sols et de la suppression des haies sur les crues.
L’EPAMA indique que ce type d’analyse ne fait pas partie du cadre du projet. Des recherches sont cependant menées
sur ce type de sujet. L’impact du drainage est difficile à évaluer et dépend du contexte et du type de crue. L’impact de
la suppression des haies est surtout important vis-à-vis du transport solide (cela peut notamment entraîner des
problèmes d’érosion). L’impact sur les crues importantes n’est pas clairement identifiable.
L’ONEMA évoque le changement important de l’occupation des sols qui est observé ces dernières années
(retournement des prairies en particulier). Il regrette que le projet HEBMA traite des conséquences et pas des causes.
L’EPAMA indique que ce problème n’est pas dans le cadre du projet. D’autres projets peuvent être menés sur cette
problématique (notamment une adaptation des documents d’urbanisme).
La Chambre d’Agriculture de Haute-Marne indique que le changement d’occupation des sols se justifie par une
adaptation au contexte économique (chute du prix du lait, augmentation de celui des céréales).
Un lien éventuel entre le changement climatique et l’aggravation des crues sur le secteur est évoqué.
L’EPAMA indique que des études ont été menées sur l’impact du changement climatique sur le bassin de la Meuse
internationale (voir http://www.amice-project.eu/fr/). Concernant les crues, aucune conclusion fiable ne peut être
avancée. Cependant, un consensus apparaît sur le risque d’aggravation des étiages sévères. L’aggravation potentielle
de la situation sur le secteur est quand même prise en compte en modélisant l’impact des aménagements pour les
crues extrêmes, jusqu’à une crue millénale.
CR COPIL 27/02/2013 6/7II.4. PLANNING
L’EPAMA insiste sur le fait qu’à la fin de la phase DIA, l’ensemble des interrogations techniques devront être levées. Il
demande que toutes les remarques soient transmises au plus tôt à l’EPAMA (avant le 14 mars 2014).
Le maître d’ouvrage présente le planning à venir du projet.
Une phase de concertation sera menée par l’EPAMA durant les mois de mars et avril. Elle aura pour objectif d’aboutir
au choix d’une solution d’aménagement sur chaque site étudié.
Une fois les solutions retenues, elles seront détaillées dans les phases ultérieures du projet. Il est prévu que l’Avant
Projet soit réalisé au cours du deuxième semestre 2014, à la fin de cette phase le scénario final d’aménagement sera
arrêté et des délibérations pourront être prises par les collectivités. Les phases Projet et DCE (Dossier de Consultation
des Entreprises) suivront au début de l’année 2015.
Il est également prévu de réaliser une visite de la zone de surstockage de Mouzon (dans les Ardennes), sans doute au
cours de l’été 2014.
II.5. ECHANGES
Question : Quel est le dispositif de prise de décision ?
Réponse : Participent aux prises de décision les collectivités, les partenaires techniques et financiers et les services de
l’Etat.
L’EPAMA ajoute qu’une délibération aura lieu à la fin de la phase AVP sur le choix d’une solution technique globale.
Question : Que se passe-t-il si une collectivité veut faire quelque chose et que le riverain s’y oppose ?
Réponse : Tout dépend du statut juridique. L’objectif n’est pas de passer en force, mais de favoriser la concertation.
Concernant les aménagements de seuil, il faut rappeler que les propriétaires de seuil ont des droits et des devoirs.
Question : Des compensations financières sont-elles prévues concernant les zones de surstockage ?
Réponse : Oui, des compensations financières sont prévues lorsqu’il y a une modification des pratiques agricoles, ou
lorsque la zone de surstockage entre en fonctionnement (entraînant une surinondation des terrains à l’amont et une
perte d’exploitation).
Ces indemnisations ont été mises en place sur l’ouvrage de Mouzon dans les Ardennes. Les conventions seront
négociées, avec participation notamment des chambres d’agriculture.
L’Agence de l’Eau précise que l’objectif est de proposer des solutions ambitieuses, pragmatiques et qui prennent en
compte les contraintes locales. Elle souligne également la nécessité d’une mise en avant du lien entre les travaux
hydrauliques et les aménagements environnementaux. Elle précise que l’Agence de l’Eau, en tant que financeur, est
intéressée par un aménagement global cohérent combinant aménagements environnementaux et hydrauliques.
Elle s’interroge sur les chiffrages présentés, qui semblent hauts.
Le maître d’œuvre répond que les chiffrages doivent prendre en compte des incertitudes à ce stade de l’étude. Ils
seront affinés lors des phases ultérieures.
En outre, certaines hypothèses (et en particulier la création de piste et le détournement des eaux) ont un impact très
important sur le montant global des travaux. Ces postes pourront être optimisés par discussion avec les acteurs locaux
et les services de l’Etat concernés.
CR COPIL 27/02/2013 7/7Vous pouvez aussi lire