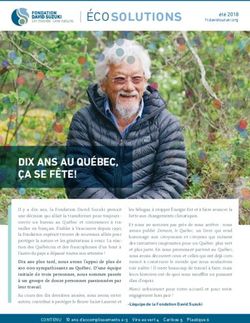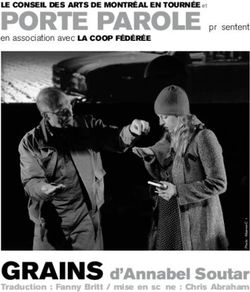À la gloire des héros - Daniel Drouin Continuité - Érudit
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Document generated on 07/11/2022 3:47 p.m.
Continuité
Dossier
À la gloire des héros
Daniel Drouin
Number 82, Fall 1999
Dans l’intimité de l’art public
URI: https://id.erudit.org/iderudit/16775ac
See table of contents
Publisher(s)
Éditions Continuité
ISSN
0714-9476 (print)
1923-2543 (digital)
Explore this journal
Cite this article
Drouin, D. (1999). À la gloire des héros. Continuité, (82), 19–23.
Tous droits réservés © Éditions Continuité, 1999 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/Entre 1880 et 1930, la commémoration des héros a connu au Québec un âge d'or. Partout dans
le paysage urbain, des monuments jettent des ponts vers le souvenir. Véritable corpus d'art
public, ces œuvres sont autant de maillons qui nous rattachent à l'histoire.
par Daniel Drouin « sculpteut national », Louis-Philippe
H é b e r t . A c e t t e é p o q u e , la ville de
u milieu du XIX e siècle,
A
Québec possède déjà ses premiers monu-
presque tous les éléments ments. La colonne Wolfe (1790) et l'obé-
sont en place pour permet- lisque Wolfe-Montcalm (1828) ont été
tre l'émergence de la sculp- érigés dans la plus pure tradition britan-
ture commemorative au nique. En 185.5, la Société Saint-Jean-
Québec. La grande bour- Baptiste de Montréal fait élever le grand
En 1914, au cœur du nouveau secteur
geoisie anglo-saxonne célèbre les vertus de obélisque à la mémoire de Ludger d'affaires de la ville de Montréal, une
l'impérialisme britannique tandis que Duvernay dans le nouveau cimetière trentaine d'érables centenaires sont
l'élite cultivée canadienne-française, qui a N o t r e - D a m e - d e s - N e i g e s . Trois ans abattus p o u r faire place au p e t i t square
vivement réagi à la publication du rapport plus tard, l'Institut canadien honore au Phillips où est érigé le monument à
Durham, entreprend l'écriture de son his- même endroit la mémoire des Patriotes Edouard VII, une œuvre de
toire à grands coups de manifestations de 1837-1838. Entre 1880 et 1930, L.-P. Hébert. L'architecte français
patriotiques. L'année 1850 voit naître celui le Québec se révèle un vaste chantier Gustave Umbdenstock réalise le piédestal.
qui deviendra au tournant du siècle notre commémoratif. Photo : Robert Etchevery
D o s s i e r numéro quotrt-vingf-deux ïLE SOUVENIR MATÉRIALISÉ biais du ministère des Travaux publics,
L'une des principales fonctions du monu- a octroyé à Louis-Philippe Hébert, en
ment est de commémorer les héros du 1913, le contrat pour la réalisation
passé. Les batailles glorieuses de toutes du plus grand bronze érigé au Québec, le
les époques ont fait l'objet de commémo- monument à Madeleine de Verchères,
ration. La plupart des villes du Québec à Verchères.
possèdent un monument à la gloire des Dans le domaine des monuments, la
soldats disparus durant les grands conflits palme revient toutefois au gouvernement
mondiaux. Les monuments servent égale- provincial qui, avec le programme
ment à souligner des dates historiques d ' e m b e l l i s s e m e n t de l'Hôtel du
importantes. La plupart des héros laïcs et Parlement, a favorisé l'essor de la commé-
religieux de la Nouvelle-France ont été moration au Québec. Dans sa conception
coulés dans le btonze, comme le du Palais législatif, l'architecte Eugène-
Champlain (1898) du sculpteur français Etienne Taché avait prévu un programme
Paul Chevré ou le Louis Hébert (1918) iconographique complexe comprenant
d'Alfred Laliberté, tous deux érigés à des représentations en bronze des héros
Québec. Il est aussi coutume de rendre nationaux. Une première série de com-
hommage, de façon posthume, aux mandes a été confiée à Louis-Philippe
contemporains qui ont apporté une Hébert, qui a livré 10 statues et groupes
contribution significative à la collectivité. allégoriques entre 1890 et 1895. Une
La monarchie anglaise a été statufiée à deuxième série de commandes a été effec-
quelques reprises. Pensons au monument tuée entre 1916 et 1928, permettant à
à la reine Victoria (Marshall Wood, 1872) Alfred Laliberté de réaliser six statues.
au square du même nom à Montréal, qui Henri Hébert, Elzéar Soucy, Marc-Aurèle
est le premier bronze érigé dans la de Foy, Suzor-Côté et Jean Bailleul ont
province. Plusieurs hommes politiques chacun conçu une sculpture. Durant les
ont leur statue bien en vue à des endroits années 1960, le programme a été complété
stratégiques de la ville, en particulier avec quatre statues d'Emile Brunet, une
d'anciens premiers ministres du Canada de Sylvia Daoust, de C l é m e n t Paré
et du Québec. La société du temps a et de Raoul Hunter. Les instances muni-
aussi rendu hommage à des membres cipales ont joué un rôle similaire, mais à
du clergé, à des hommes d'affaires et à une plus petite échelle, comme en fait foi
quelques grands auteurs. Elzéar Soucy le monument aux Héros de la Grande
a sculpté la statue de M" Louis-François Guerre (1923) de Lachute, commandé par
Laflèche (1927) pour l'évêché de Trois- un regroupement de municipalités de cette
Rivières. Le premier président du région au sculpteur George William Hill.
Canadien Pacifique, Lord Mount Parallèlement aux initiatives des gouver-
Stephen, a son monument (Frederick nements, le clergé a contribué à l'érection
Lessore, 1913) à la gare Windsor de d'au moins une trentaine de monuments.
Montréal. L'auteur de la première Histoire En 1909, à Montréal, les religieuses de
du Canada, François-Xavier Garneau, a le l'Hôtel-Dieu inauguraient le monument à
sien à Q u é b e c (Paul Chevré, 1912). Jeanne Mance, commandé à Louis-
Fondu à la fonderie montréalaise
Certains événements tragiques ont égale- Philippe Hébert par MBr Paul Bruchési
L.-J. Hérard, le monument à
ment été soulignés. Par exemple, le pour marquer le 250 e anniversaire de
Michel de Salaberry, à Chambly, monument Short-Wallick (Louis-Philippe l'arrivée de la fondatrice. Q u e l q u e s
est le premier monument à être Hébert, 1891) installé devant le Manège grandes sociétés, et patticulièrement la
entièrement conçu et réalisé par un militaire à Québec rappelle le grand Société Saint-Jean-Baptiste, ont de même
Québécois (1.-P.Hébert, 1881). incendie du quartier Saint-Sauveur, été à la source d'un grand nombre de pro-
Photo: Ville de Chambly survenu en 1889. jets. Plusieurs initiatives privées sont éga-
lement à souligner, notamment celle de
DES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES Norbert Brouillet, un mécène originaire
Le mode de financement le plus répandu de Chambly qui a assumé les coûts du
pour les monuments était la souscription m o n u m e n t à l'abbé Pierre-Marie
populaire. Dans certains cas, des campa- Mignault (Louis-Philippe Hébert, 1909).
gnes de levées de fonds se sont échelon- La communauté italienne de Montréal a
nées sur plusieurs années. Au chapitre de donné le monument à Dante (Balboni,
la commandite, les diverses instances 1922) à la métropole canadienne tandis
gouvernementales ont également joué un que la Marianne (Paul Chevré, 1913) du
rôle de premier plan. Par exemple, c'est square Viger a été offerte aux Montréalais
le gouvernement du Canada qui, par le par la République française.
C numéro qutirrr-vingr-deux D o s s e rLE CHOIX DU CANDIDAT
ET LA COMMANDE
Par le biais des journaux et d e circulaires,
un appel aux sculpteurs québécois, cana-
diens et étrangers était lancé, selon qu'il
s'agissait d ' u n c o n c o u r s local, n a t i o n a l
ou international. Des quelque 150 monu-
ments commémoratifs réalisés entre 1880
e t 1930, p l u s d ' u n e c e n t a i n e o n t é t é
commandés à des sculpteurs d'ici. Louis-
Philippe Hébert en a réalisé 25 à lui seul.
V i e n n e n t e n s u i t e Alfred L a l i b e r t é avec
u n e vingtaine, George William Hill, u n e
quinzaine, Henri Hébert, une dizaine et,
plus près de nous, Emile Brunet avec une
quinzaine également. Les artistes étrangers
ayant obtenu des commandes étaient prin-
cipalement de nationalité française, belge
ou anglaise.
Les concours étaient alléchants pour les
artistes r é p u t é s c o m m e p o u r les m o i n s
connus. Décrocher un contrat assurait en
effet une aisance financière et la renom-
mée à ceux qui ne la possédaient pas déjà.
À titre indicatif, L o u i s - P h i l i p p e H é b e r t
a obtenu l'importante somme de 25 000$
p o u r la r é a l i s a t i o n d u m o n u m e n t à
Madeleine de Verchères. Certains
concours ont attire plus d ' u n e vingtaine
d'artistes. Selon qu'il s'agissait d'une com-
m a n d e p u b l i q u e ou privée, le jury était
composé de politiciens, de fonctionnaires, et Hill. Le comité arrêta son choix sur la En 1908, lors du dévoilement du monument
d'ingénieurs, d'architectes, d'hommes p r o p o s i t i o n du d e r n i e r . C e t t e d é c i s i o n à M»' de Laval (L.-P. Hébert, 1908) face à
d'affaires, d e m e m b r e s du clergé et d e déclencha toute une polémique avec pour l'évêché de Québec, une foule considérable
gens de professions libérales. Va sans dire toile de fond les origines ethniques des fina- s'était massée pour assister à /'événement.
q u e ces p e r s o n n e s n ' a v a i e n t pas forcé- listes. Laliberté, en conférence de presse, Photo : J.-E. Livernois, Fonds Livernois,
m e n t u n e g r a n d e c o n n a i s s a n c e d a n s le alla jusqu'à accuser publiquement le pré- ANQQ
d o m a i n e d e l'art. À l'occasion, le comité sident du comité de pratique déloyale.
d e m a n d a i t la c o l l a b o r a t i o n d ' u n artiste Les diverses étapes de création du monu-
accompli, la plupart du temps un peintre. ment étaient soumises à l'approbation du
Napoléon Bourassa, Charles Huot et comité et, dans certains cas, cautionnées
Charles Gill ont joué ce rôle. La présélec- par des s c u l p t e u r s étrangers r e n o m m é s .
tion et le choix du gagnant trouvaient un Ainsi, Louis-Philippe Hébert dut présen-
écho dans les journaux. ter au comité du m o n u m e n t à M" de Laval
À quelques reprises, le choix final du jury (1908), à Québec, des lettres d'approbation
a suscité chez des participants des réac- des s c u l p t e u r s français Horace Daillion,
tions très vives et fait les choux gras de la L é o n Fagel et Victor Ségoffin. P o u r le
presse. En s e p t e m b r e 1912, le concours m o n u m e n t à Paul C h o m e d e y de
p o u r le p l u s i m p o r t a n t m o n u m e n t d e Maisonneuve de Montréal, H é b e r t dut
M o n t r é a l , c e l u i d é d i é à Sir G e o r g e s - m o d i f i e r sa m a q u e t t e à au m o i n s trois
E t i e n n e C a r t i e r , t o u r n a au v i n a i g r e . reprises. Ces opérations transformèrent de
Louis-Philippe Hébert, Alfred Laliberté, façon appréciable le projet initial qui lui
G e o r g e William Hill, C œ u r - d e - L i o n avait permis d'obtenir la commande.
MacCarthy, Olindo Gratton, Emile L'étape suivante consistait à reproduire la
B r u n e t , O n é s i m e L é g e t et un c e r t a i n composition de l'artiste dans le bronze, le
Kilton ont p r é s e n t é des m a q u e t t e s . L e s marbre ou le granit, les principaux maté-
quatre premiers furent retenus en présé- riaux de l'époque. La plupart des bronzes
lection. Ensuite, les m a q u e t t e s d ' H é b e r t de la période 1880-1930 ont été fondus en
et d e MacCarthy ayant été éliminées, le France et en Belgique où se trouvaient les
choix final devait se faire entre Laliberté plus importantes fonderies d'art.
D o s s e r numéro qu(itrr-vin0-(lfu\ 2L ' A m é r i q u e du Nord c o m p t a i t peu C e r t a i n e s statues s u t m o n t e n t des cons-
d'entreprises de ce genre. Louis-Philippe tructions architecturales servant de fon-
Hébert fit affaire avec la maison parisienne taines, c o m m e le m o n u m e n t à J a c q u e s
Thiébault Frères pour le monument Mai- Cartier (Arthur Vincent, 1893) du quartiet
s o n n e u v e . Alfred L a l i b e r t é c o m m a n d a Saint-Henri à Montréal. D'autres monu-
pour sa part la fonte de son m o n u m e n t à m e n t s sont tout s i m p l e m e n t des copies
Dollard des Ormeaux (1920) à la Roman d'œuvres célèbres, comme la fontaine de
Bronze Works de N e w York. La fonderie la S u n L i f e ( H i l l , 1897) du s q u a r e
m o n t r é a l a i s e d e L.-J. H é r a r d réalisa le Dominion à Montréal qui reprend le Lion
tout premier bronze coulé au Q u é b e c , soit de Belfort du grand s c u l p t e u r français
la statue du m o n u m e n t à l'abbé Antoine Frédéric-Auguste Bartholdi. D a n s q u e l -
Girouard (François Van L u p p e n , 1878) q u e s cas, u n e r é p l i q u e d ' u n m o n u m e n t
i n s t a l l é e d e v a n t le c o l l è g e d e S a i n t - situé dans une ville e u r o p é e n n e ornera un
Hyacinthe. L e premier m o n u m e n t com- lieu p u b l i c d e la p r o v i n c e . L e J a c q u e s
mémoratif e n t i è r e m e n t conçu et réalisé C a r t i e r ( G e o r g e s B a r e a u , 1926) d e
par un Q u é b é c o i s e s t le m o n u m e n t à Q u é b e c est i d e n t i q u e à celui de Saint-
Michel de Salaberry (Louis-Philippe Malo, tandis q u e le Montcalm (Leopold
H é b e r t , 1881) de C h a m b l y , é g a l e m e n t M o r i c e , 1911) s i t u é p t è s d e s P l a i n e s
fondu par Hérard. Pour tailler dans le gta- d'Abraham est une copie de la statue éri-
nit son m o n u m e n t Mignault, Hébert opta gée à Vauvert en France.
pour un artisan de la St. Lawrence Marble L e p i é d e s t a l , un é l é m e n t i m p o r t a n t du
and Granite Works de Montréal, propriété m o n u m e n t , p r é s e n t e parfois t o u t e s les
de Joseph-Georges Picher, un de ses col- qualités d'une véritable œuvre d'art. Fait
laborateurs réguliers. La statue du monu- d e g r a n i t , d e m a r b r e ou d e c i m e n t , il
m e n t à l ' a b b é J o s e p h - M a t h u r i n Bourg adopte une grande variété de formes.
(1922) à Carleton a été sculptée dans du D a n s plusieurs cas, il a é t é d e s s i n é par
marbre de Carrare à l'atelier italien de la des architectes qui ont travaillé en étroite
compagnie Daprato de Montréal. collaboration avec les sculpteurs. En plus
du piédestal, la commande prévoyait par-
L'UNIVERS DES FORMES fois la conception et l ' a m é n a g e m e n t du
Les monuments empruntaient à un registre s i t e d e v a n t t e c e v o i r le m o n u m e n t .
de formes s o m m e t o u t e assez restreint. L ' a r c h i t e c t e français G u s t a v e U m b d e n -
N o m b r e u x étaient les bustes installés sur stock a dessiné pour Louis-Philippe
des piédestaux. U n e statue, très souvent H é b e r t les p i é d e s t a u x d e s m o n u m e n t s
plus gtande que nature et montée sur un M " de Laval et E d o u a r d VII (1914) du
piédestal, d e m e u r a i t toutefois la norme. square Philips à Montréal, en plus d'amé-
On trouve ce genre de compositions dans nager leur e n v i r o n n e m e n t immédiat. L e
p r e s q u e t o u t e s les régions du Q u é b e c . Montréalais William Sutherland Maxwell
Selon les désirs du commanditaire, l'artiste a créé, toujours pour Hébert, le piédestal
pouvait complexifier son œuvre en y ajou- et la fontaine du m o n u m e n t à John Young
tant des reliefs et, dans quelques cas, des (1911) du Vieux-Port de Monttéal. Pour
groupes allégoriques. À Montréal, le monu- son compatriote André Vermare, l'archi-
Le marquis de Montcalm, héros t o m b é lors ment à M" Ignace Bourget (Louis-Philippe tecte français Maxime Roisin a conçu le
de la bataille des plaines d'Abraham, Hébert, 1903) compte, en plus de la statue, socle du m o n u m e n t au cardinal Elzéar-
est immortalisé sur la façade du Parlement deux groupes allégoriques représentant la Alexandre Taschereau (1923) de Q u é b e c .
par Louis-Philippe Hébert. Charité et la Religion ainsi que deux bas- Les p i é d e s t a u x q u e l'on retrouve sur le
Photo: Michel Élie, CCQ reliefs illustrant des moments significatifs territoire québécois ont p r a t i q u e m e n t
de la vie du prélat. tous été taillés ici par des artisans spéciali-
Les statues équestres sont des sculptures sés en sculpture funétaire. Les matériaux
impressionnantes à cause principalement provenaient, dans la plupart des cas, de
des proportions de l'animal qui y est repré- carrières s i t u é e s d a n s les C a n t o n s -
senté. L e Q u é b e c en c o m p t e q u e l q u e s - de-l'Est.
unes, dont deux représentations de sainte La grande majorité des monuments conçus
J e a n n e d'Arc situées à Sillery (Jules e n t r e 1880 et 1930 e m p r u n t e n t au style
Dechin, 1931) et dans la Capitale (Anna académique à l'européenne très en vogue
H y a t t H u n t i n g t o n , 1938). La p r e m i è r e tout au long du XIX e siècle. Entourés de
s t a t u e é q u e s t r e d e la p r o v i n c e e s t le leurs attributs de gloire, les personnages
m o n u m e n t aux H é r o s de la g u e r r e des posent habituellement en héros, adoptant
Boers, u n e œ u v r e d e Hill i n a u g u r é e à des attitudes solennelles. Hébert, Laliberté
Montréal en 1907. et Hill ont étudié à Paris, l'Olympe de tous
2 numéro quatre-vtn^r-rtrux D o s s i e rles grands courants artistiques. Au début sont redevenues favorables, la conception
du XXe siècle, les artistes européens de l'art commémoratif avait changé. À par-
embrassent de nouvelles tendances, mais tir des années 1940, des artistes comme
ici le renouvellement s'effectue timide- Emile Brunet, Sylvia Daoust et Raoul
ment. Un Henri Hébert, pourtant sensible H u n t e t recherchent une plus gtande
aux styles en vogue - son monument aux authenticité et adoptent des formes sim-
Morts (1925) d'Outremont est du plus pur plifiées, empreintes de modernisme. La
Art déco - , exécutera une statue tout ce sculpture contemporaine prend la relève
qu'il y a de plus académique pour le mo- du monument traditionnel avec l'intégra-
nument à Sir Louis-Hippolyte Lafontaine tion de l'art à l'architecture.
(19.^0) situé dans le parc du même nom à En parallèle, un long calvaire commence >ri-
Monttéal. pour tout ce qui rappelle le passé religieux
et patriotique. Certains monuments dispa-
LE MONUMENT raissent, tel le Laviolette (1885) d'Hébett
DANS SON ENVIRONNEMENT qui avait échappé en 1908 au grand incen-
La destination du monument faisait l'ob- die de Trois-Rivières, mais qui sera tout
jet d'une attention particulière. Compte de même démoli en 1919. Quelques-uns
tenu de leur position stratégique dans sont remplacés en raison de la fragilité de
la ville, les parcs urbains et les places leur matériau. Le Pierre Le Moyne d'Iber-
publiques se sont avérés des lieux de pré- ville du square du même nom à Montréal
dilection pour rendre hommage aux héros. est une copie récente (1983) de celui
Maintes esplanades d'édifices publics (1898) d'Atthur Vincent qui, gravement
à vocation institutionnelle ou religieuse détérioré, a été retiré au cours des années
ont reçu des statues. Le lieu de naissance 1950. D'autres connaissent les affres du
ou de résidence d'un grand personnage vandalisme comme le monument à
est un autre endroit des plus appropriés Victoria (1897) dans le parc du même nom
pour l'érection d'un monument. Un buste à Québec. De cette œuvre du sculpteur
de Sir Georges-Etienne Cattier (Hill, 1919) anglais Marshall Wood ne subsiste plus
se dresse à Saint-Antoine-sur-Richelieu, aujourd'hui que q u e l q u e s fragments
son lieu de naissance ; celui de Pierre de exposés au Musée de la civilisation à
Saint-Ours (Elzéar Soucy, 1922) orne la Québec. La douteuse transformation qu'a Le monument en hommage à Frontenac,
devanture du manoir seigneurial dans subie le monument à Jacques de Lesseps une oeuvre de Louis-Philippe Hébert,
le village de Saint-Ours. Des monuments (1932) d'Henri Hébert laisse perplexes les est l'un des 22 bronzes qui ornent la façade
ont aussi été érigés sur les lieux d'une spécialistes de la question. Et que dire du Parlement de Québec.
bataille, tel celui installé à Carillon, site du déplacement, durant les années 1970, Photo : Michel Élie, CCQ
présumé de l'affrontement, en 1660, entre du monument à Octave Crémazie (1906)
Dollard et les Iroquois. de Louis-Philippe Hébert. Autrefois situé
Les grandes fêtes nationales comme la au carré Saint-Louis à Montréal, il a été, puisque le Musée des beaux-arts de
Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada ou pour des raisons obscures, déménagé sur Montréal a présenté, en 1990, une exposi-
la Fête des travailleurs, offraient le contexte un tetre-plein au carrefour de la rue tion sur Alfred Laliberté. En association
idéal pour les inaugurations. Dans des Crémazie et du boulevard Saint-Laurent avec cette même institution, le Musée du
mises en scène souvent grandioses avec comme arrière-scène le boulevard Québec est à préparer une grande rétros-
et devant d'importants rassemblements Métropolitain. D'auttes ont connu le pur- pective de l'œuvre de Louis-Philippe
- 100 000 personnes au dévoilement du gatoire pour des raisons politiques. Citons Hébert. L'exposition, qui sera présentée
monument à M" de Laval -, les dirigeants le cas de la statue de Maurice Duplessis en 2001, soulignera l'apport exceptionnel
politiques et ecclésiastiques prononçaient réalisée au début des années 1960 pat le du sculpteur à l'art commémoratif au
force discours célébrant les vertus des sculpteut Emile Brunet, mais installée Québec. A l'automne de l'an 2000, le
héros immortalisés. En 1895, en l'espace seulement à la fin des années 1970 sur la musée national aura offert aux Québécois
d ' u n e semaine, trois monuments de colline Parlementaire à Québec. une exposition sur Henri Hébert, le fils
Louis-Philippe Hébert ont été inaugurés Au début des années 1980, les différentes de Louis-Philippe.
dans autant de villes: le 24 juin, la statue administrations gouvernementales, les
de Lévis à l'Hôtel du Patlement de villes de Montréal et de Québec mesu- Daniel Drouin est historien de l'art et chargé
Québec et, le 1" juillet, les monuments raient l'importance de sauvegarder le de projet pour l'exposition Louis-Philippe
Maisonneuve à Montréal et John A. patrimoine sculpté. D'autres organismes Hébert au Musée du Québec.
Macdonald à Ottawa. ont aussi voulu poursuivre une certaine
tradition commemorative en l'actualisant.
JE ME SOUVIENS... ENCORE La Commission de la capitale nationale,
notamment, inaugurait récemment la sta-
La Crise de 1929 a mis un sérieux frein au
tue de René L é v e s q u e . Les grands
processus de commémoration au Québec.
musées québécois ne sont pas en reste
Aussi, lorsque les conditions économiques
D o s s e r numéro quatre-vingt-deux wVous pouvez aussi lire