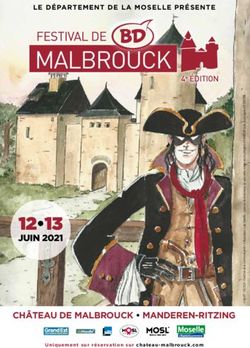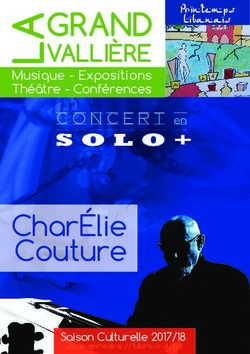La traduction à l'époque de sa reproductibilité technique Ou L'im-possible dissonance interculturelle
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
RENÉ LEMIEUX – LA TRADUCTION À L’ÉPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE 19
La traduction à l’époque de sa reproductibilité technique
Ou L’im–possible dissonance interculturelle
René LEMIEUX
Programme de doctorat en sémiologie, Faculté des arts
Université du Québec à Montréal
RÉSUMÉ
Le débat traductologique se reconnaît, souvent inconsciemment, dans une économie du langage où les
termes en cause – équivalence, manque ou surplus – pourraient se résumer à une théorie des poids et
mesures. Si le débat semble être le fondement du questionnement traductologique, il n’est toutefois pas
certain que la formalisation de la conception strictement communicationnelle de la traduction chez
Roman Jakobson et le développement subséquent de la traduction assistée par ordinateur laissent le
débat indemne. Du point de vue d’une économie du langage, la question qui se pose est alors : que
peuvent apporter les traducteurs « humains » de plus que la machine ? À partir d’une conceptualisation
« théologico-sémiotique » des oppositions à l’œuvre dans le discours traductologique (d’abord son
interprétation juive et chrétienne de la Loi, puis ses versions catholique et protestante), l’article voudra
repenser la question d’une im–possibilité du « retour » comme source de l’alternative entre l’assonance
ou la dissonance entre les cultures.
MOTS-CLÉS
Sémiologie ; traductologie ; Jacques Derrida ; traduction assistée par ordinateur
1. INTRODUCTION : (DIS)SONANCES DU MONDE
Qu’est-ce que la dissonance dans notre monde ? Comment l’identifier ? Est-elle, en soi,
problématique ? Je vais tenter de répondre à ces questions à partir d’une réflexion sur la traductologie
comme discipline de la traduction, et sur certains de ses concepts, et ce, à partir de deux problèmes
contemporains. Ces deux problèmes sont liés à l’informatique, aux technologies de l’information, aux
programmes et aux grammes, aux calculs et à une économie du discours fondée sur l’équivalence, bref,
à une théorie des poids et mesures qu’on jugerait suffisante pour penser le langage1.
La traductologie contemporaine reconnaît ce problème et la question tourne très souvent autour
de l’« équivalence », notion qui permet de penser la transposition la plus fidèle du « sens » du texte
original. Une grande partie de sa réflexion a pourtant voulu penser l’autre de l’équivalence, la
possibilité d’une traduction qui ne s’envisage pas seulement en termes d’égalité ou d’identité2. Je pense
1
Sur cette question des poids et mesures, je me base partiellement sur les réflexions de Derrida (1967). On
pourra lire, sur la question de la cybernétique qui parcourra ce texte, particulièrement le premier chapitre (1967 :
15-41).
2
On pourra lire à ce sujet Pym (2009), un court texte qui synthétise bien la balance entre les paradigmes de
l’équivalence et de sa critique.20
que, de cette autre tradition, il est possible de percevoir une volonté, pour le traducteur, de dissoner
dans le monde, et c’est cette volonté qu’il s’agira ici d’expliciter. Je me propose d’abord d’expliquer
ces deux problèmes pour ensuite les considérer conjointement sous une forme aporétique. Pour ce faire,
je tenterai de conceptualiser deux distinctions qui pourront valoir d’idéaux-types pour penser les
théories de la traduction. Cette conceptualisation, je la tiens de la persistance du schème théologique
judéo-chrétien dans la pensée du langage en Occident, aujourd’hui « mondialatinisé »3.
2. PERMANENCE DU THÉOLOGICO-SÉMIOTIQUE ?
Le premier problème que je voudrais exposer est celui qu’un peu tout le monde a expérimenté avec ce
qu’on nomme les traducteurs automatiques (par exemple « Google translate ») et m’a été donné à
penser par une lecture récente : un entretien avec une traductrice professionnelle, publié sur un blogue,
révélateur, je crois, d’une certaine conception idéologique de la traduction (Vaufrey, 2012). Cette
traductrice répondait à une question sur l’apport irremplaçable du traducteur humain dans l’industrie de
la traduction : « Dans un texte, un traducteur automatique voit des mots ; un traducteur humain voit du
sens. » Il y a au moins deux sous-entendus dans cet énoncé : 1) le traducteur humain diffère en nature
du traducteur automatique ; 2) le traducteur humain fait plus que la traduction automatique,
informatisée, il crée un surplus, et ce surplus ou ce supplément, c’est le sens. Cette idée n’est pas
unique, elle est même assez partagée dans le monde intellectuel de la traduction4. On pourrait qualifier
ce problème d’a posteriori, dans la mesure où il devient problématique lorsque la pratique de la
traduction est déjà en jeu, lorsqu’on compare la traduction automatique après (ou d’après) une
traduction dite « humaine ».
Le deuxième problème que je qualifierai d’a priori se situe dans l’enseignement de la traduction
à l’université. La traduction, considérée comme une discipline « professionnalisante », est encore
concentrée de nos jours sur le concept d’équivalence, ce qu’on nomme une « traduction pragmatique ».
Sa visée, c’est de faire en sorte que, de deux versions d’un même texte, aucune différence ne puisse
transparaître. Il y a encore peu de temps, il s’agissait de mettre en parallèle l’original et la traduction, le
modèle et la copie. Aujourd’hui, les techniques se sont considérablement améliorées avec l’apport
complémentaire de différents programmes informatiques conçus pour les traducteurs, surtout sur le
marché du travail, et spécifiquement dans le domaine de l’informatique ou des jeux vidéo, des secteurs
d’activité en pleine expansion. Le marché de l’emploi a pris tellement d’importance dans
l’enseignement de la traduction qu’il a pu fournir ce qu’Anthony Pym qualifie de nouveau paradigme
pour théoriser la traduction, notamment avec la « localisation », devenue pour l’heure une nouvelle
méthode de travail :
The term [localisation] generally refers to a work process in which a source text, perhaps a piece of
software, is stripped of its culture-specific features (thus becoming « internationalized ») and is then
translated into a number of target languages simultaneously, with each translation team inserting the
features appropriate to the specific target « locale » (whence the term « localisation ») (Pym, 2009).
3
Sur la « mondialatinisation », mot-valise où « latinisation » a été incorporé à « mondialisation », conçue
comme complexe économico-religieux, on pourra lire Derrida (2000).
4
Voir Cassin (2007a). On pourra retrouver un résumé de ses thèses sur « Google translate » dans un entretien
qu’elle a accordé à Michaël Oustinoff (Cassin, 2007b).RENÉ LEMIEUX – LA TRADUCTION À L’ÉPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE 21
Cette méthode se constitue donc en deux traductions successives : la première vise à enlever dans
l’original toutes caractéristiques culturelles tout en l’organisant sous forme d’un codage, une manière
de neutraliser le texte de départ pour qu’il soit apte à être traduit une deuxième fois, cette fois par
plusieurs traducteurs, chacun dans sa langue-cible, et ce, simultanément. On pourrait dire qu’il n’y a
plus d’original, sinon le produit de la première transformation. On pourrait rapprocher cette méthode de
la reproductibilité technique de l’œuvre d’art analysée par Walter Benjamin : l’œuvre originale, qui
n’est plus, perd son aura, et du même coup ses privilèges (Benjamin, 2005 [1955]). On ne peut plus ici
comparer une copie (le texte traduit dans sa langue d’arrivée) à un modèle (le texte original), car s’il y a
bien un « texte de départ », c’est-à-dire un texte chronologiquement antérieur, celui-ci disparaît au
profit d’un codage qui permettra la réécriture du texte dans plusieurs langues. Entre ces langues, la
comparaison, quoique ludique, ne pourra pas servir de base à une critique traductologique.
Cette industrie de la traduction influence cependant la manière d’enseigner la traduction, qui
cesse dès lors d’être une réflexion sur le langage pour devenir un rouage pour le futur marché de
l’emploi auquel les étudiants auront à s’intégrer. Pour résumer le propos jusqu’à maintenant, on
pourrait dire que le premier problème (a posteriori) posé a pour finalité d’améliorer la machine pour
qu’elle soit plus humaine et le deuxième (a priori), celle d’améliorer l’humain pour qu’il soit plus
efficace, efficient, bref, pour qu’il soit plus conforme à la machine. Pour comprendre ce mouvement
aporétique à l’œuvre, je proposerai deux dichotomies « théologico-sémiotiques »5 qui m’aideront à
comprendre ce problème du langage et de la machine. La première et la plus classique en théorie de la
traduction, se présente comme la distinction entre la traduction littérale et la traduction du sens ou,
comme je la qualifierai, entre une interprétation juive et une interprétation chrétienne de la Loi. La
deuxième se veut, au cœur de l’interprétation chrétienne, une distinction entre sa lecture catholique et
sa lecture protestante.
3. LA TRADUCTION ENTRE LA LETTRE ET LE SENS
La première dichotomie est celle entre une traduction préférant le sens et une traduction préférant la
lettre. C’est sans doute le problème originel de la traduction en Occident. Rappelons-nous tout d’abord
que la réflexion sur la traduction provient spécifiquement de la traduction des textes sacrés, mais plus
généralement de la traduction dans l’histoire, plutôt qu’entre les cultures, comme c’est le cas
aujourd’hui. Cette distinction entre le sens et la lettre a été le grand problème de saint Jérôme,
traducteur de la Vulgate entre le IVe et le Ve siècles, qui considérera, dans une de ses lettres à
Pammachius, qu’il y a deux manières de traduire : le verbum de verbo (la traduction du mot à mot,
c’est-à-dire la traduction dite littérale) ou le sensum de sensu (ou ad sententiam, la traduction dite du
sens, non pas de la lettre, mais de l’esprit). Pour saint Jérôme, le traducteur devra choisir l’une ou
l’autre selon la nature du texte original : « Oui, quant à moi, non seulement je le confesse, mais je le
5
Je ne pense pas qu’une pensée sur la traduction puisse faire l’économie d’une réflexion sur le signe, et « signe »
est une notion primairement religieuse. L’expression ici employée, qui peut sonner étrange à certaines oreilles,
se veut en quelque sorte un « pastiche » du théologico-politique chez Claude Lefort (1986), pour qui une pensée
du politique et une pensée du religieux allaient de pair. Je me contente seulement pour ma part de dégager les
similitudes d’une réflexion traductologique (dès son origine, par ailleurs, avec saint Jérôme, mais aussi jusque
dans ses grands bouleversements de la Modernité, de Martin Luther à Henri Meschonnic, en passant par Eugene
A. Nida) avec celle sur le phénomène religieux. À cet égard, puisque mes recherches sur ce point ne font que
commencer, je me contenterai de simples « idéaux-types » tirés de la tradition judéo-chrétienne.22 professe sans gêne tout haut : quand je traduis les Grecs – sauf dans les Saintes Écritures où l’ordre des mots est aussi un mystère – ce n’est pas un mot pour un mot, mais une idée pour une idée que j’exprime » (Jérôme, 1953 : 59)6. C’est bien saint Jérôme – et non pas Cicéron, autre grand penseur de la traduction dans l’Antiquité7 – qui pense cette distinction qui ne pouvait l’être qu’à partir d’une certaine conception dualiste entre la forme et le fond ou, comme on l’emploiera désormais en reprenant les mots de Saussure, entre le signifiant et le signifié. Comme l’explique Étienne Dobenesque, « Cette opposition du verbum et du sensu n’apparaît qu’au IVe siècle. C’est avant tout un produit du christianisme, dont l’arrière-fond est la théologie de la langue qui fait la sacralisation du verbum » (2007 : 3). On pourrait ajouter, comme le soulignera à plusieurs reprises Henri Meschonnic, que cette conception chrétienne du rapport entre le contenant et le contenu est la réappropriation, en traduction, du dualisme corps/esprit ou monde matériel/monde intellectuel dans le platonisme 8 . Un épisode classique des Évangiles, tel qu’il est souvent interprété, met en scène cette dualité de manière tout à fait exceptionnelle. Dans l’évangile selon saint Jean (chapitre 8, versets 1 à 11), on peut voir Jésus répondre au défi des scribes qui amenèrent une femme adultère devant lui pour qu’il la condamne selon la Loi de Moïse (c’est-à-dire selon la lettre de la Loi). Le texte dit qu’après s’être penché pour écrire des signes sur le sol, Jésus s’est relevé et a répondu : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre »9. C’est le préjugé chrétien bien connu entre la Loi – la chair, le matériel, la lettre, la littéralité, le judaïsme – et l’esprit de la Loi – la légèreté, le spirituel, la métaphore, la chrétienté, et ainsi de suite. Bref, c’est la distinction entre le Juif et le chrétien mise en scène notamment dans Le Marchand de Venise de William Shakespeare, et commentée par Jacques Derrida dans « Qu’est-ce qu’une traduction "relevante" ? » (2004 [1999] : 561-576). Le Juif Shylock dépeint par Shakespeare, véritable caricature du Juif usurier, veut le respect de la lettre du contrat qu’il a signé, c’est-à-dire – littéralement – une livre de chair, bien pesée, coupée près du cœur10. 6 Le latin dit : « Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor me in interpretatione Graecorum, absque scripturis sanctis, ubi et verburum ordo mysterium est, non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu. » 7 Saint Jérôme s’appuie bien sur l’autorité de Cicéron pour faire son commentaire, mais, comme le montre bien Dobenesque (2007 : 4), le texte canonique de Cicéron sur la traduction, De optimo genere oratorum, ne fait pas de distinction entre le mot et le sens, mais entre le mot à mot et les mots (au pluriel) dans leur ensemble : « Non pro verbo verbum necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servavi. » En français, dans la traduction de Henri Bornecque : « Je n’ai pas cru nécessaire de rendre mot pour mot ; c’est le ton et la valeur des expressions dans leur ensemble que j’ai gardé. » (Cité par Dobenesque qui suggère une autre traduction : la « force des mots » à la place de « ton et valeur ».) 8 Voir notamment Meschonnic (2007). 9 À noter l’opposition entre l’abaissement (la lourdeur) de l’écriture et la relève (la légèreté) de la prise de parole. 10 Pour résumer l’histoire rapidement, le marchand Antonio avait emprunté une somme d’argent à Shylock pour lui-même la prêter à son ami Bassanio qui désirait marier Portia. Suite à la perte de ses bateaux, Antonio qui ne peut plus rembourser le prêt à temps doit se soumettre aux conditions du contrat qui stipule que le prêteur pourra réclamer une livre de chair coupée près du cœur. Shylock refusera toute offre équivalente de paiement : « An oath, an oath, I have an oath in heaven. Shall I lay perjury upon my soul ? No, not for Venice. / Juré, juré, j’ai juré face au ciel. Dois-je charger mon âme d’un parjure ? Non, pas pour tout Venise. » Derrida expliquera que c’est par un stratagème que Portia sauvera Antonio de sa dette : contre le littéralisme de Shylock et après avoir tenté de le raisonner avec l’esprit de la Loi (et le pardon chrétien), Portia usera d’un sur-littéralisme : le contrat dit bien une livre de chair, mais en la prenant, il ne devra pas faire couler une seule goutte de sang chrétien (« no jot of blood / pas un iota de sang »), car cela constitue un crime à Venise. Shylock, seulement pour avoir proféré sa menace, sera condamné, puis gracié par le doge à condition de se convertir à la religion chrétienne. Pour une analyse plus approfondie, notamment avec la notion de « relève » chez Jacques Derrida, on pourra lire Lemieux (2009).
RENÉ LEMIEUX – LA TRADUCTION À L’ÉPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE 23
Cette distinction – entre le respect aveugle à la Loi et l’interprétation de son sens ou de son
esprit – est au cœur de la possibilité de la traduction dans le projet structuraliste, surtout chez Roman
Jakobson (et rappelons-nous qu’il participait avec Claude Lévi-Strauss aux Conférences Macy qui ont
mené au développement de la cybernétique et des ordinateurs). Dans un court texte sur la traduction,
Jakobson distingue bien évidemment le signifiant du signifié (distinction que l’on retrouve chez
Saussure), mais fera du signifié le pivot qui servira à traduire le signifiant d’une langue au signifiant
d’une autre, ce qu’on nomme parfois le tertium comparationis (Pym, 2010 : 18), et ce que Derrida
(1967 : 71 ; 1972 : 30-31) appellera le signifié transcendantal. Cette distinction appliquée à la
traduction mènera Jakobson à poser une certaine impossibilité de la traduction de la poésie :
In poetry, verbal equations become a constructive principle of the text. Syntactic and morphological
categories, roots, and affixes, phonemes and their components (distinctive features) – in short, any
constituents of the verbal code – are confronted, juxtaposed, brought into contiguous relation according
to the principle of similarity and contrast and carry their own autonomous signification. Phonemic
similarity is sensed as semantic relationship. The pun, or to use a more erudite, and perhaps more precise
term – paronomasia, reigns over poetic art, and whether its rule is absolute or limited, poetry by
definition is untranslatable (Jakobson, 1992 [1959] : 150-151).
L’intraduisibilité est la conséquence de la possibilité de la paronomase, c’est-à-dire du rapprochement
de deux mots ou de deux locutions par effet sonore, sans que le sens entre nécessairement en jeu : le
sens devient le produit résiduel de l’assonance11. Ce n’est donc pas parce que le sens du poème serait
trop dur à comprendre, mais au contraire parce que sa constitution fait en sorte que c’est le signifiant, la
lettre, la chair, la matérialité, qui l’emporte lorsqu’on le traduit.
Cette distinction entre la lettre et l’esprit – ou, pour employer les mots du structuralisme, entre
le signifiant et le signifié – est donc au cœur du problème de la traduction, et ce, même s’il n’est pas
toujours conscient chez le traducteur ou la traductrice. C’est en tout cas ce que laissait penser la
traductrice dans le blogue que j’ai cité précédemment – et je reformule : on aura toujours besoin d’un
traducteur humain, parce que lui, il peut accéder au sens ou au signifié, alors que la machine, elle, ne
s’attarde qu’au mot, au signifiant. La poésie deviendrait-elle qu’une affaire de machine ?
À bien des égards, la conception formulée par la traductrice voulant que seul l’humain accède
au sens est très exactement ce et seulement ce que la machine sait faire. Si on accepte de faire la
distinction entre mot et sens, ou entre signifiant et signifié, on doit aussi accepter ce qui vient avec cette
conception du signe, à savoir que chacune des deux faces du signe ne peut pas être pensée en termes
positifs, qu’elle doit être pensée de manière relationnelle, et que la relation entre ces deux faces est
arbitraire12. Le sens (ou signifié) en lui-même est une différence, et ce que fait la machine, c’est
exactement d’attribuer à des mots ou des syntagmes des caractéristiques différentielles qui permettront
de passer d’un signifiant A à un signifiant B par l’entremise d’un signifié unique, et ce signifié n’est
que l’ensemble des caractéristiques différentielles en jeu.
11
Jakobson donne l’exemple de la formule Traduttore, traditore qui perd sa force sonore (et donc signifiante)
dans sa traduction anglaise, « the translator is a betrayer », mais aussi dans sa traduction française, « traducteur,
traître ».
12
Voir Saussure (1982 : 100-103).24
Certes, la machine, comme Google translate, est encore imparfaite, mais elle vise une
perfectibilité humaine13. Au demeurant, les nombreuses critiques qu’on peut lire à l’encontre des
traducteurs automatiques et les exemples absurdes donnés sont souvent le produit de rumeurs et
d’exagération14. L’essentiel ici est de comprendre que la « machine » n’est pas le nom de la possibilité
ou pas de traduire une des faces du signe sans disposer de la compréhension « humaine » du sens, mais
le fait même de faire du signe un composé bifide et de préférer une de ses faces. Il s’agira, pour la suite,
de penser la possibilité de sortir de ce cadre conceptuel hérité du christianisme platonisant.
4. LA TRADUCTION ENTRE L’ÉVÉNEMENT ET LA MACHINE
Le deuxième problème que j’ai souligné plus haut pourrait se résumer ainsi : la machine est, peut-être
inconsciemment, le modèle du traducteur dans le domaine de l’enseignement de la traduction. On
pourrait développer un deuxième concept « théologico-sémiotique » pour répondre à ce problème, et
ce, à partir de Jacques Derrida : la distinction entre l’événement et la machine. Cette distinction
parcourt l’œuvre de Derrida, mais je n’utiliserai ici qu’un seul texte, « L’avant-dernier mot : archives
de l’aveu », publié dans Papier Machine en 200115. Même si dans ce texte Derrida ne parle pas
spécifiquement de traduction et qu’il s’intéresse plutôt à la confession chez saint Augustin et Jean-
Jacques Rousseau, il est possible de penser, je crois, la distinction qu’il fait dans les premières pages
entre l’événement et la machine, par rapport à la traduction. Au premier, il attribue le sensible,
l’æsthésique, l’organique : « Pourquoi organique ? Parce qu’il n’est pas de pensée de l’événement,
semble-t-il, sans une sensibilité, sans un affect esthétique et quelque présomption d’organicité vivante »
(Derrida, 2001 : 35). On attribuera donc à la machine vouée à la répétition le contraire :
elle serait destinée à reproduire impassiblement, insensiblement, sans organe ni organicité, l’ordre reçu.
En état d’anesthésie, elle obéirait ou commanderait sans affect ni auto-affection, en automate indifférent, à
un programme calculable. Son fonctionnement, sinon sa production n’aurait besoin de personne. Puis il est
difficile de concevoir un dispositif purement machinal sans quelque matière inorganique.
13
J’aborderai, ci-dessous, la perfectibilité machinique de l’enseignement de la traduction. Cette aporie à l’œuvre
m’a été suggérée par ma collègue Caroline Mangerel.
14
Pour un exemple fameux (le verset tiré de Marc 13:4, « The spirit is willing but the flesh is weak » devenant,
après une première traduction en russe et un retour en anglais « The vodka is good but the meat is rotten »), on
pourra se référer à Hutchins (1995 : 17-18). Que cet article ait été publié il y a près de vingt ans (avant l’arrivée
d’Internet) ne surprendra pas le lecteur puisque Hutchins, parti à la recherche des sources de cette rumeur,
retrouve l’exemple d’abord dans un livre datant de 1984, puis dans un autre publié en 1977, ensuite dans un
article de 1962, et encore une fois dans une conférence donnée en 1958, et finalement dans une autre conférence
datant de 1956 où un journaliste lançait à la blague que la traduction automatique [mechanical translation] serait
bientôt chose courante parce que l’état de la traduction dans la presse populaire française est déjà si pauvre
qu’une traduction donnant « the ghost wills but the meat is feeble » ne changerait rien à ce que les traducteurs
produisaient alors. Ironique de penser, donc, que l’exemple ait d’abord été conçu en fonction de l’état de la
traduction « humaine ». Dans une vidéo récemment diffusée sur la BBC (12 août 2013, avec la journaliste Lara
Lewington), intitulée « Will the web’s translation tech make us multilingual ? », un spécialiste de la traduction
informatique, Shalom Lappin, est interviewé et reprend l’exemple de la « viande pourrie ». Fait à remarquer, le
verset en question est l’exemple par excellence du dualisme platonico-chrétien, et par conséquent la métaphore
la plus riche de ce qui est en cause, à savoir que la viande, le corps, le matériel, la lettre, mais aussi l’animal et
donc la machine sont tous corruptibles.
15
Il s’agit d’abord d’une conférence prononcée à la Bibliothèque nationale de France, disponible en ligne :
.RENÉ LEMIEUX – LA TRADUCTION À L’ÉPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE 25
Disons bien inorganique. Inorganique, autrement dit non vivant, parfois mort mais toujours, en principe,
insensible et inanimé, sans désir, sans intention, sans spontanéité. L’automaticité de la machine
inorganique n’est pas la spontanéité qu’on prête au vivant organique (Derrida, 2001 : 35).
De prime abord, si on veut relier la distinction entre l’événement et la machine avec une pensée
théologique, on pourrait réfléchir à la place que prend la technologie dans nos vies, à l’action presque
magique que les dispositifs mécaniques engendrent sur nos existences et à la croyance qu’on engage
collectivement dans ces machinations. En ce sens, la technologie serait en quelque sorte une nouvelle
religion ; la machine, un nouveau Dieu.
Ce n’est pas le problème que tente de penser Derrida, qui pose la question, présente de saint
Augustin à Rousseau, de la possibilité de dire « je » grâce à la confession, et ce dans la conjonction
entre l’événement et la machine16. C’est dans les confessions comme genre littéraire que Derrida
apercevra cette distinction, exemplairement dans la confession de la conversion de Rousseau, citoyen
de Genève, au catholicisme lorsqu’il avait seize ans et qu’il relate ainsi :
Enfin, suffisamment instruit et suffisamment disposé au gré de mes maîtres, je fus mené
processionnellement à l’église métropolitaine de Saint-Jean pour y faire une abjuration solennelle, et
recevoir les accessoires du baptême, quoiqu’on ne me rebaptisât pas réellement : mais comme ce sont à
peu près les mêmes cérémonies, cela sert à persuader au peuple que les protestants ne sont pas chrétiens.
J’étois revêtu d’une certaine robe grise garnie de brandebourgs blancs, et destinée pour ces sortes
d’occasions. Deux hommes portoient, devant et derrière moi, des bassins de cuivre, sur lesquels ils
frappoient avec une clef, et où chacun mettoit son aumône au gré de sa dévotion ou de l’intérêt qu’il
prenoit au nouveau converti. Enfin rien du faste catholique ne fut omis pour rendre la solennité plus
édifiante pour le public, et plus humiliante pour moi. Il n’y eut que l’habit blanc qui m’eût été fort utile, et
qu’on ne me donna pas comme au Maure, attendu que je n’avois pas l’honneur d’être Juif (Rousseau,
1865 [1782] : 48).
Derrida remarque que pour Rousseau, la conversion – ou l’abjuration, pour reprendre le terme de
Rousseau – est d’abord mécanique, car, trop jeune pour avoir véritablement conscience de son acte,
Rousseau abjure « sans avoir l’intention d’abjurer » (Derrida, 2001 : 55), il se convertit mécaniquement
à une religion mécanique. Rousseau avait lui-même distingué le protestantisme et le catholicisme de
cette manière, « la doctrine des uns exige la discussion, celle des autres la soumission », et nul besoin
d’aller chercher un critique du catholicisme pour découvrir cette distinction, car des penseurs
catholiques eux-mêmes s’en sont chargés. Je pense notamment à Blaise Pascal, inventeur de la
« pascaline », la première calculatrice, qui termine la célèbre pensée sur le pari (concept qui ne va pas
lui non plus sans un certain calcul) par ce dialogue avec un libertin désirant se convertir :
16
Je n’entrerai pas spécifiquement dans ce problème auquel, au demeurant, Derrida ne répond pas directement. Il
laisse plutôt la question ouverte : « Pourrons-nous un jour, et d’un seul mouvement, ajointer une pensée de
l’événement avec la pensée de la machine ? Pourrons-nous penser, ce qui s’appelle penser, d’un seul et même
coup et ce qui arrive (on nomme cela un événement), et, d’autre part, la programmation calculable d’une
répétition automatique (on nomme cela une machine) ? Il faudrait alors dans l’avenir (mais il n’y aura d’avenir
qu’à cette condition), penser et l’événement et la machine comme deux concepts compatibles, voire
indissociables » (Derrida, 2001 : 34).26
— Oui ; mais j’ai les mains liées et la bouche muette ; on me force à parier, et je ne suis pas en liberté ; on
ne me relâche pas, et je suis fait d’une telle sorte que je ne puis croire. Que voulez-vous donc que je
fasse ?
— Il est vrai. Mais apprenez au moins votre impuissance à croire, puisque la raison vous y porte, et que
néanmoins vous ne le pouvez. Travaillez donc, non pas à vous convaincre par l’augmentation des preuves
de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Vous voulez aller à la foi, et vous n’en savez pas le
chemin ; vous voulez vous guérir de l’infidélité, et vous en demandez le remède : apprenez de ceux qui
ont été liés comme vous, et qui parient maintenant tout leur bien ; ce sont gens qui savent ce chemin que
vous voudriez suivre, et guéris d’un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par où ils ont
commencé : c’est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des
messes, etc. Naturellement même cela vous fait croire et vous abêtira.
— Mais c’est ce que je crains.
— Et pourquoi ? qu’avez-vous à perdre ? (Pascal, 1976 [1669] : 116)
Le catholique fait comme si, machinalement. Rousseau se convertissant au catholicisme sans trop y
croire agissait ainsi comme un catholique. Il n’y a pas de contenu à la croyance : la croyance, c’est agir
comme un croyant. Cela donne à Derrida une série de caractères pour distinguer le catholicisme et le
protestantisme :
Ne peut-on dire que le catholicisme est moins intérieur, plus ritualiste, plus machinal, machiniste,
mécaniste, et donc plus littéraliste ? Le protestantisme, que Rousseau abjure, serait au contraire plus libre,
plus intentionnaliste, plus décisionniste, moins mécaniste, moins littéraliste, et donc plus spirituel,
spiritualiste (2001 : 55).
Je rappelle le deuxième problème posé avec la traduction aujourd’hui : l’industrie de la traduction
demande au traducteur d’agir en machine. Une de ses dernières méthodes, la localisation, vise d’abord
à éliminer entièrement ce qui pourrait se donner, dans le texte original, comme un particularisme
culturel, et ce dans le but de l’élever dans une universalité neutre, débarrassée, paradoxalement, de son
originalité. Cette première étape, l’« internationalisation », ne donne pas le contenu profond d’un
message, mais son code compris comme structure simplifiée, servant désormais de pivot entre les
langues. Ce n’est que par la suite que cette structure prendra sur elle ce qui pourra se lire comme une
« localisation », c’est-à-dire la particularisation du message selon la culture du public-cible. N’obtient-
on pas là l’esprit qui animait Vatican II ? On avait déjà l’universalisation du message ecclésiastique
avec une langue qui n’avait rien d’original (au sens où le latin n’est pas une « langue originale » des
Saintes Écritures), mais qui, culturellement, servira à relocaliser la Bonne Nouvelle selon les langues
nationales des fidèles17.
L’enseignement de la traduction aujourd’hui est-il, fondamentalement, catholique ? Qu’on y
enseigne la traduction juridique, la traduction médicale ou la traduction commerciale, aucun étudiant
suivant ce programme (donc ce qui participe du mécanique et de la machine, ce qui est prévisible ou
calculable : programmé) ne peut légitimement prétendre être avocat, médecin ou banquier. En
traduction, on n’enseigne pas un contenu intellectuel (un savoir), mais le fonctionnement ou le
17
Sur cette question, on pourra se référer à la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium (Vatican II, 1963)
sur la sainte liturgie, promulguée le 4 décembre 1963. À titre purement anecdotique, il est intéressant de
constater que, dans ce texte, le terme français « traduction » se dit en latin conversio (en parlant du processus,
cf. §36) et versio (pour le produit, cf. §101). Le latin est vraiment pensé comme le pivot à partir duquel tournent
(premier sens du converso latin) les différentes « versions ».RENÉ LEMIEUX – LA TRADUCTION À L’ÉPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE 27
mécanisme du savoir des autres. Bref, le traducteur fait comme s’il savait, et l’injonction implicite de
son travail, c’est de rendre son produit le plus mobile possible. Ce qui pouvait se comprendre depuis
toujours de la traduction comme secondarité textuelle contingente de l’original devient, avec le
paradigme de la localisation, l’essence enfin révélée de sa non-essentialité. La traduction à l’époque de
sa reproductibilité technique, c’est l’impossibilité de toute dissonance entre les cultures.
5. CONCLUSION : CE QUI (NE) FAIT (PAS) RETOUR
J’ai voulu tenter l’expérience de penser le rapport homme-machine en traductologie avec la notion de
dissonance, et ce, à partir de deux distinctions « théologico-sémiotiques ». De prime abord, le thème de
la machine – qui se trouve au cœur de la cybernétique, mais qu’on retrouve déjà, historiquement, de la
µηχανή grecque à l’animalité chez Descartes – pourrait se penser en dehors de l’humanité, comprise ici
dans toutes ses vertus pacificatrices et consensuelles, quelque chose comme une bonne entente entre les
nations. C’est plutôt la machine qui prend sur elle cet idéal cosmopolite. D’abord parce que la µηχανή,
comme machine de théâtre et machine de guerre, est ce qui, chez l’homme, participe à la fois du
politique et de l’esthétique dans son rapport à l’autre. Ensuite parce que l’animal-machine cartésien,
compris comme un automate fait de muscles, de veines et de nerfs, animé mais sans âme, montre la
doublure temporelle entre l’antériorité de l’homme (l’animal) et sa descendance technique
(l’informatique). Or, il y a toujours de la machine dans l’humain.
Les deux distinctions théologico-sémiotiques au cœur de la pensée traductologique nous
permettent de penser l’évolution du rapport à la machine. Si l’opposition classique entre la lettre et
l’esprit, elle-même descendante d’un préjugé chrétien envers le judaïsme, permet de répondre à
l’illusion d’une séparation radicale entre le « traducteur humain » et le « traducteur automatique »,
peut-on alors dire qu’une nouvelle opposition entre une pensée mécanique (catholique) et une pensée
spirituelle (protestante) est nécessaire ? Cette nouvelle distinction ne reprend-elle pas finalement
l’ancienne distinction ? Quand Jacques Derrida soulève la dualité événement-machine, il pose la
possibilité, dans l’à-venir, d’en penser la conjonction, à savoir ce qui serait à la fois un événement et
une machine, à la fois organique et inorganique, je me permets d’y revenir avec une nouvelle citation :
Si un jour, en un seul et même concept, on pensait ensemble ces deux concepts incompatibles,
l’événement et la machine, on peut parier qu’alors on n’aura pas seulement (je dis bien non seulement)
produit une nouvelle logique, une forme conceptuelle inouïe. En vérité, sur le fond et à l’horizon de nos
possibilités actuelles, cette nouvelle figure se mettrait à ressembler à un monstre. Mais peut-on ressembler
à un monstre ? Non, bien sûr, la ressemblance et la monstruosité s’excluent. Il nous faut donc déjà corriger
cette formulation : la nouvelle figure d’un événement-machine ne serait même plus une figure. Elle ne
ressemblerait pas, elle ne ressemblerait à rien, pas même à ce que nous appelons encore familièrement un
monstre. Mais cela serait donc, par cette nouveauté même, un événement, le seul et le premier événement
possible, car im–possible. C’est pourquoi je me suis risqué à dire que cette pensée ne pouvait
qu’appartenir à l’avenir – et même rendre l’avenir possible. Un événement n’advient que si son irruption
interrompt le cours du possible et, comme l’impossible même, surprend toute prévisibilité. Mais un tel
super-monstre événementiel serait, cette fois, pour la première fois, aussi produit par de la machine
(Derrida, 2001 : 35-36).
La possibilité du « monstre » ou « super-monstre » à la fois organique et inorganique ne fait l’objet
d’aucun retour dans ce texte. Comme pour plusieurs textes de Derrida, il semble lancer des tangentes
que le lecteur pourra reprendre à son tour. La discussion sur la confession, chez saint Augustin puis
chez Rousseau, pourrait-elle fournir une possible mise en scène textuelle de la monstruosité ? C’est en28
tout cas ce que je voudrais suggérer, par-delà le texte derridien, plus précisément avec Rousseau et la
transformation de la confession dans la Modernité. Il y a quelque chose de monstrueux dans le texte
rousseauiste, ce « je » qui parle à la fois relève de l’organique, de la vie et du nouveau, mais aussi de
l’inorganique, de la mort et de la répétition. Je rappelle que Rousseau, d’abord protestant, se convertit
au catholicisme, mécaniquement, à seize ans, et qu’il se reconvertira par la suite au protestantisme. Or,
premier paradoxe de la confession rousseauiste comme genre textuel, cet acte de parole est d’abord, et
typiquement, catholique, « car la confession en tête à tête et le protestantisme s’excluent » : c’est donc
dire qu’une certaine critique du catholicisme mécanique (par Rousseau reconverti au protestantisme)
est rendue possible par ce qui est le plus essentiel à son mécanisme, la confession elle-même.
Le deuxième paradoxe de cette confession est la reconversion de Rousseau au protestantisme,
puisqu’il argumentera, dans la Profession de foi du Vicaire savoyard, qu’il est toujours préférable de
garder sa religion d’origine :
Vous sentirez que, dans l’incertitude où nous sommes, c’est une inexcusable présomption de professer une
autre religion que celle où l’on est né, et une fausseté de ne pas pratiquer sincèrement celle que l’on
professe. Si l’on s’égare, on s’ôte une grande excuse au tribunal du souverain juge. Ne pardonnera-t-il pas
plutôt l’erreur où l’on fut nourri, que celle qu’on osa choisir soi-même ? (Cité dans Derrida, 2001 : 57)18
Vaut mieux, dans l’incertitude, hériter de l’erreur que de la commettre volontairement. Et c’est un
doublement converti – ou un reconverti – qui parle, qui, d’un point de vue, est revenu sur sa décision,
est retourné à sa profession originale, mais en même temps fait deux fois la même erreur ! Le
protestantisme – d’abord involontaire, puis volontaire – est préférable pour Rousseau parce qu’il s’y
trouvait, par sa naissance, automatiquement, donc machinalement. Il s’agit bien d’un deuxième
paradoxe, car, encore une fois, la distinction entre le catholicisme et le protestantisme n’est plus claire
du tout.
Cette anecdote de la conversion et de la reconversion de Rousseau peut devenir la métaphore
exemplaire de l’état de la question traductologique qui anime ce court texte depuis le début, car ce qui
distingue un désir machinal d’un désir humaniste dans la traduction, c’est la possibilité ou pas à la fois
du retour et de la répétition. Implicitement, l’idéal machinique d’une traduction, c’est qu’un message
puisse passer d’une langue à une autre, puis de cette deuxième langue à la première avec exactement la
même forme19. C’est bien sûr un idéal, qu’on nomme « équivalence », mais c’est celui qui soutient la
possibilité du régime juridique canadien qui veut qu’aucune des deux versions d’une même loi,
anglophone ou francophone, n’ait préséance sur l’autre. C’est contre cet idéal d’une neutralité
assonante que se constitue une bonne partie de la pensée traductologique après les théories de
18
Ce court extrait est interprété par Derrida (2001 : 57) comme un certain pari, pas très loin de celui énoncé
autrefois par Pascal.
19
Il faut se rappeler de la bonne vodka et de la viande pourrie : on désire que, en retour, le message christique
soit le même. L’utilisation, dans cette rumeur, de la langue russe n’est pas non plus anodine, comme le rappelle
Hutchins (1995), car son origine se trouve au cœur de la Guerre froide où l’espoir de la paix passait par une
intercompréhension nouvelle entre les Américains et les Soviétiques. Derrida, avec un peu d’humour, tentera de
le penser avec la chanson « Back in the USSR » des Beatles (chanson de 1968) jouant sur la quasi-homonymie
entre US et USSR, et avec un certain back (ou fort/da) qui traverse les récits de retour de voyage en pays
communistes, notamment chez Gide et Benjamin (Derrida 2005).RENÉ LEMIEUX – LA TRADUCTION À L’ÉPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE 29
l’équivalence20. La possibilité ou pas d’un retour du message détermine alors la portion humaine dans
la traduction, sa différance, son reste, sa trace ou son excédant, ce qui ne rentre pas dans l’économie de
l’échange ou du négoce. La confession im–possible de Rousseau, ce « je » paradoxal qui s’exprime en
revenant sur sa propre vie, répétant son existence, deviendrait peut-être ainsi un modèle générique pour
ce qui, dans la traduction, résiste et dissone. La traduction, alors, ferait parler d’elle, elle deviendrait,
contre toutes les forces qui la voudraient muette, sonore, et laisserait s’exprimer avec elle la voix d’une
restance.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Benjamin, Walter. 2005 [1955]. L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Paris :
Allia.
Cassin, Barbara. 2007a. Google-moi. La deuxième mission de l’Amérique. Paris : Albin Michel.
________. 2007b. « Intraduisible et mondialisation », entretien avec Michaël Oustinoff. Hermès. no 49.
En ligne : http://hdl.handle.net/2042/24145, consulté le 10 mai 2014.
Derrida, Jacques. 1967. De la grammatologie. Paris : Minuit.
________. 1972. Positions. Paris : Minuit.
________. 2000. Foi et savoir, suivi de Le siècle et le pardon, entretien avec Michel Wieviorka. Paris :
Seuil.
________. 2001. « Le ruban de machine à écrire (Limited Ink II) : L’avant-dernier mot : archives de
l’aveu ». Dans Papier Machine. Le ruban de machine à écrire et autres réponses. Paris : Galilée.
________. 2004 [1999]. « Qu’est-ce qu’une traduction "relevante" ? ». Dans Marie-Louise Mallet et
Ginette Michaud (dir.), Cahier de L’Herne Derrida : Jacques Derrida. Paris : L’Herne, p. 561-
576.
________. 2005. Moscou aller-retour. Paris : L’Aube.
Dobenesque, Étienne. 2007. « Pour une histoire du sujet de la traduction (et pourquoi la
Renaissance) ». Doletiana. no 1. En ligne :
http://webs2002.uab.es/doletiana/1Documents/1Dobenesque.pdf, consulté le 10 mai 2014.
Hutchins, John. 1995. « "The whisky was invisible", or Persistent myths of MT ». MT News
International. no 11 (juin 1995), p. 17-18. En ligne : http://hutchinsweb.me.uk/MTNI-11-
1995.pdf, consulté le 10 mai 2014.
Jakobson, Roman. 1992 [1959]. « On linguistic aspects of translation ». Dans Rainer Schulte et John
Biguenet (dir.), Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida.
Chicago : University of Chicago Press, p. 144-151.
Jérôme. 1953. « À Pammachius – La meilleure méthode de traduction ». Dans Correspondance tome
III. Lettres LIII-LXX, éd. et trad. par Jérôme Labourt. Paris : Les Belles Lettres, p. 59-73.
Lefort, Claude.1986. « Permanence du théologico-politique ? ». Dans Essais sur le politique. XIXe-XXe
siècles. Paris : Seuil, p. 275-329.
Lemieux, René. 2009. « Force et signification à l’épreuve de la traduction : la différance derridienne et
son transport à l’étranger ». RS/SI. vol. 29, nos 2-3, p. 33-58. En ligne :
http://www.bbc.co.uk/news/technology-23637174, consulté le 10 mai 2014.
Meschonnic, Henri. 2007. Éthique et politique du traduire. Lagrasse : Verdier.
Pascal, Blaise. 1976 [1669]. Pensées. Paris : Garnier-Flammarion.
Pym, Anthony. 2009. « Western translation theories as responses to equivalence ». En ligne :
20
Anthony Pym situe l’origine, très justement, avec Vinay et Darbelnet (1973 [1958]), deux linguistes d’origine
française dont la motivation pour développer une nouvelle méthode, écriront-ils dans leur préface, provenait
d’un voyage de retour de New York à Montréal. Back from the US, donc.30
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/translation/2009_paradigms.pdf, consulté le 10 mai 2014.
________. 2010. Exploring Translation Theories. Londres et New York : Routledge.
Rousseau, Jean-Jacques. 1865 [1782]. « Confessions ». Dans Œuvres complètes, tome 8. Paris :
Hachette.
Saussure, Ferdinand de. 1982. Cours de linguistique générale, éd. Tullio de Mauro. Paris : Payot.
Shakespeare, William. 1994. Le marchand de Venise [The Merchant of Venice], éd. bilingue, trad. Jean
Grosjean [1956]. Paris : Flammarion.
Vatican II. 1963. Sacrosanctum Concilium, constitution conciliaire sur la sainte liturgie, promulguée
sous Paul VI. En ligne,
en latin : http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_lt.html.
En ligne,
en français : http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html, consulté le 10 mai 2014.
Vaufrey, Christine. 2012. « Dans un texte, un traducteur automatique voit des mots ; un traducteur
humain voit du sens. Entretien avec Véronique Litet », Thot Cursus : Formation et culture
numérique. En ligne : http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/71/traduire/articles/18283/dans-
texte-traducteur-automatique-voit-des/, consulté le 8 mai 2012.
Vinay, Jean-Paul et Jean Darbelnet. 1973 [1958]. Stylistique comparée du français et de l’anglais.
Méthode de traduction. Montréal : Beauchemin.
NOTICE BIOBIBLIOGRAPHIQUE
Politologue de formation, René Lemieux est doctorant en sémiologie à l’Université du Québec à
Montréal et enseigne la traduction des sciences humaines et sociales à l’Université Concordia. Ses
recherches portent principalement sur les théories de la traduction et de la réception, ainsi que sur la
philosophie française contemporaine. Sa thèse de doctorat a pour objet Jacques Derrida étudié comme
phénomène culturel et politique dans l’université américaine. Il a codirigé, avec Dalie Giroux et Pierre-
Luc Chénier, le collectif Contr’hommage pour Gilles Deleuze (Presses de l’Université Laval, 2009),
ainsi qu’un dossier de la revue de critique littéraire Postures avec Jade Bourdages : « Lieu et non-lieu
du livre : penser la bibliothèque » (no 13, printemps 2011).Vous pouvez aussi lire