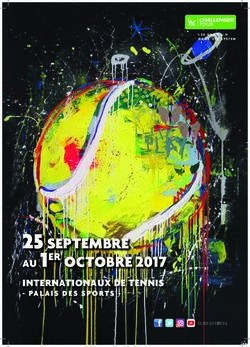Les capacités de recherche scientifique au Cameroun - Etudes d'impact Rapport No. 5
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
MESIA
Etudes d’impact Rapport N o . 5
�����
������� ���
�����
������ ���� ������
������������
����
����������
�
������
������� �����
������� ��
���� ������
������� ��
����� ������
�
������ ��������
����� ��
�
�����
��
����� ����� �����
��
������
�����
���
����� ���
���
����� ��
����� �
Les capacités de recherche
scientifique au Cameroun
Une évaluation de l’impact des activités de l’IFS
Jacques Gaillard
Eren Zink
avec la collaboration de
Anna Furó TullbergIFS La Fondation Internationale pour la Science est une organisation non gouvernemen- tale fondée en 1972 dont le mandat est de contribuer au renforcement des capacités scientifiques des pays en développement dans les domaines relatifs à la gestion, la conservation et le renouvellement des ressources naturelles. Pour remplir cette mission, la Fondation identifie et soutient, en début de leur car- rière, de jeunes scientifiques prometteurs dont les qualités attestent d’un potentiel leur permettant d’envisager une carrière de chercheur de haut niveau et de jouer un rôle scientifique dans leur pays. La principale forme d’aide et le moyen d’entrer dans le “dispositif IFS” est l’attribution d’une bourse modeste octroyée dans le cadre d’une sélection internationale. Le candi- dat qui a obtenu une bourse peut ensuite être aidé de différentes manières: invitation à des ateliers, service des achats, allocations de voyages, formation, mise en relation avec des scientifiques, participation à des réseaux, aide à la publication, etc. A ce jour, l’IFS a aidé plus de 3,500 scientifiques en Afrique, Asie et Pacifique, Améri- que Latine et Caraïbes. Copyright © International Foundation for Science, Stockholm All rights reserved, 2003 Layout: Eren Zink Printing: AB Norrmalmstryckeriet, Sweden Cover photos: Vincent Fondong (cassava leaf) and Tanja Lundén (city of Yaoundé)) ISSN 1651-9493 ISBN 91-85798-52-5
Les capacités de recherche
scientifique au Cameroun
Une évaluation de l’impact des activités de l’IFS
Jacques Gaillard
Eren Zink
avec la collaboration de Anna Furó Tullberg
Octobre, 2003Les capacités de recherche scientifique au Cameroun 3
Table des Matières
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. La Science et la Technologie au Cameroun, un aperçu . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Candidats et bénéficiaires des allocations de recherche . . . . . . . . . . . . . . 13
4. Caractéristiques des scientifiques allocataires de l’IFS . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5. Les conditions de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6. Les publications scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
7. Achèvement du projet de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
8. Avancement de carrière et mobilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
9. Evaluer l’aide de l’IFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
10. Science, société et objectifs de carrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
11. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Liste des sigles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Liste bibliographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Les capacités de recherche scientifique au Cameroun
Préface
La Fondation Internationale pour la Science (IFS) entre les chercheurs et par un processus local d’éva-
offre sélectivement des allocations de recherche luation scientifique du projet par les pairs avant sa
aux jeunes scientifiques des pays en développe- soumission à l’IFS.
ment. Les scientifiques camerounais ont été parmi
les premiers boursiers de l’IFS en Afrique, et c’est Les femmes sont sous-représentées parmi
un total de 83 chercheurs qui ont obtenu à ce jour les allocataires camerounais (leur proportion
au moins une bourse de recherche. est moitié moins élevée que dans la population
scientifique nationale). Ce résultat interroge: les
Afin de mesurer l’impact de l’action de l’IFS, femmes ont-elles des réseaux informels plus fragi-
une vaste étude de suivi a été entreprise. Ce rapport les ? Sont-elles moins présentes dans les thémati-
est le quatrième d’une série d’études portant sur ques soutenues par l’IFS? Leurs charges familiales
les conditions de travail des boursiers (les études les amènent-elles à mettre leur carrière scientifique
précédentes concernaient le Mexique, la Tanzanie, au deuxième plan, les rendant inéligibles en raison
et l’Afrique sub-saharienne en général). de leur âge à l’allocation de l’IFS lorsqu’elles sont
aptes à la demander?
Cette étude, réalisée par Jacques Gaillard et
Eren Zink, s’est faite sur la base d’une enquête Cette question mérite d’être approfondie. En
questionnaire, d’une série d’entretiens, de visites effet, si l’IFS veut étendre son aide aux pays les
d’institutions de recherche sélectionnées et grâce à moins développés, les femmes doivent être davan-
l’exploitation de la base de données de l’IFS. tage soutenues. Il conviendra alors de comprendre
pourquoi elles sont sous-représentées dans certains
Les résultats montrent que le paysage scientifi- pays.
que au Cameroun, très érodé après 1990, montre
des tendances à l’amélioration ces dernières L’étude porte également sur la perception
années. Malgré de sévères réductions budgétaires qu’ont les allocataires camerounais de la qualité
au cours de cette dernière décennie, il existe un des prestations fournies par l’IFS. L’activité princi-
certain nombre «d’îlots» académiques forts, où se pale de la Fondation, à savoir l’administration des
produit une science de qualité, mais ils restent très bourses est largement appréciée. La majorité des
dépendants des financements internationaux. personnes enquêtées considère qu’il s’agit d’un ser-
vice excellent et la totalité d’entre elles s’en disent
L’étude montre que les boursiers de l’IFS ont eu au moins «satisfaites ». Parmi les autres prestations
une progression académique satisfaisante et qu’ils largement appréciées par les allocataires, notons le
sont maintenant parvenus à des postes élevés au processus de sélection, le service d’achat d’équipe-
sein de leur communauté scientifique. La fuite des ments, le conseil et le suivi des projets de recherche
cerveaux est extrêmement faible parmi les anciens ainsi que les relations avec le secrétariat.
allocataires, seuls trois travaillent en Amérique du
Nord, et quatre se sont déplacés vers d’autres pays
africains.
Le taux d’approbation aux demandes d’alloca- Stockholm, octobre 2003
tions de l’IFS est relativement élevé, proche de 30%
alors qu’il est en moyenne de 20% pour l’ensemble Michael Ståhl
des candidatures africaines. Selon l’étude, ce taux Directeur
élevé s’explique par la fréquence des échanges Fondation Internationale pour la ScienceLes capacités de recherche scientifique au Cameroun 5
1. Introduction
La mission de la Fondation Internationale pour Cameroun et l’IFS se sont activement développées,
la Science (IFS) est de soutenir des chercheurs d’abord par l’adhésion, en 1977 de l’ONAREST2
de pays en développement, en début de carrière, aujourd’hui Ministère de la Recherche Scientifique
travaillant sur des projets relatifs au management, et Technique (voir section 2) comme membre de la
à l’utilisation et à la conservation des ressources Fondation, puis par l’assistance régulière des repré-
biologiques. Ce soutien, d’abord financier, con- sentants et chercheurs camerounais aux assemblées
siste en l’octroi d’une allocation de recherche d’un et aux ateliers de l’IFS. Enfin, le personnel de la
montant maximum de 12000 dollars américains et Fondation visite fréquemment les universités et les
renouvelable deux fois. Cette aide, destinée d’abord institutions de recherche camerounaises.
à acheter des équipements, des fournitures et de la
documentation ainsi qu’à couvrir certains coûts de En décembre 2002, le nombre de chercheurs
terrain (prise en charge éventuelle du coût salarial camerounais ayant bénéficié d’une allocation de
d’assistants de recherche et techniques) offre égale- l’IFS s’élevait à 84. Cela situe le Cameroun au
ment aux chercheurs la possibilité d’interagir avec troisième rang des pays bénéficiaires de l’aide de
d’autres scientifiques, de participer à des séminaires l’IFS en Afrique Sub-saharienne (sur 40 pays), le
ou d’effectuer des stages de formation dans d’autres Nigeria et le Kenya arrivant en tête3. Au total, 139
institutions académiques. Concomitamment, la allocations de recherche ont été attribuées à 86
Fondation organise ses propres ateliers (environ scientifiques (dont deux n’ont jamais démarré leur
une centaine à ce jour), elle soutient et stimule les projet, ce qui porte bien le nombre des bénéficiai-
réseaux scientifiques tant au niveau international res à 84) ; parmi ces derniers six sont aujourd’hui
que régional et attribue des prix scientifiques afin décédés. Au début de l’année 2003, 34 chercheurs
de récompenser les chercheurs ayant obtenu, grâce camerounais étaient toujours allocataires de l’IFS.
à son allocation de recherche, les résultats les plus
remarquables. Tous ces efforts visent à renforcer la Le montant global de l’aide (sans compter les
crédibilité scientifique de ces chercheurs afin qu’ils allocations de voyage et de formation) est évalué
puissent trouver leur place et être reconnus au sein à 1,4 Millions de dollars américains. L’IFS a, en
de la communauté scientifique nationale et inter- outre, organisé ou co-organisé 8 ateliers scientifi-
nationale. De 1974 à 2002, l’IFS a soutenu près de ques au Cameroun. La situation spécifique du pays,
3400 chercheurs dans 99 pays en développement, principalement son bilinguisme, le rend particuliè-
dont plus du tiers (1231) en Afrique. rement attractif pour l’organisation de séminaires
pour les boursiers francophones et anglophones
Les premières allocations ont été attribuées dès de cette partie du monde. Le premier séminaire
1976 à des chercheurs camerounais travaillant à tenu à Buea en 1979, rassemblait, pour la première
l’Institut National de Recherche Agricole1. L’un fois de nombreux chercheurs d’Afrique Centrale et
d’entre eux, Monsieur Ayuk-Takem, docteur en d’Afrique de l’Ouest travaillant sur l’Igname. Parmi
génétique, spécialiste du maïs, est aujourd’hui les derniers citons l’atelier sur l’achat l’entretien
directeur de l’IRAD après avoir été Ministre de et la maintenance des équipements de recherche
la Science et de la Technologie au début de la dans les pays en développement qui s’est tenu,
décennie 1990. Depuis lors, les relations entre le également à Buea, en novembre 2002 et la Con-
1. Aujourd’hui IRAD : Institut de Recherches Agricoles pour le Développement
2. Office National de la Recherche Scientifique et Technique
3. Cet ordre correspond également à la taille respective des trois communautés scientifiques nationales
(Gaillard, Waast et Hassan, 2002).6 Les capacités de recherche scientifique au Cameroun
férence de Yaoundé sur l’alimentation en Afrique que aujourd’hui, ont été publiés (Gaillard et Furó
(Food-Africa) en mai 2003 (ces deux derniers étant Tullberg, 2001). En outre, trois études de cas ont
co-organisés avec des partenaires nationaux et été réalisées et publiées, la première au Mexique
internationaux). (Gaillard et al. 2001), la deuxième en Tanzanie et
la troisième au Cameroun (Gaillard et Zink, 2003)
dont le présent document constitue la synthèse.
1.1 La mesure de l’impact des acti-
vités de l’IFS
1.2 Les composantes de l’étude
Pour évaluer les effets du soutien de l’IFS sur la car- MESIA au Cameroun
rière académique et institutionnelle des chercheurs
allocataires, le secrétariat de la fondation a mis en Cette étude a commencé par une série d’interviews
œuvre une étude d’impact nommée « Monitoring réalisées en novembre 1999 par Jacques Gaillard
and Evaluation System for Impact Assessment sur différents sites (Bamenda, Buea, Douala,
(MESIA) » (Système d’Analyse et de Mesure d’Im- Dschang, Ekona, Foumbot, Limbe, Njombe et
pact ), utilisant un certain nombre d’approches Yaoundé) ainsi que dans différentes institutions
complémentaires : interviews, enquêtes question- spécialisées principalement en sciences agricoles
naires, études bibliométriques des publications et biologiques, et dans une moindre mesure en
scientifiques des allocataires et études d’impact sciences de la nutrition et de la santé. Deux mises à
nationales (dont la présente étude sur le Came- jour ont ensuite été réalisées en mars 2003 d’abord
roun). Ces études s’effectuent dans un cadre con- auprès des scientifiques allocataires de l’IFS pour
ceptuel précis et suivent des directives soigneuse- les aspects relatifs à leurs situations et leurs carrières
ment élaborées pour permettre des comparaisons puis auprès des institutions pour l’actualisation des
internationales et impliquer autant les personnels données relatives à l’activité en science et technolo-
de l’IFS que les Organisations membres (Gaillard gie au Cameroun. L’étude couvre donc la période
2000). comprise entre 1974 et 2002 et concerne les 84
chercheurs qui ont participé aux programmes de
La première enquête questionnaire a été adres- l’IFS pendant cette période. Ces scientifiques sont
sée aux allocataires de l’IFS et à ceux du programme répartis dans 8 institutions nationales, mais il est
africain de la Commission Européenne INCO-DEV. à noter que les deux tiers d’entre eux sont établis
Les résultats de ce travail, éclairant les conditions et dans les deux institutions nationales qui reçoivent
les contraintes des professions scientifiques en Afri- le plus d’allocations de l’IFS : L’Institut de Recher-
che Agricole pour le Développement (IRAD) et
Tableau 1
l’Université de Yaoundé.
Principales institutions bénéficiaires au Cameroun (1974-
2002) Cette étude combine cinq approches complé-
mentaires (brièvement décrites ci-dessous) :
Nombre
Institutions Ville 1 une vue générale sur les activités scientifiques
d’allocataires
Institut de Recher- Nkolbisson/ 28 et techniques au Cameroun,
che Agricole pour Yaoundé et 6
le Développement autres villes 2 une analyse rétrospective (de 1974 à 2002)
(IRAD) des demandes d’allocations, des candidats et
Université de Yaoundé 27 des allocataires,
Yaoundé I
Université de Dschang 16 3 les résultats de l’enquête questionnaire
Dschang envoyée aux allocataires de l’IFS au Came-
Université de Ngaoundéré 6 roun,
Ngaoundéré
Université de Buea Buea 3 4 une analyse bibliométrique de leur produc-
Autres 4
tion scientifique sur la période 1974-1999 et
Total 84 5 des interviews de ces allocataires.Les capacités de recherche scientifique au Cameroun 7
1.2.1 Vue générale des activités 1.2.5 Les interviews
scientifiques et techniques au
Cameroun En octobre et novembre 2000, une série d’inter-
views a été conduite à Yaoundé auprès des minis-
Cette partie informative peut être lu séparément tres en charge de la recherche et de l’éducation
du reste du rapport. Elle s’adresse principalement supérieure, auprès des directeurs institutionnels et
aux personnes et organisations oeuvrant au renfor- auprès de 27 chercheurs allocataires de l’IFS.
cement des capacités scientifiques au Cameroun.
Sont décrits, dans la section 2, l’environnement
scientifique au Cameroun : développement et 1.3 Le contenu du rapport
politique scientifique, paysage institutionnel, con-
ditions d’exercice des professions scientifiques, ini- Cette synthèse suit l’organisation du rapport en
tiatives et institutions nouvelles ainsi que position 11 sections (y compris l’introduction et la conclu-
des allocataires de l’IFS dans le système scientifique sion). La section 12 résume les principaux résultats
et technique camerounais. de l’étude.
1.2.2 Analyse rétrospective des 1.4 Remerciements
demandes, des candidats et des
allocataires Les personnes et les institutions ayant permis, à un
titre ou un autre de mener à bien cette étude, sont
Cette partie centrale de l’étude présente les taux de chaleureusement remerciées : l’Institut de Recher-
succès des candidatures et des allocataires, la répar- che pour le Développement (France et Cameroun),
tition et la durée des projets, la qualité des rapports M. Jean Nya-Ngatchou, Directeur de Recherche
fournis, le niveau académique des chercheurs et Emérite (Cameroun), Hocine Khelfaoui (Algérie,
leur promotion institutionnelle. Canada), les personnels de l’IFS et enfin et surtout
les chercheurs camerounais allocataires de l’IFS.
1.2.3 L’enquête questionnaire
Cette enquête, partie intégrante de l’enquête sur
les chercheurs africains, a été envoyée a 59 cher-
cheurs camerounais en mars 2000. Une relance a
été envoyée en juin de la même année à ceux qui
n’avaient pas répondu. En tout, 48 questionnaires
ont été renvoyés remplis, ce qui constitue un taux
de réponse de 81%.
1.2.4 Une étude bibliométrique de la
production scientifique.
L’étude bibliométrique conduite visait à déter-
miner si le soutien de l’IFS avait eu un impact
sur l’orientation, la nature et le volume de la
production scientifique. Sur les 66 allocataires
camerounais contactés fin 1999, 49 ont envoyé
leur liste de publication (pour un total de 972
notices bibliographiques, tous types de production
confondus). Cela constitue un taux de réponse de
71%, considéré comme très satisfaisant. Les résul-
tats de l’analyse bibliométrique sont présentés
dans la section 6.8 Les capacités de recherche scientifique au Cameroun
Les capacités de recherche scientifique au Cameroun 9
2. La Science et la Technologie au Cameroun, un aperçu1
2.1 Construction d’un système alors que la recherche dépend du Ministère de la
national de recherche Recherche Scientifique et Technique.
Comme dans la plupart des pays d’Afrique subsa- Cette séparation entre recherche et enseigne-
harienne, la « science moderne » a été introduite ment rend plus difficiles les collaborations entre
au Cameroun pendant la période de colonisation. chercheurs d’instituts et professeurs d’université.
En 1960, lors de son indépendance, le pays dispo- Les premiers ayant plus difficilement accès à l’ac-
sait d’une infrastructure de recherche appréciable, tivité d’enseignement et de direction de thèses.
mais le nombre des chercheurs camerounais était Les chercheurs interviewés qualifient la relation
très réduit. Durant la période post-coloniale, la entre les instituts de recherche et les universités de
coopération qui s’est établie entre le Cameroun et « solidarité conflictuelle » et signalent que les col-
la France a permis aux autorités nationales de con- laborations engagées aujourd’hui entre chercheurs
centrer leurs efforts sur l’enseignement et la forma- et enseignants sont le résultat de contacts informels
tion sans que cela ne porte préjudice à la recherche se développant en dehors des institutions.
car, si l’Etat camerounais finançait les institutions,
le salaire des chercheurs, français pour la plupart,
était assuré par la France. 2.2 Ressources humaines et bud-
gets
La recherche était essentiellement agricole et
portait principalement sur l’amélioration des plan- Jusqu’au milieu des années 80, la relative prospé-
tes, la protection des cultures et l’amélioration des rité (due aux revenus du pétrole) liée à une forte
systèmes agricoles. On commençait également à volonté politique de former une élite scientifique
s’intéresser à la recherche sur les plantes vivrières, nationale a amené le Cameroun à fortement inves-
sujet jusqu’alors négligé au profit de la recherche tir dans la recherche. Le pays faisait alors partie du
sur les cultures d’exportation. groupe de tête des pays africains en termes d’inves-
tissement dans la recherche.
Dès l’indépendance, l’accent est mis sur l’ins-
titutionnalisation de l’éducation supérieure. Entre En 1980 un décret fonde le statut du chercheur.
1972 et 1984, le pays se dote progressivement C’est le début d’une période de développement de
d’institutions pour la recherche. La situation était la recherche et l’amorce de création d’une com-
alors complexe, le pays, héritier de deux cultures munauté scientifique dont le rôle est clairement
coloniales, cherchait à harmoniser ses systèmes de perçu par l’opinion publique. Entre 1980 et 1987
recherche dans le cadre d’une coopération avec la le nombre de chercheurs nationaux passe de 152
France, coopération elle-même reflet de l’évolution à presque 400, le nombre d’expatriés restant cons-
des institutions de recherche françaises. De 1984 à tant sur la période (autour de 82).
1992, le gouvernement rassemble sous la houlette
d’un seul ministère l’éducation supérieure et la La fin de la décennie marque toutefois la fin
recherche pour à nouveau les diviser et les placer brutale de cette remarquable expansion : la crise
sous deux ministères dépendants. Depuis 1992 les économique que subit le pays à partir du milieu
universités et institutions d’enseignement dépen- de la décennie entraîne la fin des recrutements, la
dent du Ministère de l’Enseignement Supérieur cessation des financements des programmes, des
1. Pour une présentation plus détaillée voir Gaillard et Khelfaoui, 2001.10 Les capacités de recherche scientifique au Cameroun
délais dans le paiement des salaires et, progressive- A partir de 1987, les recrutements se font rares.
ment, l’érosion de l’intérêt et des motivations pour En conséquence, on assiste à une stagnation du
la profession scientifique. nombre des chercheurs nationaux jusqu’au début
des années 1990, puis à une réduction, les scienti-
Entre 1990 et 1996 les seuls programmes de fiques partant en retraite ou démissionnant n’étant
recherche poursuivis sont ceux qui sont financés plus remplacés. La crise économique entraîne
par des programmes étrangers. Alors qu’avant également la dégradation des infrastructures
1987 l’Etat finance entre 85% et 95% des activités de recherche : perte progressive du patrimoine
de recherche (salaires compris), le pourcentage (génétique, végétal, animal etc.), dégradation du
des financements étranger atteint presque 40% potentiel scientifique et technique dont l’entretien
dans les années qui suivent (1987-1993). Aucun n’est plus assuré. Pendant cette crise, les sciences
programme ne peut plus se faire sans la contribu- sociales sont aussi sacrifiées, le seul institut ayant
tion de fonds internationaux. Les contributions les survécu étant devenu depuis l’Institut National de
plus importantes viennent de la Banque Mondiale Cartographie.
(principalement sous forme de prêts), du Fonds
d’Aide à la Coopération (FAC), de la Caisse Cen- Cette crise et les tensions qu’elle a suscitées ont
trale de Coopération économique (CCCE)1 du à la fois affaibli les professions de la recherche et
British Overseas Development Admnistration créé un environnement très difficile dans lequel les
(ODA)2, de l’Union Européenne, du Deutsche chercheurs camerounais ont, malgré tout, démon-
Gesellschaft für Technishen Zusammenarbeite tré une grande force de survie et d’innovation.
(GTZ) et de l’USAID. Des aides sont également
apportées pour le renforcement des équipes de
recherche (AIRE-Développement) ou sous forme 2.3 Les transformations de la pro-
de soutien individuel (Institut de Recherche pour fession
le Développement – IRD et Fondation Internatio-
nale pour la Science – IFS). Avant la crise économique, les chercheurs et les
enseignants de l’université recevaient des salaires
Le développement des infrastructures de recher- relativement bons et jouissaient, en conséquence,
che s’est accompagné de celui des universités. En d’un bon niveau de vie. En 1993, une réduction
1977, pour faire face à l’accroissement du nombre de 66% fut opérée sur ces salaires, suivie, quelques
d’étudiants, les autorités créent quatre nouvelles mois après d’une dévaluation de 50% du CFA.
universités, puis six autres, en 1993, dans le cadre Pour subsister dans ce contexte, les chercheurs
d’une nouvelle réforme de l’enseignement supé- ont dû développer des stratégies de survie qui ont
rieur. Ces transformations qui se font également souvent pris la forme d’emplois complémentaires :
dans un contexte de crise budgétaire nécessitent consultations et expertises auprès d’organismes
une répartition des fonds qui pénalise certaines uni- internationaux, d’organisations non gouverne-
versités au profit d’autres. L’Université de Yaoundé mentales ou d’entreprises privées, activités qui
(scindée en deux lors de la réforme de 1993) voit n’avaient, la plupart du temps, aucun rapport avec
par exemple son budget diminuer de 90% entre les activités de recherche.
1991 et 1999 alors que le budget des universités
de provinces s’accroît modestement (sans corres- Tous les chercheurs n’ont, cependant, pas quitté
pondre toutefois aux coupes budgétaires opérées la recherche. Les stratégies de survie mises en place
à Yaoundé). Sur l’ensemble de la décennie 1990 ont été différentes selon l’âge, les situations fami-
le budget total des universités s’est divisé pratique- liales et les disciplines. Les coûts d’habitation ont
ment par 10 alors que les étudiants arrivaient de été réduits (certains jeunes chercheurs s’étant cons-
plus en plus nombreux, passant de plus de 43700 truit eux-mêmes des logements modestes dans des
en 1992 à plus de 60500 en 1999. Partant, malgré quartiers bons marchés). Les économies gagnées à
une reprise des budgets en 1998-1999, la moyenne l’étranger ont été mises à contribution. Certains
des financements publics par étudiant n’a cessé de chercheurs ont fait des investissements productifs
diminuer durant la décennie. (taxis, minibus, boutique, production maraîchère,
etc.). D’autres sont devenus, selon les termes de
1. Aujourd’hui AFD
2. Aujourd’hui DFIDLes capacités de recherche scientifique au Cameroun 11
leurs collègues, des « chasseurs d’indemnités », recherches autres que celles financées par l’étran-
courant d’un séminaire à un autre, ou des « chas- ger limite forcément les programmes qui peuvent
seurs d’expertises », ou encore donnent des cours être conduits et obligent les scientifiques à, selon
dans d’autres pays africains. les dires de certains d’entre eux, « devenir des mer-
cenaires à la merci des donateurs ». C’est dans ce
La pratique de la consultance qui s’est ainsi contexte que le Ministère de la Recherche Scienti-
établie est devenue, à terme, un objet de débat et fique et Technique parle de « reprendre possession
il apparaît maintenant que le temps passé par un de la recherche ». Les chercheurs camerounais
chercheur en consultation externe devrait pouvoir considèrent que trop souvent les pays d’Afrique
profiter à son institut. Ainsi le Ministère de la sont devenus des objets de recherche, non plus des
Recherche Scientifique et Technique souhaiterait sujets. « Nous sommes devenus les petites mains
que 20% des revenus de la consultance soient des Français mais aussi des autres qui viennent de
remis aux institutions d’attache des chercheurs. plus en plus nombreux utiliser les pays africains
comme des laboratoires ». C’est probablement une
Les difficultés accumulées par cette décennie de des raisons pour lesquelles le Ministre de la Recher-
crise financière façonnent aujourd’hui encore la che Scientifique et Technique a organisé en 1999 à
communauté scientifique et l’on peut considérer Yaoundé, la première conférence avec les ministres
qu’une génération de chercheurs a été sacrifiée1. chargés de la recherche-développement dans les
Cette érosion de la recherche se manifeste aussi pays d’Afrique de l’Ouest sur le thème « Relance
par la léthargie des associations scientifiques. Ces et Réappropriation de la recherche scientifique par
associations qui, comme la « Société des Mathé- l’Afrique au bénéfice des peuples africains dans le
maticiens Camerounais » ont été à l’origine de contexte de la mondialisation »
nombreuses revues scientifiques (qui maintenant
n’existent plus) sont maintenant très peu actives.
2.4 Innovations institutionnelles et
Malgré cela, le niveau des diplômes obtenus au nouvelles formes de partenariat
Cameroun est considéré comme bon. La sélection
est rude pour les étudiants et le passage au niveau Pour essayer d’aller dans le sens d’une « reprise de
supérieur est décidé par les enseignants unique- possession », un programme d’appel d’offre a été
ment en fonction des résultats. Ce gage de qualité lancé à l’Université de Yaoundé 1 pour la période
est vérifié au niveau international où les chercheurs 1999-2001 : « Le Fonds Universitaire d’Appui à la
camerounais rencontrent un important taux de Recherche (FUAR) » financé par les autorités came-
succès lorsqu’ils soumissionnent à des program- rounaises pour permettre la restructuration et le
mes bilatéraux ou internationaux. renforcement de la recherche scientifique.
Aujourd’hui, de nombreux membres du gou- Les organismes de coopération internationale
vernement sont des scientifiques de haut niveau. ont également été amenés à revoir leurs modes
Il en est de même de ceux qui, en charge de l’édu- d’intervention, ce qui a permis l’émergence de nou-
cation et de la recherche, essaient d’introduire une veaux dispositifs institutionnels fonctionnant dans
politique scientifique dynamique que l’héritage de un contexte de partenariat renégocié. Par ailleurs,
la crise empêche de concrétiser. L’absence de finan- le retrait de l’Etat camerounais du financement de
cements et le manque d’opportunités pour con- la recherche a ouvert la voie à d’autres acteurs du
duire des recherches pour le bien public limitent la développement, notamment à des organisations
capacité des chercheurs à œuvrer pour le dévelop- non gouvernementales.
pement de leur pays. Ce manque d’engagement au
regard des besoins de la population contribue à la Dans ce contexte, des « îlots de résistance »
dégradation de l’image du chercheur aux yeux de sont apparus qui, dus à la qualité de groupes de
l’opinion publique. chercheurs, ont su, avec la solidarité internationale,
faire vivre leurs laboratoires, encadrer des étudiants
C’est une situation que de nombreux chercheurs et entretenir leurs réseaux scientifiques avec l’étran-
dénoncent. Le fait de ne pouvoir conduire de ger. Cela est particulièrement vrai pour les discipli-
1. Depuis la fin des années 80 le chômage affecte une grande partie des personnels diplômés. Chaque année
1300 diplômés de premier cycle sortent des universités camerounaises, mais ils sont déjà des milliers (8000)
à n’avoir pas trouvé d’emploi dans un marché local inadapté à leurs qualifications.12 Les capacités de recherche scientifique au Cameroun
nes, telle la chimie (et notamment la chimie orga- Supérieur a, par ailleurs, été doublé en 2003 (pas-
nique), qui ont su former une relève et atteindre sant de 150 millions de CFA en 2002 à 300 Mil-
une masse critique capable « d’ensemencer » les lions en 2003).
nouvelles universités ouvertes en 1993.
D’autres signes sont encourageants, telle la
Concomitamment, de nouveaux centres de campagne de recrutements lancée en 2002-2003
recherche ont été créés qui, autonomes sur le par le Ministère de la Recherche Scientifique et
plan de la gestion, sont l’illustration des formes Technique grâce à laquelle 278 jeunes chercheurs
renouvelées du partenariat international. Citons, ont pu être embauchés, principalement dans la
parmi ceux-ci : le Centre Régional des Bananiers recherche agricole et médicale. Ces jeunes scientifi-
et Plantains (CRBP) de Njombé et la Station IRAD ques âgés de 25 à 30 ans ont été formés au Came-
de Garoua. roun et sont titulaires de maîtrises, de Diplômes
d’Etudes Approfondies (DEA) et pour quelques-
uns, de doctorats.
2.5 Des signes de reprise
Ces signes laissent espérer le début d’un effort
Les sciences et les techniques semblent faire national pour le renforcement de la science au
aujourd’hui l’objet d’un renouvellement d’intérêt Cameroun. Ce sont toutefois des signes fragiles et
de la part des autorités camerounaises. En février la poursuite du rajeunissement des effectifs scienti-
2003, le nouveau ministre de l’éducation supé- fiques ainsi que le renforcement des infrastructures
rieure a lancé les Journées Universitaires pour la de recherche dans ce pays dépendra dans les années
Science et la Technologie (JUST) établissant le à venir de la volonté politique des autorités came-
cadre d’un dialogue entre l’Université et le secteur rounaises ainsi que de la coopération qui s’établira
privé et devant aboutir à de nouveaux partenariats avec les partenaires et financeurs nationaux et
locaux. Le budget du Ministère de l’Enseignement internationaux.Les capacités de recherche scientifique au Cameroun 13
3. Candidats et bénéficiaires des allocations de recherche
3.1 Demandes d’allocations de l’ancrage de cette discipline au Cameroun depuis
recherche et taux de réussite plusieurs décennies. Il est également dû au dyna-
misme du département de Chimie Organique de
Entre 1993 et 2002, plus d’un tiers (44) des 120 l’Université de Yaoundé dont la masse critique a
premières demandes d’allocations de recherche permis, avec l’aide internationale (dont celle de
parvenues à l’IFS1 ont été approuvées. Cela repré- l’IFS), le développement de ce domaine scien-
sente un taux d’acceptation relativement élevé tifique dans de jeunes universités (Dschang et
(36,6%), soit plus du double de celui obtenu sur Buea). Il faut noter également le mauvais score des
l’ensemble de l’Afrique (15%) et de l’Asie (17%) et demandes en Ressources aquatiques. Seulement 2
sensiblement supérieur à celui obtenu en Améri- allocations de recherches ont été attribuées dans ce
que Latine (30%). domaine depuis 1974.
Ce taux élevé d’attribution s’explique par L’étude montre également que les taux de
1 La qualité de la formation scientifique des succès sont meilleurs dans les grandes institutions
candidats : nombre d’entre eux ont suivi leurs nationales (Universités et IRAD) que dans les
études supérieures à l’Université de Yaoundé, institutions de taille plus modeste et isolées où la
établissement dont la qualité est reconnue recherche n’est pas la principale mission et où la
dans le pays et hors du pays. masse critique de personnels scientifiques n’est pas
2 Les projets sont rarement soumis à l’IFS sans
avoir été, au préalable, l’objet d’un examen
critique de la part de collègues (souvent des
anciens allocataires de l’IFS). Ceci est prin- Tableau 2
cipalement vrai en chimie organique et en Répartition par domaine des premières demandes et des
sciences agro-alimentaires, lesquelles obtien- attributions d’allocations de recherche (1998-2002)2
nent respectivement des taux de réussite de
50% et de 47% (tableau 2). Domaines de Attribu- Taux de
Demandes
recherche tions réussite (%)
Sciences ali- 6 3 50
En moyenne, une dizaine de projets sont mentaires
soumis annuellement à l’IFS et 3 à 6 allocations de Substances 17 8 47
recherche octroyées. Il est notable que les années naturelles
où les demandes sont les plus nombreuses corres- Productions 6 2 33
pondent à un regain de visibilité de l’IFS dans le animales
pays (visites ou séminaires d’informations). Productions 10 3 30
végétales
Pendant la période des 4 années observées, 49 Foresterie / 5 1 20
agrofores-
demandes ont été soumises et 17 ont été approu- terie
vées, ce qui constitue un taux de réussite de 35%. Ressources 5 0 0
Le fort taux de réussite du domaine des Substances aquatiques
naturelles (déjà mentionné) est également dû à Total 49 17 35
1. Ne sont pas comptées ici les demandes de renouvellement pour les allocations déjà accordées.
2. Le choix de cette période correspond aux informations disponibles sur la base de données de l’IFS.14 Les capacités de recherche scientifique au Cameroun
Tableau 3
Répartition des allocataires par domaines, nombre d’allocations et statut
Une bourse Deux bourses Trois bourses Quatre bourses
Domaine Total
A T A T A T A T
Ressources aquatiques 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Productions animales 3 3 1 2 0 2 0 0 11
Productions végétales 5 12 1 3 2 2 0 0 25
Foresterie/Agroforesterie 2 5 2 3 0 1 0 0 13
Sciences alimentaires 3 4 0 1 1 0 0 0 9
Substances naturelles 9 2 6 0 2 3 0 2 24
23 26 10 9 5 9 0 2
Nombre d’allocataires 84
49 19 14 2
Statut : A = allocation Active; T= allocation Terminée
atteinte (exemple : Délégation provinciale de l’éle- La plus grande concentration d’allocataires
vage, des pêches et des industries ou associations (70% d’entre eux) s’observe à Yaoundé, capitale
d’agriculteurs : Fako Animal Farmer Cooperative). et plus vieille ville universitaire du pays ainsi qu’à
Dschang, site d’une jeune université particulière-
ment dynamique. Les autres lieux d’implantation
3.2 Les bénéficiaires d’allocations des bénéficiaires de l’IFS sont les sites où ont été
de recherche créées les jeunes universités (Ngaoundéré, Buea
et Douala), les centres ou stations de recherche
Entre 1974 et 2002, 86 scientifiques camerou- de l’IRAD (Bamenda, Buea, Garoua, Kribi) ou
nais ont bénéficié d’une première allocation de les autres institutions tel le Jardin Botanique de
recherche de l’IFS. Deux n’ont jamais commencé Limbe.
leur projet partant, les allocations ne leur ont
pas été allouées. Le nombre total de boursiers de
l’IFS s’élève donc à 84. Parmi ces derniers, 6 sont
aujourd’hui décédés et 38 étaient encore allocatai- Graphique 1
res actifs de l’IFS en début 2003. Répartition par domaines de recherche
Le domaine regroupant le plus grand nombre ����������
de bénéficiaires est celui des Productions végétales ����������
�����������
avec 25 allocations attribuées, suivi de près par ��������
celui des Substances naturelles avec 24 allocations ����������
����������
(graphique 1).
Sur les 84 scientifiques camerounais allocataires
de l’IFS seulement 5 sont des femmes soit 6% alors
que les femmes sont proportionnellement moitié
plus représentées dans la communauté scientifique �����������
camerounaise. Ce taux est également très faible au ��������
���������
regard des statistiques de l’IFS dont les allocataires ������������
femmes représentent 11% des scientifiques afri-
cains aidés et 22% toutes nationalités et périodes �������������������������
confondues (26% en 2002).Les capacités de recherche scientifique au Cameroun 15
4. Caractéristiques des scientifiques allocataires de l’IFS
Cette section met en perspective les caractéristiques Sur les 48 scientifiques ayant répondu à l’en-
de la population des allocataires de l’IFS Camerou- quête (sur 59 sollicités), 22 ont répondu en anglais
nais et celles, connues, de la communauté scien- et 26 en français. Tous étaient mariés. Le nombre
tifique nationale. La moyenne d’âge des boursiers moyen d’enfants par enquêté était de 3,7, bien que
de l’IFS au moment où ils effectuent leur première tous n’aient pas eu d’enfants (fourchette située
demande est d’environ 35 ans. Il est à noter une entre 0 et 11 enfants). L’occupation des conjoints
légère augmentation de cette moyenne d’âge (il n’y a que 3 hommes parmi ceux-ci) est connue
durant les 5 dernières années (36,2). On ne trouve dans 43 cas. Il s’agit pour la plupart de professions
plus, dans les candidatures ni dans les attributions intermédiaires (enseignants, infirmiers, fonction-
des dernières années de très jeunes trentenaires naires, techniciens, libraires etc.) Deux conjoints
(ou moins âgés) alors que cela n’était pas rare dans occupaient des postes académiques, un était méde-
les décennies 70 et 80. Cette tendance au vieillis- cin, et 8 étaient au foyer.
sement au moment de la première candidature
pourrait encore s’accroître en raison de l’âge moyen En majorité, les allocataires étaient titulai-
de l’ensemble de la communauté scientifique et de res d’un doctorat au moment de leur première
sa difficulté à se renouveler. demande (52%). La même étude réalisée en Tan-
zanie faisait apparaître un taux de 35% dans ce
La sous-représentation des femmes dans la pays. Les diplômes de niveau Licence (BSc) ont
population observée (5 personnes dont 3 ayant été très largement obtenus au Cameroun (74%) ce
répondu à l’enquête questionnaire) ne permet qui n’est pas le cas des diplômes supérieurs (il faut
pas d’émettre d’hypothèses sérieuses à ce sujet. Il noter cependant un nombre relativement impor-
ressort toutefois d’un ensemble d’interviews que, tant de doctorats obtenus au Cameroun : 25 sur
du fait des charges familiales (que les femmes 64). Les diplômes obtenus (tous diplômes d’études
assument généralement davantage que leurs col- supérieures confondus) avant et après l’obtention
lègues masculin), elles rempliraient plus tard que de l’allocation de recherche de l’IFS l’ont été majo-
ces derniers les critères leur permettant de sou- ritairement au Cameroun (52%). Les 5 principaux
mettre une demande d’allocation à l’IFS. Partant, pays étrangers ayant délivré les 48% des diplômes
la limite de 40 ans pour la formulation de la pre- restants sont, par ordre d’importance décroissante :
mière demande serait un handicap pour elles. L’âge la France (28 dont 12 doctorats et 2 post-doc), le
moyen des chercheurs ayant répondu à l’enquête Nigeria (26 dont 9 Ph.D.), les Etats-Unis d’Améri-
était de 46 ans au moment de l’enquête (s’inscri- que (23 dont 5 Ph.D. et 1 post-doc), le Royaume-
vant dans une fourchette d’âge s’échelonnant de 38 Uni (13 dont 6 Ph.D. et 1 post-doc) et la Belgique
à 58 ans). (7 dont 3 doctorats) (tableau 4).16 Les capacités de recherche scientifique au Cameroun
Tableau 4
Pays d’obtention des diplômes des bénéficiaires de l’IFS
Pays BSc / Licence MSc / Maîtrise PhD / Doctorat PostDoc Total
Cameroun 56 29 25 8 118
France 4 10 12 2 28
Nigeria 7 10 9 26
Etats-Unis 4 13 5 1 23
Royaume-Uni 1 5 6 1 13
Belgique 1 3 3 7
Suède 1 2 3
Allemagne 2 2
Sierra Leone 2 2
Pays-Bas 2 2
Russie 1 1
Rwanda 1 1
Suisse 1 1
Togo 1 1
Total 76 73 64 15 228Les capacités de recherche scientifique au Cameroun 17
5. Les conditions de la recherche
5.1 Les moyens d’existence des (définies par l’enquête comme étant la recherche,
bénéficiaires de l’IFS l’enseignement, l’administration, la valorisation
des résultats de recherche et la consultance). Les
Les scientifiques soutenus par l’IFS travaillent pres- chercheurs travaillant dans les universités publi-
que tous dans le secteur public de la recherche (45 ques répartissent à peu près également leur temps
sur 48). Ils sont quasiment unanimes (46 sur 48) à entre la recherche et l’enseignement (autour de
dire que leur salaire de chercheur n’est pas suffisant 40%). Ils souhaiteraient se consacrer un peu
pour satisfaire aux besoins de leur famille. C’est la moins à l’enseignement (35%) et plus à la recher-
raison pour laquelle la moitié d’entre eux (24) ont che (50%) ainsi qu’à la valorisation de celle-ci
des activités secondaires, la plus répandue étant (laquelle est quasiment inexistante dans les univer-
l’activité agricole (31% des chercheurs enquêtés), sités publiques).
suivie de l’enseignement (presque 17%).
Les chercheurs travaillant en instituts de recher-
Les réponses données aux questions posées che dédient, quant à eux, la majeure partie de leur
pour savoir ce qui, parmi un certain nombre de temps (plus de 60%) à la recherche et peu de temps
caractéristiques de l’exercice de la profession scien- à l’enseignement (autour de 5%). Ils semblent, eux
tifique, était considéré comme un « avantage » aussi, relativement satisfaits de cette répartition
ou un « inconvénient », révèlent un pessimisme tout en manifestant un important souhait d’aug-
mitigé (tableau 5). L’échelle des salaires ainsi menter leur temps d’enseignement (le doubler).
que les avantages professionnels sont clairement Cela corrobore les interviews menées par ailleurs,
identifiés comme des «inconvénients» alors que où les chercheurs travaillant dans les instituts se
la sécurité de l’emploi est largement vécue comme disent « déconnectés » du système universitaire et,
un «avantage». Les avis sont partagés en ce qui con- partant, regrettent le peu d’opportunités qu’ils ont
cerne la retraite et les opportunités de promotion. de s’engager auprès des étudiants qui constituent
pourtant la « relève » scientifique.
Les scientifiques semblent relativement satis-
faits de la répartition de leur temps de travail entre L’activité de consultation est pratiquée par pres-
les différentes activités de leur vie professionnelle que la moitié du groupe. Les 21 scientifiques qui
signalent s’y consacrer y dédient entre 1 et 20%
de leur temps. La plupart d’entre eux, ainsi que 10
Tableau 5 autres chercheurs (au total 29) souhaitent accroître
Avantages et inconvénients de l’exercice de la profession ce temps d’activité (la moyenne souhaitée étant de
scientifique 9% du temps de travail). Les interviews conduites
dans le cadre de cette évaluation tendent à mon-
Vu comme Vu comme un trer que l’intérêt pour la consultance est à mettre
Eléments avantage inconvénient
en relation avec la modicité des salaires servis aux
Echelle de 9 37 chercheurs.
salaire
Développement 19 26
de carrière
Sécurité de l’em- 38 7 5.2 Les sources de financement
ploi
Avantages pro- 7 33 Les allocataires de recherche de l’IFS présents et
fessionnels passés sont, comme l’ensemble des chercheurs
Retraite 20 18 camerounais (voir section 2), très dépendants desVous pouvez aussi lire