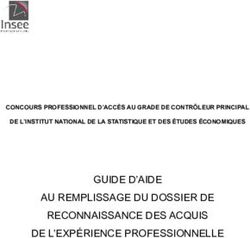LICENCE SCIENCES DU LANGAGE - Université de Lorraine
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LICENCE SCIENCES DU LANGAGE
Domaine : Sciences humaines et sociales Durée : 3 ans
Lieux d'enseignement : Nancy - Metz Accessible en : Formation initiale -
Niveau d'accès : Baccalauréat ou plus Formation continue
Les enseignements se déroulent en intégralité à Nancy ou à Metz en
fonction du choix de l’étudiant. Aucun déplacement ne se fait entre les
deux sites.
1. LES SCIENCES DU LANGAGE EN BREF
Les Sciences du langage cherchent à comprendre et à décrire
l’activité de langage à travers l’étude des langues dans leur diversité,
et sous différents aspects : fonctionnement, structure, variation et
évolution. Elles s’intéressent également à l’acquisition du langage et à
l’apprentissage et à l’enseignement des langues.
> Objectifs des études en Sciences du langage
Les objectifs de ces études sont de fournir des connaissances
indispensables à toute réflexion dans laquelle le langage joue un rôle
central. Il s'agit de décrire et d’expliquer, selon différents degrés de
spécialisation, les fonctionnements langagiers en contexte, et d'utiliser
ces compétences dans des situations pratiques. De par sa formation
et ses exigences, la discipline permet à l’étudiant d’acquérir des
compétences et des connaissances nécessaires à l’accès, après
complément d’études, à différents métiers : métiers de
l’Enseignement, de la Recherche, du Traitement Automatique des
Langues, de la traduction notamment.
> Contenu
La base de la licence est constituée par les enseignements
fondamentaux de la discipline (phonétique, phonologie, morphologie,
étude du lexique, syntaxe, sémantique, pragmatique) et par
l’acquisition de compétences méthodologiques : analyses qualitatives
et quantitatives d’unités de différents niveaux (son, mot, phrase, etc.)
et de différentes formes de discours sur divers supports, écrits (livre,
dépliant, affiche, journal, etc.) et oraux (entretien, cours, conférence,
dispute, etc.). Ces enseignements couvrent des domaines allant de la
linguistique française à l’étude de l’acquisition du langage et à la
comparaison des langues.
Cette base est complétée par des enseignements proposés dans des
disciplines connexes. A cela s’ajoutent des enseignements
transversaux : langues vivantes, initiation à la méthodologie
universitaire, ainsi que des enseignements menant à une certification
en informatique (C2i).
Page 1 sur 13A l’issue de sa licence mention Sciences du langage, l’étudiant
dispose donc d’un socle de connaissances solide en linguistique,
affiné par de la méthodologie et ses choix de préprofesionnalisation. Il
construit, au cours des trois années, un projet professionnel, et sa
formation est complétée par un perfectionnement en langues
étrangères et des notions en informatique.
4 parcours sont proposés à partir du semestre 4 (2ème semestre
de L2) :
● Apprendre et enseigner le français langue maternelle (Metz)
● Enseigner et apprendre les langues vivantes (Metz et Nancy)
● Approche de la recherche en sciences du langage (Metz et
Nancy)
● Langage, Education, Formation 1 (Nancy)
o Orthophonie
o Formateur langage oral et écrit
o Langue des signes française
o Professorat des écoles
> Et après la licence ?
Les sciences du langage constituent un ensemble d’apprentissages et
de savoirs. Ces connaissances ne s'appliquent pas directement dans
des professions. Dans la plupart des cas, vous devrez compléter votre
licence par une formation professionnelle complémentaire ou par un
master, à l’issue duquel vous aurez les compétences et les
connaissances nécessaires à votre insertion dans le monde du travail.
Les métiers, accessibles généralement à Bac+5, se regroupent dans
les trois champs suivants :
● Les métiers de l'enseignement : La licence mention
Sciences du Langage constitue une excellente formation pour
la préparation du concours de professorat des écoles. Les
débouchés se situent également, après poursuite d’études en
master de Sciences du langage, dans les métiers de
l’enseignement des langues (pour adultes, étudiants
étrangers, migrants, publics d’apprenants de français à
l’étranger), et dans la gestion de ces formations (coopération
linguistique et éducative à l’étranger, administration, édition,
institutions d’insertion pour migrants, publiques ou
associatives).
● Les métiers du champ social :
○ La licence mention Sciences du Langage fournit un
adossement universitaire intéressant pour la formation au
métier d’orthophoniste. Bien que l’inscription aux concours
d’entrée des écoles d’orthophonie ne présuppose pas, en
France et jusqu’à nouvel ordre, de formation universitaire
1
Deux cours au choix parmi les quatre proposés.
Page 2 sur 13au-delà du baccalauréat, on ne peut que recommander
aux aspirants orthophonistes de valider un diplôme
universitaire.
○ De plus, la licence de Sciences du langage vous donnera
de bonnes bases pour les métiers des pathologies du
langage (en complément avec des études de psychologie
par exemple).
○ L’enseignement de la Langue des Signes Françaises
(LSF) ainsi que la présentation des métiers en lien avec la
surdité permettent à l’étudiant d’acquérir une
sensibilisation à ce handicap, qui pourra être réinvestie
soit dans les métiers directement en lien avec une
population sourde (éducateur spécialisé, interprète, etc.),
soit afin d’accueillir correctement les personnes sourdes
(loi 2005 sur le handicap et l’accessibilité)
● Les métiers de l'ingénierie des langues : métiers de veille
technologique (recherche d'information sur le Web, analyse
informatique de documents), synthèse et reconnaissance de
la parole, production informatique de contenu écrit (traduction
ou résumés automatique, génération de textes), conception
de lexiques (bilingues, spécialisés), de terminologies, etc.
(avec poursuite d'étude dans un master "Traitement
automatique des Langues" ou "Linguistique Informatique")
> Poursuite d'études
L’étudiant pourra s’inscrire dans le Master mention Sciences du
langage et Didactique des langues, de l’Université de Lorraine, avec
deux spécialités au choix :
● Lexique, Texte, Discours
● Apprentissage et Acquisition des Langues
> Scolarité
La Licence est un diplôme national de niveau BAC + 3, sanctionnant
une formation supérieure en 3 ans (6 semestres), accessible avec un
Baccalauréat. Un diplôme de Licence se définit par un Domaine (par
exemple Sciences, Technologies, Santé), une Mention (par exemple
Écologie) et parfois une Spécialité (par exemple Gestion de la
biodiversité). Différents parcours permettent à l’étudiant d’orienter ses
choix en termes de poursuite d’études.
Une Licence est constituée de 3 années réparties en 6 semestres,
numérotés de 1 à 6. Chaque semestre obtenu équivaut à 30 crédits
européens ECTS (European Credit Transfer System).
Chaque semestre comprend un certain nombre d'Unités
d'Enseignement (UE). Une UE est composée de cours magistraux
(CM) et de travaux dirigés (TD par groupes plus restreints).
Page 3 sur 13La licence est composée :
● d’unités d’enseignements fondamentaux disciplinaires (UFD) :
enseignements fondamentaux des Sciences du Langage (voir
“contenu pédagogique”)
● d’unités d’enseignements d’ouverture (UEO), permettant à
l’étudiant d’acquérir, dans une autre discipline, des
compétences complémentaires à sa propre discipline
● d’une unité d’enseignement libre (UEL), à choisir dans une
liste proposée par l’ensemble des disciplines de l’université de
Lorraine (selon le site, Metz ou Nancy)
● d’unités d’enseignements fondamentaux transverses (UFT) : il
s’agit d’enseignements tels que langue vivante, informatique,
méthodologie de la vie universitaire, etc.
> Modalités d’inscription
Inscription en L1 pour les futurs bacheliers :
• 1ère étape : Pré-inscription à l’université sur le portail
www.admission-postbac.fr de la mi-janvier à la mi-mars.
• 2ème étape : Confirmation de l’inscription, obligatoire, dès les
résultats du bac sur : www.univ-lorraine.fr
En savoir plus sur les inscriptions :
http://www.univ-lorraine.fr/content/ouverture-des-inscriptions-en-ligne
En savoir plus sur les validations d’acquis :
http://www.fc.univ-lorraine.fr/notre-offre/validation-des-acquis-de-
lexperience-vae.html
> Contacts
UFR Sciences du langage de Nancy
Tel : 03 54 50 50 92
clsh-licence-contact@univ-lorraine.fr
UFR Lettres et Langues ( LL ) de Metz
Tel : +33 (0)3 87 31 56 41
nathalie.nocera@univ-lorraine.fr
Virginie ANDRE (responsable de la licence pour Nancy)
Tel : 03 54 50 50 99
Virginie.Andre@univ-lorraine.fr
Julie LEFEBVRE (responsable de la licence pour Metz)
Tel : 03 87 31 59 28
Julie.Lefebvre@univ-lorraine.fr
Page 4 sur 13Parcours Approche de la recherche en Sciences du langage
PRÉSENTATION
Le parcours Approche de la recherche en Sciences du langage s’adresse à tous étudiants
des domaines Sciences humaines et Sociales (SHS) et Lettres et Langues (LL) curieux
d’apprendre et de compléter leurs connaissances dans les outils théoriques, pratiques et
méthodologiques de description du langage et des langues.
Le parcours est proposé à Metz et à Nancy en L2 et L3, durant les semestres 4, 5 et 6. Il est
composé de trois unités d’enseignement (UE) de 2 x 24h chacune :
- Genres écrits et oraux des discours (genres de l’écrit ; genres de l’oral)
- Systèmes de signes (ponctuation ; sémiotique)
- Exploitation de corpus textuels numériques (interrogation et annotation de corpus
numériques pour l’analyse de la langue)
Ce parcours est conçu comme une ouverture pré-professionnalisante pour des étudiants de
toutes disciplines qui chercheraient à compléter leur domaine de compétence, en sciences
humaines comme en lettres ou en langues, par des apports de la linguistique.
POURSUITE D'ÉTUDES
Secteurs Envisageables
• Recherche
• Enseignement
• Information / communication
• Formation
Types de filières, à l’issue de la L3
• Masters (en deux ans) en Sciences du langage ou dans des disciplines connexes
• Préparations aux concours administratifs
DÉBOUCHÉS
Secteurs
• Journalisme et information média
• Traitement automatique des langues
• Traduction, interprétariat
Exemples de métiers visés, avec complément de formation
• Journaliste – rédacteur scientifique
• Rédacteur de presse
• Rédacteur, correcteur
• Traducteur
Page 5 sur 13• Concepteur de logiciel de traduction automatique, de reconnaissance vocale,
d’édition de texte…
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
UEO41 Genres écrits et oraux des discours
EC1 : Genres de l’écrit (24h)
Un enseignement sur les genres d’écrits a pour objectif principal de définir et d’illustrer les
critères distinctifs de genre et de les doter d’indicateurs linguistiques pertinents. Dans cette
optique, on peut s’aider de plusieurs oppositions (public/privé ; exclusivement verbal/pluri-
sémiotique, …) et de différents critères (lieu institutionnel d’émission, but visé, complexité de
l’objet développé, longueur relative, …).
EC2 : Genres de l’oral (24h)
De l’oral le plus spontané, ordinaire et interactif, au discours le plus élaboré et monologal, la
gamme des variétés d’oral est large. Il importe d’aider les étudiants à repérer des indices
différenciateurs pour les phénomènes les plus représentatifs (notamment interactionnels),
que ces derniers soient strictement linguistiques ou paraverbaux (indices mimo-gestuels et
intonatifs). L’enjeu est d’amener les étudiants à appréhender la variété des situations d’oral
qui sollicitent des performances langagières.
UEO51 Systèmes de signes
EC1 : Ponctuation (24h)
Les signes constituant le champ de la ponctuation, ainsi que leurs fonctions (principalement
énonciatives et syntaxiques), seront définis et illustrés. Le cadre donné sera celui d’une
conception d’abord étroite et socio-historique de la ponctuation. On envisagera ensuite le
renouvellement dont ce stock de signes fait l’objet depuis une trentaine d’années sous
l’influence, notamment, du développement de l’informatique et d’Internet, et on mesurera les
incidences de ces transformations sur la définition traditionnelle des signes de ponctuation.
EC2 : Sémiotiques (24h)
Sémiotique du récit : Le cours de sémiotique du récit présente sur le mode critique les
travaux classiques des sémioticiens de la narrativité et propose des situations de production
de discours de fiction sémiotiquement réglés.
Sémiotique de la culture : Présentation de typologies des signes (linguistiques et non
linguistiques : photographie, littérature, mode) à partir des principaux concepts de la
sémiotique. A partir d’une approche des codes et conventions culturelles, on abordera des
analyses de diverses productions symboliques contemporaines envisagées en tant que
systèmes de signes.
UEO61 Exploitation de corpus textuels numériques
Les cours ont lieu en salle informatique
EC1 : Outils d’interrogation de corpus numériques (24h)
Ce cours propose une formation pratique, qui associe manipulation de données linguistiques
et découverte d’outils informatiques accessibles par Internet (le Trésor de la Langue
française, dictionnaire informatisé et Frantext, base de données textuelles). L’étudiant sera
amené à la suite de cette présentation à constituer ses propres ensembles de données, en
vue d’analyses linguistiques.
EC2 : Annotation de corpus numériques (24h)
Page 6 sur 13Le développement croissant des documents numériques tend à généraliser l'utilisation
d'annotations pour faciliter leur gestion grâce à des outils de traitement automatisé :
extraction et recherche d'information, représentation des connaissances, indexation
automatique... Le but de cet enseignement est d’amener l’étudiant aux pratiques et
compétences répondant à ces objectifs : gérer des textes sous format numérique (problèmes
d’encodage, XML), produire et exploiter des annotations linguistiques fiables.
Page 7 sur 13Parcours Enseigner et apprendre une langue vivante
PRÉSENTATION
Le parcours Enseigner et apprendre une langue vivante s’adresse à tous les étudiants des
domaines Sciences humaines et Sociales (SHS) et Lettres et Langues (LL) curieux
d’apprendre et de compléter leurs connaissances dans les problématiques liées à
l’apprentissage, à l’acquisition, et à l’enseignement d’une langue vivante.
Le parcours est proposé à Metz et à Nancy en L2 et L3, durant les semestres 4, 5 et 6. Il est
composé de trois unités d’enseignement (UE) de 2 x 24h chacune :
- Didactique des langues vivantes (Connaissance du système graphique ; Genres de
l’oral)
- Acquisition et apprentissage (Acquisition et apprentissage : l’exemple d’une LV ;
Variations, normes et usages)
- Langue et civilisation (Civilisations et cultures ; Grammaire et métalangue)
Ce parcours est conçu comme une ouverture pré-professionnalisante pour des étudiants de
toutes disciplines qui chercheraient à compléter leur domaine de compétence, en sciences
humaines comme en lettres ou en langues, par des apports de la didactique des langues
vivantes.
POURSUITE D'ÉTUDES
Secteurs Envisageables
• Enseignement • Recherche
• Education et Formation • Information et Communication
Types de filières, à l’issue de la L3
• Masters (en deux ans) en Sciences du langage ou dans des disciplines connexes
comme les sciences de l’éducation, les sciences de l’information et de la
communication, ou les masters enseignement (ESPE) ;
• Préparations aux concours administratifs.
DÉBOUCHÉS
Secteurs
• Métiers de l’enseignement du FLE (Français langue étrangère)
o A l’étranger, les titulaires d’une licence ou d’un master comportant un
parcours « FLE » peuvent travailler dans les Alliances françaises, les instituts
culturels des ambassades, les associations, etc., avec un statut vacataire ou
contractuel.
o En France, ils peuvent enseigner le FLE à des enfants ou des adultes
d’origine étrangère dans différentes structures, de l’association à l’université,
en passant par les chambres de commerce par exemple.
• Métiers de l’enseignement des langues vivantes (autres que le FLE) : les étudiants
issus des domaines de Langues et Cultures étrangère qui suivent ce parcours
peuvent valoriser leur formation dans les secteurs suivants :
o en France, publics scolaires, universitaires et adultes dans des structures de
formation publiques ou privées.
Page 8 sur 13o A l’étranger, les étudiants pourront se prévaloir d’une double compétence FLE
+ autre LV souvent requise des enseignants du secondaire dans de nombreux
pays.
• Journalisme et information média
• Traduction, interprétariat
Exemples de métiers visés, avec complément de formation
• Enseignant de langues vivantes
• Ingénieur de formation en langues (conception de dispositifs et de ressources)
• Formateur en langues vivantes
• Journaliste – rédacteur scientifique
• Rédacteur de presse
• Rédacteur, correcteur
• Traducteur
• Concepteur de logiciel de traduction automatique, de reconnaissance vocale,
d’édition de texte…
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
UEO41 Didactique des langues vivantes
EC1 : Didactique des langues vivantes (24h)
Au plan notionnel sera présentée l’histoire des principales méthodologies de l’enseignement
des langues vivantes (méthodologie grammaire–traduction, méthodologie audio-orale,
méthodologie SGAV, approche communicative, approche actionnelle), à la lumière de leurs
différents choix théoriques : a) type de langue à enseigner (norme, langue « fondamentale »,
usages linguistiques) ; b) conception de la langue ; c) approche implicite ou explicite,
inductive ou déductive ; d) théorie de l’acquisition mise en œuvre (behaviourisme, approche
« cognitive »). Les applications consisteront à illustrer les courants présentés à partir de
référentiels et de manuels.
EC2 : Genres de l’oral (24h)
De l’oral le plus spontané, ordinaire et interactif, au discours le plus élaboré et monologal, la
gamme des variétés d’oral est large. Il importe d’aider les étudiants à repérer des indices
différenciateurs pour les phénomènes les plus représentatifs (notamment interactionnels),
que ces derniers soient strictement linguistiques ou paraverbaux (indices mimo-gestuels et
intonatifs). L’enjeu est d’amener les étudiants à appréhender la variété des situations d’oral
qui sollicitent des performances langagières.
UEO51 Acquisition et apprentissage d’une langue vivante
EC1 : Acquisition et apprentissage des langues vivantes (24h)
Au plan notionnel, cet enseignement expose les processus d’acquisition d’une langue
étrangère et les théories de l’apprentissage des langues étrangères (informations théoriques
et études de cas). Parallèlement, sous forme d’application, les étudiants se voient proposer
de suivre l’apprentissage d’une langue dans laquelle ils sont débutants, en vue d’une
réflexion sur leurs propres pratiques d’apprenants.
EC2 : Variations, normes et usages (24h)
Les différents types de variations langagières seront rappelés, définis et illustrés. Les
facteurs qui influencent ces variations – l’espace, le temps, la catégorie socioprofessionnelle,
etc. – seront d’abord illustrés isolément puis associés (variations plurifactorielles). Cette
entrée en matière permettra de mieux comprendre les phénomènes qui relèvent de la
Page 9 sur 13« norme ». Seront examinés alors les jugements normatifs, tout particulièrement du point de
vue de leur source (« institutions normatives » françaises telles que les grammaires,
l’Académie française ou les dictionnaires) de la situation (France ou francophonie) et leur
domaine d’application (l’orthographe, le lexique et la syntaxe surtout) pour envisager le poids
respectif de ces facteurs. Les « usages » du français seront définis par rapport aux notions,
fondamentales pour le français, de langue commune et/ou de langue nationale.
UEO61 Langue et civilisation
EC1 : Civilisations et cultures (24h)
La dimension interculturelle qui caractérise l’apprentissage d’une langue étrangère est
centrale, dans la mesure où sont mis en contact, par le canal de la langue étrangère elle-
même, des représentations et un mode d’appréhension du monde, qui ne sont pas
identiques à ceux de la langue maternelle. C’est pourquoi il importe de clarifier les notions de
culture et de civilisation, et d’en montrer les effets, directs ou non, sur les dimensions
interculturelles des enseignement/apprentissage de langues (culture, civilisation,
représentations). Plusieurs de ces aspects seront repris, appliqués et illustrés à partir des
manuels et des situations de classe.
EC2 : Grammaire et métalangue – didactique des LV (24h)
La notion de grammaire fait l’objet de définitions multiples qu’il convient de clarifier :
grammaire intuitive du locuteur, grammaire scolaire et explicite, jusqu’à grammaire du texte,
etc. De même seront envisagées plusieurs modèles concurrents (grammaire générative,
grammaire fonctionnelle, etc.) qui n’ont pas tous une même efficience s’agissant par
exemple de rendre compte des tours « parlés ». Mais quelle qu’elle soit, une « grammaire »
implique une métalangue dont les choix terminologiques engagent une conception des faits
de langue décrits. En complément de ces apports notionnels et théoriques, les étudiants
devront appliquer ces questions lors d’un rapport relatif à l’expérience d’apprentissage d’une
langue étrangère dont ils ont été eux-mêmes les sujets.
Page 10 sur 13Parcours Apprendre et enseigner le français langue maternelle
PRÉSENTATION
Le parcours Apprendre et enseigner le français langue maternelle s’adresse à tous les
étudiants des domaines Sciences humaines et Sociales (SHS) et Lettres et Langues (LL) qui
souhaitent une ouverture pré-professionnalisante vers les métiers de professeur des écoles
et les métiers de l’enseignement.
Le parcours est proposé à Metz en L2 et L3, durant les semestres 4, 5 et 6. Il est composé
de trois unités d’enseignement (UE) de 2 x 24h chacune :
- Le français écrit et oral (genres de l’oral ; Connaissance du système graphique)
- Acquisition et apprentissage (Acquisition et apprentissage de la langue maternelle ;
Variations, normes et usages)
- Écrit scolaire, langue et métalangue (Analyse linguistique des écrits scolaires ;
Grammaire et métalangue)
Ce parcours est conçu comme une approche pré-professionnalisante pour des étudiants de
toutes disciplines qui chercheraient à aborder l’enseignement du point de vue de l’étude de
la langue, avec les outils et les savoirs élaborés par la linguistique.
POURSUITE D'ÉTUDES
Secteurs Envisageables
• Enseignement
• Information / communication
• Formation
Types de filières, à l’issue de la L3
• Masters (en deux ans) en Sciences du langage ou dans des disciplines connexes
• Préparations aux concours administratifs
• Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) Premier
Degré (professeur des écoles) à l’École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
(ESPE).
DÉBOUCHÉS
Secteurs
• Métiers de l’enseignement et de la formation
• Métiers de la communication
• Métiers de la rédaction
Exemples de métiers visés, avec complément de formation
• Professeur des écoles
• Enseignant de français
• Rédacteur (presse, administration)
CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
UEO41 Le français écrit et oral
Page 11 sur 13EC1 : Connaissance du système graphique (24h)
En français, contrairement à ce qui se passe dans d’autres langues romanes (l’italien ou
l’espagnol), les distinctions de genre et de nombre ne sont pas réalisées à l’oral (voir par
exemple facile et faciles). Le cours reviendra sur cette opacité de l’orthographe française et
sur les raisons (morphologie, étymologie) de la non-correspondance transparente entre
phonie et graphie. Sur quelques points, on reviendra sur les facteurs historiques qui ont
amené à la notation graphique que nous connaissons aujourd’hui pour le français, ce qui
permettra d’envisager l’orthographe du français comme un phénomène socio-culturel issu
des transformations successives de la société française et de ses institutions (école,
académie, pouvoir politique…).
EC2 : Genres de l’oral (24h)
De l’oral le plus spontané, ordinaire et interactif, au discours le plus élaboré et monologal, la
gamme des variétés d’oral est large. Il importe d’aider les étudiants à repérer des indices
différenciateurs pour les phénomènes les plus représentatifs (notamment interactionnels),
que ces derniers soient strictement linguistiques ou paraverbaux (indices mimo-gestuels et
intonatifs). L’enjeu est d’amener les étudiants à appréhender la variété des situations d’oral
qui sollicitent des performances langagières distinctes.
UEO51 Acquisition et apprentissage
EC1 : Acquisition et apprentissage de la langue maternelle (24h)
L’acquisition de la langue maternelle se distingue de son apprentissage en ce sens qu’elle
suit les influences psychogénétiques du sujet parlant, alors que l’apprentissage est
davantage soumis à des facteurs qu’on qualifiera de « sociogénétiques ». C’est ainsi par
exemple que les acquisitions lexicales et les connaissances de la mémoire sémantique sont
« construites » selon des étapes et des opérations non aléatoires et identiques chez chacun.
Quelle part faut-il faire, dans ces conditions, aux apprentissages langagiers et à quelles
déterminations (socio-scolaires) sont-ils soumis ?
EC2 : Variations, normes et usages (24h)
Les différents types de variations langagières seront rappelés, définis et illustrés. Les
facteurs qui influencent ces variations – l’espace, le temps, la catégorie socioprofessionnelle,
etc. – seront d’abord illustrés isolément puis associés (variations plurifactorielles). Cette
entrée en matière permettra de mieux comprendre les phénomènes qui relèvent de la
« norme ». Seront examinés alors les jugements normatifs, tout particulièrement du point de
vue de leur source (« institutions normatives » françaises telles que les grammaires,
l’Académie française ou les dictionnaires) de la situation (France ou francophonie) et leur
domaine d’application (l’orthographe, le lexique et la syntaxe surtout) pour envisager le poids
respectif de ces facteurs. Les « usages » du français seront définis par rapport aux notions,
fondamentales pour le français, de langue commune et/ou de langue nationale.
UEO61 Écrit scolaire, langue et métalangue
EC1 : Analyse linguistique des écrits scolaires (24h)
L’analyse linguistique des écrits scolaires est conduite selon une méthode et des étapes de
travail rigoureuses, expliquées et illustrées concrètement, de telle sorte que la solidarité mais
aussi la spécificité des différents réglages (d’unités et de niveaux d’analyse) soient
perceptibles. L’enjeu est d’aider les étudiants à affiner leur capacité d’observation et
d’analyse des productions, et, ce faisant, d‘abandonner des représentations communes (sur
les fautes, l’étourderie ou le manque de motivation des élèves…) au profit d’un examen plus
minutieux et exigeant des spécificités, langagières et linguistiques, d’un écrit produit en
situation d’apprentissage.
EC2 : Grammaire et métalangue - FLM (24h)
Page 12 sur 13Un écrit scolaire est empreint de tours « parlés », dont on peut penser qu’ils ne sont pas
toujours maîtrisés ou conscients de la part des scripteurs. Le correcteur n’est pas non plus
toujours complètement maître des sources normatives de ses jugements. L’objectif sera de
clarifier la question des relations entre langue et métalangue, sous l’angle d’un examen
critique de quelques catégories, vagues ou inappropriées, des terminologies grammaticales
et linguistiques en vigueur. On cherchera à poser les rudiments d’une métalangue plus
adaptée aux enjeux de correction et d’apprentissage qui sont les siens.
Page 13 sur 13Vous pouvez aussi lire