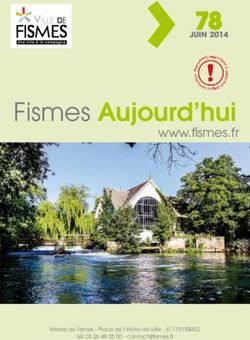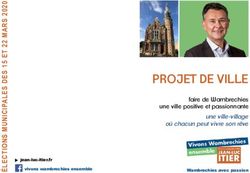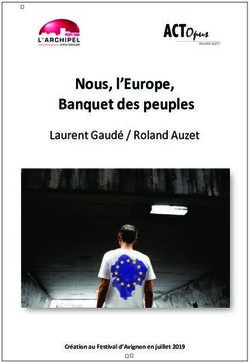Mode : les tropiques inspirent les stylistes - Journal Réforme
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Mode : les tropiques inspirent les stylistes Toucans, palmes et fleurs exotiques s’exhibent et s’entremêlent dans les collections de mode et de décoration. Depuis trois à quatre ans, le motif jungle s’y épanouit, infiltrant l’univers de l’accessoire, grimpant des chaussures jusqu’aux sacs. Hérité des podiums sans que sa filiation soit clairement établie, il a inondé les collections femme mais aussi homme, du prêt-à-porter de luxe jusqu’au streetwear (style urbain et sportif, notamment porté par les skaters). Kenzo en a fait son fonds de commerce dès ses débuts, bien qu’aujourd’hui la marque nourrisse un intérêt pour une veine « indianisante ». D’autres enseignes plus accessibles, comme la très populaire H&M, livrent aussi leur interprétation, souvent sur plusieurs pièces de leurs récentes collections, de la faune et de la flore tropicales. Ces dernières sont déclinées jusque dans l’univers de la maison. Parures de lit, torchons, coussins, vaisselle… les intérieurs foisonnent à leur tour de hampes végétales et de fruits exotiques, parfois parsemées de flamants rose, de perroquets ou de petits singes. Eastpack, le célèbre fabricant de sacs à dos, s’en est inspiré pour une série de produits en édition spéciale. L’imprimé « jungle » trouve ses sources dans les motifs des années 1970. Selon Arielle Monnerot-Dumaine, codirectrice du master Marketing & Stratégie, parcours Luxe à l’université Paris-Dauphine, il est revenu porté principalement par deux courants. D’une part, le succès de la couleur vert émeraude, celle de la palme. Mais aussi le retour des motifs imprimés, en particulier le motif floral. Enfin, la tendance « color block », qui consiste en la juxtaposition de couleurs franches, sans contours noirs, a aussi favorisé son évolution dans les collections. Comment expliquer l’engouement des consommateurs ? « La jungle, c’est le
paradis terrestre, la nature brute, des thèmes qui sont en vogue », commente Arielle Monnerot-Dumaine. C’est aussi l’exposition « Gauguin l’alchimiste », grand succès de l’hiver 2018 au Grand Palais, à Paris, comme le rappelle la professeure. Qu’elle invite au voyage ou qu’elle débarque en Occident en empruntant de nouveaux chemins, tels ceux des tendances à la mode, la fascination pour les tropiques reste intacte. Avec “La cité perdue du Dieu Singe”, plongée dans la jungle du Honduras Pendant des siècles, des explorateurs ont tenté, en vain, de retrouver la mystérieuse « Ciudad blanca » (« Cité blanche »), évoquée par le conquistador Hernán Cortés en 1525, dans une lettre à l’empereur Charles Quint. « J’ai des renseignements sur de grandes et riches contrées gouvernées par de puissants seigneurs dont le royaume dépasserait celui de Mexico en richesses et l’égalerait pour la grandeur de ses villes, la multitude de ses habitants et l’ordre qui les gouverne », écrit-il au souverain qui l’a envoyé conquérir le continent centre- américain. Mais malgré ses recherches et celles d’autres explorateurs au cours des siècles suivants, la cité de pierres blanches tant fantasmée demeure introuvable. En 1940, la polémique autour de l’existence de la « Ciudad blanca » rebondit : l’explorateur Theodore A. Morde ressort de la Mosquitia, gigantesque forêt tropicale du nord-est du Honduras, réputée impénétrable, les bras chargés
d’objets dont il affirme qu’ils proviennent de la mythique cité blanche, rebaptisée « Cité du Dieu Singe » après que des indigènes ont indiqué à Morde qu’une statue géante d’un primate y était enterrée. L’explorateur refuse de divulguer l’emplacement de l’hypothétique cité hondurienne, afin de la protéger des pillards, puis se suicide, emportant son secret dans la tombe. Des vestiges détectés Depuis toutes ces péripéties et devant l’absence de preuves, certains scientifiques ont fini par conclure que cette cité mystérieuse au cœur de la jungle amazonienne relevait plus du mythe que de la réalité. Passionné d’archéologie, le journaliste américain Douglas Preston faisait lui aussi partie des sceptiques. En 2012, le magazine américain The New Yorker l’envoie couvrir les travaux d’un petit groupe de chercheurs, dans la Mosquitia. L’équipe monte à bord d’un avion équipé d’un LIDAR (light detection and ranging), un laser ultraperfectionné, mis au point par la NASA, capable de cartographier le sol à travers l’épaisse canopée des arbres. Les explorateurs identifient trois zones (T1, T2, T3) qui indiquent clairement la présence d’anciennes constructions en formes de pyramides, d’escaliers et de terrasses, sous les feuillages. « J’étais complètement stupéfait !, se souvient Douglas Preston. C’est incroyable de se dire qu’au XXIe siècle, il est encore possible de découvrir des territoires inexplorés. Tout ça grâce au LIDAR, un outil considéré par certains archéologues comme l’une des dernières plus grandes avancées depuis le carbone 14. » Trois ans plus tard, une nouvelle expédition se met en place. Mais cette fois-ci, la petite équipe composée de documentaristes, d’archéologues, d’un botaniste et d’un anthropologue s’enfonce à pied au cœur de l’épaisse Mosquitia. Douglas Preston fait encore partie de l’aventure en tant que reporter envoyé par la National Geographic Society. « C’est une zone extrêmement difficile d’accès notamment parce que les alentours sont contrôlés par les cartels de la drogue, mais aussi pour des raisons géographiques, rappelle le journaliste. La zone est isolée par des montagnes et entourée d’une jungle extrêmement dense, sans la moindre rivière navigable. » Les aventuriers ont choisi la zone T1, la plus accessible des territoires repérés du ciel. « Sur place, le danger était bien plus important que ce que j’imaginais, confie
Douglas Preston. Dans cette forêt, l’une des dernières zones intouchées par l’homme sur cette planète, nous n’étions pas les bienvenus : entre les boues capables de vous avaler vivants, les énormes félins qui n’ont jamais vu d’humains de leur vie et qui vous fixent en se demandant s’ils vont faire de vous leur déjeuner, les serpents venimeux ou encore la pluie d’insectes qui vous tombe dessus en permanence… La nature nous a donné une belle leçon d’humilité. » Piqué par un moustique, Douglas Preston attrapera d’ailleurs la leishmaniose muco-cutanée, une maladie parfois mortelle causée par un dangereux parasite dévoreur de muqueuses. Pour autant, le journaliste ne regrette pas une seconde son aventure dans la Mosquitia et l’énorme émotion ressentie en découvrant les premiers vestiges de la cité perdue. « J’ai aperçu une énorme tête de jaguar plantée dans le sol : c’était ma première rencontre avec cette culture et j’ai eu soudain la sensation de comprendre qui étaient ces gens et d’avoir affaire à une civilisation extrêmement avancée et cultivée », rapporte Douglas Preston. Au total, quelque 500 sculptures (certaines à têtes d’animaux : vautours, serpents, jaguars, etc.) ont été retrouvées dans une cache, au pied d’une structure en forme de pyramide. Selon les archéologues, il pourrait s’agir d’une tombe au sein de laquelle tous les objets sacrés ont été rassemblés vers 1500, alors que la cité était en train de dépérir, contaminée par plusieurs maladies apportées par les colons européens, comme la rougeole, la variole ou la grippe. C’est ainsi que cette civilisation précolombienne mystérieuse, proche de celle des Mayas, aurait été exterminée. Les recherches se poursuivent pour tenter d’en savoir plus sur les habitants de la Mosquitia. « Le site va être utilisé comme laboratoire pour former toute une nouvelle génération d’archéologues honduriens et les aider à enquêter sur le patrimoine culturel indigène, explique Douglas Preston. Nous n’avons pas fini de faire des découvertes fascinantes dans cette région. »
Europe : l’image de l’islam se détériore chez les chrétiens Selon une enquête récente du Pew Research Center, 71 % des Européens de l’Ouest se définiraient comme « chrétiens ». La formulation de la question n’est pas étrangère à ce taux plus élevé par rapport à celui d’autres enquêtes. Mais des chercheurs n’excluent pas une remontée de l’identification au christianisme face à l’importance prise par l’islam dans la perception sociale des Européens. En tout cas, les chrétiens, surtout les pratiquants [assiste à un office religieux au moins une fois par mois], ont beaucoup plus que les sans-religion une image négative de l’islam et un sentiment national identitaire (même si, globalement, une majorité ou une minorité non négligeable de chrétiens ne partagent pas ces opinions). En Europe de l’Ouest, 49 % des chrétiens pratiquants et 45 % des non-pratiquants estiment que l’islam est fondamentalement incompatible avec leur culture nationale et leurs valeurs, alors que ce n’est le cas que de 32 % des sans-religion. 29 % des chrétiens pratiquants et 30 % des non-pratiquants n’accepteraient pas de musulmans dans leur famille alors que seulement 11 % des sans-religion répondent en ce sens. Si 54 % des chrétiens pratiquants et 48 % des non- pratiquants sont d’accord pour dire « notre peuple n’est pas parfait, mais notre culture est supérieure aux autres », ce n’est le cas que de 25 % des sans-religion. Si 72 % des chrétiens pratiquants et 52 % des non-pratiquants considèrent que pour être un vrai Allemand ou un vrai… d’un autre pays, il est important d’avoir un arrière-plan familial allemand ou du pays considéré, ce n’est le cas que de 42 % des sans-religion. Ni la Hongrie, ni la Pologne, ni la Grèce ni d’autres pays d’Europe centrale qui associent une dimension religieuse chrétienne à leur identité nationale ne sont inclus dans cette enquête qui ne concerne que 15 pays d’Europe de l’Ouest. Dans
ces derniers, on observerait donc également une tendance à la réaffirmation nationale et celle-ci serait particulièrement portée par les chrétiens, notamment les pratiquants. L’affichage de l’identité musulmane réactiverait l’affichage de l’identité chrétienne. Assisterions-nous à l’émergence d’un christianisme réactif ? Philippe Dessertine : “Relancer L’Europe, une nécessité de plus en plus urgente” Peut-on dire que le monde actuel est en train de passer du libéralisme au nationalisme ? Je pense qu’il faut distinguer ce qui est économique et ce qui est politique. Aujourd’hui, le monde est taraudé par la question des migrants, par la peur de la migration massive – en Europe au premier chef, mais aussi aux États-Unis. Là-bas comme ici, de nombreux pays sont tentés de fermer leurs frontières. Cela signifie, de fait, que la libre circulation du commerce, des flux financiers mais encore la libre circulation des personnes et des idées sont remises en cause de manière très forte. Cela ne heurte-t-il pas, de front, l’Union européenne, dont la philosophie, dès l’origine, consistait à favoriser les échanges, associer la libre circulation des personnes et des biens ? Je ne peux vous répondre sans rappeler quelques éléments d’Histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, les pères fondateurs de l’Europe ont cherché le moyen
de ne pas retomber dans la barbarie, l’éventuelle troisième guerre mondiale risquant de faire disparaître l’humanité. Leur démarche visait donc à protéger la paix. On comprend bien que la question militaire et la question économique étaient, dans leur esprit, tout à fait scellées. L’échec de la Communauté européenne de défense (CED) a mis à mal cette entreprise. D’un côté, les citoyens européens comme la plupart de leurs représentants ne souhaitaient pas s’inscrire dans une logique militaire, de l’autre, les États-Unis n’ont jamais voulu que l’Europe soit autonome – on s’en est rendu compte encore il y a quelques jours, à l’occasion de la réunion de l’OTAN. Cependant, l’organisation de la paix a été rendue possible. Selon quelle inspiration ? Dès les années cinquante, les pères de l’Europe se sont inspirés des deux grandes périodes de paix : l’Empire romain, la Pax Romana, dont l’une des conséquences était le développement du commerce et qui, pendant plusieurs siècles, a su assurer la paix à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières, et les années qui se sont écoulées de la fin du Moyen Âge au début des guerres de Religion. Attardons-nous sur celle-ci. En Occident chrétien, la facilité de paiement, la question monétaire permettaient les échanges. Cette responsabilité était assumée par les banquiers lombards, qui garantissaient les réserves d’or des uns et des autres au moyen de traites ou de lettres de créance et qui, par ce procédé, facilitaient les transactions – comme une préfiguration de notre monnaie unique. Or, on l’ignore souvent, le taux directeur de la Banque centrale allemande s’appelle toujours le taux lombard. C’est dire la force de l’Histoire. Vous soulignez ainsi que l’Europe a d’emblée pris racine dans le terreau financier. En effet, mais pas seulement. Durant les années cinquante ont été créées des coupes d’Europe de football. Je sais bien que ce sont là des références un brin ludiques, mais il suffit de suivre les commentaires générés par la victoire de l’équipe de France en Coupe du Monde pour imaginer la force symbolique d’une telle innovation. Les compétitions, dont le champ d’action s’étendait jusqu’en Turquie et en Israël, se divisaient en une « Coupe des clubs champions », réunissant comme son nom l’indiquait les champions de chaque nation du continent, mais aussi la coupe de
l’UEFA qui s’appelait, en ce temps-là « Coupe des villes de foire ». De quoi s’agissait-il ? En allusion transparente et formidable à l’histoire de l’Europe : au Moyen Âge, depuis la mer Noire jusqu’à Brest, des villes accueillaient des marchés, des foires, qui favorisaient les échanges commerciaux et constituaient la véritable colonne vertébrale de l’Europe. On voit par là que l’économie ne se réduit pas à la caricature que veulent en faire les partisans d’un monde replié sur lui-même. Le commerce et les échanges ne sont pas des lubies mais bien les éléments cruciaux qui font vivre la paix. Lorsqu’en 1949 a été créée la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), c’est la volonté de fonder les échanges sur les matières premières de guerre qui était à l’œuvre. En les partageant, on se donne les moyens de se prémunir de la guerre. Pourtant aujourd’hui, de très nombreux citoyens européens semblent réclamer la paix par un regain de souveraineté nationale… C’est une illusion. La peur d’être envahis, celle de perdre des repères culturels ou des valeurs animent un grand nombre de nos concitoyens européens. Derrière cette peur, on trouve la pression démographique, aujourd’hui considérable. Nous avons passé le cap des 7 milliards 600 millions d’êtres humains. Notons au passage que ceux qui préconisent la décroissance nous conduisent dans une impasse : quand chaque année cent millions d’être humains s’ajoutent à la population totale, il faut les nourrir et donc produire des richesses. Pour l’heure, cette pression démographique provoque des mouvements migratoires considérables qui expliquent le vote en faveur du Brexit et l’élection de Donald Trump. L’urgence est de leur apporter des réponses efficaces. Encore une fois, ce n’est pas le libéralisme qui crée le populisme, c’est la peur de l’étranger, la peur du migrant qui attise le désir de fermeture des pays. Le populisme est un phénomène indépendant de toute réflexion économique. Certes, mais aujourd’hui, nous constatons que nos concitoyens veulent que la souveraineté de leur nation soit renforcée, l’Union européenne se révélant trop souvent technocratique à leurs yeux…
Dès l’origine, les Pères fondateurs se sont interrogés sur la meilleure façon de répondre aux angoisses des peuples. Au cours des années 70 et 80, au moment de l’élargissement aux pays du Sud, qui étaient à l’époque très pauvres, ils ont été confrontés au risque d’un afflux de populations venant des pays migrants. Ils ont choisi de lancer des plans d’investissement massif dans les pays les plus pauvres. Aujourd’hui, cette hypothèse européenne se vérifie partout. Les gens ne migrent pas pour obtenir des avantages à court terme, mais parce qu’ils pensent que là où ils se trouvent, ils n’ont plus d’avenir. Vous souvenez-vous des panneaux affichés dans les régions les plus démunies de notre continent, voici une trentaine d’années ? « L’Europe investit pour votre avenir. » À chaque fois que l’on met en œuvre cette politique, les flux migratoires sont arrêtés, non parce que la situation est immédiatement meilleure, mais parce qu’on entre sur un chemin de progrès qui permet de construire un avenir. Comment peut-on recouvrer une identité capable de séduire la jeunesse ? Il faut faire comprendre que le dérèglement climatique est une question capitale. L’Europe doit prendre le virage de la quatrième révolution industrielle qui, comme son nom l’indique, propagera les progrès de la science dans le secteur économique et qui bouleversera la façon dont les humains vivent. Déjà, l’intelligence artificielle et les innovations dans le domaine de la santé changent en profondeur nos modes de vie. Je préside le comité prospectif du Comité 21. Nous avons commencé à formuler des propositions. La logique de production, la logique de consommation se transforment de façon radicale. Nous devons définir une stratégie. Alors que l’Europe a été leader de la réflexion scientifique et économique aux XIXe et XXe siècles, elle est trop absente des enjeux contemporains. Les grands groupes qui dominent ces marchés ne sont pas européens. Cette révolution industrielle ne peut être décidée par un État mais par la libération des énergies créatrices que nos pays possèdent. Quand la France s’est couverte de lignes de chemin de fer, ce n’est pas l’État qui l’a décidé, mais des centaines de compagnies privées qui pouvaient aller bien au-delà de ce que pouvaient prévoir les pouvoirs publics. Il en va de même de nos jours. L’État ou les États ne peuvent porter la rupture parce qu’ils ont en charge la gestion de la
continuité. Ce sont les institutions européennes qui pourront libérer les capacités d’investissement, l’innovation. Nous n’en sommes qu’au début parce que la science évolue de manière prodigieuse. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que la réponse à la crise européenne réside dans une réappropriation de souveraineté politique ? L’enjeu majeur est la survie de l’humanité. Pour cela, nous devons mettre en place un nouveau modèle économique. Peu d’économistes même comprennent à quel point la proposition d’un nouveau modèle, en réponse au problème démographique et au dérèglement climatique, est essentielle. L’enjeu n’est pas de savoir s’il faut défendre la SNCF ou construire des automobiles, mais la façon dont nous allons appréhender les « Big data », la création de robots. Certes, mais pour accueillir les migrants, ne devrions-nous pas nous poser la question de notre identité ? Pour accueillir, ne faut-il pas savoir qui l’on est ? Bien sûr… Et c’est même une dimension capitale parce que sur le plan démographique l’Europe va être, au fil des années, de plus en plus minoritaire. Alors la question se posera de savoir si une entité minoritaire sera en mesure de représenter, de soutenir, les valeurs qu’elle estime centrales et qui peuvent avoir un caractère universel, même si les autres peuples ou les autres entités politiques refusent de les reconnaître comme telles. Acceptation des différences, égalité homme-femme, liberté de circulation, tolérance, humanisme, telles sont les valeurs qui définissent notre civilisation. Pour les défendre, il est indispensable de bâtir une force militaire. Tant que nous ne disposerons pas des outils communs pour incarner une défense européenne, nous ne serons pas crédibles. De quelle façon pouvons-nous faire émerger une puissance européenne ? Je l’imagine plutôt comme une étoile. Chacune des nations qui compose l’Union européenne a des relations particulières, anciennes, avec d’autres parties du monde. L’Allemagne a des liens très forts avec la Russie, donc avec l’Asie, le Royaume-Uni peut se targuer d’une relation spéciale avec les États-Unis, l’Espagne et le Portugal ont tissé des relations très étroites avec l’Amérique latine, l’Italie déploie naturellement son rayonnement dans le bassin
méditerranéen, la France en Afrique. À mon sens, l’Europe doit mener une réflexion à long terme sur ces zones d’influence. Elle ne peut pas tout faire elle-même, c’est vrai, mais elle peut dépêcher ses « pays spécialistes » et faire en sorte que son avis soit écouté, pris en compte. Vous voyez bien qu’à travers cette problématique, on retrouve les grands débats qui ont mobilisé nos concitoyens lorsque fut présenté le projet de Constitution européenne. De quelle façon considérez-vous le poids grandissant de la Chine ? Elle sera, je n’en doute pas, la grande puissance mondiale de ce siècle. On doit lui associer l’Inde, ce qui ne sera pas sans poser des problèmes stratégiques et provoquera peut-être même des guerres, des tensions locales entre ces deux puissances. Mais sous l’angle des rapports entre l’Europe et l’Asie, la Russie peut jouer un rôle déterminant. Pour l’instant, et nous ne pouvons que le regretter, du fait de l’invasion de la Crimée, du fait du comportement de Vladimir Poutine, tout cela me semble au point mort. Le comportement du président Trump ne contrarie-t-il pas l’avènement d’une Europe unie ? Je veux d’abord dire que Donald Trump n’est pas l’imbécile que l’on décrit souvent. Très mauvais businessman, il a dilapidé l’essentiel des appuis que son père avait accumulés. Mais il est un véritable acteur politique. Il n’en demeure pas moins que sa façon d’être peut nous inquiéter : rejetant toute réflexion stratégique à moyen ou long terme, il refuse de voir le monde tel qu’il est en train d’évoluer. Ce président représente un facteur de déstabilisation important. Mais à quelque chose malheur est bon. Nous ne devons pas espérer le changer, mais utiliser ce qu’il incarne comme l’urgence de notre nécessaire évolution. L’avancée de l’Europe n’est pas une option, mais une nécessité, de plus en plus urgente.. Propos recueillis par Frédérick Casadesus
À lire Le talent et les assassins Philippe Dessertine Anne Carrière éditions 250 p., 18 €. Le monde s’en va-t-en guerre Philippe Dessertine Anne Carrière éditions 170 p., 15 €. Russie : quel bilan pour la Coupe du Monde de football 2018 ? La Coupe du Monde s’est terminée ce 15 juillet à Moscou avec la victoire de l’équipe de France. Vladimir Poutine ne cachait pas ce week-end sa joie d’être parvenu à organiser un Mondial « parfait ». C’est en tout cas ce qu’il a déclaré, vendredi 13 juillet, devant un parterre de célébrités du football et quelques délégations de diplomates étrangers réunis dans le majestueux théâtre Bolchoï pour une soirée de gala. Conscient du pouvoir de « soft power » d’un tel événement, le président russe s’est félicité d’avoir permis à des milliers de supporteurs de pouvoir « voir la Russie de leurs propres yeux et que les mythes et préjugés antirusses aient volé en éclats ». Un optimisme partagé par le président de la FIFA, Gianni Infantino : « C’est la meilleure Coupe du Monde de tous les temps, la Russie a changé », a-t-il déclaré en conférence de presse.
Il faut dire que la Russie était attendue au tournant depuis l’Euro 2014 durant lequel des dizaines de hooligans russes s’étaient battus contre des hooligans anglais. Calmés par les services de sécurité russes durant les mois précédents le Mondial, ces hordes sauvages ne se sont pas montrées. Aucun problème lié au racisme ou à l’homophobie n’a été signalé, mieux, deux « maisons de la diversité » ont été ouvertes à Moscou et Saint-Pétersbourg à l’initiative de la FIFA, permettant aux jeunes homosexuels d’assister aux matchs de foot tous ensemble. Une première en Russie. Autre succès, Vladimir Poutine avait admis s’attendre à de mauvais résultats pour son équipe nationale, la « Sbornaïa », qui s’est finalement hissée jusqu’aux quarts de finale, déclenchant des scènes de liesse jamais vues à travers toute la Russie. Bilan de l’opération : 630 000 spectateurs ont reçu un « passeport du supporteur » et 9,5 milliards d’euros ont été dépensés pour l’organisation de l’événement. Un défilé au Kremlin Absent des stades, excepté durant le premier et le dernier match, le président Poutine a laissé son discret Premier ministre Dmitri Medvedev se charger du soutien présidentiel à l’équipe nationale. Et pour cause, l’air de rien, le Mondial a fait office de séquence diplomatique pour le président russe. Un mois durant, Vladimir Poutine a rencontré une vingtaine de chefs d’État venus échanger quelques mots à l’occasion d’un match de football. La plupart des chefs d’État venus à Moscou ont fait un passage par le Kremlin avant de se rendre au stade. Le week-end de la finale, pas moins d’une douzaine de responsables politiques ont défilé au Kremlin, venus de la Palestine, du Gabon, de la Moldavie, de Hongrie, du Soudan jusqu’à la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic et Emmanuel Macron, heureux de soutenir leur équipe finaliste. Durant la dernière semaine de compétition, c’est le dossier syrien que le président russe a tenté de faire avancer en rencontrant dans sa maison de campagne à quelques kilomètres de Moscou un responsable iranien et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, dans la même journée. De quoi pousser certains observateurs à soupçonner le président Poutine d’avoir utilisé la Coupe du Monde pour s’organiser son sommet diplomatique personnel
en miroir à celui de l’OTAN organisé à Bruxelles les 11 et 12 juillet derniers. Cerise sur le gâteau, au lendemain de la finale de la Coupe, le président Poutine s’est rendu à Helsinki pour rencontrer Donald Trump. Donnant l’image d’un homme fort n’ayant « qu’à y gagner » face à un président américain ayant tout à attendre de ce sommet, Vladimir Poutine est semble-t-il sorti vainqueur de cette rencontre à en voir le tollé général déclenché par l’attitude de Donald Trump. Si la Coupe du Monde a bel et bien été une réussite en termes d’image, d’organisation et de sport, le spectacle n’a été conçu que pour être éphémère. Dans le centre de Moscou, nombreux furent les supporteurs européens à se trouver agréablement surpris par cette Russie qu’ils visitaient souvent pour la première fois. Une Russie ouverte, pleine de folie et des Russes heureux de rencontrer des étrangers. S’il faut souhaiter au pays de conserver cet esprit d’ouverture, il semble que les autorités russes comptent s’y opposer. Il n’y a pas eu de miracles, la répression ne s’est pas arrêtée pendant la Coupe du Monde. Retour à la normale Cet élan de liberté n’était qu’un « village Potemkine », une façade. Une vidéo diffusée sur Internet pendant le tournoi a rencontré un franc succès sur le web russe. On y voit un supporteur russe, une bière à la main, rue Nikolskaïa, lieu de ralliement des supporteurs dans le centre de Moscou, aborder un policier. « On pourra toujours boire de la bière dans la rue quand la Coupe se terminera ? », demande le jeune homme. « Vous êtes russe ? Alors ce sera interdit », répond le policier. Quelques jours plus tard, des hommes en civil ont menacé des actrices qui venaient de jouer un spectacle en soutien au réalisateur ukrainien en grève de la faim, Oleg Sentsov. « Ils nous attendaient à la sortie du théâtre, ils connaissaient nos noms, nos adresses. Ils m’ont dit : “Prends cette rencontre comme un avertissement” », a raconté Maria Chuprinskaya, comédienne. Lundi 16 juillet, comme une dernière preuve que la « récréation » est finie, les quatre militants des Pussy Riot qui avaient brièvement envahi le terrain ont été condamnés par un tribunal de Moscou à 15 jours d’emprisonnement. La veille, dans l’enceinte du stade, ils s’étaient fait sermonner par un policier. « Dommage
que nous ne soyons plus en 1937 », leur avait-il lancé, faisant référence aux pires heures de la grande terreur stalinienne… Panne de téléviseur à l’ambassade de France S’il y avait un championnat du monde des supporteurs, c’est sûrement la France qui arriverait en dernière position, en terme de nombre. Alors que des vagues de supporteurs d’Amérique du Sud envahissaient les 11 villes hôtes de la Coupe du Monde, il aura fallu attendre la toute fin de la compétition pour croiser les premiers Français dans les rues de Moscou. « Les Français sont du genre à faire l’aller-retour avant et après les matchs sans s’attarder sur place », confirmait un supporteur durant la dernière semaine de compétition. « Les Français ne sont pas un peuple de foot », étaient-ils plusieurs à affirmer. Environ 3 000 supporteurs français auraient accompagné leur équipe durant la finale dimanche 16 juillet quand les Croates semblaient trois fois plus nombreux. La France a pourtant la cote en Russie. Les hymnes nationaux chantés par des dizaines de supporteurs dans les longs escalators du métro de Moscou et sur la place Rouge dimanche ont fait le tour du web russe. Mais dès la demi-finale, les Français de Moscou ont jalousé les Parisiens en voyant les images des Champs-Élysées en pleine effervescence. Dimanche, ceux qui n’avaient pu assister au match dans l’enceinte se sont retrouvés dans un bar réservé aux expatriés. Du moins jusqu’à la panne du téléviseur, poussant certains à tenter d’accéder à l’ambassade qui diffusait elle aussi le match dans ses jardins. Pour certains, la soirée s’est terminée à la maison, pour les autres, dans une ambassade privée de télévision elle aussi, au coup de sifflet final, à cause d’un orage. Le tout dans une ambiance nostalgique de fin de Coupe. C’est sans aucun doute en France qu’il fallait être dimanche pour vivre cette victoire !
Victoire en Coupe du Monde de foot : merci les Bleus ! La France championne du monde de foot ! Difficile de passer à côté de cette information capitale. D’ailleurs, en été les colonnes de nos journaux sont en grande partie consacrées aux sports sous toutes leurs formes : après les tournois internationaux de tennis, la Coupe du Monde de foot avec les Bleus, nous ne resterons heureusement pas avec des pages vierges dans nos quotidiens, il y a le Tour de France ! Peut-être est -il nécessaire de faire une pause dans les mauvaises nouvelles qui nous viennent de partout dans le monde, une sorte de shabbat de l’information, une cure de distraction. Les besoins de jeu et de légèreté sont, parmi d’autres, des besoins tout à fait légitimes. Les satisfaire est essentiel à notre équilibre, personnel et communautaire. Nous ne cracherons donc pas sur la nouvelle, ni non plus sur les moments de joie qui se sont vécus un peu partout, pendant et après le match. Et je pense tout particulièrement à ce bar parisien du Xe arrondissement, le Carillon, qui avait été visé lors des attentats du 13 novembre où les gens de toutes origines, à l’image de l’équipe de France, rassemblés dans la liesse ont vibré ensemble, chanté, et ont même interprété une chanson particulièrement symbolique : I Will Survive. Se réjouir est donc une façon de résister à la peur qui conditionne tellement de nos réactions. Le faire collectivement est une force supplémentaire. Alors, merci les Bleus !
État de grâce On peut être sceptique sur la durée de cet état de grâce, de ce « black, blanc, beur » version 2018, mais rien n’interdit d’un profiter tant que ça dure. Pas sûr que le bonheur sera éternel ainsi que titre L’Équipe à sa Une, mais le souvenir, lui, peut l’être, et rappeler qu’il est possible de partager un élan commun. Comme un contrepoison à toutes les tentatives de divisions entre les groupes dont notre époque est trop souvent témoin. Comme une occasion de réaliser qu’un besoin de communion se manifeste ainsi fortement, qui pourrait prendre d’autres visages que celui du sport, la spiritualité par exemple. Oyez, oyez bonnes gens, c’est l’été et tout va bien ! D’autant nous dit-on qu’une victoire en Coupe du Monde fait monter le PIB : 0,1 % de prévision. En 98, 1,3 point de mieux pour la France. De quoi aider à répondre à la grâcieuse « invitation » de Donald Trump de passer à 4 % du PIB les contributions à l’OTAN ?… Malgré le silence estival de nos journaux, la guerre, en effet, n’est hélas jamais loin, et ce n’est pas parce qu’elle disparaît de nos écrans radar qu’elle n’existe plus. Le PIB, on peut le définir comme le résultat positif, pour les comptes de l’État, de notre travail à tous, de notre créativité, de nos services. Avons-nous envie que le meilleur de nous-même serve à l’augmentation des dépenses militaires ? Avons- nous envie de participer, de près ou de loin, à la vision que monsieur Trump a de la marche du monde ? Alors, si la victoire en Coupe du Monde pouvait servir à cela – redécouvrir l’aspect positif d’un combat commun qui unit les différences et s’en nourrit pour un meilleur résultat –, voilà qui serait un résultat encore plus réjouissant que le titre ! Engagement Voilà qui serait utile et même nécessaire. Le jeu est-il capable de modifier notre vision du monde ? Il y a des moments, comme aujourd’hui, où on pourrait le souhaiter. Le président Macron, en emmenant avec lui dans les vestiaires, à l’issue de la
finale, dimanche soir, un soldat lourdement blessé au Mali a accompli cette jonction symbolique : les Bleus ont découvert qu’ils avaient pu faire rêver des hommes qui s’engagent, autrement, au service de la France. Ils ont pu admirer en retour cet engagement-là. Une manière de rappeler aussi que la guerre existe. Chacun à sa place a donc la capacité de jouer un rôle dans la bonne marche du monde. Dans le jeu, en marge du jeu, et dans la « vraie vie » dans toutes ses dimensions, y compris spirituelle. Série “4 artistes et la Réforme” (2/4) : Dürer, défricheur du temps neuf Devant des œuvres du peintre et graveur Albrecht Dürer, on demeure d’abord un peu perplexe. On cherche ces tourments créatifs, ces violentes contradictions qui font le martyre, mais aussi la puissance attractive d’autres artistes du XVIe siècle. On ne peut se retenir, devant un art si contrôlé, d’une sorte de réserve. Comme si le cœur n’y battait pas. Mais le sculpteur Auguste Rodin, cinq siècles plus tard, après avoir ressenti sans doute la même impression, fait exploser ce préjugé : « Dürer, dit-on parfois, a une couleur dure et sèche. Non point. Mais c’est un Allemand ; c’est un généralisateur : ses compositions sont précises comme des constructions logiques ; ses personnages sont solides comme des types essentiels. »
Esprit de la Renaissance Dürer était curieux de tout ce qui pouvait étayer sa représentation de l’humain. Esprit de la Renaissance, il se passionnait de science autant que d’art. Les voyages qu’il accomplit en Europe, surtout en Italie, le portèrent à s’intéresser de près à l’étude de la géométrie et de la perspective. Peintre de portraits et d’autoportraits, de scènes religieuses ou profanes, aquarelliste flamboyant de la nature et des animaux, il demeure pourtant avant tout graveur. Peut-on déceler chez ce natif de Nuremberg une sympathie pour la révolution religieuse qui va exploser à ses côtés ? Alors même qu’elle n’est pas encore née ? Dès les gravures sur bois de l’Apocalypse à la fin du XVe siècle, on trouve chez Dürer des éléments éclairants. À 28 ans, il va plus loin que ses prédécesseurs germaniques, flamands, italiens. Une évidence éclate : il ne peut se contenter d’intégrer une tradition. Il relève la tête, secoue le joug de la filiation artistique. Accusant ainsi une discontinuité, une fracture du temps dans laquelle l’être humain revendique son droit d’existence. Dans cette série de l’Apocalypse, si l’on trouve des gravures de différentes sortes, les unes très peuplées (Les Sept Trompettes), d’autres scindées en deux (Saint Michel terrassant le dragon), d’autres enfin dont la géométrie se distribue symétriquement dans l’espace (La Vision des Sept Chandeliers), elles ont en commun le rejet d’un monde plat, sans relief. Le modelé des figures fait presque oublier les lignes de départ. Et l’ombre et la lumière libérées semblent jouer toutes seules entre elles. On retrouve ce mouvement dynamique dans les gravures sur cuivre de l’âge mûr. Mais l’artiste a atténué le contraste noir/blanc en introduisant une chatoyante gamme de tons intermédiaires du blanc gris au gris noir. Leur contenu surgit alors comme d’un creux profond. Creux serein pour Saint-Jérôme dans sa cellule, où l’on se sent invité à entrer dans une intériorité limpide. Ou creux ravagé pour la célèbre Melencolia I, son pendant. Dürer a 52 ans quand les thèses de Luther paraissent. Et plus que six ans à vivre. La plupart de ses grandes œuvres sont derrière lui. Sur le plan de la reconnaissance, la chance lui sourit depuis sa jeunesse et on ne voit pas quels lauriers combleraient une existence déjà si couronnée. Dürer manifestera un vif sentiment d’admiration pour Luther. « Si, avec l’aide de Dieu, écrit-il à Georg
Spalatin, conseiller du duc de Saxe, je peux rencontrer le Dr Martin Luther, je m’empresserai diligemment de faire son portrait et de le graver, afin de perpétuer la mémoire de ce chrétien qui m’a aidé à me libérer de grandes angoisses. » Si l’on doute de sa sincérité quand il s’adresse à l’employé d’un prince, comment douter de cette confidence, écrite en 1521 dans son journal de voyage aux Pays- Bas alors que circule le faux bruit d’un assassinat du Réformateur : « Si Luther est mort, qui désormais nous expliquera avec tant de clarté les saints Évangiles ?… Aidez-moi à pleurer cet homme illuminé et à prier Dieu d’en envoyer un autre aussi inspiré. » Cette admiration pour une personne et son message signifie-t-elle qu’il adhère à une doctrine ? « Essayer de comprendre la position religieuse de Dürer exige beaucoup de prudence, explique Pierre Vaisse, professeur honoraire d’histoire de l’art à l’université de Genève. Considéré depuis l’époque romantique comme une incarnation du génie allemand et des vertus allemandes dans un pays divisé entre deux confessions, il a été mis par ses historiens au service de leur cause. À cette absence d’objectivité s’ajoute une vision anachronique, formée par des siècles d’opposition entre deux Églises institutionnalisées. » La situation en son temps demeurait plus confuse. Il y avait Luther, ceux qui se réclamaient de lui, mais aussi ceux qui, à partir de lui, s’élançaient dans des voies nouvelles, encore plus radicales. Il semble par exemple que Dürer se soit éloigné de Luther sur le thème de l’eucharistie pour se rapprocher du Réformateur zurichois Zwingli. Tout en rejetant l’iconoclasme de ce dernier. Inéluctables excès Toute révolution, même salutaire, entraîne dans son sillage certains excès. « Les aspects sont très divers, ajoute Pierre Vaisse, depuis de pures questions théologiques jusqu’à des problèmes de politique municipale en passant par les conflits sociaux, et les réponses ne se regroupent pas en deux blocs homogènes. La correspondance de la sœur de Pirckheimer (le grand ami de Dürer), supérieure d’un couvent à Nuremberg, donne un aperçu des vexations subies lorsque la ville passa au pouvoir des luthériens. » Pirckheimer écrivait qu’ils s’étaient révélés pires que les partisans de Rome. En se détournant de la Réforme, influença-t-il Dürer ? Il l’a prétendu. Avis contrecarré par Philipp Melanchton, témoin du désaccord des deux amis sur les questions religieuses.
Christine Lazerges : “Le délit de solidarité n’a pas été abrogé” “C’est une grosse erreur de penser – ou d’écrire comme certains médias ont pu le faire – que le Conseil constitutionnel a abrogé, la semaine dernière, le délit de solidarité, qui recouvre ces actions de soutien menées par des citoyens français en direction des migrants. Il y avait jusqu’alors trois sortes de délits, au regard des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers : aide à l’entrée sur le territoire français, aide à la circulation, aide au séjour, tous susceptibles de cinq ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende. En 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait élargi les exemptions pour l’aide au séjour. Un citoyen pouvait être autorisé à héberger un étranger si l’on pouvait prouver qu’était portée atteinte à la dignité de la personne accueillie, qu’elle se trouvait dans une situation inacceptable humainement. D’où des questions du type : peut-on offrir une carte de téléphone à quelqu’un qui est privé de communiquer avec sa famille ? En revanche, il n’y avait pas d’exemptions pour l’aide à l’entrée et à la circulation. Un individu ne pouvait donc transporter dans sa voiture une femme enceinte par exemple… La grande nouveauté apportée par la décision du Conseil constitutionnel, c’est que l’aide à la circulation bénéficie désormais du même régime que l’aide au séjour et donc des mêmes exemptions. C’est pourquoi Cédric Herrou, cet agriculture venu au secours de migrants à la frontière italienne, ne peut plus être poursuivi au titre de l’aide à la circulation. En revanche,
concernant l’aide à l’entrée sur le territoire, rien ne change. Plusieurs associations dont La Cimade avaient posé une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité et nos observations leur ont été utiles. Nous avons développé trois arguments forts : il n’y a pas nécessité à poursuivre le délit d’hospitalité et de solidarité, au regard de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; selon le principe de légalité, la loi manquait de précision, et les cas d’exemption se révélaient trop flous ; la Fraternité telle qu’elle est définie aux articles 1 et 2 de notre Constitution est une composante des droits et des libertés au même titre que la Liberté et l’Égalité. Voici ce que nous avons écrit : « La Fraternité est un lien transcendant des appartenances singulières, elle est au servcie du respect de la dignité humaine. » Le Conseil constitutionnel a, lui, écrit : « La Fraternité applique la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. » Ceci est évidemment très important. Cette phrase fait de la Fraternité un principe au même titre que la Liberté ou l’Égalité. La Fraternité n’est plus seulement un objectif à atteindre ou une exigence sociétale, elle entre explicitement dans les droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel enjoint ainsi le législateur à modifier la loi. Les députés vont devoir reprendre des amendements de la loi Asile et Immigration qu’ils avaient rejetés en première lecture…” Propos recueillis par Nathalie Leenhardt cncdh.fr
Donald Trump et Vladimir Poutine, ennemis de l’Europe et de l’OTAN S’il est un objectif partagé par Donald Trump et Vladimir Poutine, c’est celui d’affaiblir l’Union européenne. Le président américain vient d’en faire la démonstration au sommet de l’OTAN, les 11 et 12 juillet, en s’en prenant avec brutalité à ses partenaires européens, mis en demeure de payer davantage pour la sécurité collective et accusés de bénéficier de la protection américaine sans contrepartie. Donald Trump ne dit plus de l’OTAN qu’elle est « obsolète », mais laisse planer le doute sur ses intentions réelles, au risque de miner la confiance. Quant au président russe, que Donald Trump a rencontré à Helsinki le 16 juillet, il entretient des relations exécrables avec l’UE, surtout depuis que celle-ci a condamné l’annexion de la Crimée et qu’elle manifeste sa volonté de contenir l’expansionnisme russe. L’Europe est devenue pour les deux présidents, unis dans la même détestation, l’ennemie qu’il faut combattre, au nom d’une logique de puissance contraire au multilatéralisme dont se prévalent les Européens. Donald Trump s’est attaqué à l’Allemagne, mêlant le contentieux commercial à la question militaire et rendant la chancelière Angela Merkel responsable de tous les malentendus. Les vingt-neuf États membres de l’OTAN ont fini par s’entendre sur une déclaration commune. En apparence, l’essentiel a été préservé. Les Européens ont confirmé leur promesse de consacrer à leur défense 2 % de leur PIB en 2024. Et Donald Trump n’a pas remis en cause la présence militaire des États-Unis en Europe. Pourtant la suspicion s’est installée. La passe d’armes laissera des traces. La rencontre d’Helsinki n’a fait que renforcer les craintes des Européens tant la complaisance du président américain à l’égard de son homologue russe a frappé les observateurs. L’occupant de la Maison-Blanche a donné satisfaction au chef du Kremlin en niant l’ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine, en dépit des affirmations de ses propres services de renseignements. Il a ainsi mis en péril une part de sa crédibilité auprès de ses alliés européens. Mauvaise passe pour la
relation transatlantique, mauvaise semaine pour l’OTAN. Tziganes protestants : le temps des grands passages L’association protestante des amis des Tziganes (APATZI) relance son projet de faciliter la rencontre entre protestants. Créée en février 2016, APATZI veut soutenir l’inclusion paisible des Tziganes dans la société. « L’idée est de développer des liens entre des groupes de Vie et Lumière [l’Église évangélique tzigane, ndlr] et des paroisses protestantes locales afin d’apporter un soutien logistique, de défendre la culture et le mode de vie du monde du voyage, notamment par rapport aux injustices vécues et d’organiser des rencontres fraternelles pour faire connaître le mouvement Vie et Lumière », explique Désiré Vermeersch, dit Nanou, administrateur de Vie et Lumière, président de l’association Action Grands Passages (AGP) qui gère les pérégrinations estivales des groupes. En effet, les voyageurs partent souvent après le premier rassemblement de Pâques et voyagent jusqu’à la mi-août pour se retrouver au second rassemblement annuel qui clôt cette période de grands passages. Travailler et évangéliser Ce nomadisme leur permet à la fois d’exercer leur métier (forains, artisans, vente sur les marchés…) et d’évangéliser les voyageurs rencontrés sur la route. Les itinéraires des plus de 120 groupes sont déclarés à l’avance auprès du ministère de l’Intérieur, des préfectures et des mairies. Pour chaque groupe, il faut compter entre trente et une centaine de caravanes.
Même si les itinéraires sont déclarés en avance, certains groupes se retrouvent en difficulté, car l’aire n’est pas adaptée, n’a pas d’eau ou d’électricité, contraignant les groupes à aller s’installer ailleurs, sur un lieu illégal. Certains élus ne les voient pas d’un bon œil. « Nous voulons mettre les gens en contact pour aider à régler ces différends et sur du long terme qu’ils se rencontrent et apprennent à se connaître », explique Séverine Faubeau, secrétaire d’APATZI. Si vous voulez entrer en contact avec un groupe près de chez vous, vous pouvez consulter les itinéraires en ligne. Site d’APATZI http://amisdestziganes.wixsite.com/amisdestziganes
Vous pouvez aussi lire