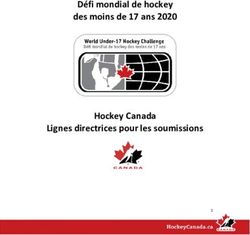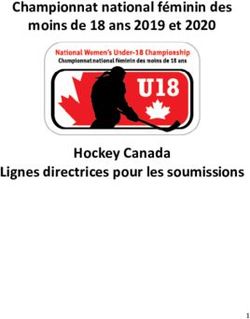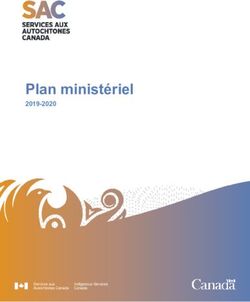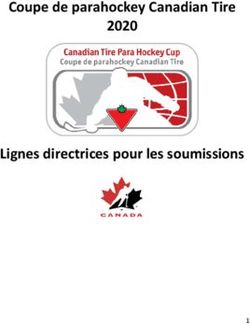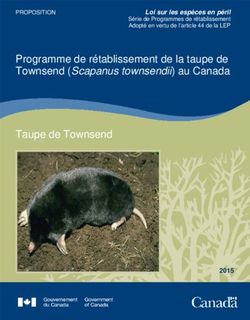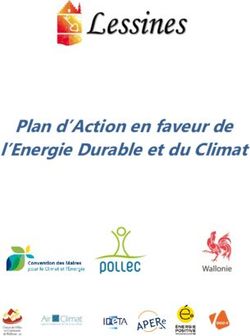Prévention et promotion de la santé Plan directeur du Conseil d'État
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
Prévention et promotion de la santé
Plan directeur du Conseil d'État
République et Canton de Neuchâtel
Document élaboré en collaboration avec la Commission cantonale de prévention
LUM Page 1 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
1. Introduction ......................................................................................................................3
1.1. Objectif du plan directeur de prévention des maladies et de promotion de la santé ............... 3
1.2. La prévention et promotion de la santé dans le Canton de Neuchâtel ..................................... 4
1.3. Processus d'élaboration du plan directeur................................................................................... 4
2. Plan directeur cantonal de promotion de la santé .............................................................5
2.1. Une inscription dans un contexte suisse ..................................................................................... 5
2.2. Intentions générales du Conseil d'État......................................................................................... 6
2.3. Les champs d'action prioritaires retenus par le Conseil d'État .................................................. 7
1. Maintenir les acquis ................................................................................................................. 9
2. Favoriser la coordination et la responsabilité multisectorielle pour la santé ....................... 9
3. Adopter des modes de vie plus sains................................................................................... 11
4. Améliorer la santé mentale.................................................................................................... 12
5. Réduire les dommages causés par l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme ............... 13
6. Faire reculer les maladies transmissibles ............................................................................ 15
7. Faire reculer les maladies non transmissibles..................................................................... 16
8. Diminuer le nombre de blessures dues aux actes de violence et aux accidents ............. 18
3. La mise en oeuvre ......................................................................................................... 20
3.1. Les acteurs et ressources humaines ......................................................................................... 20
3.2. Les ressources financières ......................................................................................................... 21
3.3. Engagement financier du Conseil d'État pour la promotion de la santé 2009-2013.............. 23
4. Suivi et évaluation ......................................................................................................... 24
5. Annexes ........................................................................................................................ 24
Annexe 1: Quelques définitions ......................................................................................................... 25
Annexe 2: Bases légales .................................................................................................................... 27
Annexe 3: Principes et valeurs de la promotion de la santé ........................................................... 28
Annexe 4: Enquêtes de santé ............................................................................................................ 29
Annexe 5: Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé .............................................................. 42
LUM Page 2 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État 1. Introduction 1.1. Objectif du plan directeur de prévention des maladies et de promotion de la santé Le présent plan directeur a pour objectif de présenter la politique du Conseil d'État en matière de prévention et de promotion de la santé. Cela se concrétise par la détermination de priorités d'action, d'objectifs et d'une stratégie d'application. Les études suisses sur la santé montrent que la santé de la population vivant en Suisse est bonne et ne cesse de s'améliorer. Cela est dû à de nombreux facteurs, dont les progrès de l'hygiène et des conditions de vie, les progrès du système de soins et le développement de la prévention. Il en est de même pour la santé de la population neuchâteloise. Cependant, force est de constater que notre canton se distingue négativement, dans les enquêtes de santé, en regard d'un certain nombre de problèmes. C'est le cas par exemple pour certains facteurs à risque (tabagisme, sédentarité) ainsi que pour des problématiques de santé psychique. On observe de même qu'une partie importante des décès précoces serait évitable et que les maladies infectieuses cèdent le pas au "mal-être" et aux problèmes à composante psychosociale. De nouvelles épidémies sont à craindre, notamment les affections liées au mode de vie (obésité, diabète, cancers, etc.). Face à cette situation, la vision biomédicale ne suffit plus pour répondre aux problèmes de santé complexes d'aujourd'hui. L'amélioration constante du système de soins (et la maîtrise de ses coûts) reste une priorité, mais n'est plus à même, seule, de garantir une amélioration de la santé de la population. Il faut agir en amont, sur les déterminants de la santé (conditions de vie et de travail, environnement, comportements individuels) La prévention des maladies et la promotion de la santé1 ont donc un rôle fondamental à jouer: on estime que la moitié des décès précoces est évitable et que les effets de la prévention et de la promotion de la santé sur la mortalité seront accompagnés par une amélioration de la santé et de la qualité de vie. De plus, chaque franc consacré à la prévention ou à la promotion de la santé dégage un retour sur investissement plus élevé que s’il est attribué au système de soins. De nombreuses initiatives locales de qualité ont déjà lieu dans le Canton de Neuchâtel. Cependant, la situation peut encore être améliorée par la mise en place d'une coordination efficace, s'appuyant sur les structures existantes. Ce rôle de coordinateur incombe à l'État par la mise en œuvre d'une politique de promotion de la santé, c'est à dire une stratégie commune visant des objectifs principaux sur lesquels s'accordent les acteurs de la promotion de la santé. L'exhaustivité en la matière est impossible à atteindre. C'est pour cette raison que des priorités claires doivent être dégagées et qu'il faut accepter, de manière transparente et assumée, que les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ne sauraient être efficaces sur tous les fronts à la fois. En développant ce plan de promotion de la santé et en clarifiant les priorités et les compétences, les acteurs de la promotion de la santé parviendront à intervenir de façon plus crédible et efficace. 1 Voir définitions en annexe 1 LUM Page 3 23 avril 2009
Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
1.2. La prévention et promotion de la santé dans le Canton de Neuchâtel
Dans notre canton, la prévention des maladies et la promotion de la santé sont inscrites dans la
Constitution comme rôle fondamental de l'État et des communes. Les domaines d'activité de la
prévention et promotion de la santé sont par ailleurs décrits dans la Loi de santé (annexe 2).
La prévention et promotion de la santé reposent également sur un certain nombre de valeurs
fondamentales, telles la solidarité, l'équité, la responsabilité individuelle et collective. Ces valeurs
sont le fondement même de la promotion de la santé et en guident les activités. Une définition des
principales valeurs reconnues se trouve en annexe 3.
Les priorités de prévention et de promotion de la santé se fondent également sur les besoins de
santé. Ces besoins peuvent être mis en lumière lors d'études épidémiologiques ou d'enquêtes de
santé auprès de la population. Les principales enquêtes permettant de connaître l'état de santé de
la population neuchâteloise sont l'Enquête suisse sur la santé, l'étude HBSC (Health Behaviour in
School Aged Children) auprès des écoliers du niveau primaire et secondaire I et l'enquête SMASH
02 (Swiss Multicenter Adolescent Health Survey) auprès des élèves du secondaire II. Quelques
brèves informations extraites de ces études peuvent être trouvées en annexe 4.
1.3. Processus d'élaboration du plan directeur
La promotion de la santé étant de la responsabilité de tous les acteurs de la société, le plan mis en
œuvre se doit de l'être en collaboration avec les partenaires concernés. Il ne saurait en aucun cas
être un texte imposé sans concertation.
Ce plan a donc fait l'objet de plusieurs phases de consultation dont notamment des entretiens et
un questionnaire auprès des acteurs du terrain et une consultation écrite auprès des chefs des
services concernés. Il a également été discuté de manière régulière avec la Commission cantonale
de prévention.
Les priorités retenues l'ont également été sur la base des critères de fréquence et de gravité des
séquelles de la maladie ainsi que de possibilités de prévention selon les connaissances actuelles.
Les activités concrètes qui découlent de ces priorités doivent également être jugées:
- pertinentes;
- économiquement faisables;
- acceptables par la population;
- respectueuses des dispositions légales;
- accessibles en termes de ressources à disposition.
Le modèle de catégorisation des résultats de Promotion santé suisse a été utilisé pour faire un
premier instantané de la situation neuchâteloise et des priorités retenues.
Les priorités seront évaluées à nouveau pour chaque législature.
LUM Page 4 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
2. Plan directeur cantonal de promotion de la santé
2.1. Une inscription dans un contexte suisse
Le Conseil d'État a clairement souhaité que le plan directeur cantonal s'inscrive dans un contexte
plus large, afin de pouvoir profiter de synergies intercantonales et de nombreux partenariats.
Le document Buts pour la santé en Suisse2 a été une première tentative d'élaboration d'une
stratégie de promotion de la santé au niveau suisse, basée sur les références de l'Organisation
mondiale de la santé. Ce document met en exergue vingt et un buts pour la santé publique en
Suisse.
De plus, Promotion Santé Suisse, la fondation suisse pour la promotion de la santé, a élaboré une
nouvelle stratégie dans laquelle sont retenus trois champs prioritaires:
• Renforcer la promotion de la santé et la prévention
• Poids corporel sain
• Santé psychique – stress
L'ensemble des objectifs cités dans ces documents est reconnu comme pertinent par le Conseil
d'État du canton de Neuchâtel. Cependant, il est impossible de mener un programme d'action
complet pour chacun d'entre eux, faute de moyens et au risque de se disperser. Il s'agit donc d'un
"objectif idéal", à long terme, poursuivi par les activités de prévention et de promotion de la santé
neuchâteloises.
Les 21 buts pour la santé en Suisse
1) Solidarité en faveur de la santé dans la région européenne
2) Équité en matière de santé
3) Démarrer la vie en bonne santé
4) Santé des jeunes
5) Vieillir en bonne santé
6) Améliorer la santé mentale
7) Faire reculer les maladies transmissibles
8) Faire reculer les maladies non-transmissibles
9) Diminuer le nombre de blessures dues aux actes de violence et aux accidents
10) Un environnement physique sain et sûr
11) Adopter des modes de vie plus sains
12) Réduire les dommages causés par l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme
13) Cadres favorables à la santé
14) Responsabilité multisectorielle pour la santé
15) Secteur de santé intégré
16) Gestion axée sur la qualité des soins
17) Financement des services de santé et allocation des ressources
18) Amélioration des ressources humaines pour la santé
19) Recherche et utilisation des connaissances pour la santé
20) Recruter des partenaires pour la santé
21) Politiques et stratégies de la santé pour tous.
Buts pour la santé en Suisse. La santé pour tous au 21e siècle, OMS Europe, SOCIETE SUISSE
DE SANTE PUBLIQUE, 2002
2
SOCIETE SUISSE DE SANTE PUBLIQUE, Buts pour la santé en Suisse. La santé pour tous au 21e siècle
(OMS Europe, 2002
LUM Page 5 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
2.2. Intentions générales du Conseil d'État
Dans le domaine de la prévention et promotion de la santé, le Conseil d'État entend renforcer trois
axes stratégiques:
v développer la prévention des maladies et la promotion de la santé;
v favoriser la responsabilité multisectorielle en matière de santé;
v favoriser le développement de partenariats et de la collaboration.
Développer la prévention des maladies et la promotion de la santé
Les maladies chroniques liées aux conditions et aux modes de vie (environnement, conditions de
travail, statut socio-économique, comportements) grèvent de manière importante les potentialités
d'amélioration de la qualité de vie et représentent un lourd fardeau financier pour la société.
L'amélioration et la planification du système de soins ne suffisent pas pour enrayer cette évolution.
Le développement de la prévention et promotion de la santé fait donc partie des priorités du
Conseil d'État. La prévention et la promotion de la santé font partie des tâches fondamentales de
la santé publique et des fonctions essentielles d’un système de santé. Le Conseil d’État confirme
cette intention par une volonté claire et la mise à disposition de moyens financiers proportionnés.
Favoriser la responsabilité multisectorielle et collective
L'impact des secteurs autres que sanitaires – emploi, environnement, éducation, social, etc.- sur
l'état de santé de la population n'est plus à démontrer. Le secteur sanitaire ne parviendra pas seul
à obtenir des améliorations notables en termes de santé; tous les acteurs de la société sont
concernés. Au niveau de l'État, tous les départements se doivent ainsi d'inscrire la promotion de la
santé parmi leurs préoccupations et l'ensemble des politiques publiques doivent tenir compte de
l'aspect sanitaire dans leur processus d'élaboration.
Conformément à la Loi de santé (800.1), la responsabilité individuelle et collective est reconnue en
matière de santé. De même que le secteur sanitaire ne doit pas se préoccuper seul de la santé de
la population, l'individu ne peut pas être tenu seul pour responsable de la dégradation éventuelle
de sa santé. Des mesures doivent être prises au niveau structurel et législatif pour permettre aux
individus de vivre dans des conditions les plus favorables possibles. Ainsi, la promotion de la santé
ne se limitera pas à des activités d'éducation à la santé axées sur les individus, mais intégrera des
aspects influant sur l'environnement et les conditions de vie et de travail.
Favoriser le développement de partenariats et de la coordination
Le souhait des autorités est que chacun, à son niveau, vise les mêmes objectifs. Canton,
communes, associations, institutions et individus sont invités à partager leurs compétences et à
coordonner leurs actions. Afin de favoriser les synergies, le Conseil d'État veillera au maintien et
au développement des espaces de coordination, notamment à travers la Commission cantonale de
prévention et de promotion de la santé.
LUM Page 6 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
2.3. Les champs d'action prioritaires retenus par le Conseil d'État
Suite aux diverses phases de consultation et de manière coordonnée avec les priorités existantes
au niveau national, le Conseil d'État a décidé de retenir huit champs d'action comme étant
prioritaires lors de la législature 2009-2012.
Principes généraux
Il s'agit de priorités générales, nécessaires à une stratégie de promotion de la santé solide.
1. Maintenir les acquis: De nombreuses activités de prévention et de promotion de la santé
existent actuellement dans le canton. Le soutien cantonal à ces activités se doit d'être maintenu.
Nous pouvons citer, parmi d'autres, les activités existantes liées à la prévention des dépendances,
à la santé sexuelle et reproductive, au soutien des parents et de la petite enfance, aux activités
d'entraide des ligues et des associations. L'article 41 de la Loi de santé est le fondement des ces
activités (voire annexe 2).
2. Favoriser la coordination et la responsabilité multisectorielle: Plusieurs organes de
coordination existent pour la promotion de la santé, notamment la commission cantonale de
prévention, la commission addictions et la commission cantonale de médecine scolaire. La
pérennité des ces commissions se doit d'être garantie et les budgets nécessaires à leur
fonctionnement maintenus. L'objectif de ces commissions est de garantir le partage d'information
et la coordination des actions. Dans le cas de la médecine scolaire, il s'agit également d'élaborer
des directives et processus de travail communs. La collaboration entre services se doit également
d'être constamment développée. La contiguïté de certaines thématiques, comme par exemple la
santé et l'environnement ou la santé au travail, en font des champs d'actions illustrant parfaitement
cette responsabilité multisectorielle.
Au niveau intercantonal, Neuchâtel participe également activement à la Commission
intercantonale de prévention et de promotion de la santé du Groupe des responsables romands de
la santé publique et à l'Association suisse des délégués à la promotion de la santé.
En vue de favoriser la responsabilité multisectorielle, le canton se tient régulièrement à jour en ce
qui concerne les études d'impact sur la santé, dans le cadre d'une plate-forme intercantonale.
Programmes prioritaires à développer
Il s'agit des thématiques que l'État souhaite développer en initiant des projets propres ou en
soutenant des actions de tiers, en coordination avec les activités déjà existantes, afin d'aboutir à
un programme global de promotion de la santé:
3. Adopter des modes de vie plus sains (but 113), avec notamment un accent principal sur
l'alimentation et l'activité physique.
4. Améliorer la santé mentale (but 6) de manière coordonnée avec le programme de Promotion
santé suisse sur la santé psychique et le stress.
5. Réduire les dommages causés par l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme (but 12),
notamment par un soutien important à la lutte contre le tabagisme.
3
Référence aux 21 buts pour la santé en Suisse, mentionnés précédemment.
LUM Page 7 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État 6. Faire reculer les maladies non-transmissibles (but 8): il s'agira, dans ce domaine, de soutenir le programme intercantonal de dépistage systématique du cancer du sein par mammographie. 7. Faire reculer les maladies transmissibles (but 7): dans ce champ, les activités de recherche et de promotion liées à la couverture vaccinale seront développées. 8. Diminuer le nombre de blessures dues aux actes de violence et aux accidents (but 9): ce champ fait l'objet d'un programme d'éducation routière sous la responsabilité du Comité d'éducation routière. Le présent plan directeur s'articule sur des champs d'action prioritaires: Principes généraux 1. Maintenir les acquis 2. Favoriser la collaboration et la responsabilité multisectorielle Programmes prioritaires à développer 3. Adopter des modes de vie plus sains (but 11) 4. Améliorer la santé mentale (but 6) 5. Réduire les dommages causés par l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme (but 12) 6. Faire reculer les maladies non-transmissibles (but 8) 7. Faire reculer les maladies transmissibles (but 7) 8. Diminuer le nombre de blessures dues aux actes de violence et aux accidents (but 9) LUM Page 8 23 avril 2009
Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
1. Maintenir les acquis
Il existe tout un ensemble d'acquis à maintenir en faveur de la santé et du bien-être de la
population neuchâteloise. Il s'agit des activités subventionnées par l'État répondant aux champs
d'application de l'article 41 de la Loi de santé:
a) l'information et l'éducation à la santé;
b) la protection maternelle et infantile;
c) la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation
professionnelle;
d) l'hygiène, la médecine et la sécurité du travail;
e) la prévention et le contrôle de l'infection;
f) la lutte contre les maladies transmissibles;
g) la lutte contre les maladies socialement coûteuses;
h) la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies;
i) la prévention des accidents.
Sont également concernées les activités de santé à l'école, telles qu'elles découlent de l'article 14
de la Loi sur les autorités scolaires. Ces dernières sont chargées de prendre toutes les mesures
utiles en matière d’hygiène (médecine scolaire et médecine dentaire scolaire). La surveillance en
est attribuée au médecin cantonal à l'article 10, lettre d, de la loi de santé.
L'objectif premier du Conseil d'État est de maintenir ces activités, tout en engageant, là où cela
s'avèrerait nécessaire, une réflexion sur les structures. Peuvent être citées à titre d'exemple, les
activités des centres de planning familial ou du Groupe d'information sexuelle et d'éducation à la
santé, le soutien à diverses ligues et associations de santé, la coordination de la médecine
scolaire, etc.
2. Favoriser la coordination et la responsabilité multisectorielle pour la santé
"Notre santé et notre bien-être ne dépendent pas seulement de la politique de la santé au sens
stricte: ils sont aussi soumis à d'autres facteurs, d'ordre sociétal, économique et écologique, qui
sont à leur tour déterminés par les politiques menées dans d'autres secteurs. C'est pourquoi,
souvent, les mesures adoptées en faveur de la promotion de la santé cèdent le pas à des
mesures ou des évolutions qui concernent d'autres secteurs politiques. Pour être efficace, la
promotion de la santé doit donc miser sur une assise politique très large, couvrant l'ensemble des
politiques sectorielles, en veillant à ce que les aspects touchant à la santé soient pris en compte
dans le cadre de projets et des décisions relevant de politiques sectorielles." 4
Cette citation montre bien à quel point, en ce qui concerne la promotion de la santé, chaque
secteur de la société ainsi que chaque citoyen est concerné.
Afin de favoriser cette prise de conscience et la participation des différents partenaires, le premier
pas est la diffusion d'informations – sur ce qu'est réellement la promotion de la santé ainsi que sur
les acteurs et activités existantes- permettant par la suite un travail de coordination et de
recherche de synergies au sein d'un réseau actif.
Ce travail de coordination se fait essentiellement au travers de la Commission cantonale de
prévention et la Commission cantonale addictions. Les commissions intercantonales de promotion
4
Lignes directrices pour une politique multisectorielle de la santé, OFSP, 3 novembre 2003
LUM Page 9 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
de la santé et d'addictions sont également à mentionner.
Au niveau scolaire, les professionnels de la santé scolaire (médecine et médecine dentaire
scolaire) sont parmi les acteurs importants de la santé, y effectuant les visites de santé, des
dépistages ainsi que certaines activités d'éducation à la santé. Par exemple, l'importance de la
médecine dentaire scolaire ne doit pas être sous-estimée, la carie dentaire étant l'une des
pathologies les plus communes de notre pays, provoquant d'importants coûts de traitement5. Une
meilleure coordination en matière de santé scolaire permettra donc dans ce domaine également
de créer des synergies importantes. Le lien devra notamment être renforcé entre les
départements en charge de ces dossiers. En ce qui concerne la santé au travail, un lien plus étroit
devra également être noué entre le domaine de la prévention et promotion de la santé et celui de
la santé et sécurité au travail.
Parallèlement, il est nécessaire de mieux comprendre l'impact des différentes décisions politiques
sur l'état de santé de la population et de l'évaluer. Une réelle politique de promotion de la santé
vise donc non seulement le secteur de la santé publique traditionnelle, mais également à favoriser
la prise en compte des aspects sanitaires dans les autres politiques publiques. La Loi de santé
neuchâteloise prévoit d'ailleurs, en son article 42 al. 3 que "dans l'accomplissement de leurs
tâches, l'État et les communes tiennent compte des objectifs de la promotion de la santé et de la
prévention."
Ce souci de veiller aux impacts sur la santé de l'ensemble des décisions importantes, quel que
soit le secteur, est à la base du développement des études d'impact sur la santé. Le but est de
faciliter la prise de décision, tout en s'assurant que les options retenues sont favorables (ou
neutres) en ce qui concerne la santé de la population.
Une réflexion est en cours à ce sujet au niveau national et intercantonal, à laquelle le Canton de
Neuchâtel gagnera à participer activement, en bénéficiant des expériences acquises et des
synergies créées.
Les mesures prioritaires sont les suivantes:
v Les mesures de promotion de la santé dépendent d'efforts multisectoriels. La
participation de nombreux partenaires est donc encouragée en vue d'un
renforcement des collaborations et des recherches de synergies.
Ceci se fera notamment par l'échange régulier d'information et des rencontres régulières
entre les différents partenaires concernés, au niveau cantonal et intercantonal et par la
participation aux processus de réflexion nationaux.
Organes privilégiés:
Commission cantonale de prévention
Commission cantonale de médecine scolaire
Commission cantonale addictions
Commission intercantonale de prévention et promotion de la santé
v Le canton participe régulièrement aux réflexions intercantonales en matière
d'études d'impact sur la santé.
5
Une étude genevoise démontre par exemple qu'en l'an 2000, la proportion d'enfants avec des dents saines
était de 70% chez les enfants de 4 ans, 50% chez les 6 ans et 30% chez les 9 et 11 ans, Evidence based
dental health promotion , Thèse de Maurice GONDIAN, Genève 2003
LUM Page 10 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
3. Adopter des modes de vie plus sains
Les modes de vie, et notamment les habitudes alimentaires et de mouvement, influent sur la
santé. Il est estimé qu'en Suisse, environ de 30% de la totalité des coûts de la santé peuvent être
attribués aux maladies résultant de l’alimentation.
Le Rapport sur la santé dans le monde, de l’OMS, 2002, classe la surcharge pondérale et
l’obésité, liées en partie à un manque d’activité physique, comme étant un des dix risques les plus
meurtriers pour la planète et parle d'une "véritable épidémie d'excès de poids et d'obésité". Au
niveau de la Suisse, une enquête6 montre que, parmi 600 enfants de 6 à 12 ans, 34% souffrent
de surcharge pondérale; 3.8% sont considérés obèses.
Il ne faut pas cependant que la problématique spécifique du poids occulte la thématique plus
globale de l'alimentation équilibrée et de son importance sur le bien-être. En effet, une fixation
trop importante sur le poids pourrait conduire à des comportements risqués tels que régimes
excessifs, troubles du comportement alimentaire voire anorexie.
Le manque d’activité physique atteint également des proportions inquiétantes. 37% de la
population suisse ne fait pas suffisamment d'activité physique. La Suisse romande est
particulièrement concernée (62% vs. seulement 27% d'inactifs en Suisse alémanique). Il est
estimé que le manque d’exercice physique est responsable de 1.4 millions de cas de maladie, de
quelques 2’000 décès et de 1.6 milliards de francs de frais de traitement directs chaque année.
La promotion de la santé, pour favoriser des modes de vie sains, se doit d'agir autant sur le
contexte structurel dans lequel les personnes vivent et évoluent que sur leurs comportements
individuels.
Les mesures prioritaires sont les suivantes:
v La population neuchâteloise est informée sur les principes d'une alimentation
équilibrée et sur l'importance de l'activité physique et les conditions nécessaires à
leur mise en oeuvre sont développées.
Partenaires privilégiés:
Fourchette Verte
Professionnels de l'éducation et de la petite enfance
Service cantonal des sports
Services communaux des sports
Professionnels de la santé scolaire
Cet objectif va dans le sens de la motion parlementaire Obésité et activité physique (04 172) ainsi
que de l'interpellation Problèmes de surcharge pondérale (obésité) dans le canton de Neuchâtel
(04 171).
Cette priorité est en lien avec l'axe stratégique Poids corporel sain de Promotion santé suisse, et
le Programme national Alimentation et Activité physique de l'Office fédérale de la santé publique.
6
ZIMMERMANN MB, HESS SY, HURRELL RF, A national study of the prevalence of overweight and obesity in 6-
12 year old Swiss children: body mass index, body-weight perceptions and goals, in Eur J Clin Nutr. 2000 Jul;
54(7):568-72; cité dans www.suissebalance.ch
LUM Page 11 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
4. Améliorer la santé mentale
Les troubles psychiques ont une importance considérable au sein de notre système de santé. Il a
été clairement démontré que les conditions de vie socio-économiques difficiles et un manque de
soutien social (isolement, faiblesse du réseau social) augmentent la densité des hospitalisations.
On estime, en Suisse, que chaque année 25% à 30% de la population générale a besoin d'un
traitement pour des troubles psychiques7. Le nombre de rentiers AI a augmenté de plus de 50%
entre 1986 et 1998, alors que pendant la même période, les cas de rentes AI dus à des
problèmes psychiques ont augmenté de plus de 100%8.
Il ressort de l'enquête suisse sur la santé que, même si de manière générale la santé psychique
de la population semble s'être améliorée entre 1997 et 2002, la santé psychique des jeunes
neuchâtelois est moins favorable que celle des autres jeunes romands. A titre illustratif, notons
que les jeunes de 15 à 34 ans sont 40.1% à avoir un faible sentiment de maîtrise de leur vie, en
regard de 26.9% de la même classe d'âge pour la Suisse romande et 20% pour la Suisse. Les
jeunes neuchâtelois seraient également plus souvent atteints de symptômes graves de
dépression que leurs homologues romands. Environ 3% des Romands de 15 à 34 ans font
mention de symptômes dépressifs, alors que c’est le cas de 10% des Neuchâtelois.
Le taux de suicide est également très élevé en Suisse en comparaison internationale. Le suicide
représente, chez les jeunes, la deuxième cause de mortalité. Il est responsable d'un cinquième à
un quart des décès chez les 15 à 25 ans. Parmi les personnes de 26 à 40 ans, le suicide
représente même la première cause de décès. En 1996, en Suisse, 29 hommes sur 100'000 et 12
femmes sur 100'000 se sont ôté la vie. Selon les estimations, entre 8'000 et 15'000 personnes
tenteraient de se suicider chaque année 9.
La santé psychique a été inscrite par la Confédération comme projet prioritaire de la Politique
nationale de la santé et est l'un des champs d'actions prioritaires de Promotion Santé Suisse.
Les mesures prioritaires sont les suivantes:
v Une consultation est initiée, à l'échelle cantonale, et un plan de promotion de la
santé mentale est élaboré.
Cette consultation permettra la détermination des besoins cantonaux en matière de santé mentale
et sera le premier pas d'un processus de priorisation et de conception d'un plan d'action
spécifique.
Partenaires privilégiés
Professionnels de la santé
Associations de personnes concernées
Associations et oeuvres d'entraide
Un lien sera instauré avec la Politique nationale suisse, notamment la Stratégie nationale visant à
protéger, promouvoir, maintenir et rétablir la santé psychique de la population suisse dans le
cadre de la Politique nationale suisse de la santé et le thème prioritaire Santé psychique – stress
de Promotion Santé Suisse.
7
SOCIETE SUISSE DE SANTE PUBLIQUE, Buts pour la santé en Suisse. La santé pour tous au 21e siècle
(OMS Europe, 2002
8
Doris SCHOPPER, 50+santé, Promotion de la santé des personnes de plus de 50 ans, document de
programme, sept.2003
9
La santé psychique en Suisse, Monitorage de l'Observatoire national de la santé, mai 2003
LUM Page 12 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
5. Réduire les dommages causés par l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme
La consommation de substances addictives est l'une des principales causes de maladie et de
décès dans les pays occidentaux. Le Canton de Neuchâtel est par ailleurs particulièrement
concerné par les dommages liés au tabagisme et la consommation d'alcool. La consommation de
ces substances par les jeunes est une source particulière d'inquiétude.
La moitié des fumeurs réguliers meurent prématurément à cause du tabac. En Suisse, le
tabagisme actif et passif est responsable de plus de 8'000 décès par année et de coûts directs et
indirects extrêmement importants 10.
Le canton de Neuchâtel présente l'incidence le plus élevé de Suisse pour le cancer pulmonaire:
20.7% de tous les cancers, contre 16.7% en Suisse11. Le 80% à 85% des cancers du poumon est
dû à la fumée.
En ce qui concerne l'alcool, la consommation générale est élevée en Suisse. Quelque 7% des
hommes et 4% des femmes sont considérés être des gros consommateurs12, proportion
significativement plus élevée en suisse romande (10% et 5% respectivement) par rapport à la
moyenne suisse13. 20% des adultes en Suisse consomment régulièrement ou ponctuellement trop
et 300'000 personnes seraient dépendantes 14. Parmi la population neuchâteloise de 11 à 16 ans,
ils étaient en 1999, le double de la moyenne suisse à boire régulièrement un apéritif (4.9% chez
les garçons et 3.4% chez les filles)15. Les données actuelles ne permettent pas de confirmer cette
tendance. Cependant, de manière générale, il est constaté que le cumul des comportements à
risque est significativement plus fréquent dans le canton de Neuchâtel qu'en moyenne suisse16.
La consommation excessive d'alcool favorise la survenue de nombreuses maladies. Il existe
également des liens bien établis entre la consommation excessive d’alcool, la violence, les
comportements sexuels à risque, les accidents de la circulation et autres, les invalidités
permanentes et les décès. En tout, l'alcool intervient dans pas moins de 10% des décès touchant
les 15 à 34 ans dans notre pays17.
En 2002, plus d'un homme sur trois et une femme sur cinq dans la tranche d’âge des 15 à 39 ans
avait consommé une drogue illégale au moins une fois dans sa vie. Le plus souvent, il s’agissait
de produits dérivés du cannabis. La comparaison de ces données avec celles de 1992 montre un
accroissement sensible du nombre de personnes ayant déjà consommé du cannabis. En ce qui
concerne l'ensemble des autres drogues illégales, on constate que la consommation est restée
relativement stable.
Le traitement et la prévention dans le domaine de l'alcool ainsi que des autres drogues est de la
responsabilité opérationnelle de la Fondation Neuchâtel Addiction. Une collaboratrice s'y occupe
spécifiquement de la coordination de la prévention. Un état des lieux, rédigé par la Commission
cantonale des addictions, rappelle les contextes et pratiques dans le canton dans le domaine des
addictions. Un bilan de ses activités et des recommandations sont également en cours de
préparation.
La prévention du tabagisme est, quant à elle, confiée par mandat à la Ligue pulmonaire
neuchâteloise, qui gère le Centre Vivre sans fumer. Les actions sont menées également en
collaboration avec la Ligue neuchâteloise contre le cancer.
10
VITALE S. et al, Le coût social de la consommation de tabac en Suisse, IRER, Université de Neuchâtel, 1998
11
Enquête sur l'état de santé de la population jurassienne et neuchâteloise, IUMSP, Lausanne, 1999
LUM Page 13 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
Les mesures prioritaires sont les suivantes:
v La lutte contre les dépendances est renforcée, notamment dans le domaine de la
consommation excessive d'alcool, le tabagisme (actif et passif) et la consommation
de drogues illégales.
La récente modification de la loi de santé votée par le Grand Conseil (novembre 2008) concernant
la protection contre le tabagisme passif va dans le sens de cet objectif, de même que les motions
parlementaires Interdiction de l'affichage en faveur du tabac et de l'alcool (02 153) du groupe
PopEcoSol et Pour une information ferme et rigoureuse sur les dangers du cannabis (02. 118)
déposée par M. Bernard Matthey.
Partenaires privilégiés
Centre neuchâtelois d'alcoologie
Vivre sans fumer
Fondation Neuchâtel Addiction
Commission cantonale addictions
Cette priorité est en lien notamment avec la Convention-cadre internationale de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour la lutte anti-tabac, le Plan national d'action alcool, le Programme
national pour la prévention du tabagisme.
12
Sont considérés "gros consommateurs" les hommes ayant une consommation quotidienne moyenne de plus de 40 gr
d'alcool pur et 20 gr pour les femmes.
13
OBSAN, La santé en Suisse romande et au Tessin en 2002, Une analyse intercantonale des données de l'Enquête
suisse sur la santé, mars 2006
14
Site de l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme, www.sfa-ispa.ch
15
Enquête sur l'état de santé de la population jurassienne et neuchâteloise, IUMSP, Lausanne, 1999
16
OBSAN, La santé en Suisse romande et au Tessin en 2002, Une analyse intercantonale des données de l'Enquête
suisse sur la santé, mars 2006
17
Site de l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme, www.sfa-ispa.ch
LUM Page 14 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
6. Faire reculer les maladies transmissibles
En Suisse, le nombre de cas de maladies transmissibles a fortement diminué au cours du 20e
siècle, grâce aux progrès de l'hygiène et du développement des vaccins et antibiotiques. De
nombreuses maladies sont actuellement sous contrôle, voire éradiquées.
Mais la vigilance reste de mise et les actions en vue de l'amélioration de la couverture vaccinale
doivent être inscrites dans la durée. Il est important de pouvoir évaluer régulièrement l'état de la
couverture vaccinale et de prendre les mesures qui s'imposent. A titre d'exemple, les données de
l'Enquête suisse de la santé révèlent que, bien que la vaccination contre la grippe soit plus
fréquente en 2002 qu’en 1997, elle n’est mentionnée que par la moitié des personnes âgées de
65 ans ou plus dans les cantons latins. Une récente enquête 18 de l'Université de Zurich, sur
mandat de l'Office fédéral de la santé publique, s'est penchée sur le taux de couverture vaccinale
de la population suisse. Cette étude met clairement en évidence que la couverture vaccinale en
Suisse en en dessous du seuil recommandé par l'OFSP et l'OMS pour garantir l'immunité de
groupe.
Au niveau de l'hygiène également, la vigilance est plus que jamais d'actualité, vu l'augmentation
régulière des infections nosocomiales et des résistances développées par certains germes. Un
plan d'action efficace se doit d'être mis sur pied pour limiter autant que possible ce phénomène.
Il existe également des maladies transmissibles pour lesquelles il n'existe aucun vaccin et pour
lesquelles d'autres moyens de prévention doivent être privilégiés, notamment l'infection
sexuellement transmissible qu'est le VIH. Des organisations de prévention existent dans le
Canton de Neuchâtel. Leur action se doit d'être continuellement soutenue. La récente
augmentation du nombre de nouvelles infections VIH confirme, ici également, que la vigilance doit
être constante.
Les mesures prioritaires sont les suivantes:
v Les efforts de lutte contre les maladies transmissibles existantes (grippe, infections
multi-résistantes, VIH, etc.) sont maintenus et L'État se prépare activement pour
l'émergence d'éventuelles nouvelles épidémies.
Partenaires privilégiés
Médecins scolaires
Institutions pour personnes âgées
Hôpitaux
Groupe Sida Neuchâtel
Groupe d'information sexuelle et d'éducation à la santé
Centres de planning familial
Cette priorité est en lien avec la Campagne nationale de prévention de la grippe de l'Office
fédérale de la santé publique, le programme romand Unis contre la grippe
18
OFSP, La couverture vaccinale en Suisse de 1999-2003, Bulletin OFSP n°19, 8 mai 2006
LUM Page 15 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
7. Faire reculer les maladies non transmissibles
En Suisse, comme à Neuchâtel, les maladies non transmissibles les plus importantes sont les
maladies cardio-vasculaires et les cancers.
En ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires, la mortalité a diminué de moitié depuis les
années 50 et nous avons, en Suisse, un des taux les plus bas par rapport à l'Europe. Malgré ce
constat réjouissant, beaucoup d'améliorations sont possibles, notamment en agissant en amont,
sur les facteurs individuels 19.
En ce qui concerne le cancer, 18'000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en Suisse
chez les hommes et 15'000 chez les femmes 20. L'homme est avant tout atteint par les cancers du
poumon (53 pour 100'000) et les femmes par le cancer du sein (29 pour 100'000)21. La mortalité
par cancer du poumon a fortement augmenté entre 1950 et 1980, pour diminuer depuis chez les
hommes alors qu'elle continue à augmenter chez les femmes. Cette pathologie est due dans 80%
à 85% des cas à la consommation de tabac. Dans le Canton de Neuchâtel, le taux de cancer du
poumon est particulièrement élevé chez les femmes, en comparaison avec le reste de la Suisse.
De plus, en Suisse, plus de 5'000 femmes sont confrontées chaque année à un diagnostic de pré-
cancer du col de l’utérus et doivent subir des examens complémentaires et/ou une intervention
chirurgicale. Chaque année en Suisse, environ 320 femmes présentent un cancer du col de
l’utérus et une centaine en décède 22. Dans le monde, il est la deuxième cause de cancer chez la
femme, juste après le cancer du sein. Le cancer de l'utérus résulte d'une infection au virus du
papillome humain, virus infectant plus de 70% de la population sexuellement active et dégénérant,
chez une femme sur 4 ou 5 environ, en pré-cancer ou cancer.
Il serait possible de prévenir une majorité des cas de cancer actuels en induisant certains
comportements et en évitant les facteurs de risque que sont le tabagisme, une alimentation non
équilibrée, un mode de vie trop sédentaire, la consommation d'alcool et les rayonnements UV 23.
Par des actions de prévention secondaire (dépistage), il est également possible de diminuer la
mortalité et d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. C'est le cas notamment pour le
cancer du sein. Les données de l’Enquête suisse sur la santé montrent que la pratique de la
mammographie est plus fréquente en Suisse romande qu’en Suisse alémanique, grâce
notamment aux programmes de dépistage.
La mesure prioritaire est la suivante:
v Les programmes de dépistage systématique du cancer du sein par mammographie
ainsi que de vaccination contre le virus du papillome humain (HPV) sont maintenus
et développés dans le canton de Neuchâtel.
Partenaires privilégiés
Professionnels de la santé
Centre de dépistage du cancer du sein BEJUNE
19
SOCIETE SUISSE DE SANTE PUBLIQUE, Buts pour la santé en Suisse. La santé pour tous au 21e siècle
(OMS Europe, 2002
20
ONCOSUISSE, Programme national contre le cancer 2005-2010, Première esquisse, mars 2004
21
SOCIETE SUISSE DE SANTE PUBLIQUE, Buts pour la santé en Suisse. La santé pour tous au 21e siècle,
OMS Europe, 2002
22
Source: www.infovac.ch
23
Doris SCHOPPER, Reto OBRIST, Programme national contre le cancer pour la Suisse, 2005-2010, ONCOSUISSE
LUM Page 16 23 avril 2009Prévention et promotion de la santé
Prévention et promotion de la santé - Plan directeur du Conseil d'État
Fédération suisse pour le dépistage du cancer du sein
Ligue neuchâteloise contre le cancer
Commission intercantonale de prévention et promotion de la santé
Cet objectif est en lien avec la Politique suisse contre le cancer, Oncosuisse et les activités de la
Ligue suisse contre le cancer
LUM Page 17 23 avril 2009Vous pouvez aussi lire