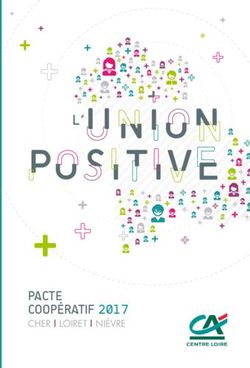Pourquoi l'Union européenne continue-t-elle à verser de l'argent à la Turquie ? - Journal Réforme
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Pourquoi l’Union européenne continue-t-elle à verser de l’argent à la Turquie ? Alors que plus personne ne croit à l’accession de la Turquie d’Erdogan à l’Union européenne, cette dernière continue à verser des subventions à Ankara.Pourquoi ? Il y a bien sûr, depuis 2016, les six milliards d’euros convenus par Bruxelles en échange du contrôle par la Turquie du flot de réfugiés syriens. Des sommes, cependant, indépendantes du processus d’adhésion. En revanche, depuis l’ouverture des négociations en octobre 2005, l’UE a donné beaucoup d’argent à Ankara, jusqu’à 40 % des fonds européens. C’est même le pays candidat qui a coûté le plus cher, en valeur absolue, à Bruxelles : 9,3 milliards d’euros budgétisés, de 2007 à 2020, sur une enveloppe totale, tous pays candidats confondus, de 23,2 milliards. L’objectif de ces soutiens financiers : aider le gouvernement turc à se mettre au « niveau européen » dans le domaine des politiques régionales, des droits et des libertés, de la politique agricole commune, etc. Or, ces dernières années, cette assistance a paru, parfois, déconnectée des négociations. Certains « chapitres » (domaines de négociation), bloqués par l’UE ou qu’Ankara a refusé d’ouvrir, ont tout de même reçu des financements. L’arrêt de ces soutiens a été plusieurs fois évoqué. En 2018, 70 millions ont même été affectés ailleurs, dans des actions en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Mais la Commission européenne a fait valoir que c’était l’un des seuls leviers d’influence
qui lui restait pour pousser la Turquie dans la voie de la démocratisation, en particulier via les projets concernant la société civile (un peu moins de 20 % des sommes allouées). Cependant, fin 2018, le Parlement européen a finalement voté la réduction de 40 % de ces subventions pour les deux années à venir. La disparition de l’État de droit en Turquie a eu raison de sa générosité. Tandis que, malgré la rhétorique clivante du président turc contre l’UE, les négociations d’adhésion ne sont, elles, toujours, ni arrêtées, ni même suspendues. Retrait des troupes américaines de Syrie : quelles conséquences ? Difficile de peser toutes les conséquences du retrait des troupes américaines du nord-est de la Syrie, annoncé mercredi 19 décembre par Donald Trump. Certaines cependant font peu de doute. La première concerne le risque, bien moindre mais encore existant, que fait peser Daech, qui a perdu 90 % de son territoire mais n’est pas complètement rayé de la carte. Sans l’appui américain, les unités combattantes kurdes, les YPG, majoritaires au sein des forces démocratiques syriennes (FDS) et en première ligne de ce combat contre les djihadistes, ne pourront plus être aussi efficaces. De plus, le retrait américain va entraîner un vide politique et militaire dans lequel ce qui reste de l’État islamique mais également ses avatars présents et à venir s’engouffreront.
Les Kurdes pourraient bien d’ailleurs chercher à négocier la libération des centaines de djihadistes étrangers qu’ils détiennent, d’autant qu’il va leur falloir mobiliser leurs forces contre l’armée turque dont l’intervention serait imminente, selon le président Tayyip Erdogan. Ankara cherche à chasser les forces kurdes autonomistes de la zone frontalière avec la Turquie afin d’y prendre pied, d’y installer ses supplétifs arabes syriens armés et de casser ainsi le continuum territorial kurde, base de repli potentiel pour les militants kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en guerre contre Ankara depuis 1984. Or jusqu’ici les Américains s’étaient opposés à toute intervention turque à l’est de l’Euphrate. Lâchés par l’allié américain, les Kurdes syriens devraient se retourner vers Moscou, tandis qu’ils n’ont jamais vraiment coupé les ponts avec le régime d’Assad. Plus de chaos à venir ? Ou un nouvel ordre syrien, dessiné par l’Iran, la Russie et la Turquie ? À certains égards, ce retrait américain signe la défaite occidentale – France incluse – en Syrie dont le premier acte s’est joué en septembre 2013, lorsque Barack Obama renonçait à frapper le régime syrien, laissant ainsi Vladimir Poutine prendre la main. Affaire Khashoggi : que cherche
donc Erdogan ? Au mépris absolu de la Turquie, sur le territoire de laquelle le crime est commis, de hauts responsables saoudiens assassinent et découpent en morceaux un opposant de premier ordre, un « traître » au palais du roi Salmane. Une humiliation que le président Erdogan va magistralement retourner à son profit, prouvant une nouvelle fois son habileté à gérer les crises. Avec un sens avéré de la dramatisation, son entourage politique puis la presse gouvernementale lâchent au compte-gouttes les détails, plus sordides les uns que les autres, qu’ils ont en leur possession. Un véritable « plan com » pour acculer Riyad à reconnaître les faits après les avoir niés. Que cherche l’homme fort de Turquie ? Quelques milliards de dollars d’investissements en échange de son silence ? Sans exclure cette hypothèse, c’est d’abord une lutte d’influence qui guide Erdogan dans la façon dont il instrumentalise cette affaire. Le monde sunnite est divisé en deux camps. D’un côté l’Arabie saoudite, les émirats arabes et l’Égypte alignés avec les Américains, certains Européens dont la France, Israël. De l’autre côté, la Turquie, membre de l’Otan, liée au Qatar, par plusieurs accords de coopération militaire. Le petit pays gazier richissime est l’objet d’un blocus économique de la part de Riyad depuis 2017 qui lui reproche de soutenir le « terrorisme », islam politique des Frères musulmans compris, alors que Riyad a appuyé l’intervention du général Sissi pour destituer le Frère musulman Morsi en 2013 en Égypte. L’affaire Khashoggi a redoré l’image de Recep Tayyip Erdogan dans la région ainsi qu’auprès de tous les musulmans du monde critiques de l’Arabie saoudite. Le voilà défenseur de la liberté d’expression et des droits de l’homme, ce qui est un comble pour l’un des chefs d’État dont les prisons comptent encore 42 journalistes professionnels, et qui réprime à grande échelle ses opposants. Mais l’important pour Erdogan, c’est son grand dessein : ranimer l’influence de l’ancien califat ottoman au Proche-Orient, en Afrique et dans les Balkans. Et grâce à cette crise, il a marqué des points.
Guerre en Syrie : pourquoi la Russie et la Turquie se rapprochent-elles ? La scène se déroule à Sotchi, station balnéaire de la mer Noire, le 17 septembre dernier. Debout aux côtés de Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine, le chef de l’État russe, déclare à la presse qu’il s’est entendu avec son homologue turc pour créer une « zone démilitarisée » dans la région d’Idlib, dernier territoire d’envergure aux mains des insurgés en Syrie. La volonté de Bachar al-Assad de reconquérir Idlib attendra encore un peu. Cet accord entre Moscou, premier soutien du régime syrien, et Ankara, principal appui des groupes rebelles de la région, est-il le signe d’une alliance en devenir ? Ce serait aller un petit peu vite en besogne. Une chose est sûre cependant : la relation entre Turquie et Russie est une clef de l’avenir de la Syrie. Tout comme l’Iran, ces deux pays entendent bien conserver leurs sphères d’influence acquises au cours du conflit, alors que les Européens semblent totalement hors jeu. « En Syrie, la Russie et la Turquie sont avant tout des alliés de circonstance, précise Fabrice Balanche, professeur à l’université Lyon-2 et spécialiste du Proche- Orient. Leur relation est une relation d’intérêt et non de confiance. » Entre ces deux nations, la méfiance ne date pas d’hier. La rivalité entre Russes et Turcs est séculaire, leur histoire commune jalonnée d’une dizaine de guerres. Cette longue histoire de rivalité se manifeste de nouveau à la faveur des révolutions arabes de 2011, saluées par Ankara et vues d’un mauvais œil par Moscou. L’opposition entre les deux capitales se cristallise sur le sort du président syrien Bachar al-Assad, qu’Erdogan appelle publiquement à renverser.
Tout s’accélère en 2015, lorsque l’armée russe est envoyée secourir le régime syrien, moribond. Le 24 novembre, c’est la stupeur : la Turquie, membre de l’OTAN, vient d’abattre un avion de chasse russe à la frontière syro-turque. Le motif ? Violation de l’espace aérien. La réaction du Kremlin ne se fait pas attendre. Dans les jours qui suivent, Moscou annonce une série de sanctions économiques contre Ankara. Moins d’un an plus tard, en août 2016, Poutine et Erdogan scellent pourtant leur réconciliation. L’assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie, le 19 décembre 2016, ne la remet pas en cause. Les deux États ont trop besoin l’un de l’autre. « Si l’armée syrienne a pu venir à bout d’Alep, en décembre 2016, c’est parce que la Turquie a cessé de ravitailler les insurgés, note Fabrice Balanche. De même, le régime a pu reconquérir l’est de la Syrie car les Turcs ont intimé aux groupes rebelles de la province d’Idlib de ne plus harceler les troupes loyalistes. En échange, les Russes ont laissé Erdogan pénétrer dans le nord de la Syrie pour y chasser les Kurdes du PYD de la région d’Afrin. C’est du donnant donnant. » Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan partagent une même vision autoritaire du pouvoir. Ils ont aussi en commun une profonde désillusion vis-à-vis de l’Occident, qui s’est muée en défiance. « La relation entre Russie et Turquie repose sur le pragmatisme, relève Julien Nocetti, chercheur à l’Ifri. Pour Poutine, éloigner de l’Occident un acteur important de l’OTAN est une victoire symbolique majeure. C’est pour lui la preuve que la vision du monde qu’il promeut est attractive, et cela le conforte dans sa volonté d’établir la Russie comme un acteur régional d’envergure. » « Erdogan veut lui aussi faire de la Turquie une puissance reconnue, digne de son prestigieux passé ottoman, ajoute la politologue Jana Jabbour. Sa diplomatie est celle d’une quête de statut ; elle veut être reconnue comme l’égale de ses partenaires européens. À défaut, Erdogan cherche à faire pression sur les Occidentaux en se rapprochant de leurs adversaires, comme la Russie. » Le coup d’État avorté de 2016 contre Erdogan, ainsi que les sanctions décidées par les États-Unis contre des proches du président turc nourrissent par ailleurs une hostilité virulente vis-à-vis de Washington dans le pays. Si les domaines de convergence sont réels, les désaccords entre Ankara et Moscou n’en restent pas moins importants, pour ne pas dire insurmontables. Leur
rapport à la religion en est une, majeure. La vision stratégique du président turc repose sur la promotion de l’islam politique, d’où un soutien actif aux Frères musulmans. Vladimir Poutine, au contraire, voit l’islam politique comme une source de déstabilisation des régimes en place, d’autant plus dangereuse que la Turquie reste influente dans les républiques russes du Caucase. Les divergences sont encore plus marquées au sujet de la Syrie. Le soutien à Bachar al-Assad a permis à la Russie de s’affirmer comme un acteur incontournable au Moyen-Orient, et de s’afficher aux yeux du monde comme un partenaire fiable. Pour la Turquie, la guerre en Syrie est une menace sécuritaire directe : Ankara, toujours en guerre avec le PKK kurde, veut à tout prix éviter la mise en place d’un Kurdistan autonome dans le nord du pays. Les Turcs doivent aussi tenir compte des millions de Syriens qui ont trouvé refuge chez eux, source d’un mécontentement interne croissant. Erdogan verrait d’un bon œil la création d’une zone d’influence turque dans le nord syrien, qu’il pourrait repeupler avec les réfugiés présents sur son sol. Pour Bachar al-Assad, qui entend bien reconquérir l’intégralité des territoires perdus, il n’en est pas question. Le flou de l’après-conflit La Turquie, enfin, rechigne à demander à ses affidés d’affronter les djihadistes d’Hayat Tahrir al-Cham, la branche syrienne d’al-Qaïda, dans la province d’Idlib, ce que souhaiterait pourtant la Russie. « S’ils sont parvenus à un modus vivendi en Syrie, Erdogan et Poutine ne peuvent masquer leurs dissensions sur l’après- conflit, résume Jana Jabbour. On le voit dans les difficultés rencontrées dans les négociations d’Astana, qui réunissent Russie, Turquie et Iran. Erdogan et Poutine s’accordent néanmoins sur un point crucial : la solution au conflit syrien doit être régionale. Les deux pays sont d’ailleurs fort hostiles à la présence américaine dans le nord-est de la Syrie, en soutien aux Kurdes du PYD. » Aujourd’hui exécrable, la relation d’Ankara avec Washington est un autre facteur de rapprochement entre Erdogan et Poutine. Mais si elle venait à s’améliorer, il y a fort à parier que les tensions entre Russie et Turquie repartiraient de plus belle. Entre les deux puissances, la méfiance reste de mise.
L’énergie, facteur de rapprochement… et de tensions Impossible d’appréhender les relations entre Turquie et Russie sans aborder la question de l’énergie. La Russie, riche en hydrocarbures, cherche à diversifier ses exportations, pour ne pas dépendre du seul marché ouest-européen. Les conflits avec l’Ukraine ces dernières années ont par ailleurs montré au Kremlin la vulnérabilité des gazoducs situés dans ce pays. La Turquie, à l’inverse, est un pays importateur : plus de la moitié de ses importations de gaz naturel provient de Russie. Même au plus fort des tensions entre Ankara et Moscou, en 2015, la Russie n’a pas utilisé la livraison de gaz comme d’une arme diplomatique, soucieuse de maintenir ses parts de marché. Malgré cela, la Turquie cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement et souhaiterait, à terme, devenir une « plaque tournante » du transit de gaz vers l’Europe, en accueillant sur son territoire du gaz en provenance d’Asie centrale, d’Azerbaïdjan et du Turkménistan notamment. C’est le projet dit de « corridor gazier sud-européen ». Moscou est vent debout contre ce projet et lui préfère un autre gazoduc, baptisé « TurkStream ». Ce dernier permettrait au gaz russe de ne plus avoir à traverser le territoire ukrainien. À lire La Turquie, l’invention d’une diplomatie émergente Jana Jabbour, CNRS éditions, 2017, 25 €.
Élections en Turquie : Erdogan, fin stratège Erdogan n’est pas un populiste comme les autres. C’est un tacticien hors pair. S’il a appelé à des élections anticipées, c’était bien parce qu’il savait qu’il les gagnerait. Le contexte était propice, avec le succès de la récente intervention militaire à Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, contre les Kurdes syriens, alliés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, en guerre contre l’état turc depuis 1984) ; et la répression interne à l’égard des cadres du Parti démocratique des peuples (HDP), de gauche, soutenant l’autonomie kurde en Turquie. Et puis à la tête de l’état, il avait – outre la maîtrise du calendrier – pu modifier la loi électorale et mobiliser des ressources publiques pour une campagne parfaitement inéquitable. Résultat : dimanche 24 juin, Erdogan a été réélu président dès le premier tour avec 52,6 % des voix. Tandis que son alliance avec le parti ultra-nationaliste d’extrême droite (MHP) a permis à son propre camp politique, le Parti de la justice et du développement (AKP), d’obtenir la majorité parlementaire : 53,7 % et 344 des 600 sièges. C’est la victoire d’un populiste qui a su reconstruire un récit national et donner une nouvelle fierté à la majeure partie de son peuple qu’il a réconcilié avec son passé ottoman. Car la grande réussite d’Erdogan, c’est d’avoir réalisé la synthèse entre le nationalisme longtemps porté par les kémalistes laïcs et souverainistes, et l’islamisme qui en fut longtemps le rival. D’où ce terme d’« islamo- nationaliste » pour le définir. Mais, à la différence des autres populistes – Trump, Orban et même Poutine – Erdogan s’est taillé un régime hyperprésidentiel à sa mesure qui entrera en vigueur lors de son intronisation. Plus de Premier ministre responsable devant le Parlement, plus de Conseil des ministres ; le nouveau Président nommera et révoquera vice-présidents et ministres à sa guise. Il est le chef de son parti et dispose de la totalité d’un pouvoir exécutif renforcé pouvant gouverner par décret. Le pouvoir judiciaire est placé sous sa tutelle. Bref, plus de poids et contre-poids qui définissent les régimes démocratiques.
Risques d’escalade au Moyen- Orient : entretien avec Fabrice Balanche Questions à Fabrice Balanche, géographe, spécialiste de la Syrie, chercheur invité à la Hoover institution de l’université de Stanford, aux États-Unis. Plus de 50 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne lundi 14 mai. Comment analysez-vous la situation à Gaza depuis plusieurs semaines ? Le contexte est d’abord celui d’un ras-le-bol d’une population palestinienne qui est dans une situation désastreuse, d’une jeunesse sans avenir, sans espoir et qui réagit au quart de tour. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a aussi pu utiliser les protestations contre le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem pour renforcer sa légitimité vis-à-vis de l’Autorité palestinienne. L’Iran se réjouit de cette situation, source d’embarras pour Tel-Aviv, qui peut toutefois compter sur le soutien des États-Unis. Mais si l’on se dirige vers une nouvelle intifada avec des dizaines de morts par jour pendant un mois, même les Américains vont finir par demander des comptes à Israël. Le 10 mai, des roquettes attribuées aux forces iraniennes ont frappé le plateau du Golan, en Israël. Quel en est l’intérêt pour Téhéran ? Occupé par Israël depuis 1967 au détriment de la Syrie, ce plateau a d’abord une forte charge symbolique. Il faut ensuite rappeler que les Israéliens ont deux
lignes rouges : ils ne veulent pas que les Iraniens ou leurs affidés s’approchent du Golan, et ils souhaitent par tous les moyens empêcher la livraison d’armes sophistiquées au Hezbollah, le mouvement politico-militaire chiite libanais soutenu par l’Iran. Pour cela, l’aviation israélienne n’hésite pas à bombarder la Syrie. Jusqu’à présent, les Iraniens s’étaient abstenus de répliquer, mais avec ces roquettes, ils souhaitent signifier à Israël qu’ils ont les moyens de riposter à une attaque en visant le territoire de l’État hébreu. Aux faucons israéliens qui estiment qu’il faut mener une guerre préventive en Syrie pour détruire le stock d’armes iraniennes et tuer dans l’œuf la menace qu’elles représentent, les Gardiens de la Révolution iraniens veulent faire comprendre qu’il est trop tard, qu’ils disposent déjà de moyens de se défendre. Pour Israël, il est aussi fondamental d’empêcher une continuité géographique entre Téhéran et Beyrouth via l’Irak et la Syrie, d’enrayer le renforcement des milices pro-iraniennes dans la région et notamment du Hezbollah. Pour les va-t- en-guerre israéliens, il faut agir maintenant. Galvanisés par le soutien de Donald Trump, ils ont le vent en poupe et comptent bien en profiter. Le Hezbollah est sorti renforcé des récentes élections législatives au Liban. En quoi est-il un acteur géopolitique majeur dans la région ? Le Hezbollah, qui dispose d’une véritable force militaire, est un acteur incontournable de la vie politique libanaise. Il faut replacer son émergence dans le cadre plus global de la construction d’un axe iranien au Moyen-Orient, surtout depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Les Iraniens maillent le territoire, en Irak, en Syrie et au Liban, d’un réseau de milices qui lui sont inféodées. Outre ces milices, Téhéran finance généreusement les campagnes de ses alliés politiques, et n’hésite pas à assassiner ses opposants. Il faut ajouter à cela un réel travail de terrain avec l’action d’organisations caritatives qui pallient les carences de l’État dans ces différents pays. Le Hezbollah, main de l’Iran au Liban, est intervenu en Syrie dès 2012 pour sauver le régime de Bachar al-Assad, une aide très efficace. Le mouvement chiite s’est considérablement renforcé grâce à cette guerre. Il est maintenant capable d’utiliser des armes sophistiquées et d’agir en coordination avec l’aviation. Il a permis de mobiliser la jeunesse chiite libanaise, de la rendre plus combattive aussi. Sur le plan régional, c’est une vraie success story pour l’Iran.
Le régime de Bachar al-Assad a-t-il gagné la guerre en Syrie ? Il reste plusieurs poches de rébellion, dans les provinces d’Idlib et de Deraa. Le groupe État islamique (ÉI) contrôle toujours quelques villages sur l’Euphrate et reste présent dans la steppe. Les Kurdes, qui administrent le nord-est du pays, ont relâché des milliers de combattants de l’ÉI membres de tribus locales, en échange d’une allégeance de ces tribus. En cas d’affaiblissement du pouvoir kurde, le retour de bâton pourrait être terrible. On n’en a pas tout à fait terminé avec l’ÉI. Assad a sauvé son régime, mais il reste de nombreux obstacles à une reconquête rapide du territoire. Les Kurdes contrôlent près d’un tiers de la Syrie, et les Turcs renforcent leur présence dans le Nord. Tout va dépendre de la décision des Américains de se maintenir ou non auprès des forces kurdes. Donald Trump a tenu des propos contradictoires à ce sujet. D’un côté, rester sur place présente le risque de se fâcher avec la Turquie, hostile aux Kurdes, et de subir des pertes militaires. De l’autre, retirer les troupes renforcera de fait l’influence de l’Iran. Chassés de leur enclave d’Afrin par l’armée turque au début de l’année, les Kurdes de Syrie ont été abandonnés par leurs alliés russe et occidentaux… Depuis deux ans, les Russes cherchent à convaincre les Kurdes de les rejoindre et de renoncer à leur alliance avec les États-Unis. Les Kurdes, qui bénéficient de livraisons d’armes américaines, ont longtemps louvoyé jusqu’à renier un engagement qu’ils avaient pris auprès des Russes et des forces loyalistes syriennes : leur livrer des champs pétrolifères et gaziers dans la région de Deir ez-Zor. Les Russes ont donc décidé de laisser Recep Tayyip Erdogan s’emparer de l’enclave d’Afrin, jusqu’ici protégée par l’aviation russe. Les Kurdes étaient persuadés que les Américains leur viendraient en aide, et qu’ils pourraient résister jusqu’à ce que la communauté internationale fasse pression sur Erdogan, car ce sont eux qui se sont battus en première ligne contre l’ÉI. Mais les Occidentaux n’ont pas bougé. Les États-Unis ne veulent pas qu’Ankara quitte l’OTAN, et Erdogan en a conscience. Il sait aussi monnayer sa capacité de blocage au sein de l’organisation atlantique auprès de Vladimir Poutine. Ce qui lui permet de réprimer en toute impunité l’opposition turque et de mener une politique d’épuration ethnique à Afrin – quelque 200 000 Kurdes ont été expulsés de chez eux.
La décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, le 8 mai dernier, rebat-elle les cartes dans la région ? L’administration Trump considère que la racine du Mal au Moyen-Orient, c’est l’Iran. Son calcul est qu’asphyxier économiquement la République islamique entraînera un mécontentement populaire qui finira par faire tomber le régime, comme ce fut le cas pour l’URSS. Barack Obama avait fait l’analyse inverse : ouvrir l’économie iranienne devait renforcer la classe moyenne, donc les réformateurs, et marginaliser les radicaux. Avec cette décision, Washington se positionne dans une logique de confrontation avec Téhéran. Cela peut constituer un frein à l’influence iranienne, pour peu que les États-Unis conservent leur présence militaire en Syrie, pour pouvoir « couper » l’axe iranien. Les Européens disposent-ils d’une réelle marge de manœuvre pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien ? Emmanuel Macron, Theresa May et Angela Merkel se sont tous rendus à Washington mais Donald Trump n’a rien voulu savoir. Les Américains ont laissé 90 jours aux entreprises européennes pour quitter l’Iran, sous peine de subir des sanctions massives. Je ne pense pas que les Européens vont prendre ce risque. La diplomatie européenne a été humiliée par la décision du président américain. Elle est aujourd’hui décrédibilisée, impuissante. Qui pourra maintenant faire confiance aux Européens ? Propos recueillis par Louis Fraysse
Des États-Unis à la Turquie, des lobbies créationnistes puissants On pense au procès de Galilée au XVIIe siècle et aux contestations de la théorie de l’évolution à la suite de la publication en 1859 de L’origine des espèces de Darwin (avec notamment, en 1925 aux États-Unis, le fameux « procès du singe » condamnant un enseignant ayant intégré la théorie de l’évolution dans ses cours de biologie). Devenue un élément fondamental des sciences du vivant admise par les biologistes du monde entier, les conflits qu’elle a suscités semblaient appartenir au passé, l’Académie pontificale des sciences ayant reconnu en 1996 que la théorie de l’évolution reposait sur trop de données convergentes pour être rejetée. Aux États-Unis, et en Europe, il y a certes un lobby créationniste protestant interprétant littéralement le récit biblique de la Genèse et croyant que le monde a bien été créé en six jours. Mais les décisions judiciaires nord-américaines ont fait barrage à tout enseignement créationniste dans les écoles publiques : le créationnisme ne pouvait pas être considéré comme une vérité scientifique. Dans la Turquie d’Erdogan, le conseil de l’enseignement supérieur vient de retirer la théorie de l’évolution des manuels de biologie au prétexte qu’elle serait contraire aux valeurs du pays. Créationnisme musulman Qu’un gouvernement d’un pays faisant partie du Conseil de l’Europe se fasse le relais d’un islam conservateur, juge de la science, est très inquiétant. En 2006, on avait déjà pris conscience de l’importance d’un créationnisme musulman avec la diffusion mondiale d’un Atlas de la Création dû à un pamphlétaire turc. Dans sa résolution dénonçant en 2007 les « dangers du créationnisme dans l’éducation », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a rappelé, tout en soulignant son respect de la liberté de croire, qu’il lui incombait de « mettre en garde contre certaines tendances à vouloir faire passer une croyance comme science » et qu’il fallait « empêcher que la croyance ne s’oppose à la science ». En ces temps où les données scientifiques les mieux établies peuvent être contestées par une opinion qui se croit mieux éclairée, la défense de la science
est un impératif démocratique. Référendum en Turquie : l’opposition peine à exister face à Erdogan Chaque jour depuis fin février, les télévisions turques diffusent les mêmes images. Une marée de drapeaux rouges, une foule de partisans en liesse et un homme sur la scène : le président Recep Tayyip Erdogan ou le Premier ministre Binali Yildirim. Chacun enchaîne deux, trois meetings dans la journée pour soutenir le projet de réforme constitutionnelle. Soumis ce 16 avril au vote des électeurs, le texte dote la Turquie d’un régime présidentiel fabriqué sur mesure pour l’actuel occupant du poste. D’un rassemblement à l’autre, le discours varie peu. Le chef de l’état promet un « pouvoir fort » au nom de la « stabilité ». Il accuse les ennemis de la Turquie – le groupe état islamique, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et l’imam Fethullah Gülen, cerveau désigné du putsch manqué de l’été 2016 – de « faire campagne pour le “non” ». Les opposants au texte sont associés aux terroristes et aux putschistes dont ils feraient le jeu. « La place de ceux qui disent “non” est aux côtés de ceux du 15 juillet », date de la tentative de putsch, martelait récemment Recep Tayyip Erdogan. « Le nouveau système mettra fin au terrorisme », affirme régulièrement le Premier ministre Yildirim.
Expliquer et dédramatiser Autre budget, autre décor. À Istanbul, au premier étage d’un café aux escaliers vétustes, une vingtaine de jeunes empilent des brochures marron – la couleur du « non » – sur les bulletins de vote. « La plupart de ceux qui voteront “oui” ne nous voient pas comme des terroristes ou des complices des terroristes, estime Göksenin Ekiyorum. Ce serait considérer la moitié du pays comme des ennemis. Ce n’est pas réaliste. » Lorsqu’il tracte aux arrêts de bus, cet architecte assure s’en tenir à deux règles : expliquer et dédramatiser. « Je dis aux gens : “Voici ce qu’il y a dans la réforme, êtes-vous d’accord ou pas ?” ». En l’occurrence, si le « oui » l’emporte le 16 avril, le chef de l’état deviendra chef de l’exécutif. Il pourra nommer et révoquer ses ministres et vice-présidents sans contrôle parlementaire, gouverner par décrets, dissoudre l’Assemblée, décider de presque toutes les nominations dans la haute magistrature et décréter l’état d’urgence quasiment lorsque bon lui semble. « Quand la personne en face de moi est un partisan du pouvoir, je lui dis que si le “non” l’emporte, rien ne changera, poursuit le militant Göksenin Ekiyorum. Cela veut dire que le gouvernement ne tombera pas, que le président sera toujours président. Contrairement à ce qu’on essaie de nous faire croire, le régime présidentiel n’est pas une question de vie ou de mort. Il y a des centaines de problèmes beaucoup plus importants, comme l’économie ou la guerre. » L’architecte a rejoint un mouvement créé fin 2016 sur les réseaux sociaux : « Biraradayiz Buradayiz » (Nous sommes ensemble, nous sommes ici). à Istanbul, le groupe organise chaque semaine des « assemblées du non » dans une vingtaine d’arrondissements. « Nous ne sommes que l’un des visages de l’opposition, concède Melis Özbakir, 25 ans, une des animatrices. Le camp du “non” ne cherche pas à mener une campagne commune. Nous sommes trop différents. » Face au bloc du « oui » emmené par le président Erdogan, le parti au pouvoir AKP (Parti de la justice et du développement) et son allié du MHP (Parti d’action nationaliste), le bloc du « non » n’en est pas un. Il mélange des nationalistes en rupture de ban, les sociaux-démocrates du CHP (Parti républicain du peuple), les prokurdes du HDP (Parti démocratique des peuples), un parti islamiste, l’extrême gauche nationaliste, l’extrême gauche communiste et une myriade de groupes de la société civile. « Chacun fait campagne dans son camp. Ce n’est pas forcément
un handicap, veut croire Melis Özbakir. Il vaut mieux qu’un frondeur du MHP explique à un autre nationaliste pourquoi il faut voter non. Il saura bien mieux le convaincre que moi, qui suis plus proche du HDP. » Cette militante se plaint surtout du manque de visibilité. Face à la machine électorale du pouvoir, l’opposition peine à accéder aux médias – plus que jamais victimes de censure et d’autocensure – et à l’espace public dans une Turquie sous état d’urgence depuis le coup d’État manqué. « Récemment, un décret-loi a mis fin à l’impartialité des radios et télévisions en supprimant l’obligation d’équilibrer le temps de parole des deux camps, s’insurge l’avocat Basar Yalti. La lutte est inégale. Dans les universités, les plus éminentes voix du “non” ont été limogées sous prétexte de lutte contre le terrorisme. C’est simple, nous faisons face au souhait ultime d’un homme : gouverner sans entrave », dénonce celui qui est aussi vice-président de l’Union des barreaux de Turquie (TBB). Le HDP prokurde, qui avait créé la surprise en s’imposant en 2015 comme deuxième force d’opposition, ne peut pas faire campagne. Treize de ses députés, dont ses codirigeants, sont en prison pour « terrorisme », accusés d’être membres du PKK kurde. « Le pouvoir espère gagner en jouant sur les peurs, observe Garo Paylan, député HDP d’Istanbul. Mais comme la peur, la colère est contagieuse. Elle monte dans la société et j’espère qu’elle se traduira dans les urnes le 16 avril. Pour l’opposition, ce référendum est une grande opportunité de se faire entendre. » Découragements Sanar Yurdatapan, célèbre musicien, ne sait trop quoi penser. « Le pire n’est jamais sûr », observe-t-il, rappelant l’incertitude qui pèse sur le résultat. « Dans mes moments de découragement, j’en arrive à me dire que si le “oui” l’emporte, au moins on sait vers où l’on va. Mais si le “non” l’emporte, personne ne sait ce qu’Erdogan sera capable de faire ! Souvenez-vous de ce qui s’est passé à l’été 2015, quand il a perdu la majorité absolue aux législatives. Il a relancé la guerre avec le PKK pour gagner les législatives anticipées de novembre 2015 », lâche cet opposant qui vient d’être condamné à quinze mois de prison avec sursis pour deux articles publiés dans Özgür Gündem, un journal prokurde désormais interdit.
Difficile de se fier aux sondages. La plupart des observateurs s’accordent à penser que la victoire – d’un camp ou de l’autre – se jouera sur le fil, parmi les indécis, en proportion non négligeable dans les rangs du pouvoir et des nationalistes. « Chaque jour, je change d’état d’esprit, confie la militante Melis Özbakir. Si le référendum avait lieu aujourd’hui, le “non” pourrait l’emporter. Mais le pouvoir n’a pas encore montré ce dont il est capable », soupire-t-elle. Je suis sûre qu’ils tenteront des manœuvres de sabotage, comme des arrestations, si le “non” se renforce. C’est à ce moment-là qu’il faudra être unis. » L’écrivaine Asli Erdogan, incarcérée pendant plus de quatre mois pour « propagande » et « appartenance » au PKK en raison de ses écrits, partage ce pessimisme. « Un langage de violence et de guerre s’est développé dans le pays, la polarisation augmente », déplore cette voix de l’opposition qui risque la prison à vie. Elle cite pour exemple la promesse du président turc, renouvelée à chaque meeting, de rétablir la peine capitale en cas de victoire au référendum. « Les foules qui l’écoutent hurlent à la mort. Normalement, on réclame du travail, la baisse des impôts… Mais la mort ?, s’étonne la romancière. Cela m’effraie. La Turquie a un besoin urgent de démocratie, de dialogue, de paix. Je n’en vois aucun signe. » Les Turcs et l’Europe, une relation ambivalente « Une alliance de croisés ». C’est ainsi que Recep Tayyip Erdogan a qualifié l’Union européenne dans un discours tenu le 2 avril à Ankara, à deux semaines du référendum sur la réforme constitutionnelle de la Turquie. Quelques jours plus
tôt, le président turc comparait l’UE à « l’Europe médiévale qui était l’ennemie des Turcs et de l’islam ». Pour nourrir sa campagne, le président turc ne cesse de faire appel à l’Histoire, avec une constante : par essence, l’Europe est l’ennemie de la Turquie. Au regard du passé, cependant, cela n’a rien d’une évidence. Dès la fin du XVe siècle, l’Empire ottoman contrôle une grande partie de l’Europe du Sud, de la Grèce aux Balkans. Ces territoires ne sont pas des périphéries marginalisées. « Les historiens ottomanistes des XVIe et XVIIe siècles parlaient de “provinces centrales” pour désigner l’Anatolie et les pays balkaniques, par opposition aux provinces arabes ou aux États vassaux du Caucase, note Nicolas Vatin, directeur de recherche au CNRS et historien de l’Empire ottoman. Dès le XVe siècle, la Porte entre dans le jeu diplomatique des puissances européennes, notamment en Italie. » Récits de voyageurs En 1536, le sultan Soliman le Magnifique, rival de l’empereur Charles Quint, scelle une alliance avec le chrétien François Ier. Une entente qui durera, bon an mal an, plus de deux siècles. Dans l’Europe chrétienne, l’image du Turc n’en est pas moins exécrable. Les érudits contemporains de l’avance turque en Europe les dépeignent en barbares dépourvus de toute notion de civilisation et de morale. Dans les siècles qui suivent, un nombre croissant de voyageurs italiens, germaniques ou français se rendent dans l’Empire. Leurs témoignages, qui soulignent la discipline des soldats ou l’efficacité du système judiciaire, sont autant de moyens pour ces chroniqueurs chrétiens de faire passer un message : louer l’autre, le Turc, c’est en miroir critiquer les siens. Rares sont en revanche les Ottomans musulmans à pouvoir voyager dans les États chrétiens. L’échec du siège de Vienne, en 1683, marque la fin de l’expansion ottomane en Europe. Le siècle suivant, la Porte se voit menacée par les ambitions des tsars russes. Mais à l’orée du XIXe siècle, l’Empire ottoman est toujours européen. « La Roumélie – la Turquie d’Europe – rassemble alors des provinces parmi les plus riches de l’Empire, et des villes parmi les plus dynamiques, comme Salonique, rappelle François Georgeon, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l’Empire ottoman. Les Jeunes Turcs, qui prendront le pouvoir à Istanbul en 1908, seront d’ailleurs originaires de la Turquie d’Europe. »
Mais en moins d’un siècle, du fait de la poussée combinée des mouvements de libération nationale et des appétits des puissances européennes, l’Empire perd la quasi-totalité de ses territoires européens, de la Grèce, en 1830, à l’Albanie et à la Macédoine en 1913. Le XIXe siècle marque aussi l’emprise croissante des puissances européennes sur l’Empire ottoman. En échange de leur soutien militaire à Istanbul, notamment au cours de la guerre de Crimée (1854-1856), elles obtiennent son ouverture au libéralisme économique. S’érigeant, non sans cynisme, en protecteurs des minorités chrétiennes, Français, Russes et Britanniques exercent de fait une ingérence dans les affaires intérieures de l’Empire. Ce mouvement est accompagné, tout au long du siècle, par la présence de nombreux Européens – commerçants, aventuriers, conseillers, missionnaires, banquiers ou archéologues – dans les grandes villes du Levant. Une présence qui entraîne une certaine « occidentalisation » du mode de vie, dans le vêtement ou dans les manières de table. Moderniser l’Empire Conscients de la supériorité technique, industrielle et administrative des puissances européennes, les dirigeants de l’Empire ottoman, qualifié « d’homme malade de l’Europe » par le tsar Nicolas Ier, souhaitent à tout prix moderniser leur État. « Cette modernisation, cependant, ne signifie pas reprendre à son compte les valeurs de l’Occident, rapporte François Georgeon. Ziya Gökalp, le maître à penser de la Turquie moderne, distinguait la “civilisation”, qui concernait le domaine des techniques, et la “culture”, qui exprimait les valeurs nationales et spirituelles. Les élites devaient porter la première, alors que le peuple était dépositaire de la seconde. Cela a conduit les élites ottomanes à vanter le Japon de l’ère Meiji, exemple à leurs yeux d’un État modernisé sans avoir eu à sacrifier son identité nationale. » Après l’effondrement de l’Empire ottoman, à la fin de la Première Guerre mondiale, Mustapha Kemal Atatürk, premier président de la république de Turquie, n’aura de cesse de vouloir ancrer son pays « dans la famille des nations civilisées », en lorgnant pour cela vers l’Europe. Adoptés en 1926, les nouveaux codes civil et pénal turcs s’inspirent ainsi du code civil suisse et du code pénal italien, alors que le code de commerce est lui issu de la législation française. De
même, rappelle François Georgeon, l’adoption en 1928 de l’alphabet turc à base latine traduit à la fois « le désir de se rapprocher de l’Occident et le sentiment d’une identité nationale ». « Aujourd’hui, les Turcs estiment toujours faire partie de la même ère culturelle que les Européens, indique Dorothée Schmid, directrice du programme « Turquie contemporaine » à l’Ifri. Mais une vraie ambivalence subsiste au sujet de l’Europe, à la fois source d’inspiration et soupçonnée de chercher à démembrer le pays en favorisant les droits des minorités. L’enlisement du processus d’adhésion du pays à l’UE a blessé la fierté nationale et créé du ressentiment. Un ressentiment attisé par Erdogan, qui veut redonner aux Turcs le sentiment de leur grandeur passée. » « Ce qu’il tait sciemment, c’est que l’Empire ottoman n’a jamais été uniquement turc, ni même uniquement musulman, ajoute Nicolas Vatin. Chez Erdogan, la manipulation de l’Histoire prend des proportions folles. » Can Dündar : “Erdogan ne croit pas réellement en la démocratie” Le journaliste Can Dündar vient d’être nommé citoyen d’honneur de la ville de
Paris. Ex-rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet, il s’est attiré les foudres d’Erdogan après la publication en mai 2015 d’une enquête sur la livraison d’armes par les services secrets turcs à des insurgés islamistes en Syrie. Soutenu par Reporters sans frontières, il vit à Berlin, après avoir échappé à une tentative d’assassinat. Sa femme est toujours retenue en Turquie. Comment analysez-vous la situation actuelle ? Erdogan a décidé d’accélérer les choses dans l’optique du référendum qui aura lieu au printemps prochain, et qui doit consacrer sa volonté de mener la Turquie vers un régime présidentiel. Depuis la tentative de putsch en juillet dernier, il utilise les pouvoirs que lui confère l’état d’urgence pour faire taire toute forme d’opposition, que ce soit la presse indépendante, les intellectuels ou aujourd’hui le troisième parti politique du pays, le HDP, soutenu par de nombreux Kurdes. Erdogan mène la Turquie vers un système de parti unique qu’il pourra diriger seul. L’Europe a pourtant besoin du président turc, du fait de la crise des réfugiés… C’est une certitude, mais ce n’est pas à l’honneur de l’Europe d’avoir gardé le silence sur la répression orchestrée par le régime. Cet accord a peut-être permis d’atténuer l’afflux de réfugiés vers les pays européens, mais ces derniers vont maintenant devoir accueillir d’autres réfugiés : les universitaires, journalistes et politiciens turcs persécutés. Depuis plusieurs mois, Recep Tayyip Erdogan cherche à s’affirmer comme le protecteur des musulmans sunnites au Moyen-Orient. Comment
l’expliquez-vous ? Longtemps, la Turquie s’est considérée comme européenne. Pendant plus de 50 ans, elle a cherché à intégrer l’UE. Nous étions si enthousiastes à l’idée d’entrer dans cette grande famille. Mais à force d’attendre à la porte, on se lasse. Et on passe à autre chose. Erdogan ne croit pas réellement en la démocratie et aux valeurs occidentales ; sa ligne est bien plus proche de celle de l’Arabie saoudite et du Qatar. Il explique au peuple turc que puisque l’Europe ne veut pas de lui, la Turquie doit suivre son propre chemin. Ce chemin, c’est le monde musulman ; Erdogan s’imagine en nouveau sultan. Mais c’est une chimère. Aucun pays musulman ne l’accepte comme tel. Lorsque nous avons interviewé l’historien Hamit Bozarslan (entretien à lire ici), il a rappelé le poids des tabous – le génocide des Arméniens, la question kurde – au sein de la société turque. Partagez-vous cette opinion ? Ces tabous sont réels, mais moins puissants qu’autrefois. Il y a encore dix ans, il était impossible de discuter du génocide des Arméniens, ou ne serait-ce que prononcer le mot kurde. Nous avons parcouru du chemin depuis lors puisqu’il est possible aujourd’hui d’aborder ces sujets, à condition d’être prêts à en payer le prix. Interroger la politique menée par le gouvernement à l’égard des Kurdes, c’est prendre le risque d’être jugé et condamné pour apologie du terrorisme. Comment expliquer que ces sujets restent si sensibles ? Toute société moderne doit à un moment ou un autre regarder en face sa propre histoire. Tout pays a connu des périodes sombres. Mais en Turquie, la propagande d’État affirme que le pays n’a rien à se reprocher. Pendant 100 ans, personne n’a jamais abordé la question du génocide. Ce sujet génère une telle violence, une telle haine, qu’il faut vraiment du courage pour oser en parler publiquement. Mais il est certain que notre société va devoir à l’avenir affronter son passé. Que peut-il être fait en Europe pour soutenir les militants pro-
démocratie ? L’UE devrait franchement rompre le silence et dénoncer la répression. L’accord sur les réfugiés ne doit pas être un blanc-seing pour opprimer. Il ne faut surtout pas considérer que tous les Turcs sont derrière Erdogan et sa politique. Il existe une autre Turquie, une Turquie attachée à la démocratie, la laïcité, aux droits humains, à l’égalité entre hommes et femmes, à l’État de droit… Cette Turquie souffre et a besoin qu’on lui témoigne de la solidarité. Les universités peuvent accueillir des étudiants ou des professeurs. Les médias, eux, doivent parler de ce qu’Erdogan voudrait taire. Il faut investir dans l’avenir de la Turquie. Car si l’Europe perd la Turquie, elle perdra la seule société laïque et démocratique du monde musulman. Les Français doivent par ailleurs savoir que le président turc justifie son utilisation de l’état d’urgence par l’emploi de l’état d’urgence en France. Il déclare en substance que si la France en a prolongé la durée, pourquoi ne pourrait-il pas faire de même ? C’est à vous de lui expliquer qu’en France, l’opposition parlementaire est une réalité, qu’il n’y a pas de journalistes ou d’universitaires en prison, que des dizaines de milliers de fonctionnaires n’ont pas été licenciés du jour au lendemain dans une véritable purge qui se poursuit à ce jour. Ne laissez pas Erdogan détourner l’exemple français à son avantage personnel. Propos recueillis par Louis Fraysse
Vous pouvez aussi lire