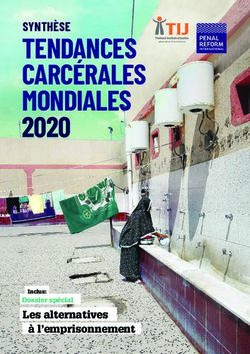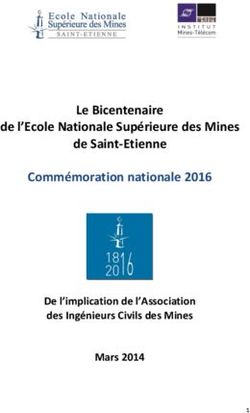Prévention de l'abus sexuel : une meilleure information est cruciale
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Prévention de l’abus sexuel : une meilleure information est cruciale Hans Zollner SJ1*, Katharina A Fuchs1 et Jörg M Fegert2 publié: 2014 Résumé Les abus sexuels peuvent avoir des conséquences durables, voire à vie, et constituent un problème grave au niveau individuel, familial et sociétal. Par conséquent, les mesures de prévention à différents niveaux constituent un enjeu de santé publique. Les mineurs comme les adultes doivent être impliqués dans le travail de prévention afin d'empêcher durablement les abus sexuels sur les mineurs. Outre les normes, les structures et les valeurs de la société, les lois respectives ainsi que les attitudes et les structures doivent être modifiées et amendées de manière à ce que les abuseurs et les abus soient clairement confrontés partout. Au cours des dernières décennies, de nombreux programmes de prévention à l'intention des victimes ont été mis au point pour différents groupes cibles (par exemple, des cours d'éducation parentale, des programmes de visite à domicile, l'éducation du public, des sessions de formation pour les enseignants, des programmes d'apprentissage en ligne du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche et du centre de protection de l'enfance). Nombre de ces programmes se sont avérés partiellement efficaces. Néanmoins, jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique sur ce qui constitue l'efficacité dans ce contexte. Les raisons en sont les divergences dans les définitions ou le peu d'attention accordée à l'évaluation des mesures de prévention. Contexte Au cours de la table ronde sur les "abus sexuels dans l'enfance" organisée entre 2010 et 2012 par trois ministères fédéraux allemands (le ministère de la recherche et de l'éducation, le ministère de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse et le ministère de la justice), l'une des principales questions a porté sur les moyens d'éviter à l'avenir la nouvelle victimisation à grande échelle des enfants et des jeunes dans les institutions, mais aussi dans les familles. De plus, le Dr Christine Bergmann, ancienne ministre fédérale, a été nommée commissaire indépendante chargée d'enquêter sur les abus sexuels commis sur des enfants. De nombreuses personnes concernées, qui s'étaient adressées au Commissaire indépendant pour les abus sexuels durant l'enfance [1], avaient demandé une meilleure prévention et une intervention plus précoce afin d'éviter les possibles conséquences néfastes pour les personnes abusées. Plusieurs domaines ont été identifiés comme essentiels pour la diffusion d'une meilleure information et de meilleures stratégies de prévention, notamment la psychothérapie spécifique, l'éducation scolaire et de loisir, ainsi que les activités de bénévolat associées à l'église et au sport. Le besoin de formation continue semble être particulièrement élevé dans les institutions qui s'occupent d'une population déjà plus en danger, comme les foyers pour enfants et les internats. L'étude commandée par le Commissaire indépendant a montré que, dans ce dernier domaine en particulier, les directeurs de ces foyers et écoles voyaient un risque nettement accru d'être confrontés à de tels scénarios [2]. Le ministère fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse a chargé l'Association allemande pour la prévention et l'intervention (DGfPI) en matière de maltraitance et de négligence envers les enfants de développer un programme de formation continue pour les institutions fournissant des services à la jeunesse. Actuellement, ces programmes sont mis en place à l'échelle nationale avec des experts des services d'aide à la jeunesse. Afin d'améliorer les informations disponibles pour les professionnels de la santé et de l'éducation, le ministère fédéral de la recherche et de l'éducation a financé le développement d'un programme d'apprentissage en ligne [3]. L'Université pontificale grégorienne de Rome a fondé en 2012 le Centre pour la protection de l'enfance (CCP) et l'a chargé de développer un programme d'apprentissage en ligne à vocation internationale à l'usage de l'Église [4]. * Correspondance : psicolpres@unigre.it 1Istituto di Psicologia - Centre pour la protection de l'enfance, Pontificia Università Gregoriana, Rome, Italie La liste complète des informations sur les auteurs est disponible à la fin de l'article.
(c) 2014 Zollner et al. ; licencié BioMed Central Ltd. Il s'agit d'un article en accès libre distribué selon les termes de la licence Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), qui permet l'utilisation, la distribution et la reproduction sans restriction sur tout support, à condition que l'œuvre originale soit correctement créditée. La renonciation à la licence Creative Commons Public Domain Dedication (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) s'applique aux données mises à disposition dans cet article, sauf indication contraire. Pour ce faire, un consortium a été créé à Munich, en Allemagne, avec le soutien de l'archidiocèse de Munich-Freising et d'autres sponsors. Au cours de la phase initiale, le consortium pourra s'appuyer sur l'expertise de la faculté de médecine d'Ulm, en Allemagne, dans les domaines de la protection de l'enfance et de l'apprentissage électronique. Au cours des discussions de la table ronde, il a été convenu que les activités mises en œuvre rapidement pour améliorer les mesures de prévention axées sur les victimes devaient être évaluées. Cependant, il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur les critères à utiliser pour mesurer le succès, au-delà de la simple indication de la satisfaction. Cela est dû en grande partie au fait qu'il existe différentes façons de conceptualiser et de mettre en œuvre la prévention. Le présent article tente d'intégrer les activités de prévention spécifiques aux abus sexuels durant l'enfance dans le débat plus large sur la prévention en matière de santé publique. Dans le cadre d'un débat de santé publique sur la prévention, l'accent devrait être mis sur les environnements sensibles et porteurs et sur la responsabilité des adultes, au lieu de faire porter à l'enfant une responsabilité excessive pour apprendre à se protéger des abus sexuels. Dans environ 80% des cas d'abus, les auteurs sont des personnes connues de l'enfant et de sa famille [5,6]. Par conséquent, l'environnement adulte de l'enfant devrait être au centre des approches de prévention. L'article mettra en évidence les défis correspondants dans les stratégies de prévention et soulignera les approches potentielles d'évaluation. Comment définir la prévention ? Il n'existe pas de définition uniforme et généralement applicable de la prévention. Cependant, on peut relever quelques points communs entre les différentes définitions. Pour Bloom [7], par exemple, la prévention est généralement interdisciplinaire et a pour objectif un changement à long terme à plusieurs niveaux. De manière plus large, la prévention peut être comprise comme une voie permettant de réduire les blessures potentielles du corps et de l'esprit et, simultanément, d'encourager les interactions et les contextes positifs. En ce qui concerne la violence sexuelle, la prévention consiste à créer des circonstances et des comportements sains et sûrs afin d'empêcher les crimes sexuels avant même qu'ils se produisent [8]. La prévention de la violence sexuelle n'est pas facile à mesurer, ce qui rend d'autant plus indispensable une discussion critique ainsi qu'une évaluation régulière du travail de prévention et des approches de prévention [8]. Le modèle de santé publique pour la prévention de la violence, adapté du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, conçoit la prévention principalement comme une réduction des facteurs de risque et une augmentation des facteurs de protection dans le but d'empêcher la violence sexuelle de se produire en premier lieu [9]. Le modèle (voir figure 1) comporte quatre niveaux : [1) définition du problème, 2) identification des facteurs de risque et des facteurs de protection, 3) élaboration et mise à l'essai de stratégies de prévention, et 4) adoption généralisée de ces stratégies. Les approches préventives de la violence sexuelle peuvent prendre de nombreuses formes. La prévention axée sur les victimes, par exemple, peut inclure la prévention basée sur les relations (changements et/ou contrôle des relations potentiellement dangereuses par des mesures politiques ou juridiques) et/ou la prévention basée sur le comportement (soutien au développement de modes de comportement et de stratégies actives et auto-protectrices) [10]. En ce qui concerne la prévention basée sur le comportement, les différenciations suivantes peuvent être faites : - la prévention primaire - Prévention secondaire - Prévention tertiaire
Définir le problème --) Identifier les facteurs de risque et de protection --) Elaborer et mettre à l'essai des stratégies de prévention --) Assurer une adoption généralisée Schéma 1 Modèle de santé publique (selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC) [9]). Ce concept [11] a été adopté par l'OMS en 1994 et est souvent utilisé dans les programmes de prévention curriculaire. Dans ce contexte, la prévention primaire fait référence à toutes les mesures prises pour réduire la violence sexuelle dès le départ, par exemple par le biais d'ateliers avec les mineurs. La prévention secondaire comprend les mesures utilisées dans les situations à haut risque, par exemple pour mettre un terme à un abus naissant ou en cours. La réaction aux crimes sexuels déjà commis est le domaine de la prévention tertiaire qui vise à atténuer les conséquences immédiates de l'abus et à minimiser les conséquences secondaires. En outre, ce niveau comprend des thérapies et des mesures pertinentes pour prévenir une rechute afin de renforcer la santé psychologique et physique des personnes concernées, cf. entre autres [12]. Jusqu'à présent, la majorité des mesures politiques actuelles pour la prévention des abus sexuels repose sur la prévention secondaire et tertiaire. Les stratégies de prévention primaire n'ont reçu que peu d'attention dans les programmes de prévention ainsi que dans les politiques de prévention à vocation internationale. Outre les distinctions du concept "classique" de Caplan [11] décrites ci-dessus, le concept de prévention de Gordon [13], plus axé sur la personne, introduit par l'Institut de médecine (IOM), est de plus en plus utilisé. Le modèle de Gordon fait la distinction entre la prévention universelle, sélective et indicative (voir [12,14,15]). Contrairement au modèle précédent, Gordon [13] ne fait pas de distinction en ce qui concerne le calendrier des mesures, mais plutôt en ce qui concerne les groupes cibles qui doivent être atteints par ces mesures. La prévention universelle s'adresse à la population globale d'un pays, d'une région, d'une ville, aux employés d'une entreprise ou aux élèves d'une école. La prévention sélective s'adresse à un groupe ou à des individus qui présentent un risque plus élevé d'abus en raison de conditions spécifiques et généralement connues. La prévention indicative intervient lorsque des individus se trouvent dans des situations à risque ou présentent un comportement inhabituel (par exemple, une baisse soudaine des résultats scolaires à laquelle les parents et les enseignants réagissent rapidement et avec attention). La figure 2 illustre le fait que ces deux concepts [11,16] ne peuvent pas seulement être utilisés séparément mais aussi en combinaison et par le biais d'approches intégrées. Comme mentionné ci- dessus, la prévention secondaire comprend des mesures utilisées dans des situations à haut risque, par conséquent, comme le suggère Meili [17], elle n'est pas seulement importante pour les individus présentant un risque élevé d'abus, mais aussi pour l'ensemble de la population d'une région, d'une ville ou d'une école, où les individus présentent un risque élevé. En outre, la prévention tertiaire ne peut pas seulement être considérée comme une prévention indicative ; la prévention tertiaire peut, selon Meili [17], être comprise comme une prévention sélective en essayant de minimiser les conséquences immédiates et secondaires pour un groupe ou des individus à haut risque d'abus.
Prévention primaire --) Prévention universelle --) Cible l’ensemble de la population Prévention secondaire --) Prévention sélective --) Cible des sous-ensembles de la population Prévention tertiaire --) Prévention indicative --) Cibles des individus avec des risques identifiés Schéma 2 Chevauchement entre les types de prévention (d'après Meili, [17]). Dans leur Spectrum of Prevention Model, Cohen et Swift [18] soulignent l'importance d'une approche organisationnelle. Selon leur modèle, la prévention des abus sexuels se fait à plusieurs niveaux : du niveau individuel au niveau organisationnel. Ils affirment que pour travailler à la prévention des abus sexuels, les objectifs politiques et les cadres juridiques doivent également être modifiés au niveau organisationnel. Ce concept correspond à l'approche du modèle socio-écologique de Dahlberg & Krug [19] qui identifie quatre niveaux de l'environnement social d'une personne comme nécessaires à la prévention des abus (cf. Fig. 3) : le niveau individuel, le niveau relationnel, le niveau communautaire et le niveau sociétal.
Pour prévenir durablement et à long terme la violence sexualisée à l'encontre des mineurs et les abus sexuels, la prévention doit se faire à plusieurs niveaux. Les raisons souvent citées pour expliquer la violence sexuelle dans le monde sont : l'inégalité de traitement entre les sexes, les disparités économiques ainsi que les normes sociales et culturelles qui sanctionnent des images particulières de la masculinité fondées sur le contrôle des femmes et qui valorisent la force et la résistance des hommes [20]. Dans les débats publics et les discussions politiques, cette analyse est toutefois rarement liée aux abus sexuels sur les mineurs. La nette augmentation de l'intérêt de l'opinion publique nationale [2] et internationale [21] pour les questions d'abus sexuels a néanmoins abouti à des efforts accrus de la part d'un nombre croissant de nations (comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, l'Australie ou les Philippines) qui tentent de mener des politiques actives contre les abus sexuels [22-24]. Les exemples incluent des mesures de formation dans les écoles pour reconnaître les signes d'abus sexuels chez les mineurs, ou, en ce qui concerne l'emploi, la vérification des dossiers officiels pour trouver des indications sur les arrestations antérieures pertinentes. Comme Finkelhor [16] a pu le montrer, le travail de prévention contre les abus sexuels dans l'enfance est devenu très répandu dans les écoles au niveau international et bénéficie souvent d'un soutien politique. Avant d'aborder en détail la prévention et les programmes de prévention, une brève clarification terminologique peut s'avérer nécessaire, à savoir la distinction entre efficacité et efficience. Un traitement s'avère efficace s'il fonctionne dans des conditions non idéales dans la pratique quotidienne [25]. Les scientifiques, les cliniciens et les politiciens sont souvent appelés à faire la différence entre l'efficacité et l'efficience d'une prévention ou d'une intervention. Les essais d'efficience (études explicatives) indiquent si les mesures de prévention ou d'intervention produisent le résultat attendu dans des conditions quasi expérimentales. Les essais d'efficacité (études pragmatiques), en revanche, mesurent l'étendue de l'efficacité positive dans des conditions "réelles", dans des environnements quotidiens. C'est pourquoi les chercheurs formulent des hypothèses et des plans d'étude pour les essais d'efficacité en fonction de certaines conditions, telles que les pratiques cliniques courantes et l'importance des résultats de l'essai pour les décisions cliniques. L'efficacité ne peut être mesurée par le biais d'études expérimentales contrôlées, car le simple fait d'être inclus dans une étude entraîne une distorsion de la pratique habituelle. L'efficacité peut être évaluée par des études d'observation sur le terrain et permet des évaluations qualitatives et quantitatives. L'efficacité et l'efficience existent sur un continuum [25,26]. La généralisation dépend de la perspective du chercheur ou de l'observateur ainsi que des conditions prévalant pendant l'étude. Les données de base des patients (par exemple, le sexe, l'âge, la gravité de la maladie, les groupes raciaux) sont des facteurs essentiels pour la généralisabilité ; cela signifie que la généralisation d'une même étude peut, selon la population, varier de faible à élevée [25]. L'efficience de la prévention en général Les stratégies de prévention efficientes agissent à différents niveaux : au niveau des mineurs, au niveau des adultes qui vivent ou travaillent avec des enfants et des jeunes, mais aussi au niveau des normes et des valeurs sociétales, au niveau législatif, et au niveau des attitudes et des structures qui - plus ou moins intentionnellement et plus ou moins "consciemment" - protègent les auteurs ou minimisent leur comportement (cf. le programme E- Learning du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche et le Centre pour la protection de l'enfance [3,4]). Deux aspects méritent une attention particulière pour un travail de prévention réussi en matière d'abus sexuels dans l'enfance : les contenus (que faut-il savoir ?) et les structures (quelles méthodes sont utilisées ? Quel type d'aide institutionnelle et personnelle est offert ?). Les contenus des mesures et programmes de prévention déterminent dans une large mesure l'efficacité des changements de comportement des mineurs et des adultes [27]. La structure influence de manière décisive l'efficacité à long terme du programme ou de la mesure [27]. La prévention des abus sexuels sur les mineurs axée sur les victimes se fonde sur des informations compétentes et complètes et a pour objectif la protection
efficace des enfants. L'accent est mis sur la transmission d'informations factuelles et complètes qui tiennent compte des circonstances, des besoins et des ressources spécifiques de la personne et de son environnement. En outre, la prévention axée sur la victime met en évidence différentes options de prévention et intègre des partenaires de coopération à différents niveaux [12,27]. Outre la transmission du contenu, les modifications des éléments structurels sont déterminantes pour la réussite du travail de prévention. Comme l'ont montré plusieurs études de Knorth, Knot-Dickscheit & Strijker [28], il existe des facteurs structurels identifiables qui sont très prometteurs. Il s'agit notamment de la fourniture d'informations de base solides, de l'utilisation de diverses méthodes de prévention, de l'implication des parents, des membres de la famille, des enseignants, des pairs ou d'autres contacts, de l'introduction précise et compétente d'un programme de prévention ou d'une mesure de prévention spécifique et de sa mise en œuvre cohérente dans le contexte respectif (par exemple, l'école, le club de sport, la paroisse) [28]. Parmi les autres facteurs qui déterminent le succès d'une mesure donnée, citons le matériel utilisé et son mode d'intégration dans le programme, la mise en œuvre didactique et la durée de la mesure, les qualifications professionnelles des personnes qui mettent en œuvre la mesure et de celles qui occupent des postes à responsabilité, une mise en œuvre qui tient compte des aspects liés au sexe et à la culture. En outre, des études indiquent l'efficacité de réseaux interdisciplinaires étroits et de la coopération avec les services de conseil et de thérapie, les ambulances traumatiques, les lignes téléphoniques d'urgence, les commissaires aux abus, les postes de médiateurs et/ou la police et les tribunaux respectifs [27]. Les aspects suivants sont - comme le montrent les études existantes pour une vue d'ensemble, voir [27,28] - les caractéristiques d'un programme de prévention réussi : - Les mesures de prévention s'adressent en premier lieu aux adultes et seulement en second lieu aux enfants et aux jeunes ; la responsabilité de la protection des mineurs contre les abus sexuels incombe donc directement aux adultes. - Les mesures de prévention sont mises en œuvre à intervalles fréquents, courts et réguliers. - Les mesures de prévention utilisent un langage approprié ; il est important de fournir des informations compactes, facilement compréhensibles, spécifiques et complètes, qui ne demandent pas trop au groupe cible. - Dans le cas des enfants, il convient notamment de leur demander s'ils ont reçu une éducation sexuelle et dans quelle mesure. - Les filles et les garçons sont considérés de manière égale et équivalente comme des victimes potentielles. - Les programmes de prévention sont mis en œuvre par une équipe représentant les deux sexes. - Les mesures de prévention sont confrontées aux complexités quotidiennes d'un groupe cible spécifique ; cela signifie qu'outre le sexe et la langue, la culture, la religion, la politique, le statut ainsi que le système juridique de l'État concerné sont pris en compte. - De nombreux programmes de prévention (par exemple, y compris le E-Learning-Program du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche ainsi que le Centre de protection de l'enfance de l'Université pontificale grégorienne de Rome) offrent des informations de base sur les mesures d'intervention potentielles. Pour des raisons éthiques, il est souvent difficile d'étudier la prévention fondée sur des preuves sur le terrain, notamment en ce qui concerne les abus sexuels [29]. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il existe peu d'études exhaustives permettant de faire des annonces sur la base empirique de l'efficacité de la prévention. En outre, il n'existe pratiquement pas d'études permettant de se prononcer valablement sur l'efficacité et l'efficience à long terme des mesures de prévention [27]. Types de programmes de prévention et leur efficacité Au fil du temps, de nombreux programmes de prévention pour la protection des mineurs contre les abus sexuels ont été développés. Ces programmes montrent que, dans la plupart des cas, il ne suffit pas d'éduquer les mineurs pour prévenir les abus sexuels. Une prévention primaire réellement efficace ne signifie pas seulement que tout est fait pour minimiser le nombre de délits sexuels, elle comprend également une large diffusion de l'information auprès du grand public et des actions correspondantes. Si la sensibilisation du public aux abus sexuels
au cours de l'enfance dans la société en général et dans les contextes ecclésiastiques a considérablement augmenté ces dernières années en Amérique du Nord et en Europe occidentale et centrale, de nombreux groupes sociaux, pays et cultures manquent encore d'informations sur le sujet, notamment en matière de prévention. La tâche consiste donc non seulement à fournir des informations mais aussi à développer des stratégies et des programmes de prévention, à les mettre en œuvre et à évaluer leur efficacité dans les cultures et les contextes respectifs. Les programmes de prévention s'adressent soit principalement aux mineurs, soit aux adultes. Mesures de prévention s'adressant principalement aux mineurs Afin de pouvoir se protéger des avances non désirées des adultes, les mineurs doivent être en mesure de reconnaître les comportements inappropriés comme tels et d'y répondre en conséquence. C'est pourquoi un mélange de prévention comportementale et de prévention structurelle est nécessaire. Les programmes de prévention qui s'adressent spécifiquement aux mineurs adoptent le plus souvent l'approche de l'autonomisation. La préoccupation centrale de cette approche est l'acquisition de compétences d'autoprotection qui sont transmises par le biais de concepts et d'exercices pratiques, tels que dire non, éviter, fuir et signaler. Ces quatre compétences sont au centre des programmes de formation pour la prévention des abus sexuels et ont prouvé leur efficacité [30]. Les mineurs eux- mêmes les ont perçues et évaluées comme positives (voir [31]). Grâce à ces programmes de formation, ils apprennent à reconnaître les situations qui mettent en danger leur sécurité personnelle, à éviter des situations similaires, à fuir le danger et ensuite à en parler immédiatement à un adulte de confiance (prévention comportementale), mais pour une efficacité à long terme, il est également important de savoir quels adultes sont dignes de confiance et d'avoir ces adultes à disposition (prévention structurelle). Ces adultes peuvent être par exemple des psychologues scolaires ou des enseignants de liaison dans les écoles. Dans le passé, les chercheurs ont principalement utilisé trois types d'évaluation pour juger de l'efficacité de la formation à la sécurité des enfants et des jeunes : les rapports verbaux et/ou l'auto- évaluation, les jeux de rôle et la construction de cas réalistes (in situ). La recherche a prouvé qu'une évaluation in situ est le seul critère d'évaluation valable en ce qui concerne les compétences qui augmentent la sécurité personnelle. Ces résultats ont été confirmés dans le cas de femmes souffrant d'un retard mental qui ont reçu une formation sur les stratégies de prévention contre les abus sexuels, par exemple [32]. Selon Knorth et al. [28], les méta-analyses et les études de synthèse montrent des effets positifs des programmes de prévention en milieu scolaire uniquement en ce qui concerne les facteurs de protection généraux, mais pas en ce qui concerne la prévention des abus sexuels. Pour évaluer l'efficacité des programmes de prévention, les chercheurs doivent évaluer de manière critique ce que les mineurs eux-mêmes disent d'une mesure particulière et/ou de leur sentiment accru de sécurité personnelle. Les questions importantes dans ce contexte sont les suivantes : Dans quelle mesure les mineurs sont-ils capables de mettre en œuvre les compétences et les stratégies pratiquées en cas d'urgence ? Quel est le risque de traumatisme lié à la mise en scène de tentatives d'agression ? Il est évident que les enfants qui se défendent sont simplement capables de retarder l'agression mais pas de l'éviter, cf. [31]. Cela semble en partie dû au fait que les programmes de prévention destinés aux enfants et aux jeunes négligent souvent les aspects qui permettent aux abus sexuels de se produire. Les domaines et les circonstances sur lesquels les mineurs n'ont pas ou peu de contrôle et qui sont sous le contrôle complet ou primaire des adultes sont négligés [31]. Cela inclut les contextes interculturels et interreligieux auxquels la majorité des programmes existants ne prêtent pas attention, car ils s'orientent vers les cultures occidentales et leurs normes et règlements [27]. En outre, il convient de noter de manière critique que de nombreuses mesures de prévention primaire axées sur l'acquisition de compétences d'autoprotection délèguent la responsabilité de la protection contre les abus aux victimes potentielles, c'est-à-dire aux mineurs. Ces derniers portent donc le poids d'une responsabilité qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. La responsabilité de la protection des mineurs incombe aux adultes. Il est indispensable, pour une prévention efficace et réussie, que les mineurs acquièrent non seulement les compétences mais qu'ils apprennent à les appliquer dans une situation dangereuse et à haut risque en l'évitant ou en s'en échappant [27].
Mesures de prévention s'adressant en plus ou exclusivement aux adultes
Certains programmes de prévention s'adressent exclusivement aux mineurs, d'autres impliquent
également les adultes [33], d'autres encore s'adressent exclusivement aux adultes. Des études récentes
montrent que l'implication des adultes dans la prévention des abus sexuels sur les enfants est
importante. Grâce à leur participation, les adultes apprennent non seulement à parler avec les mineurs
de la sexualité et de leur développement sexuel et émotionnel, mais aussi à reconnaître les
comportements problématiques, à savoir comment les autres adultes peuvent être tenus responsables
de leur mauvais comportement, et ce qu'il faut faire lorsque des signes d'abus sexuel existent [34].
Comme le National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), basé aux États-Unis, a pu le
démontrer en 2005, l'inclusion des adultes dans le travail de prévention présente de nombreux
avantages [35]. Par exemple, les mineurs sont plus à même de saisir les messages de réduction des
risques lorsque ceux-ci sont transmis par des adultes à la maison ou à l'école. En outre, les prestataires
de soins, les enseignants, les entraîneurs ou les éducateurs devraient recevoir des conseils et des
informations sur les endroits où demander de l'aide et du soutien en cas d'urgence.
Le tableau 1 donne un aperçu des différents types de programmes de prévention destinés à divers
groupes d'adultes, ainsi que des objectifs et de l'efficacité de ces programmes.
Un autre aspect central du travail de prévention auprès des adultes est l'éducation des témoins, qui vise
à sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible au sujet. Le principe de l'éducation des
témoins vise à étendre la prévention des abus du niveau individuel et familial au niveau sociétal. Cela
signifie que les membres de groupes spécifiques de la société, mais aussi le grand public dans son
ensemble, sont encouragés et renforcés dans leur action contre la violence sexuelle et les autres formes
de violence [22]. Une telle approche inclut la remise en question des normes sociales dominantes telles
que la sphère privée, le pouvoir, les rôles de genre, etc. [40]. Comme Cohen, Lyles & Brown [41], par
exemple, ont pu le montrer, l'éducation des témoins a un effet positif. Certaines approches de
prévention dans ce contexte tentent de réagir à des lacunes clairement identifiables (par exemple,
lorsque les enseignants ne savent pas comment signaler un soupçon, ils reçoivent une formation sur cet
aspect particulier). D'autres approches s'appuient sur le bon sens ("Nous devons tenir les enfants à
l'écart des délinquants sexuels") ; d'autres encore se traduisent par des lois qui, par exemple,
interdisent le lieu de résidence de ces délinquants.Tableau 1
Colonne 1
▪ Objectifs
▪ Challenges pour la conceptualisation et l’implémentation de mesures efficaces
▪ Etudes pour évaluer les programmes de prevention
Colonne 2: Parents/Gardiens
Eduquer les parents et les gardiens sur.....,
1 Comment informer leurs enfants sur les abus sexuels
2 Comment protéger leurs enfants face aux abus sexuels
3 Comment reconnaître les signes d’un abus sexuel (potentiel) et comment y mettre un terme
4 Comment renforcer une dynamique familiale saine
Les facteurs importants pour la réussite d’un programme à l’attention des parents/gardiens sont
Intérêt pour le sujet
Qualification de l’éducateur en prévention
Durée du programme (durée des mesures d’entraînement et/ou du travail indépendant
Source de référence (les parents font davantage confiance aux recommandations des médecins ou
des enseignants qu'à celles des médias).
Les parents qui ont participé à un programme mené par des éducateurs qualifiés et qui ont discuté du sujet
se trouvent dans une meilleure position pour protéger un enfant d’abus sexuel [36]
Les programmes qui incluent les deux parents se sont clairement avérés efficaces [37]. “Les visites à
domicile dans des ‘familles à hauts risques’ se traduisent par une diminution du risque d’abus [38]
Colonne 3: Personnes travaillants avec des enfants (ex. : enseignants, coaches)
Eduquer les personnes travaillant avec les enfants sur…
Comment informer les enfants sur la prévention des abus sexuels
Comment reconnaître et rapporter un abus sexuel
Les facteurs importants pour la réussite d’un programme à l’attention de ceux qui travaillent avec des enfants
sont :
Intérêt pour le sujet
Qualification de l’éducateur en prévention
Durée du programme (durée des mesures d’entraînement et/ou du travail indépendant
Source de reference (similaire à celle des parents/gardiens)
Les programmes à l’attention des enseignants ont une influence positive sur la connaissance du sujet des
enseignants [37]
Les personnes qui ont reçu une formation se retrouvent dans une meilleure position au moment de
prendre une décision pas uniquement basée sur des signes physiques ; en plus de cela, la fréquence,
la durée, l’intensité et les standards professionnels de ces mesures d’entraînement jouent un rôle
important [39]
Colonne 4: Public général
Informer le public sur les abus sexuels (ex. prévalence, possibilités d’intervention, etc.)
Changer le comportement sociétal
Les campagnes médiatiques sont complexes quant à leur contenu et onéreuses à financer
Leur efficacité peut indirectement dépendre de la disponibilité de dons financiers
Les campagnes de marketing social doivent être fondées sur une solide recherche en direction du
groupe cible.
Jusqu’à présent, seules quelques campagnes publiques sur le sujet ont été évaluées [34]
Les campagnes qui ciblent des groupes et des sujets spécifiques reçoivent plus d’attention et sont
plus efficaces [34]
Légende : Aperçu des objectifs, des défis pour la conception et la mise en œuvre de mesures efficaces ainsi que
des études sur l'évaluation des programmes de prévention pour adultes.Discussion Depuis plusieurs années, des recherches ont été entreprises sur l'évaluation des programmes de prévention des abus sexuels, par exemple [30,42]. De nombreuses études montrent que les connaissances sur les abus sexuels et la nécessité d'une prévention accrue sont en augmentation, par exemple [43]. Cette constatation a pu être confirmée pour les programmes de formation à la sécurité avec les enfants, en particulier lorsque ces programmes de formation incluent une approche active de l'apprentissage, par exemple [44,45]. La signification de ces études est limitée car il n'y a généralement pas d'évaluation comportementale mais seulement une auto-évaluation de la part des enfants. Cela signifie que les chercheurs et les éducateurs de programmes doivent se fier à ces auto-évaluations sans pouvoir observer le comportement des mineurs in situ [46]. Des études, par exemple [44], qui ont institué des évaluations in situ comme base d'évaluation, ont montré que les mineurs se comportent différemment dans des situations qui pourraient conduire à des abus potentiels que ce qu'ils ont déclaré auparavant. Willich [47] et Damrow [27] ajoutent que l'évaluation de l'efficacité des programmes de prévention pour les mineurs contient souvent des défauts qualitatifs qui, à leur tour, limitent leur importance. Des exemples de tels défauts sont : l'utilisation de critères d'évaluation divergents pour l'évaluation des mesures préventives, la rareté des études concernant la rentabilité des mesures prises ainsi que le manque d'études longitudinales, par exemple [27].Ce n'est que grâce à la coopération, à une évaluation régulière et au travail continu de nombreuses personnes que les programmes de prévention pourront être développés à l'avenir pour éduquer et encourager les adultes à protéger les mineurs contre les abus sexuels [34]. Entre-temps, de nombreux programmes destinés aux adultes ont été évalués selon des critères empiriques stricts. Le tableau 1 en donne un aperçu détaillé. Un nombre considérable de mesures de prévention diverses, bénéficiant d'un soutien financier important, ont pour groupe cible les adultes. Ces programmes ont été évalués et mis en œuvre dans des contextes sociétaux spécifiques. Ces efforts locaux vont dans le sens d'une approche culturellement compétente, axée sur les besoins spécifiques de groupes sociétaux divergents, souvent négligés ou oubliés dans des campagnes plus larges [34]. Une coopération accrue entre les institutions peut favoriser le développement d'idées et de ressources dans ce sens. Il existe donc différentes définitions du niveau de prévention comportementale qui doit être pris en compte et des mesures préventives structurelles. Par exemple, dans la prévention de la toxicomanie, les mesures structurelles telles que les politiques fiscales nationales s'avèrent très efficaces et en même temps faciles à évaluer. Il semble toutefois difficile de décrire des mesures de prévention purement structurelles dans le contexte de l'abus sexuel des enfants, car les structures entourant un enfant dans le sens d'un environnement sensible sont créées par les comportements et la disponibilité émotionnelle des enseignants et des autres personnes en charge ou des pairs. Comme mesures structurelles, on pourrait mentionner la création de réseaux, l'installation d'un ombudsman, mais il n'y a pas beaucoup de littérature empirique sur les mesures structurelles dans la prévention des abus sexuels. Rassenhofer et al. [23] ont fait état d'un système de signalement des incidents critiques mis en place par le gouvernement fédéral allemand avec un commissaire du gouvernement faisant office de médiateur. Cet exemple montre qu'un adulte digne de confiance est essentiel pour une prévention et une intervention précoce efficaces. Si l'enfant ne sait pas à qui parler et comment trouver un adulte qui l'écoutera, le croira et l'aidera, les formations comportementales destinées aux enfants ne les protégeront pas longtemps des abus sexuels. Il est donc nécessaire de sensibiliser les adultes et de mettre à la disposition de l'enfant une personne qualifiée et digne de confiance.
La contribution politique Une évaluation adéquate des programmes de prévention doit faire face à de nombreux obstacles : manque de moyens financiers, manque d'expertise professionnelle, temps supplémentaire nécessaire, attitude critique de la société envers les résultats de la recherche. Dans certains cas, les politiciens, les juristes et les scientifiques se sont sentis sous pression pour "devoir" confirmer l'efficacité d'un programme particulier. Une telle pression peut entraîner une distorsion de l'analyse des données et de l'interprétation des résultats de la recherche [48]. C'est pourquoi les chercheurs [49,50] plaident pour une compréhension plus large de l'efficacité ainsi que pour une stratégie d'évaluation plus intégrative combinant diverses approches. Selon Tseng [50], une telle approche pourrait empêcher de négliger les stratégies prometteuses et promouvoir de nouvelles approches pour trouver des solutions aux questions sociétales urgentes. À moyen et long terme, une approche intégrative de la production de connaissances sera utile pour mieux protéger les mineurs et les familles en danger. En outre, l'utilisation de plusieurs méthodes d'évaluation permet une évaluation plus complète de l'efficacité des programmes de prévention [49]. A partir de ces résultats, on peut déduire d'autres étapes pour le travail de prévention dans les organisations et les institutions [2,51]. Les partenariats et les projets de coopération entre politiciens et chercheurs pourraient donner naissance à des mesures de prévention politiques dont l'effet sociétal et l'efficacité préventive devront continuellement être réévalués [2,23,50]. Les groupes, les institutions et les organisations dans leur ensemble, ainsi que ceux qui y occupent des postes à responsabilité, sont appelés à évaluer régulièrement l'efficacité de leur travail politique. Conclusions Le présent article offre un aperçu des concepts de prévention en général et des programmes de prévention et des mesures politiques contre l'abus sexuel des mineurs en particulier. En outre, il met en évidence les difficultés liées à l'évaluation de l'efficacité des mesures préventives visant à protéger les mineurs contre les abus sexuels. Un point central est le développement de méthodes d'évaluation ciblées et/ou la révision et l'évaluation critique des stratégies existantes. Les programmes visant à éviter les abus sexuels doivent être régulièrement et valablement évalués quant à leur efficacité et, si nécessaire, être modifiés dans un contexte particulier ou, s'ils s'avèrent inefficaces, être abandonnés. Jusqu'à présent, il existe une multitude de programmes de prévention différents qui s'adressent à une clientèle différente (mineurs et/ou adultes), utilisent des méthodes variées (par exemple, e-learning, face-à-face) ou visent des contextes différents (école, famille, clubs, église, etc.). En outre, un certain nombre d'efforts sont déployés au niveau politique (par exemple, le Commissaire indépendant chargé d'enquêter sur les abus sexuels envers les enfants) [1,2] et ecclésial (par exemple, le programme d'apprentissage en ligne du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche, Centre pour la protection de l'enfance) ([52], Zollner H, Fuchs KA : Wirksamkeit von Prävention, à paraître) ainsi que des campagnes publiques. Nombre de ces stratégies et programmes visent à protéger efficacement les enfants et les jeunes contre les abus sexuels [51]. Cependant, une trop grande euphorie peut être injustifiée. La quantité n'est pas automatiquement synonyme de qualité et ce qui semble être efficace à première vue peut ne pas l'être après un examen empirique. Cela signifie que les programmes de prévention contre les abus sexuels doivent être évalués consciencieusement et régulièrement à l'aide de méthodes fiables et qu'il faut continuer à les développer [23]. A l'heure actuelle, personne ne peut prédire quel type de prévention ou quelle combinaison de différentes stratégies sera le plus efficace. De nombreux programmes doivent être adaptés aux contextes et aux besoins spécifiques.
Intérêts concurrents
HZ reçoit des financements de l'archidiocèse de Munich et de l'Université Grégorienne pour le développement de programmes
d'apprentissage en ligne pour la prévention des abus sexuels.
Contributions des auteurs
HZ, KF, JF ont contribué à parts égales à la préparation de l'article. Tous les auteurs ont lu et approuvé le manuscrit final.
Informations sur les auteurs
JMF : Prof. Dr. med. ; Professeur et Chaire de Psychiatrie et Psychothérapie de l'Enfant et de l'Adolescent à l'Université
d'Ulm/Allemagne. Direction du groupe de travail scientifique de la "Table ronde sur la maltraitance des enfants" du
gouvernement fédéral allemand. Membre du comité directeur du "Centre pour la protection de l'enfance" de l'Université
pontificale grégorienne.
HZ : Prof. Dr. théol. Licencié en psychologie ; Vice-recteur académique de l'Université Pontificale Grégorienne à Rome/Italie.
Doyen de l'Institut de Psychologie et Président du "Centre pour la protection de l'enfance" de l'Université Pontificale
Grégorienne.
KAF : Dott.ssa ; Dipl. Psych.(Univ.) ; Institut de Psychologie de l'Université Pontificale Grégorienne de Rome/Italie
Remerciements
Commentaire modifié basé sur une publication originale allemande : Zollner H., Fuchs K.A., Fegert J.M. Vermeidung von
Viktimisierung durch bessere Information. Nervenheilkunde 2013 ; 32 (11).
Author details
1Istituto di Psicologia - Centre for Child Protection, Pontificia Università Gregoriana, Rome, Italy. 2Clinique de psychiatrie et de
psychothérapie pour enfants et adolescents, Clinique universitaire d'Ulm, Ulm, Allemagne.
Reçu : 19 septembre 2013
Accepté : 9 janvier 2014
Publié : 12 février 2014
Références
1. Fegert JM, Bergmann C, Spröber N, Rassenhofer M: Therapieangebote ausbauen, Risiken minimieren - Herausforderungen an die Medizin
formuliert von Missbrauchsbetroffenen. Nervenheilkd 2013, 11:819–825.
2. Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM): Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur
Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs. [http://beauftragter-missbrauch.de/file.php/30/Abschlussbericht_UBSKM.pdf]
3. Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF): Online-Kurs für medizinisch-therapeutische und pädagogische Berufe. Prävention von
sexuellem Kindesmissbrauch. [http://missbrauch.elearning-kinderschutz.de/]
4. Centre for Child Protection (CCP) der Päpstlichen Universität Gregoriana:Zentrum für Kinderschutz. E-Learning Program. [http://elearning-
childprotection.com/]
5. Finkelhor D, Hammer H, Sedlak AJ: Sexually assaulted children: national estimates and characteristics. [http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/214383.pdf]
6. Wurtele SK: Child sexual abuse prevention: preventing sexual abuse ofchildren in the twenty-first century: preparing for challenges and
opportunities. J Child Sex Abus 2009, 18:1–18.
7. Bloom M: Primary Prevention Practices. Thousand Oaks: Sage; 1996.
8. Postmus JL: Sexual Violence and Abuse. An Encyclopedia of Prevention, Impacts, and Recovery (Volume 2). Santa Barbara, California: ABC-Clio; 2013.
9. Center for Disease Control and Prevention (CDC): The public health approach to violence prevention. 2012 [http://www.cdc.gov/
violenceprevention/overview/publichealthapproach.html]
10. von Lengerke T: Individuum und Bevölkerung zwischen Verhältnissen und Verhalten: Was ist Public-Health-Psychologie? In Public Health-
Psychologie. Individuum und Bevölkerung zwischen Verhältnissen und Verhalten. Edited by von Lengerke T. Weinheim: Juventa; 2007:11–18.
11. Caplan G: Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books; 1964.
12. Smallbone S, Marshall WL, Wortley R: Preventing Child Sexual Abuse –
Evidence, Policy and Practice. New York, NY: Routledge; 2011.
13. Gordon R: An operational classification of disease prevention. PublicHealth Rep 1983, 98:107–119.
14. Mrazek PJ, Haggerty RJ: Reducing risks for mental disorders: frontiers for preventive intervention research. Washington, DC: National Academy Press; 1994.
15. Banyard VL: Sexual violence: current perspectives on prevention andintervention. J Prev Interv Community 2008, 36:1–4.
16. Finkelhor D: The prevention of childhood sexual abuse. Future Child 2009,
19:169–194.
17. Meili B: Indizierte Prävention bei gefährdeten Jugendlichen.
Suchtmagazin 2004, 6:21–25.
18. Cohen L, Swift S: The spectrum of prevention: developing a comprehensive approach to injury prevention. Inj Prev 1996,5:203–
207.
19. Dahlberg LL, Krug EG: Violence: A Global Public Health Problem. In WorldReport on Violence and Health. Edited by Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA,
Zwi AB, Lozano R. Geneva: World Health Organization; 2002:1–21.
20. World Health Organization: London School of Hygiene and Tropical Medicine Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and
generating evidence. Geneva: World Health Organization; 2010.
21. Mac Millan H, Wathen CN, Barlow J, Fergussin DM, Leventhal JM, TaussigHN: Interventions to prevent child maltreatment and associated
impairment. Lancet 2009, 373:250–266.
22. Plummer C: Using Policies to Promote Child Sexual Abuse Prevention: What is working?. Harrisburg, PA: VAWnet, a project of the National Resource
Centeron Domestic Violence; 2013.
23. Rassenhofer M, Spröber N, Schneider T, Fegert JM: Listening to victims: useof a critical incident reporting system to enable adult victims of
childhood sexual abuse to participate in a political reappraisal process inGermany. Child Abuse Negl 2013, 9:654–663.Vous pouvez aussi lire