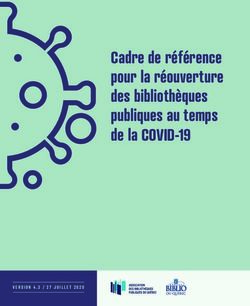REFERENTIEL " Porter à Connaissance et association de l'Etat aux documents d'urbanisme " - Document d'aide à l'élaboration d'une note d'enjeux ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
NOTES
Cete Ouest
Cete Normandie Centre
Cete Sud Ouest
Juin 2013
REFERENTIEL
« Porter à Connaissance et
association de l'Etat aux
documents d'urbanisme »
Document d'aide à l'élaboration
d'une note d'enjeux dans le cadre
de l'association de l'EtatSOMMAIRE
I. Notions et modalités d'association
1. L'association de l'Etat
2. Les attentes des collectivités et des bureaux d'études
II. Organisation des services de l'Etat
1. Pilotage et organisation interministérielle
2. Connaissance du territoire
III.Contenu de la note d'enjeux de l'Etat
1. Afficher les enjeux de l'Etat pour le territoire
2. Mentionner des éléments de gouvernance du projet de document
IV. Forme et portage de la note d'enjeux
1. Les attentes des collectivités et bureaux d'études vis-à-vis de la forme et du portage
2. Mise en forme du document écrit
3. Communiquer oralement sur les enjeux de l'Etat pour le territoire
V. Conclusion
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 3/19Préambule Des icônes sont utilisées dans le présent document. Leur signification est la suivante : Conseil pratique Boîte à outils Point de vigilance Point méthode Illustration Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 4/19
I. Notions et modalités d'association
1. L'association de l'Etat
Dans le cadre de la réalisation des documents d'urbanisme, l'Etat tient des rôles multiples tout au long de
la procédure : conseil amont auprès des acteurs locaux, porter à la connaissance de l'Etat (PAC1),
association de l'Etat comme personne publique associée, formulation de l'avis de l'Etat et contrôle de
légalité.
L'association vise à assurer la prise en compte des objectifs des politiques publiques de l’État dans les
documents d’urbanisme. Pour cela, les services de l'État peuvent être associés à l'élaboration du projet,
soit à la demande du préfet soit à l'initiative de la collectivité en charge du document d'urbanisme.
Il n'y a pas de forme définie précisément pour cette association, les services de l'Etat en définissent
librement les modalités. En pratique, elle peut se traduire par différents types d'intervention des services :
• en proposant, dès le début de la réflexion des élus, des documents dits notes d'enjeux (ou
documents d'association de l'Etat2) pour préciser les objectifs poursuivis par l'État et adaptés aux
enjeux du territoire concerné,
• en participant aux réunions des personnes publiques associées (PPA) pour y porter la parole de
l'Etat et contribuer aux réflexions,
• en formulant un avis sur les documents produits au fur et à mesure de l'établissement du projet,
• en proposant des contributions complémentaires selon les questionnements et les besoins des
acteurs.
Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la production des notes d'enjeux de l'Etat. À la
différence du PAC, sa production n'est pas obligatoire, l'idéal étant que les services de l'Etat puissent
produire une telle note pour chaque démarche d'urbanisme engagée. Cela est souvent peu réaliste, et
conduit à faire des choix et à les expliciter pour être capable de les expliciter auprès des collectivités.
Pour y aider, on peut par exemple mettre en avant que, dans le cas d'une procédure de SCoT, la note
d'enjeux apparaît incontournable d'un point de vue stratégique, dans la mesure où les enjeux sur le
périmètre considéré sont ensuite déclinés au niveau des PLU et des cartes communales par l'application
du principe de compatibilité. Elle est également très importante pour les communes élaborant des PLU ou
des cartes communales et non couvertes par des SCoT.
L'association de l'Etat est définie aux articles L121-4 et L122-6-1 du code de l'urbanisme. Ses modalités
sont précisées par des circulaires, qui évoquent, entre autres, la « note d'enjeux ».
Circulaire UHC/PS/18 n°2001-63 du 06/09/01 relative au rôle de l'Etat
dans la relance de la planification (extrait)
« La loi a redéfini l'association de l'État à l'élaboration des documents d'urbanisme. Son déroulement ne
sera plus formalisé par un arrêté de mise en œuvre, ce qui doit permettre, outre la suppression de sources
de contentieux, de mettre l'accent sur les questions de fond et l'organisation d'un véritable dialogue.
N'ayant plus à participer à l'ensemble des réunions d'élaboration, vous pourrez apporter votre contribution
non seulement à l'occasion des réunions spécifiques organisées par la collectivité territoriale mais aussi, le
cas échéant, par écrit. Vous n'hésiterez pas non plus à provoquer une réunion chaque fois que vous
l'estimerez nécessaire en vous appuyant sur le pouvoir d'initiative que vous donne la loi.
Vous porterez une attention particulière à l'association aux schémas de cohérence territoriale qui auront
1 Dans le document, le Porter à Connaissance sera désigné par l'acronyme PAC.
2 Nous retiendrons par la suite le terme « note d'enjeux » qui semble plus couramment employé.
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 5/19une influence déterminante sur l'organisation du territoire, notamment parce que les autres documents de
planification communaux ou intercommunaux devront être compatibles avec eux. Vous resterez
néanmoins présents dans l'élaboration des plans locaux d'urbanisme en tenant compte des responsabilités
que la loi vous donne et des enjeux liés aux politiques nationales.
Vous vous assurerez, au cours de l'association, du respect des principes de l'article L.121-1 du code de
l'urbanisme, en apportant si nécessaire des propositions concrètes sur la base des problématiques et des
enjeux propres au territoire, que vous pourrez confronter à celles des autres personnes publiques. Vous
devez également veiller à la prise en compte des projets des collectivités publiques autres que celle qui
élabore le document d'urbanisme.
Par ailleurs, l'association est le lieu où vous exprimerez et concrétiserez les attentes et les objectifs qui
résultent des politiques nationales (transport, habitat, politique de la ville, aménagement du territoire,
universités, environnement, etc.), et plus généralement le point de vue et les réflexions stratégiques de
l'État sur le territoire.
Vous pourrez par exemple : proposer les coupures d'urbanisation prévues par la loi sur le littoral, dont la
localisation et l'ampleur sont laissées à l'appréciation des collectivités, veiller à ce que les règlements des
plans locaux d'urbanisme ne fassent pas obstacle à l'implantation de logements sociaux dans des
conditions économiquement acceptables, travailler sur les modalités de prise en compte d'un projet
d'infrastructure dans le document d'urbanisme, etc.
Dans tous les cas, le document arrêté vous sera adressé pour avis avant l'enquête publique. Les nouvelles
dispositions réglementaires du code de l'urbanisme ne permettent plus à la collectivité de modifier ce
document avant l'enquête pour tenir compte de votre avis, mais prévoient que cet avis sera joint au dossier
d'enquête.
Vous veillerez donc à faire part de toutes vos observations aux collectivités dans le cadre de l'association,
pour ne pas leur envoyer dans l'avis des informations dont elles n'auraient pas disposé antérieurement ».
Circulaire UHC/PA3 n°2006-12 du 14/02/06 relative au rôle de l'Etat
pour favoriser la prise en compte des besoins en logements dans les documents d'urbanisme (extrait)
« Au stade de l'association, vous irez jusqu'à proposer des contributions précises au contenu des documents
à partir de diagnostics établis en propre et d'enjeux clairement identifiés et quantifiés ».
Circulaire du 01/09/09 relative au contrôle de légalité en matière d'urbanisme (extrait)
« Il est souvent opportun d'accompagner le porter à connaissance d'un document complémentaire
constituant une « note d'enjeux » dans laquelle sont communiqués les enjeux que l'Etat défend en matière
d'urbanisme dans le département ».
La production d'une note d'enjeux, non obligatoire, intervient en amont de la phase d'association comme
expression formalisée des enjeux de l'Etat servant de cadrage initial aux réflexions à venir pour les élus et
la maîtrise d'oeuvre chargée du document d'urbanisme.
Cette note, définie comme un document complémentaire au PAC, vient identifier les enjeux de l'Etat sur
le territoire concerné par la démarche d'urbanisme. À noter qu'en pratique, les services ont plutôt tendance
à rédiger une note d'enjeux distincte du PAC, qui peut cependant être transmise et présentée en même
temps que ce dernier.
Ainsi, la note d'enjeux est un moyen d'expression de l'association, celle-ci étant un
processus bien distinct du PAC :
- le PAC des services de l'Etat est défini par les articles L121-2 et R121-1 du code de
l'urbanisme
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 6/19- l'association de l'Etat est définie aux articles L121-4 et L122-6-1 du code de l'urba-
nisme.
L'association est l'occasion pour l'Etat d'apporter une vision qui inscrit le territoire dans un contexte plus
large, par exemple en apportant un regard à une échelle différente ou en proposant des territoires référents
à titre de comparaison. Ainsi, l'Etat joue son rôle de cohérence territoriale en favorisant le croisement des
échelles, et il participe à une mutualisation de l'ingénierie territoriale en permettant au territoire de tirer
parti d'autres expériences.
L'association permet à l’État d'entrer dans une posture de dialogue et de pédagogie de ses enjeux auprès
des collectivités. Celles-ci peuvent disposer d'éléments d'informations utiles pour leur démarche de
planification et peuvent interroger l’État plus spécifiquement sur la prise en compte de nombreux
paramètres et leur traduction dans le document d'urbanisme (par exemple, les attendus pour respecter les
objectifs d'équilibre, de mixité et diversité, et de préservation de l'environnement de l'article L121-1 du
code de l'urbanisme). C'est donc une étape primordiale de partage des enjeux pour concevoir des relations
partenariales dans la durée et préparer le bon déroulement du processus de conception du document
d'urbanisme.
La note d'enjeux s'inscrit dans le cadre de cette association. Elle n'est réellement intéressante
pour la collectivité que si elle est réellement adaptée au territoire concerné : il s'agit de se
concentrer sur les enjeux du point de vue de l'Etat appliqués à ce territoire (à différencier des
enjeux du territoire : il s'agit davantage d'exprimer les attentes de l'Etat sur la situation territoriale
eu égard aux différentes politiques publiques). Des éléments trop généraux ne permettent pas
d'alimenter les réflexions pour enrichir le projet territorial.
Il ne s'agit pas non plus de fournir une analyse territoriale fouillée, alimentée par le traitement et
le croisement de nombreuses données, qui viendrait interférer, au risque d'être redondant, avec la
démarche d'élaboration du document d'urbanisme (lequel prévoit la réalisation d'un diagnostic
territorial permettant de définir collectivement le projet d'aménagement et de justifier les choix
opérés par la collectivité).
Si la définition d'enjeux pertinents repose généralement sur une bonne connaissance locale du territoire et
des acteurs, issue d'une analyse de type diagnostic territorial, la note d'enjeux est, comme son nom
l'indique, centrée sur les résultats : la clarté du discours prévaut ici à la recherche d'exhaustivité.
La note d'enjeux n'est pas :
- une liste de recommandations générales, non territorialisés et non priorisées
- un diagnostic de territoire
- une présentation d'enjeux sans justification, sans hiérarchisation, et sans articula-
tion les uns avec les autres
- une compilation de contributions multiples, sans reformulation ni synthèse
- l'expression d'enjeux uniquement cantonnés au territoire concerné et à un instant
donné, sans prise en compte des évolutions possibles.
La note d'enjeux est :
une présentation synthétique, argumentée et contextualisée, des principaux enjeux
du point de vue de l'Etat sur le territoire concerné, tenant compte des évolutions pré-
visibles et des territoires environnants, et établie de préférence collectivement entre
services de l'Etat.
Cet investissement que demande l'élaboration d'une note d'enjeux de qualité est à envisager par les
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 7/19services de l'Etat sur la durée de la procédure, en tant que chaînon d'un ensemble d'actions des services
depuis l'expression formalisée d'enjeux et d'objectifs (la note d'enjeux vient compléter le cadrage
réglementaire du projet que constitue le document PAC), en passant par leur portage en réunion
d'association (une note d'enjeux bien construite peut alors servir de « mandat » au chargé d'études qui doit
aller porter la parole des différents services de l'Etat) jusqu'à l'avis de l'Etat et au contrôle de légalité (la
note d'enjeux peut alors servir de grille de lecture de documents et faciliter la rédaction de l'avis et la
réalisation du contrôle de légalité).
La note d'enjeux est un maillon pour asseoir le positionnement et l'accompagnement
de l'Etat dans l'ensemble de la démarche d'urbanisme.
2. Les attentes des collectivités et des bureaux d'études
Les entretiens conduits auprès de collectivités et de bureaux d'études ont permis de souligner l'importance
d'un positionnement et d'une parole de l'État cohérents tout au long de l'association, jusqu'aux étapes
finales d'élaboration de l'avis et du contrôle de légalité.
En amont de la démarche, la note d'enjeux est un outil de l'Etat permettant à la collectivité de disposer
d'un cadre de référence, notamment dans la perspective de l'avis de l'Etat sur projet arrêté.
Au cours de la démarche, d'éventuelles contributions écrites complémentaires sont appréciées des
collectivités, pour éclairer la vision de l'Etat, en fonction des questionnements qui émergent ou des
besoins de clarification de la part des collectivités.
Les attentes vis-à-vis de la formalisation de l'association de l'Etat sous forme de note d'enjeux
S'il n'y a pas de modalités imposées en termes de communication (orale ou écrite) de l'association de
l'Etat, un support écrit tel que la note d'enjeux permet à la collectivité de s'y référer tout au long de sa
démarche. Un tel support sert également à la maîtrise d'oeuvre, notamment dans l'élaboration des
scénarios de projets de territoire et dans les choix ou arbitrages à opérer, pour s'assurer de la façon dont
ces scénarios répondent aux enjeux soulevés. Pour les collectivités comme pour les bureaux d'étude, la
note d'enjeux est un moyen de connaître les points sur lesquels l'Etat sera particulièrement vigilant et
d'anticiper leur prise en compte.
En amont et lorsque le calendrier le permet, la note d'enjeux peut servir à la collectivité pour étayer le
contenu de son cahier des charges de consultation d'une équipe pour la réalisation du document
d'urbanisme, notamment vis-à-vis des problématiques et enjeux territoriaux. Ainsi, la collectivité peut
mobiliser son ingénierie dans la recherche d'un projet de territoire qui prenne en compte dès le départ du
processus les enjeux évoqués par l’État sur lesquels les élus souhaitent répondre.
En aval, la note d'enjeux constitue un support utile lors de la constitution de l'avis sur document arrêté :
elle constitue en effet une référence sur laquelle les producteurs de l'avis pourront s'appuyer pour vérifier
la réponse apportée par la collectivité aux enjeux portés par l’État.
Les attentes vis-à-vis des modalités de l'association
La diffusion de la note d'enjeux de l’État peut intervenir en même temps ou ultérieurement à l'envoi du
PAC, dont les collectivités ont besoin très tôt dans leur procédure. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre
qu'elle soit finalisée pour mettre à disposition le PAC. La présentation des deux documents peut être
concomitante. La note d'enjeux peut ensuite s'enrichir durant tout le processus d'association des services
de l'Etat à la démarche de planification, par exemple par l'apport de nouveaux éléments d'analyses à
l'appui des enjeux, que ce soit à travers des notes complémentaires ou à travers l'expression en réunions
ou groupes de travail.
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 8/19Pour les collectivités comme pour les bureaux d'études, la note d'enjeux est un
moyen de connaître les enjeux sur lesquels l'Etat sera particulièrement vigilant et
d'anticiper leur prise en compte. Elle constitue un document de référence dans le
cadre de l'association.
II. Organisation des services de l’État
La production du discours de l’État est une étape importante mais complexe compte tenu de la
multiplicité des thématiques abordées dans les documents d'urbanisme et de la transversalité nécessaire,
qui se répercute sur le nombre et la manière de mobiliser les services.
Bien que non soumise à des impératifs de délais, la transmission de la note d'enjeux le plus tôt possible
dans le processus d'élaboration du document d'urbanisme est fortement recommandée pour faciliter sa
prise en compte par la collectivité. Pour cela, les services de l’État doivent s'organiser en préalable.
1. Pilotage et organisation interministérielle
L'association de l’État est une démarche portée par le préfet de département et pilotée par les services de
la DDT en charge de l'urbanisme.
Il revient au préfet, représentant de l’État dans le département, de porter la parole de l’État dans la phase
d'association et d'informer les collectivités sur les « enjeux de l’État » (les courriers transmis sont signés
par la préfecture). La production et la présentation des éléments d'association (donc de la note d'enjeux),
tout comme la participation aux échanges avec les collectivités, incombent généralement aux services de
l'urbanisme des DDT. Il leur revient donc d'organiser la mobilisation des autres services de l’État sous
l'égide préfectorale pour porter un « dire » interministériel.
Le pilotage et l'animation de cette association sont une étape stratégique importante. Du simple recueil de
contributions après consultation des services, à l'identification partagée des enjeux propres au territoire et
au choix du ou des messages à véhiculer, la mobilisation interne doit être adaptée à l'organisation
spécifique des services de l’État au niveau départemental mais aussi régional, en fonction des enjeux et
des organisations locales.
La construction d'un discours de l’État fait intervenir des services dont les compétences sont organisées à
divers échelons territoriaux : départemental ou régional (ex : services en charge du domaine industriel,
services en charge de l'évaluation environnementale). Une double échelle est donc à considérer :
• la coordination entre services de compétence départementale,
• l'articulation entre niveau régional et niveau départemental.
DREAL et DDT définissent ensemble les modalités de coordination inter-services
aux deux échelons territoriaux afin de construire une connaissance stratégique des
territoires.
La construction du discours de l'Etat fait aussi intervenir des services extérieurs au périmètre du MEDDE
et du METL. Cette mobilisation interministérielle peut se traduire par plusieurs formes :
• des consultations simples des services concernés,
• des entretiens bilatéraux pour recueillir et partager les enjeux et leur formulation,
• des ateliers pour coordonner les visions des services de l’État, confronter, discuter et in fine
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 9/19construire un discours commun.
La construction d'un discours partagé entre les services constitue un enjeu de coordination important tant
chacun des sujets à traiter peut résulter de cultures et de disciplines différentes, le cumul de politiques à
traduire sur un même territoire nécessitant des arbitrages entre priorités dont la traduction territoriale peut
parfois s'avérer contradictoire.
Il est préférable, lorsque les délais et disponibilités le permettent, de disposer de mo-
ments de partage des enjeux en interministériel, afin que chacun explicite son point
de vue dans une vision globale et non sectorielle.
La richesse que permet alors le croisement des approches des différents services ne doit pas diluer le
positionnement de l'Etat dans une succession d'éléments à prendre en compte. Au contraire, il s'agit de
recomposer ces éléments en les recoupant et en les articulant, dans un objectif de clarification et de
cohérence des messages véhiculés pour faire émerger des enjeux transversaux et territorialisés.
→ En savoir plus sur l'organisation de la production de la connaissance et sa diffusion
2. Connaissance du territoire
L'élaboration d'une note d'enjeux fait appel à de nombreux sujets et thèmes d'aménagement du territoire
qu'il convient de rassembler. La multiplicité des projets, leurs périmètres de gouvernance et la dynamique
d'actualisation des documents d'urbanisme supposent une mise à jour régulière des éléments de diagnostic
pour élaborer le discours de l’État.
L'expression d'enjeux territorialisés et transversaux et le choix des enjeux prioritaires nécessitent de
disposer au préalable d'une connaissance suffisante du territoire et des acteurs.
→ Consulter un extrait du rapport Approche du développement durable des territoires et de leur
gouvernance, regards sur la territorialisation du Grenelle, CGEDD, janvier 2010
→ Consulter un extrait de la circulaire n°2001-63 relative au rôle de l'Etat dans la relance de la
planification
Parfois, cette connaissance est déjà disponible dans les services ou s'est construite par anticipation des
démarches des collectivités, pour favoriser leur émergence, ou encore pour rendre un avis sur la
pertinence du périmètre (de SCoT) choisi eu égard à la possibilité pour le préfet de créer ou d'étendre un
périmètre.
Des moyens humains et techniques permettant l'observation, la gestion des données, leur exploitation
(SIG, observatoires) et l'analyse (études générales) sont nécessaires pour un positionnement solide des
services de l'Etat dans l'accompagnement du processus de planification. Selon les thèmes et les échelles, il
peut être utile d'interroger l'articulation des interventions entre DREAL et DDT.
→ Exemples de pratiques en DDT
→ Exemple de démarche en DREAL
La transversalité des objectifs de développement durable et le caractère systémique de l'analyse
territoriale nécessaire à l'identification des enjeux, et donc à la rédaction d'une note d'enjeux, ont pour
corollaire la mobilisation d'une palette de compétences diversifiée en conséquence : il s'agit de disposer
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 10/19dans les services de compétences en conduite ou réalisation de diagnostics territoriaux, tant en termes de
connaissances méthodologiques, que de capacité d'analyse et d'animation pour passer de l'analyse
territoriale à l'identification des enjeux, puis de les confronter à la connaissance des politiques publiques
pour les traduire en enjeux sur le territoire du point de vue de l'Etat. Des actions de formation ou un
accompagnement méthodologique peuvent être utiles.
De telles démarches requièrent de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, ainsi qu'une animation pour
permettre les échanges au sein de l'équipe mobilisée et avec les différents services thématiques, afin de
faire émerger collectivement les principaux enjeux de l'Etat sur ce territoire.
→ Exemple de mode opératoire en plusieurs étapes
Lire le territoire sur le plan de ses enjeux de développement durable suppose d'opérer une lecture
systémique de ce territoire par le truchement d'objectifs définis d'une façon qui soit transversale aux
thématiques territoriales traditionnelles. En outre, cette lecture doit être dynamique par l'analyse de
l'évolution des données observées.
Ainsi une approche systémique est à privilégier, impliquant, au delà de l’étude des différents éléments
composant le système territorial, l’étude de leurs relations et de leurs influences croisées à différentes
échelles temporelles et spatiales. Ces réflexions et analyses croisées ne sont pas toujours aisées à
organiser et à formaliser.
L’utilisation de questionnements peut être une manière d’y arriver. Différentes grilles de
questionnements existent déjà, elles ont pour objet d’aider le service dans la réalisation et la
structuration de son diagnostic : se poser les bonnes questions pour porter un nouveau regard sur
le territoire.
Pour une meilleure appropriation, il peut être intéressant de construire sa propre grille, que ce soit à partir
des grilles de questionnement déjà existantes ou par exemple en partant des principes définis à l'article
L121-1 du code de l'urbanisme. Une manière d'aboutir aux enjeux de l'Etat sur le territoire analysé peut
passer par la mobilisation d'une analyse croisée « Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces » (AFOM) du
territoire. L'intérêt de cet outil est de permettre la prise en compte des territoires voisins grâce notamment
aux catégories « opportunités » et « menaces ».
→ Consulter la bibliographie en annexe pour des informations sur les méthodes d'analyse
territoriale
La spatialisation des enjeux, soit par un outil cartographique soit de façon schématique, procure une
vision globale et favorise l'identification d'interactions entre enjeux. Cela permet d'affirmer la
territorialité, la superposition d'enjeux amène à s'intéresser à leur articulation, voire aux éventuels conflits
d'usage.
→ Différents liens sur la « méthode des chorèmes » (Sylvie Lardon et Vincent
Piveteau) disponibles dans la bibliographie en annexe
L'élaboration de notes d'enjeux est facilitée par l'organisation de la connaissance au
sein des services, qui passe par des dispositifs de veille, de capitalisation et actuali-
sation de l'information, et de (pré-)traitement et analyse de cette information.
Elle nécessite des compétences en analyse territoriale centrée sur des approches
systémiques et non thématiques, facilitée par une bonne connaissance du territoire
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 11/19(le fonctionnement actuel, les projets, les acteurs...), ainsi que des capacités de syn-
thèse et d'animation.
Pour s'inscrire en phase amont de l'élaboration des documents d'urbanisme, la
confection de telles notes doit si possible s'inscrire dans une démarche continue
d'acquisition et d'entretien des connaissances en inter-services.
III. Contenu de la note d'enjeux de l'Etat
1. Afficher les enjeux de l'Etat pour le territoire
La note d'enjeux n'est intéressante pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre que si les enjeux
formulés sont suffisamment précis, territorialisés et circonstanciés.
Qu'entend-on par « enjeux de l'Etat sur un territoire donné » et quelle traduction en faire dans
une note d'enjeu ?
Le document Evaluation environnementale des documents d'urbanisme : le guide, CGDD, décembre
2011, développe la notion d'enjeux de l'Etat attachés à un territoire donné.
« On entend par enjeux les questions qui engagent fortement l’avenir du territoire, les valeurs qu’il n’est
pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, ou que l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant du
point de vue des ressources naturelles que de la santé publique ou de la qualité de vie. Ils peuvent
s’exprimer à partir de l’état des composantes du système territorial et de leur tendance d’évolution, de
l’importance des pressions exercées et/ou de l’insuffisance des réponses apportées. Bien entendu, la note
d'enjeux se concentrera sur la traduction des enjeux de l'Etat sur un territoire particulier et n’essaiera pas
de balayer l'ensemble des enjeux du territoire qui seront définis par la collectivité. L'Etat devra veiller à ce
que ces enjeux territoriaux prennent en compte les enjeux Etat.
Au-delà de l’expression des enjeux, la note d'enjeux gagnera à en donner une lecture hiérarchisée. Cette
hiérarchisation des enjeux ne sera pas établie dans l’absolu mais au regard de leur importance du point du
vue du développement durable (contribution au développement économique, équité sociale, identité et
image du territoire, demande sociale…). Ainsi, il n’y a pas une hiérarchie unique des enjeux, mais cela
dépend du (ou des) critère(s) objectif(s) mis en avant (en reliant notamment les constats scientifiques au
contexte particulier du territoire). Et à partir d’une telle lecture des enjeux, la collectivité pourra définir ses
priorités en connaissance de cause.
Dans la perspective de l’élaboration du PADD, les enjeux peuvent aussi être hiérarchisés en fonction des
leviers potentiels et des marges de manœuvre que le document d’urbanisme offre pour chacun d’entre eux.
Les enjeux et leur hiérarchisation doivent aussi tenir compte de la situation environnementale du territoire
au regard des orientations et objectifs de référence qui s’y appliquent.
La territorialisation des enjeux est aussi une forme de hiérarchisation : l’ensemble du territoire ne sera pas
nécessairement concerné par tous les enjeux, ou ils n’auront pas la même intensité partout. Il faut donc
territorialiser les enjeux pour prendre en compte les spécificités locales au sein du territoire. La
cartographie a ici toute son importance car elle permettra à la fois de spatialiser les parties du territoire
concernées par chaque enjeu,et de mettre en évidence les parties du territoire qui sont confrontées au
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 12/19cumul de plusieurs enjeux ».
Afin de rendre l'expression du point de vue de l'Etat opératoire, il est conseillé de réduire le
nombre de messages (autour de 3 ou 4) : le document final peut ainsi être organisé en différentes
rubriques correspondant chacune à un message, qui peuvent eux-mêmes regrouper plusieurs
enjeux.
Si l'établissement de la note d'enjeux nécessite d'avoir des éléments d'analyse territoriale pour identifier
les problématiques locales en lien avec les grandes politiques nationales, toutefois ces éléments ne
doivent pas être retranscrits intégralement dans la note d'enjeux qui n'a pas vocation à empiéter sur le
diagnostic conduit par la collectivité dans le cadre de sa démarche.
Ainsi, il est possible de simplement rappeler pour chaque enjeu :
1. les constats et tendances le justifiant, par exemple à partir de quelques éléments succincts
issus de l'analyse AFOM du territoire
2. l'explicitation de l'enjeu, éventuellement assortie d'une proposition de sa déclinaison en
objectifs territorialisés à prendre en compte dans le document d'urbanisme
3. les leviers d'actions et outils dont dispose le document d'urbanisme pour essayer de
satisfaire à ces objectifs : par exemple, sous la forme « le SCoT pourrait ... »...
La note d'enjeux présente un fort intérêt à être fournie le plus en amont de la démarche. En effet, plus tôt
l'Etat sera clair dans la formulation des enjeux sur lesquels il souhaite que s'instaure un débat, plus vite les
échanges pourront porter sur ce qui lui importe en évitant les malentendus, en mettant en évidence les
aspects intangibles tout comme les marges de manoeuvre : bien posés dès l'amont, les enjeux exprimés
par l'Etat sont un support à la réflexion.
Tout au long de l'association, le document constituant la note d'enjeux constitue une référence qui
légitime les interventions du représentant de l'Etat en réunions de personnes publiques associées. Elle
constitue aussi une grille de lecture pour les premiers documents qui seront transmis par la maîtrise
d'ouvrage, en vue d'ébaucher l'avis final (sur projet arrêté).
La note d'enjeux gagne à être synthétique, organisée autour de 3 à 4 messages pou-
vant regrouper plusieurs enjeux. Elle énonce chacun d'eux en rappelant succincte-
ment les constats et tendances le justifiant. Elle peut proposer une déclinaison en
objectifs à prendre en compte dans le document d'urbanisme, ainsi que des leviers
d'actions pour y répondre.
Elle constitue un support à la réflexion et permet de poser les points sur lesquels
l'Etat sera particulièrement vigilant (notamment dans la perspective de l'avis sur pro-
jet arrêté).
2. Mentionner des éléments de gouvernance du projet de document
« Le concept de gouvernance désigne un processus collectif d’élaboration de décisions qui tend à rendre
compte de la complexité organisationnelle grandissante du pouvoir local sur des territoires qui, bien plus
que des espaces physiques et géographiques, administratifs et politiques figés, représentent des systèmes
de relations et d’échanges en perpétuelle évolution » (Schéma de cohérence territoriale et développement
durable, un nouvel avenir pour les territoires, ARPE, 2010).
Plusieurs éléments de gouvernance méritent une attention particulière :
• le pilotage et l'organisation de la transversalité,
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 13/19• la participation (des acteurs institutionnels et socioéconomiques, des habitants),
• l'évaluation et la stratégie d’amélioration continue.
→ En savoir plus sur la gouvernance du SCoT décrite dans Schéma de cohérence territoriale et
développement durable, un nouvel avenir pour les territoires, ARPE, 2010
Généralement, un comité de pilotage suit l'avancement de la démarche aux différentes étapes, et procède à
la validation des documents. Il s'appuie sur un comité technique chargé d'organiser le déroulement des
travaux et de préparer les documents proposés à validation. Des groupes de travail ou commissions
thématiques et/ou géographiques apportent leurs contributions à la réflexion.
Si le choix et la mise en place de telles instances incombent de plein droit à la collectivité responsable de
l'élaboration du document d'urbanisme, le représentant de l'Etat au cours de l'association peut, le cas
échéant, conseiller la collectivité, notamment par référence à des dispositifs mis en place dans des
démarches similaires sur d'autres territoires de taille équivalente.
Il n'est en revanche pas indiqué que la note d'enjeux comporte ces dispositifs, tout au plus peut-elle se
contenter d'attirer l'attention sur l'importance du dispositif de gouvernance à mettre en place, dans toutes
ses composantes : pilotage, participation, suivi et évaluation.
→ En savoir plus sur la définition d'indicateurs : extraits du guide L'évaluation environnementale
des documents d'urbanisme, CGDD, décembre 2011
L'apport de l'Etat dans le cadre de l'élaboration de la note d'enjeux peut également consister à favoriser les
complémentarités et les solidarités entre territoires (que ce soit en interne ou avec les territoires voisins)
en proposant aux collectivités une approche plus large (échelle supra-territoriale), plus prospective
(réflexions sur le long terme), ou interscalaire (croisant les différentes échelles spatiales et temporelles). Il
s'agit alors d'inviter les collectivités à questionner les modes de gouvernance et les possibilités de
mutualisation. Ceci est particulièrement vrai sur des territoires ruraux pour lesquels la mutualisation de
l'ingénierie représentera un intérêt financier. Il peut aussi être opportun d'engager une démarche
interSCoT si d'autres projets émergent sur des territoires voisins.
La note d'enjeux est l'occasion d'attirer l'attention de la collectivité sur l'intérêt de ré-
fléchir à la mise en oeuvre du document au cours de son élaboration dans toutes ses
composantes : pilotage, participation, suivi et évaluation.
Elle peut également permettre de favoriser les mutualisations et les réflexions à
d'autres échelles (interSCoT par exemple).
IV. Forme et portage de la note d'enjeux
La forme de la note d'enjeux mérite d'être réfléchie pour optimiser son efficacité pédagogique et faciliter
sa lecture par les élus et les bureaux d'études prestataires. Il est conseillé d'accompagner la transmission
écrite du document d'une présentation pour une meilleure appropriation et compréhension.
1. Les attentes des collectivités et bureaux d'études vis-à-vis de la forme et du portage
Les entretiens auprès de collectivités et bureaux d'étude révèlent un réel besoin envers des documents plus
pédagogiques et plus communicants pour les élus et les bureaux d'études, avec un format attractif, aisé à
parcourir permettant d'aller rapidement à l'essentiel. Un format court (une quinzaine de pages environ) est
donc demandé pour présenter de façon concise et la plus claire possible la position de l'Etat. Le titre du
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 14/19document doit clairement afficher que le document porte les messages du représentant local de l'Etat.
Une présentation orale par les services de l'Etat est unanimement souhaitée afin d'aider la collectivité à
comprendre les enjeux portés par l'Etat et à clarifier le discours dès le début de la démarche (au plus tard
avant le PADD). Il s'avère souvent que cette présentation est une occasion particulière, permettant de
mobiliser davantage d'élus qu'au sein des réunions de travail habituelles et ainsi de faire entendre dès
l'amont les messages principaux de l'Etat plus largement que ne le permet le document écrit, celui-ci
servant de façon complémentaire de document de référence au bureau d'études. Il est donc stratégique de
s'assurer une présentation de qualité que ce soit à travers le support réalisé ou la manière de l'exprimer.
2. Mise en forme du document écrit
L'objectif de ce document est bien d'aller à l'essentiel. Un document relativement court est à privilégier,
ce qui a le mérite d'obliger le rédacteur à articuler et synthétiser les enjeux. Chaque grand message sera
mis en relief, par exemple sous forme de rubrique dédiée rassemblant des enjeux de même nature ou en
lien les uns avec les autres. Des encadrés en marge du document pourront mettre en valeur certains
éléments.
La formulation des enjeux est à adapter au degré de prise en compte attendu, selon leur niveau
d'importance (des plus exigeantes à celles dont la prise en compte laisse une marge de manoeuvre). Pour
ces dernières, le recours à des questionnements peut éventuellement être un moyen de formulation
intéressant.
Le ton de la note est à adapter selon les attentes et le degré attendu de leur prise en compte.
Ainsi, la note d'enjeux peut opérer une hiérarchie :
– entre des attentes fortes qu'il faudra afficher comme telles :
« Le document d'urbanisme devra... »
« Le document d'urbanisme prendra en compte... »
« Il est indispensable que... »
« Le développement s'appuiera sur... »
« Les orientations favoriseront... »
« Le thème de... doit être clairement abordé »
– et des enjeux qui laissent davantage de marges de manœuvre à la collectivité, qui peuvent être
formulés sous forme conditionnelle ou interrogative :
« Le document d'urbanisme pourra, pourrait... »
« Il pourrait être utile de... »
« Il conviendrait de... »
« L'enjeu serait de... »
« La collectivité pourra se poser la question : mon projet de territoire est-il en adé-
quation avec... ? »
La cartographie est à utiliser comme outil de visualisation et de synthèse des enjeux. Des
schémas peuvent être proposés si la compréhension est meilleure. Il est conseillé d'afficher une
carte de synthèse finale qui superpose et croise les enjeux. Elle permet de faire apparaître les
cohérences existantes ou à renforcer, ainsi que les secteurs où des choix sont à opérer pour
concilier des enjeux de nature différente.
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 15/19Un titre homogène pour toutes les notes d'enjeux du département ou de la région facilite l'identification du
document comme porteur des enjeux de l'Etat, en précisant sur la page de garde la date de son
établissement et les références de son auteur.
« Note d'enjeux de l'Etat »
Elaboration (ou révision) du document d'urbanisme de...
Il est recommandé de concevoir une mise en page spécifique qui permette de bien différencier la note
d'enjeux du PAC. Ainsi, un encadré en première page permet de préciser la vocation du document, ainsi
que son caractère non exhaustif susceptible d'être complété au cours de l'association. Par exemple :
« Cette note d'enjeux a pour objectif de définir les enjeux prioritaires du point de vue
de l'Etat sur votre territoire dans le cadre de votre démarche d'urbanisme. Elle s'ins-
crit en complément du document PAC et n'a pas vocation à être exhaustive.
Ces deux documents sont fournis en amont de la démarche pour préparer les débats
à venir. Au cours de la réflexion, d'autres éléments sont susceptibles de venir abon-
der ces éléments, pour s'adapter aux évolutions des territoires, pour tenir compte de
l'avancement de projets ou de modifications législatives ou réglementaires ».
→ Exemple de plaquettes des enjeux de l'Etat dans le cadre de démarches de SCoT
SCoT du Pays de la Baie du Mont Saint Michel : http://intra.ddtm-manche.i2/IMG/pdf/a4-
noir_et_ocre_cle229a1a.pdf
SCoT du Cotention : http://intra.ddtm-manche.i2/IMG/pdf/plaquette_enjeux-vf-
Scot_Cotentin_cle0ed12b.pdf
3. Communiquer oralement sur les enjeux de l'Etat pour le territoire
La présentation de la note d'enjeux facilite la posture de partenaire, en exposant son contenu, en étant
présent pour répondre aux questions, en précisant les attendus mais aussi les marges de manoeuvre pour
la traduction des enjeux sur leur territoire. La manière de présenter les enjeux doit favoriser le dialogue en
évitant la seule évocation des contraintes.
Au cours de cette présentation, méritent d'être explicités :
– la doctrine en matière d'aménagement du territoire si celle-ci a évolué récemment, par exemple
depuis la date d'approbation du dernier document d'urbanisme de la collectivité (cela permet de
poser le cadre et est particulièrement indiqué si la présentation de la note d'enjeux est commune à
celle du PAC) ;
– les principaux enjeux, si possible hiérarchisés ;
– le statut du document vis-à-vis des réflexions à venir : par exemple, le rôle d'alerte de la note
d'enjeux par rapport à l'avis final, le niveau d'exigence des justifications du projet, les critères qui
vont être appliqués pour examiner le projet, l'interprétation des concepts tels que « densification »,
« consommation d'espace », etc...
– les possibilités d'accompagnement de l'Etat.
La présentation de la note d'enjeux peut comporter un rappel succinct des politiques
d'aménagement du territoire, une présentation contextualisée et argumentée des
principaux enjeux, la portée du document vis-à-vis de la suite de la démarche, ainsi
que les possibilités d'accompagnement de l'Etat le cas échéant.
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 16/19→ Exemple de support de présentation des enjeux de l'Etat
http://intra.ddtm-
manche.i2/IMG/pdf/Portage_discours_Etat_sur_le_scot_Cotentin_vff_cle11f5d1.pdf
IV. Conclusion
La note d'enjeux s'inscrit dans le processus d'association de l'Etat, en complément du Porter à
Connaissance. Elle permet à l'Etat de faire part à la collectivité des enjeux qui lui paraissent importants
sur le territoire considéré, dans une logique de cohérence entre les politiques publiques et entre les
échelles de territoire, en mettant particulièrement en avant ceux faisant l'objet d'une vigilance particulière.
Elle constitue ensuite un document de référence au moment de l'avis de l'Etat sur le projet arrêté par la
collectivité, pour s'assurer de la prise en compte des enjeux qui ont été formulés.
Son élaboration suppose l'organisation d'une veille territoriale (pour faciliter l'accès à la connaissance) et
une mobilisation interministérielle des services de l'Etat. Elle peut également être l'occasion d'insister sur
le lien nécessaire entre élaboration du projet et traduction opérationnelle dans le document d'urbanisme.
Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 17/19Référentiel « Porter à Connaissance et association aux documents d'urbanisme » – Note d'enjeux – Juin 2013 18/19
Centre d'Études Techniques de l'Équipement de l'Ouest
MAN – rue René Viviani
BP 46223
44262 NANTES cedex 2
Tél. : 02 40 12 83 01
Fax : 02 40 12 84 44
CETE-Ouest@developpement-durable.gouv.fr
www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.frVous pouvez aussi lire