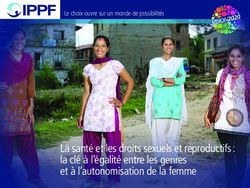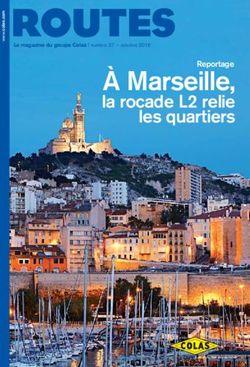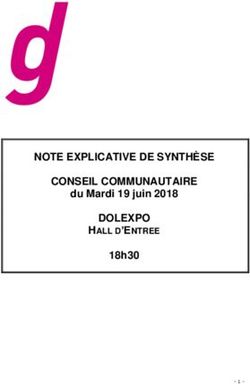Risques électriques Ti112 - Sécurité et gestion des risques - Réf. Internet : 42496
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ
Ti112 - Sécurité et gestion des risques
Risques électriques
Réf. Internet : 42496
Actualisation permanente sur
www.techniques-ingenieur.frTec h n ique s de l ’I n gé ni eur
La plus impor tante ressource documentaire scientifique
et technique en français
Une information fiable, claire et actualisée
Validés par un comité scientifique et mis à jour en permanence sur Internet,
les articles Techniques de l’Ingénieur s’adressent à tous les ingénieurs et
scientifiques, en poste ou en formation.
Outil d’accompagnement de la formation et de la carrière des ingénieurs,
les ressources documentaires Techniques de l’Ingénieur constituent le socle
commun de connaissances des acteurs de la recherche et de l’industrie.
Les meilleurs experts techniques et scientifiques
Plus de 200 conseillers scientifiques et 3 500 auteurs, industriels, chercheurs,
professeurs collaborent pour faire de Techniques de l’Ingénieur l’éditeur
scientifique et technique de référence.
Les meilleurs spécialistes sont réunis pour constituer une base de
connaissances inégalée, vous former et vous accompagner dans vos projets.
Une collection 100 % en ligne
• Accessibles sur www.techniques-ingenieur.fr, les dernières nouveautés et
actualisations de votre ressource documentaire
• Les articles téléchargeables en version PDF
Des services associés
Rendez-vous sur votre espace « Mon compte » en ligne pour retrouver la liste
des services associés à vos droits d’accès et les utiliser.
Des services associés
Pour toute information, le service clientèle reste à votre disposition :
Tél : 01 53 35 20 20 l Fax : 01 53 26 79 18 l Mail : infos.clients@teching.com
IIICet ouvrage fait par tie de
Sécurité et gestion des risques
(Réf. Internet ti112)
composé de :
Management de la sécurité Réf. Internet : 42154
Méthodes d'analyse des risques Réf. Internet : 42155
Risques chimiques - Toxicologie et écotoxicologie Réf. Internet : 42156
Risques chimiques - Pesticides et produits phytosanitaires Réf. Internet : 42568
Encadrer le risque chimique et connaître ses obligations Réf. Internet : 22742
Maîtriser le risque chimique - management, santé et sécurité Réf. Internet : 22743
dans l’entreprise
Risques d'explosion Réf. Internet : 42157
Risques d'incendie Réf. Internet : 42583
Risques électriques Réf. Internet : 42496
Sécurité par secteur d'activité et par technologie Réf. Internet : 42159
Sécurité des systèmes industriels Réf. Internet : 42830
Santé et sécurité au travail Réf. Internet : 42158
Menaces et vulnérabilités : protection des sites industriels Réf. Internet : 42648
Risques naturels et impacts industriels Réf. Internet : 42828
Sur www.techniques-ingenieur.fr
• Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne
• Retrouvez la liste complète des ressources documentaires
IVCet ouvrage fait par tie de
Sécurité et gestion des risques
(Réf. Internet ti112)
dont les exper ts scientifiques sont :
Jean-Pierre DAL PONT
Président de la SFGP (Société française de génie des procédés), Secrétaire
général de l'EFCE (Fédération européenne du génie chimique), Président de la
SECF (Société des experts chimistes de France)
François FONTAINE
Responsable « Sécurité Globale et Sécurité Globale et terrorisme », INERIS
Didier GASTON
Responsable Agence, CETE APAVE Nord-Ouest
Jean-Louis GUSTIN
Expert en sécurité des procédés Rhodia Recherches et Technologies
André LAURENT
Professeur émérite, Nancy Université, LRGP, CNRS, INPL, ENSIC
Yves MORTUREUX
Expert en maîtrise des risques à la Direction de la sécurité de la SNCF
Jean-Paul PERES
Ancien Directeur Responsable Care de Rhodia
Sur www.techniques-ingenieur.fr
• Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne
• Retrouvez la liste complète des ressources documentaires
VLes auteurs ayant contribué à cet ouvrage sont :
Christian ATLANI
Pour les articles : D5101 – D5102 – D5103
Mohamed BOUDALAA
Pour l’article : SE5120
Brigitte FALLOU
Pour l’article : D2070
Daniel HILAIRE
Pour les articles : SL6180 – SL6181
Jean-François MOREL
Pour l’article : R533
Yannick OLLIER
Pour l’article : SE5120
Jean-Louis POYARD
Pour les articles : SL6180 – SL6181
Sur www.techniques-ingenieur.fr
• Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne
• Retrouvez la liste complète des ressources documentaires
VIRisques électriques
(Réf. Internet 42496)
SOMMAIRE
Réf. Internet page
Prévention des accidents électriques. Présentation générale D5101 9
Prévention des accidents électriques. Mesures de protection D5102 13
Prévention des accidents électriques. Exploitation D5103 17
Problèmes de feu dans le matériel électrique D2070 27
Sécurité électrique. Le risque électrique dans les laboratoires SL6180 31
Sécurité électrique. Protection des personnes SL6181 35
Matériel électrique en atmosphère explosible. Sécurité intrinsèque R533 39
Électricité statique : source d'incendie et d'explosion SE5120 45
Sur www.techniques-ingenieur.fr
• Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne
• Retrouvez la liste complète des ressources documentaires
VII Sur www.techniques-ingenieur.fr
• Saisissez la référence Internet pour accéder directement aux contenus en ligne
• Retrouvez la liste complète des ressources documentairesr←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPQ
Prévention des accidents électriques
Présentation générale
par Christian ATLANI
Ingénieur, membre du groupement des industries de l’équipement électrique,
du contrôle commande et des services associés GIMELEC
Membre des commissions U 21 et UF 78 de l’AFNOR
Membre de la commission CENELEC BTTF 62-3
Ancien animateur du groupe de travail chargé de la révision de la publication
UTE C 18-510, commission U 21 de l’UTE (Union technique de l’électricité)
Ancien rapporteur général du Comité des travaux sous tension
Cet article est la version actualisée de l’article [D 5 101] intitulé « Prévention des accidents
électriques. Présentation générale » rédigé par Christian ATLANI et Dominique SERRE et
paru en 2012.
1. Risque électrique...................................................................................... D 5 101v2 - 2
1.1 Légende et histoire du risque électrique.................................................... — 2
1.2 Histoire de la normalisation ........................................................................ — 3
1.3 Statistiques d’accidents électriques ........................................................... — 3
2. Nature et importance des accidents d’origine électrique ............ — 6
2.1 Terminologie ................................................................................................ — 6
2.2 Classement ................................................................................................... — 6
2.3 Sensibilité au courant électrique ................................................................ — 8
2.4 Actions physiopathologiques du courant électrique ................................ — 8
3. Cas particulier lié à la présence d’eau ............................................... — 8
3.1 Résistivité des solutions aqueuse............................................................... — 8
3.2 Résistivité du corps humain........................................................................ — 8
3.3 Courants conduits au travers d’un corps immergé................................... — 10
3.4 Effets physiologiques du courant au travers d’un corps immergé.......... — 10
3.5 Seuil de courant ........................................................................................... — 11
3.6 Tension de sécurité intrinsèque.................................................................. — 11
4. Classement des installations en fonction de la tension ............... — 12
5. Conclusion.................................................................................................. — 12
6. Glossaire ..................................................................................................... — 12
Pour en savoir plus ........................................................................................... Doc. D 5 101v2
’emploi généralisé de l’énergie électrique dans toutes ses applications et
L dans tous les domaines (depuis la production d’énergie électrique jusqu’au
consommateur final) fait que le risque électrique est présent partout et doit
être évalué et maîtrisé en toute occasion.
Présent et invisible comme tous les risques inhérents aux formes supé-
rieures de l’énergie, il a en revanche le mérite d’être bien connu, facile à
maîtriser, ce qui, tout compte fait, le rend presque familier et en tout cas moins
redouté que, par exemple, le danger des rayonnements ionisants.
Les articles [D 5 101], [D 5 102] et [D 5 103], chacun pour leur partie, vont
développer les manières de comprendre, d’analyser et de maîtriser le risque
électrique.
p。イオエゥッョ@Z@。ッエ@RPQX
Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés D 5 101v2 – 1
Yr←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPQ
PRÉVENTION DES ACCIDENTS ÉLECTRIQUES _____________________________________________________________________________________________
Le présent article s’attache à présenter les statistiques d’accidents connues à
ce jour et les fondamentaux du choc et du courant électriques passant à
travers le corps humain. Si le poids relatif des accidents d’origine électrique ne
paraît pas très élevé par rapport à ceux dus aux autres risques tels que la cir-
culation et le milieu domestique, la prévention n’en demeure pas moins
indispensable, notamment dans certains secteurs d’activité, plus particulière-
ment exposés aux risques, tels que le bâtiment, les travaux publics, les
installations électriques dans l’industrie et les réseaux de distribution publique.
L’article [D 5 102] s’attache à présenter les règles de construction et d’instal-
lation des ouvrages et des installations électriques.
L’article [D 5 103] s’attache à présenter ce que l’on appelle l’exploitation des
ouvrages et des installations électriques, c’est-à-dire toutes les opérations de
construction, d’entretien, de dépannage et de déconstruction ainsi que la pré-
vention des incendies dans ces installations.
Ces trois articles bien que s’appuyant sur les textes réglementaires concer-
nant les ouvrages ou les installations électriques peuvent s’appliquer, dans
leur principe, à d’autres ouvrages tels que ceux de la traction électrique ou les
navires. Ils peuvent aussi servir de base à d’autres pays que la France dans la
mesure du respect de leur réglementation.
Pour les véhicules et engins électriques, la réglementation de base est la
même mais des normes spécifiques sont désormais applicables.
de soie, et posa le principe de la mise à la terre. Cette précau-
1. Risque électrique tion importante était bien connue de son contemporain, le profes-
seur Richmann, membre de l’Académie des sciences de Saint-
1.1 Légende et histoire du risque Pétersbourg qui, répétant des expériences sur la foudre (celles de
Franklin, Buffon, Lemonnier, de Romas et autres) avait été électro-
électrique cuté, le 6 août 1753. Par temps d’orage, se disposant à mesurer les
décharges au moyen d’un électromètre « n’étant plus qu’à un pied
Les historiens de la science se réfèrent avec complaisance aux du conducteur, un globe de feu bleuâtre, gros comme le poing,
textes bibliques et aux témoignages anciens. L’histoire de l’électri- vint le frapper au front et l’étendit mort ». On peut le considérer
cité n’a pas échappé à leurs investigations, et plus particulièrement comme étant le premier exemple, attesté scientifiquement, d’acci-
le risque électrique. dent électrique.
On a trouvé dans les textes bibliques une référence inattendue :
Vers 1790, l’anatomiste italien Galvani introduisit le courant élec-
l’arche d’alliance aurait été la première machine électrique. Sou-
trique dans le domaine des réactions de l’organisme animal avec
mise aux champs électriques qui, dans la zone désertique, peuvent
ses expériences sur les grenouilles, et Volta, pour réfuter les
atteindre plusieurs centaines de volts par mètre à 2 m du sol, son
conclusions du premier, construisit la première pile électrique
armature métallique pouvait se charger à un potentiel dangereux,
qui marque le début de la nouvelle et grande période de l’électri-
et foudroyer les impies, tout en restant sans danger pour les
cité.
prêtres enfermés dans leur cage de Faraday constituée de fils d’or
tissés dans leurs vêtements. L’arche était équipée d’anneaux d’or Les premières études scientifiques sur l’action physiologique
aux quatre angles dans lesquels coulissaient des bâtons de bois du courant électrique s’engagèrent alors en France et les noms
d’acacia recouverts d’or, réalisant ainsi la première mise à la terre. des chirurgiens des armées impériales Larrey et Bichat y sont atta-
L’électricité sous la forme de ses manifestations atmosphériques chés, tandis que le docteur Uré réalisa les premières expériences
a été longtemps considérée comme l’esprit du mal, l’effet de la de réanimation des électrisés. La voie était ouverte à ces méthodes
colère des dieux. L’histoire abonde des tentatives tragiques de dont on connaît l’importance aujourd’hui.
nombreux chercheurs et même, parmi eux, deux rois qui imagi- Des recherches sur les effets physiopathologiques du cou-
nèrent des systèmes de protection contre la foudre. Au Xe siècle, le rant électrique ont été effectuées par de nombreux chercheurs ;
savant Gerbert, plus connu sous le nom de pape Sylvestre II, parmi eux, il convient de citer les noms de Dalziel, Ferris, Jacob-
jalonnait le sol de perches terminées par des fers de lances très sen, Knickerbocker, Koeppen, Sam, Ozypka, Lee... Ces travaux ont
pointus pour protéger les lieux. porté sur des animaux vivants dont les réactions peuvent être
La découverte des propriétés de l’électricité statique avec la extrapolées par rapport à celles de l’homme. Des mesures de
bouteille de Leyde, vers 1746, et les expériences de décharge élec- résistance ont également été effectuées sur des cadavres humains
trique que propageait le savant abbé Nollet a polarisé pour un peu de temps après leur décès.
temps l’opinion qui se ruait dans les salons parisiens. Entre 1970 et 1980, le professeur autrichien Biegelmeier s’est
Mais les savants, poursuivant les recherches pour domestiquer livré sur lui-même à des mesures de courant et d’impédance sous
la foudre établirent un rapport entre celle-ci et l’électricité. Il y a des tensions allant de 10 à 220 V, entre différentes parties de son
plus de deux siècles, Benjamin Franklin réalisa de nombreuses corps et dans différentes conditions d’humidité. Il a ainsi effectué
expériences (le cerf-volant restant la plus célèbre) ; il adopta le pre- plus de 600 mesures qui ont permis d’améliorer de façon impor-
mier la notion d’isolement électrique de l’opérateur avec des fils tante nos connaissances sur les effets du courant électrique sur le
D 5 101v2 – 2 Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés
QPr←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPQ
_____________________________________________________________________________________________ PRÉVENTION DES ACCIDENTS ÉLECTRIQUES
corps humain. Inutile de préciser que cet homme courageux s’était mesures effectuées sur des animaux ; la publication a été reprise
entouré de toutes les précautions nécessaires pour éviter tout en trois documents :
risque d’accident ; en particulier, le circuit qui l’alimentait était – CEI/TS 60479-1 : effet du courant sur l’homme et les animaux
protégé par quatre dispositifs différentiels de 30 mA en série, et domestiques, première partie Aspects généraux (2005) ;
son assistant disposait des moyens de réanimation nécessaires.
– CEI/TS 60479-2 : effet du courant sur l’homme et les animaux
domestiques, deuxième partie Aspects particuliers (2017) ;
1.2 Histoire de la normalisation – CEI/TS 60479-3 : effet du courant passant par le corps des ani-
maux domestiques (1998).
En 1969, la Commission électrotechnique internationale décida
d’établir les seuils d’apparition de danger en fonction des
divers paramètres qui agissent toujours en interdépendance étroite 1.3 Statistiques d’accidents électriques
(en particulier le courant i et le temps t avec la charge q = it ), afin
notamment de permettre aux différents comités d’études de fixer Il n’existe pas, en France, de structure nationale permettant l’éta-
avec précision les règles de sécurité que devaient respecter les blissement d’une statistique exhaustive sur l’origine des accidents.
matériels et installations électriques. Il s’agissait, en particulier, de Des éléments partiels sont cependant disponibles auprès des
déterminer les conditions de protection qui devaient permettre aux divers organismes intéressés, susceptibles de donner une repré-
dispositifs à courant différentiel résiduel d’assurer une protection sentation assez cohérente ; la principale difficulté est, toutefois, de
contre les contacts directs en cas de défaillance des autres discerner les causes premières de ces accidents qui, sauf cas parti-
mesures de protection. culiers, ne sont pas connues avec suffisamment de précisions, et
Cette étude fut confiée par la CEI au groupe de travail no 4 du peuvent également faire l’objet d’interprétations diverses.
comité d’études 64 – Installations électriques des bâtiments. Ce
groupe de travail, composé de médecins, de physiologistes, Exemple
d’ingénieurs de sécurité, publia dès 1974 un premier rapport por-
tant l’indice 479 et établissant une première approche des dangers Prenons le cas d’une chute d’échelle causée par un choc
du courant électrique passant par le corps humain ; cette publica- électrique : le décès éventuel sera classé sous la rubrique « chutes ».
tion reconnaissait notamment que la probabilité d’apparition des Nombreux sont les incendies réputés provenir d’un court-circuit ;
accidents était très faible dans des circonstances habituelles, à des ce qui est certain, c’est que, en cas de feu, des courts-circuits se
tensions inférieures ou égales à 50 V en courant alternatif à 50 Hz produisent ; sont-ils survenus avant ou après le départ du feu ? cela
et à 75 V en courant continu. reste à discerner.
Ayant rassemblé toute la littérature disponible à ce sujet, le
groupe de travail reprenait ses études d’une façon plus approfon- Sont présentés ci-après des tableaux qui bien que portant sur
die et une deuxième édition de la publication 479 était publiée en des périodes différentes ont permis de croiser des informations et
deux parties, comprenant six chapitres ; ce rapport donne des de proposer des conclusions qui montrent que la pédagogie des
informations très complètes : accidents d’origine électrique doit continuer tant que l’on n’atteint
– le rapport 479-1, sur les valeurs de l’impédance électrique du pas la suppression de tous ces accidents.
corps humain, sur les effets du courant alternatif de 1,5 à 100 Hz,
sur les effets du courant continu ; 1.3.1 Statistiques de l’INSERM
– le rapport 479-2, sur les effets des courants de fréquence supé-
rieure à 100 Hz, les formes d’onde spéciales, les impulsions de L’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médi-
courte durée. cale) recense la plupart des cas mortels. Le tableau 1 en récapitule
Tenant compte, d’une part, des plus récentes expériences du les données pour les années 1970 à 1999 (les statistiques actuelles
professeur Biegelmeier sur lui-même et, d’autre part, de nouvelles n’étant plus publiées).
Tableau 1 – Accidents mortels (d’après données INSERM)
1 2 3 4 5 6 7 8
Population Consommation Taux (7/6)
Taux (4/5)
par millions pour 106 habitants
Année Hommes Femmes Total pour
d’habitants et 103 kWh
106 habitants (1)
[en 106 habitants] (103 kWh) consommés (1)
1970 176 26 202 50,52 2,573 4 1,55
1975 144 29 173 52,65 3,166 3,28 1,04
1980 130 19 149 53,59 4,326 2,78 0,64
1985 146 22 168 55,06 5,077 3,05 0,60
1990 112 22 134 56,61 5,704 2,37 0,41
1995 76 10 86 58,02 6,341 1,48 0,23
1999 69 12 81 58,39 6,735 1,39 0,20
Les colonnes 1 à 4 proviennent de l’INSERM.
Les colonnes 5 à 8 proviennent du croisement avec les chiffres tirés des enquêtes annuelles du ministère chargé de l’Énergie.
(1) Ce taux tient compte tant de l’accroissement de la population que de celle de la consommation.
On note, sur cette période, une baisse constante du nombre d’accidents.
Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés D 5 101v2 – 3
QQQR
r←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPR
Prévention des accidents électriques
Mesures de protection
par Christian ATLANI
Ingénieur, membre du groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle -
commande et des services associés GIMELEC
Membre des commissions U 21 et UF 78 de l’AFNOR
Membre de la commission CENELEC BTTF 62-3
Ancien animateur du groupe de travail chargé de la révision de la publication UTE C 18-510,
commission U 21 de l’UTE (Union technique de l’électricité)
Ancien rapporteur général du Comité des travaux sous tension
Cet article est la version actualisée de l’article D 5 102 intitulé « Prévention des accidents
électriques. Mesures de protection » rédigé par Christian ATLANI et Dominique SERRE et
paru en 2012.
1. Principes, définitions et méthodologie ......................................... D 5 102v2 - 2
1.1 Principes. Définitions............................................................................... — 2
1.2 Méthodologie ........................................................................................... — 2
2. Conception des installations et protections par l’installation — 3
2.1 Conception des installations................................................................... — 3
2.2 Protections par l’installation ................................................................... — 3
3. Choix des dispositifs de protection en fonction du schéma
des liaisons à la terre .......................................................................... — 5
3.1 Détermination du schéma des liaisons à la terre.................................. — 5
3.2 Choix des dispositifs de protection ........................................................ — 5
3.3 Appareils de protection à courant différentiel résiduel ........................ — 6
4. Appareils mobiles en basse tension ............................................... — 6
4.1 Contexte.................................................................................................... — 6
4.2 Outils portatifs.......................................................................................... — 6
4.3 Lampes baladeuses ................................................................................. — 6
4.4 Appareils de mesure................................................................................ — 7
5. Mesures particulières et chantiers extérieurs ............................. — 8
5.1 Mesures particulières .............................................................................. — 8
5.2 Chantiers extérieurs................................................................................. — 8
6. Entretien et vérification des installations .................................... — 9
6.1 Entretien ................................................................................................... — 9
6.2 Vérifications.............................................................................................. — 9
7. Réglementation..................................................................................... — 9
8. Conclusion ............................................................................................. — 10
9. Glossaire ................................................................................................. — 10
Pour en savoir plus ........................................................................................ Doc. D 5 102v2
es articles [D 5 101], [D 5 102] et [D 5 103], chacun pour leur partie, vont
L développer les manières de comprendre, d’analyser et de maîtriser le
risque électrique.
L’article précédent [D 5 101] s’est attaché à présenter les statistiques d’acci-
dents connues à ce jour et les fondamentaux du choc électrique et du courant
électrique passant à travers le corps humain.
p。イオエゥッョ@Z@。ッエ@RPQX
Le présent article s’attache à présenter les règles de construction et
d’installation des ouvrages et des installations électriques.
Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés D 5 102v2 – 1
QSr←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPR
PRÉVENTION DES ACCIDENTS ÉLECTRIQUES _____________________________________________________________________________________________
Les améliorations techniques apportées au matériel et aux installations ont
toujours été liées à une élévation du niveau de sécurité dès la conception des
matériels. Nous verrons l’importance des normes françaises, européennes
et internationales dans ce domaine.
La France bénéficie d’une réglementation très complète – d’aucuns disent
trop complexe –, de textes d’application bien adaptés aux différents usages, et
d’une qualité de matériel garantie par les normes. Une bonne partie de cette
réglementation se trouve aujourd’hui incluse dans le Code du travail. Les
matériels de protection des installations électriques bénéficient de tous les
progrès de la recherche qui reste importante dans ce domaine.
La prévention des accidents dès la construction ne nécessite pas des moyens
très onéreux. La conception rationnelle des installations assure à la fois la pro-
tection des personnes et des biens et en particulier la protection contre les
dangers d’incendie.
L’article suivant [D 5 103] s’attachera à présenter ce que l’on appelle l’exploi-
tation des ouvrages et des installations électriques, c'est-à-dire toutes les
opérations de construction, d’entretien, de dépannage et de déconstruction,
ainsi que la prévention des incendies dans ces installations.
Les trois articles, bien que s’appuyant sur les textes réglementaires
concernant les ouvrages ou les installations électriques peuvent s’appliquer,
dans leur principe, à d’autres ouvrages tels que ceux de la traction électrique
ou les navires. Ils peuvent aussi servir de base à d’autres pays que la France
dans la mesure du respect de leur réglementation.
Pour les véhicules et engins électriques, la réglementation de base est la
même mais des normes spécifiques sont désormais applicables.
1. Principes, définitions 1.2 Méthodologie
et méthodologie Les mesures de protection peuvent être classées en protection
contre les contacts directs et en protection contre les contacts
indirects.
1.1 Principes. Définitions 1.2.1 Protection contre les contacts directs
Les différentes protections susceptibles d’être mises en œuvre Les mesures de protection contre les contacts directs sont desti-
répondent aux impératifs suivants : nées à rendre impossible un contact avec des parties actives de
– soit empêcher le contact avec une partie sous tension ; l’installation électrique :
– soit rendre ce contact non dangereux. – protection par éloignement : cas des lignes à haute tension ;
– protection par isolation : câbles électriques ;
Les parties sous tension auxquelles il est fait référence sont : – protection par enveloppe : armoires ou boîtes de raccor-
– soit des parties conductrices destinées à être normalement dement.
sous tension (conducteurs, bornes, etc.), dites parties actives ;
– soit les parties conductrices des matériels électriques non 1.2.2 Protection contre les contacts indirects
normalement sous tension, mais susceptibles de le devenir en cas
de défaut d’isolement par exemple, et dites masses. La protection contre les contacts indirects est réalisée par :
– le raccordement des masses au conducteur de protection,
Les contacts peuvent être de deux types :
associé à la coupure de l’alimentation en cas de défaut ;
– avec des parties actives nues : contacts directs ; – l’isolation double ou renforcée ;
– avec des masses mises sous tension à la suite d’un défaut – la séparation électrique pour l’alimentation d’un seul matériel ;
d’isolement : contacts indirects. – l’usage de la très basse tension.
Pour qu’un contact dangereux survienne et que le corps soit
parcouru par un courant, il faut qu’il soit soumis à une différence 1.2.3 Protection contre les conséquences
de potentiel. Cela peut être soit : des courts-circuits
– un contact simultané avec des conducteurs à potentiels La protection contre les conséquences des courts-circuits est
différents ; réalisée par :
– un contact simultané entre un conducteur sous tension ou une – la conception des installations et le choix des matériels ayant
masse en défaut et le potentiel de la terre (sol ou élément une protection intrinsèque ;
conducteur au potentiel de la terre ou à un potentiel voisin) ; – la réduction des temps d’élimination des défauts ;
– des courts-circuits et leurs conséquences sur les personnes. – le port d’équipements de protection adaptés par les opérateurs.
D 5 102v2 – 2 Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés
QTr←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPR
_____________________________________________________________________________________________ PRÉVENTION DES ACCIDENTS ÉLECTRIQUES
2. Conception des 2.2.1 Types de schémas des liaisons
à la terre
installations et protections Les différents schémas de distribution en basse tension
par l’installation (figure 1) sont codifiés par les lettres suivantes.
– 1re lettre : situation de l’alimentation par rapport à la
terre :
2.1 Conception des installations • T : liaison directe d’un point de l’alimentation avec la terre,
• I : isolation de toutes les parties actives par rapport à la terre,
Les règles (normes) des installations électriques, quelles que ou liaison d’un point de l’alimentation à la terre à travers une
soient leurs tensions (basse tension (NF C 14-100, NF C 15-100), impédance ;
haute tension (NF C 13-100, NF C 13-200), etc.) ont pour principes
fondamentaux que leur respect « est destiné à assurer la sécurité – 2e lettre : situation des masses de l’installation par rap-
des personnes, des animaux domestiques ou d’élevage et des port à la terre :
biens, contre les dangers et dommages pouvant résulter de l’utili- • T : masses reliées directement à une prise de terre électri-
sation des installations électriques dans les conditions qui peuvent quement indépendante de celle de l’alimentation,
raisonnablement être prévues ». • N : masses reliées directement au point de l’alimentation mis
Si, toutefois, ce respect strict peut assurer l’intégrité de la sécu- à la terre, soit par un conducteur commun avec le neutre
rité des biens et des personnes du point de vue « exploitation (troisième lettre C), soit par un conducteur distinct de celui du
courante » des installations (cas du présent article), d’autres élé- neutre (troisième lettre S).
ments sont à prendre en compte pour ce qui est de l’entretien, du
dépannage, des circonstances autres que celles de l’exploitation
courante [D 5 103]. En courant alternatif, le point de l’alimentation mis à la
terre est généralement le neutre, s’il est accessible, ou, dans le
Trop souvent, en effet, les préoccupations de coût minimal lors de cas contraire, une phase.
l’investissement font l’impasse sur ces éléments ; il s’ensuit soit une
exploitation déficiente, soit des dépassements obligés des niveaux
de sécurité admissibles, tant pour les matériels que pour le person- Les schémas ont une importance majeure dans la détermination
nel. À la limite, ce dernier peut être amené à travailler dans des des conditions de protection contre les contacts indirects, basées
situations hasardeuses, par exemple sous tension, dans des sur la mise à la terre des masses associée à un dispositif automa-
conditions que l’on aurait pu éviter par une conception intégrant les tique de coupure. Ces conditions tiennent compte :
facteurs suivants (que les normes ne prennent pas en charge) : – de l’utilisation de matériels de classe I (§ 2.2.1) mis à la terre au
– un schéma bien pensé, disposant suffisamment de disposi- moyen d’un conducteur de protection ;
tifs de sectionnement pour travailler hors tension sur une partie – de la valeur du courant de défaut If circulant dans la boucle de
limitée de l’installation, sans en perturber inutilement d’autres ; défaut ;
– de la probabilité qu’un défaut se manifeste dans l’installation
– une accessibilité de l’appareillage (tant pour la manœuvre fixe, en l’absence d’un contact d’une personne avec la masse en
que pour l’entretien) et des matériels d’utilisation, respect des défaut ; la durée maximale d’élimination du défaut est :
distances minimales autour des tableaux de distribution ;
• fonction de la tension nominale et du schéma des liaisons à
– un éclairage suffisant, naturel et artificiel, normal et de
la terre pour les circuits terminaux, comportant des matériels
secours ;
tenus à la main ou susceptibles d’être fréquemment
– une disposition auto-explicative de l’appareillage, accom- manœuvrés,
pagnée d’étiquettes, de plaques indicatrices claires dont le libellé
correspond à l’usage, de schémas ou de synoptiques, d’un repé- • de 5 s au plus, pour la partie distribution, dont les matériels
rage des circuits et bornes de connexion, des consignes d’exploi- fixes sont moins souvent utilisés ou soumis à sollicitations.
tation affichées, en un mot, une recherche ergonomique menée en Le tableau 1 indique les temps de coupure maximaux pour les
essayant, autant que faire se peut, de se mettre à la place d’une circuits terminaux.
personne n’ayant participé ni à la conception, ni à la réalisation,
conditions dans lesquelles le non-dit connu complète une partie de
la réalité perçue par un tiers. Ce qui précède est valable principalement pour la basse
tension. Pour la haute tension, une notation complémentaire
prend en compte le genre de liaison des masses du poste qui
intervient notamment pour la protection contre les sur-
2.2 Protections tensions.
par l’installation
Les mesures de protection contre les contacts directs nécessitent
la mise en œuvre d’isolation ou d’enveloppe, les mesures par 2.2.2 Classification des matériels
éloignement étant réservées en général au transport de l’énergie.
Les mesures de protection contre les contacts indirects néces- 2.2.2.1 Classes des matériels
sitent dans certains cas la mise hors tension de la partie en défaut Les matériels sont répertoriés, du point de vue de la protection
de l’installation. contre les contacts indirects, en quatre classes, dont la numéro-
Le choix des dispositifs de coupure est lié à la valeur du courant tation n’implique aucune hiérarchie de valeur :
de défaut, qui est lié au schéma des liaisons à la terre, encore – classe 0 : matériels sans borne de terre, avec une isolation
dénommé régimes du neutre, c’est-à-dire les situations respec- principale, la sécurité reposant sur l’environnement (potentiel de la
tives du point neutre des transformateurs HT/BT, des masses et du terre absent, sol et parois isolants). Les matériels de classe 0 ne
conducteur neutre des installations. sont plus admis depuis 1991 ;
– classe I : matériels ayant une borne destinée à être reliée à un étant assurée par un dispositif de coupure associé ;
conducteur de protection, ayant une isolation principale, la sécurité
Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés D 5 102v2 – 3
QUQV
r←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPS
Prévention des accidents
électriques
Exploitation
par Christian ATLANI
Ingénieur, membre du groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-
commande et des services associés GIMELEC
Membre des commissions U 21 et UF 78 de l’AFNOR
Membre de la commission CENELEC BTTF 62-3
Ancien animateur du groupe de travail chargé de la révision de la publication UTE C 18-510,
commission U 21 de l’UTE (Union technique de l’électricité)
Ancien rapporteur général du Comité des travaux sous tension
Cet article est la version actualisée de l’article [D 5 103] intitulé « Prévention des accidents
électriques. Exploitation » rédigé par Christian Atlani et Dominique Serre et paru en 2012.
1. Sécurité du personnel lors des opérations électriques ................. D 5 103v2 -2
1.1 Prévention du risque électrique.................................................................. — 2
1.2 Mesures de sécurité..................................................................................... — 3
1.3 Formation et habilitation ............................................................................. — 11
1.4 Organisation du travail ................................................................................ — 14
1.5 Matériels de protection................................................................................ — 16
1.6 Accidents d’origine électrique .................................................................... — 24
1.7 Incendies sur ou près des ouvrages ou installations électriques ............ — 25
2. Incendies dans les installations électriques ..................................... — 26
2.1 Caractéristiques des incendies électriques................................................ — 26
2.2 Mesures de prévention des incendies d’origine électrique...................... — 28
2.3 Caractéristiques des matériels électriques du point de vue du risque
d’incendie ..................................................................................................... — 30
2.4 Détection du feu et lutte contre l’incendie ................................................. — 31
3. Réglementation......................................................................................... — 34
4. Conclusion.................................................................................................. — 34
5. Glossaire ..................................................................................................... — 34
Pour en savoir plus ........................................................................................... Doc. D 5 103v2
es articles [D 5 101], [D 5 102] et [D 5 103], chacun pour leur partie, vont
L développer les manières de comprendre, d’analyser et de maîtriser le
risque électrique.
Le premier article [D 5 101] s’est attaché à présenter les statistiques d’acci-
dents connues à ce jour et les fondamentaux du choc électrique et du courant
électrique passant à travers le corps humain.
Le second article [D 5 102] s’est attaché à présenter les règles de construction
et d’installation des ouvrages et des installations électriques.
Le présent article s’attache à présenter ce que l’on appelle l’exploitation des
ouvrages et des installations électriques, c’est-à-dire toutes les opérations de
construction, d’entretien, de dépannage et de déconstruction ainsi que la pré-
vention des incendies dans ces installations.
p。イオエゥッョ@Z@。ッエ@RPQX
Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés D 5 103v2 – 1
QWr←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPS
PRÉVENTION DES ACCIDENTS ÉLECTRIQUES _____________________________________________________________________________________________
La protection du personnel lors des opérations de construction, d’entre-
tien, de dépannage et de déconstruction est maintenant encadrée par des
règles européennes et françaises que les employeurs doivent respecter scrupu-
leusement. Il s’agit de règles simples et de bon sens qui demandent à chacun
et en permanence de savoir apprécier et évaluer le risque électrique à sa juste
valeur et d’appliquer les règles explicitées dans de nombreuses publications.
En plus de la formation, l’employeur est tenu de délivrer une habilitation
adaptée aux opérations à effectuer, dès qu’il y a risque électrique.
Cet article présente les modes opératoires et procédures retenus en Europe,
à savoir les travaux hors tension, représentant la meilleure sécurité puisqu’il
n’existe pas alors de risque de choc électrique, les travaux au voisinage où
les mesures de protection permettent de travailler dans un espace sécurisé, et
enfin les travaux sous tension où la présence permanente de la tension est
gérée par des mesures rigoureuses de protection du personnel qui conduisent
à une situation de travail sécurisée. Les outils, dispositifs et équipements uti-
lisés doivent être de bonne qualité et bien entretenus ; la référence aux normes
est une condition de sécurité.
En ce qui concerne les incendies dans les installations électriques, cet article
présente les causes des incendies, les mesures de prévention comprenant la
sélection des bons matériels et leur installation dans de bonnes conditions.
Les trois articles, bien que s’appuyant sur les textes réglementaires concer-
nant les ouvrages ou les installations électriques, peuvent s’appliquer, dans
leur principe, sur d’autres ouvrages tels que ceux de la traction électrique, les
véhicules électriques ou sur les navires. Ils peuvent aussi servir de base à
d’autres pays que la France dans la mesure du respect de leur réglementation.
Pour les véhicules et engins électriques, la réglementation de base est la
même mais des normes spécifiques sont maintenant applicables.
– le risque de contact entre deux parties actives de polarités dif-
1. Sécurité du personnel lors férentes, qui entraîne le court-circuit, par espacement, écrans, iso-
des opérations électriques lation, etc. ;
– le risque de court-circuit et les conséquences sur les personnes
qui travaillent sur ou près des circuits concernés.
Les accidents d’origine électrique surviennent :
– parfois du fait de défauts des matériels ; 1.1.1 Principes
– souvent du fait de comportements inadéquats des personnes ;
– et dans certains cas, de la combinaison des deux. La protection est assurée par construction [D 5 102] lorsque tout
contact avec une partie active est rendu, soit impossible, soit non
Le premier cas a été largement traité dans l’article [D 5 102].
dangereuse. Les méthodes de travail correspondantes seront expli-
Le comportement des opérateurs, intervenants, etc., doit être citées au paragraphe 1.2.
adapté aux situations susceptibles de se produire par l’informa-
Par application du Code du travail, article R. 4544-1, pour les ins-
tion, la formation, et, surtout, le respect de procédures adaptées
tallations électriques, le travail hors tension doit être privilégié.
aux cas à traiter, ainsi que par l’emploi d’outillages, de protections,
de matériels spécifiques. Plusieurs situations sont cependant susceptibles d’être abor-
dées.
Les définitions des termes employés sont données au
paragraphe 1.2.2. ■ Travaux sur un ouvrage ou une installation hors tension
(§ 1.2.4)
Encore faut-il être sûr :
1.1 Prévention du risque électrique – qu’elle le soit effectivement ;
La préparation d’une opération quelconque sur un ouvrage ou – qu’elle le restera pendant les opérations ;
une installation électrique, après sa première mise sous tension – que la consignation soit effectuée correctement ;
(auparavant, il s’agit de travaux sans risque électrique), comporte – que la remise sous tension sera faite avec soin.
potentiellement des risques qu’il s’agit de gérer. ■ Travaux au voisinage (§ 1.2.5)
La prévention du risque électrique passe par l’analyse préa- Ils sont caractérisés par :
lable de tout ce qui est susceptible de se produire, avec accompa-
gnement, pas à pas, de la ou des mesures de prévention. – les distances à respecter dépendant de la tension des ouvrages
ou des installations, y compris par les outils, engins et les pièces
C’est ainsi, par exemple, que l’on traite différemment : manipulées ;
– le risque de contact entre une personne et une partie active – l’éloignement des pièces dangereuses ;
(outils isolants, gants, écrans, isolation, etc.) ; – ou l’interposition d’obstacles ou d’isolations.
D 5 103v2 – 2 Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés
QXr←ヲ←イ・ョ」・@iョエ・イョ・エ
dUQPS
_____________________________________________________________________________________________ PRÉVENTION DES ACCIDENTS ÉLECTRIQUES
■ Travaux sous tension (§ 1.2.6) dans une norme homologuée de l’UTE, référencée NF C 18-510
Ils sont effectués suivant trois méthodes : pour les installations électriques.
– travaux au contact ; Le décret du 16 février 1982 et les textes d’application font réfé-
– travaux à distance ; rence à la publication UTE C 18-510 de 1988 par le biais de l’arrêté
– travaux au potentiel. du 17 janvier 1989. Le décret du 22 septembre 2010 relatif aux opé-
rations sur les installations électriques et dans leur voisinage rem-
■ Interventions en basse tension (§ 1.2.7) place pour ce qui le concerne celui du 14 novembre 1988. Ce
Elles peuvent être de deux types bien différents et s’appliquent à décret fait référence à des normes homologuées, qui seront préci-
des personnes ayant des compétences électriques importantes sées dans des arrêtés.
pour les uns et élémentaires pour les autres : Les deux décrets indiquent que l’employeur remet à ses salariés
– intervention BT générale ; un carnet de prescriptions en adéquation avec les conditions de
– intervention BT élémentaire. travail, établi sur la base des prescriptions pertinentes de la norme
NF C 18-510 .
■ Opérations spécifiques (§ 1.2.8)
Cette norme tient compte aussi des règles pour les travaux
Elles couvrent les essais, les mesurages, les vérifications et les d’ordre non électriques exécutés à proximité des ouvrages ou des
manœuvres. installations électriques. Ces règles étaient précédemment incluses
■ Opérations particulières (§ 1.2.9) dans l’ancien titre XII du décret du 8 janvier 1965. Elles se trouvent
actuellement incluses dans le Code du travail aux articles R. 4534-
Elles couvrent notamment les opérations sur les installations 107 à R. 4543-125.
d’éclairage extérieur, les batteries d’accumulateurs, les installa-
tions photovoltaïques. D’autres publications viennent compléter cet ensemble
réglementaire :
– le guide UTE C 18-510-1 (2012) : Recueil d’instruction de sécu-
1.1.2 Mise en œuvre rité électrique pour les ouvrages destiné au personnel des réseaux
Le risque électrique a la particularité d’une présence invisible sur publics de distribution d’énergie ;
les ouvrages ou les installations. Ceux-ci ne présentent en général – le guide UTE C 18-510-2 (2013) : Prescriptions de sécurité
aucun signe apparent de leur état de tension, sauf pour certains d’ordre électrique relatives aux opérations effectuées sur les instal-
d’entre eux où des dispositifs de mesure ou de signalisation lations de production d’électricité ou dans leur environnement des-
mettent en évidence cette présence ; encore faut-il que, en cas tiné au personnel des installations de production ;
d’absence d’indication, il ne s’ensuive pas une erreur d’apprécia- – le guide UTE C 18-510-3 (2013) : Prescriptions de sécurité
tion due à un non-fonctionnement (usure, défaut). d’ordre électrique relatives aux opérations effectuées sur les instal-
lations électriques ou dans leur environnement destiné au person-
nel des installations privées ;
La règle générale, pour tout personnel, est de considérer – le guide UTE C 18-531 (2012) : Prescriptions de sécurité élec-
qu’un ouvrage ou une installation électrique non consigné est trique pour le personnel exposé au risque électrique lors d’opéra-
sous tension. tions d’ordre non électrique et lors d’opérations d’ordre électrique
simples destiné au personnel non électricien ;
En raison des règles tenant précisément au caractère invisible – le guide UTE C 18-540 (2012) : Prescriptions de sécurité élec-
du danger, des mesures strictes, et parfois complexes, ont été éla- trique pour les opérations basse tension sur les installations et les
borées pour les travaux et les interventions sur les ouvrages et les ouvrages hors tension destiné au personnel en formation à l’édu-
installations électriques. cation nationale.
Les principes généraux sont les suivants : Pour les véhicules et engins automobiles à motorisation élec-
– dans tous les cas : trique et énergie électrique embarquée en basse tension, c’est la
• notion de formation et d’habilitation du personnel (§ 1.3), norme NF C 18-550 qui tient compte des évolutions techniques et
• utilisation de matériel de protection mis à disposition et réglementaires.
sélectionné par l’employeur, souvent normalisé (§ 1.5) ; En amont de ces normes et publications, la norme européenne
– pour les travaux hors tension et au voisinage, application des NF EN 50110-1 (Exploitation des installations électriques) portant
règles de base (§ 1.2.4 et 1.2.5) ; sur le même domaine d’application a été publiée en novembre
– pour les travaux sous tension, application des procédures opé- 2004, elle est en application dans toute l’Europe. Elle sert de base
ratoires spécifiques (§ 1.2.6). commune aux échanges européens. Dans plusieurs pays de
l’Union européenne, elle est d’application réglementaire. Elle est
complétée par liste des documents réglementaires nationaux
1.2 Mesures de sécurité propres à chaque pays de l’Union européenne inclus dans la
norme NF EN 50110-2.
1.2.1 Documents normatifs
1.2.2 Définitions
Les prescriptions de sécurité auxquelles les employeurs doivent
se conformer lors des travaux d’ordre électrique effectués dans les Les définitions des termes employés et leur exacte compréhen-
établissements soumis au Code du travail sont actuellement men- sion sont l’un des éléments clés de la sécurité dans le domaine
tionnées dans deux textes réglementaires : le décret no 82-167 du électrique lors des travaux, des interventions ou des opérations
16 février 1982, pour les ouvrages de transport et de distribution spécifiques ; cela explique que l’on y attache un grand intérêt.
de l’énergie électrique et le décret no 2010-1118 du 22 septembre Il n’est pas possible, dans le cadre du présent article, d’en
2010, pour les installations électriques (articles R. 4544-1 à R. 4544- reprendre l’intégralité (il en existe près de 70). On ne reprendra
11 du Code du travail). que les principales, nécessaires à la compréhension du contexte,
Indépendamment d’une formation adaptée aux fonctions et à la qui sont, en particulier, des définitions d’ouvrages, d’installations,
nature de travaux pouvant être confiés aux travailleurs, et basée de matériels (§ 1.2.2.1), d’opérations (§ 1.2.2.2), de la consignation
sur les prescriptions de sécurité, les prescriptions sont codifiées (§ 1.2.2.3) et de zones d’environnement (§ 1.2.2.4).
Copyright © – Techniques de l’Ingénieur – Tous droits réservés D 5 103v2 – 3
QYVous pouvez aussi lire