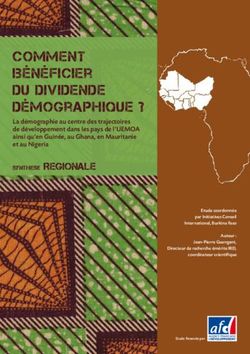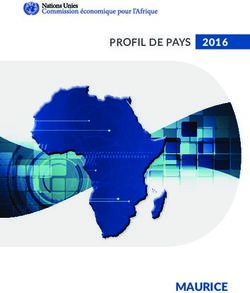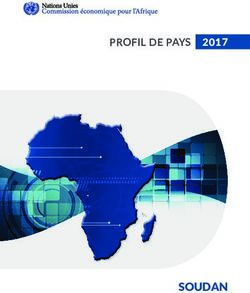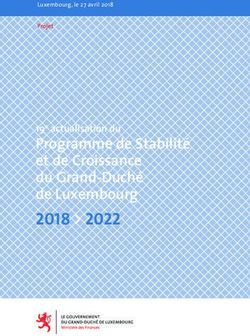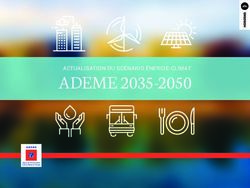SCENARIOECO - Société Générale
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
N° 36 septembre 19
SCENARIOECO
SG Études économiques et sectorielles
Croissance en décrochage
L’activité mondiale est entrée dans un ralentissement synchronisé, avec
une nouvelle perte de vitesse prévue à l’horizon 2020-21. Les grandes
banques centrales devraient assouplir davantage leur politique
monétaire en maintenant les taux d'intérêt bas plus longtemps. La
baisse des taux d’intérêt dans les économies avancées devrait favoriser
les flux de capitaux vers les marchés émergents, mais le ralentissement
de l’activité mondiale reste un frein pour ces derniers.
Plusieurs facteurs alimentent le ralentissement à l’échelle mondiale. Un
premier facteur, qui pèse encore, est le resserrement passé de la
politique économique en Chine et les effets des tensions commerciales
avec les États-Unis. Compte tenu du niveau d'endettement croissant, les
autorités chinoises adoptent une approche prudente en matière
d'assouplissement des politiques.
Aux États-Unis, le cycle des profits des entreprises se retourne et les
efforts visant à rétablir les marges devraient peser sur l'investissement
et l'emploi. Par ailleurs, la politique budgétaire deviendrait moins
accommodante aux États-Unis à l’horizon des élections présidentielles
fin 2020.
Le ralentissement du commerce mondial pèse lourdement sur le secteur
manufacturier de la zone euro. L’incertitude liée au Brexit constitue un
obstacle supplémentaire, de même que les tensions commerciales et les
incertitudes géopolitiques en cours. En outre, nous notons un
retournement du cycle des profits dans plusieurs grandes économies de
la zone euro.
A moyen terme, une relance budgétaire plus agressive représente un
risque à la hausse pour nos perspectives. Toute résolution favorable des
tensions commerciales et du Brexit offre également un potentiel de
surprise positive.
Achevé de rédiger le 24/09/2019
Merci de consulter le disclaimer à la fin du documentScénarioÉco N° 36 | septembre 19
Table des matières
SYNTHESE CONJONCTURELLE................................................................................................. 3
SOUTIEN A LA CROISSANCE, SOUTENABILITE DES DETTES… ................................................... 7
PREVISIONS ECONOMIQUES .................................................................................................. 11
ZONE EURO ........................................................................................................................... 13
ALLEMAGNE .......................................................................................................................... 15
FRANCE .................................................................................................................................17
ITALIE ................................................................................................................................... 19
ESPAGNE ............................................................................................................................... 21
ROYAUME-UNI ..................................................................................................................... 23
ETATS-UNIS ......................................................................................................................... 25
JAPON .................................................................................................................................. 27
CHINE ................................................................................................................................... 29
INDE ...................................................................................................................................... 31
BRESIL.................................................................................................................................. 33
RUSSIE ................................................................................................................................. 35
AMERIQUE LATINE ............................................................................................................... 39
ASIE EMERGENTE ................................................................................................................. 41
PAYS DU GOLFE ................................................................................................................... 43
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE .......................................................................................45
DONNEES ECONOMIQUES ET FINANCIERES ...........................................................................47
CONTACTS............................................................................................................................. 51
DISCLAIMER ......................................................................................................................... 52
2ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
SYNTHESE CONJONCTURELLE
ECONOMIE MONDIALE
La dynamique de croissance de l’économie mondiale continue de ralentir. Les
données indiquent déjà une perte de vitesse significative du commerce
international, qui concerne principalement les biens d’investissement et de
consommation durables.
Les données montrent que le secteur des services résiste toujours bien, ce qui a
contribué à renforcer l’emploi, la confiance des consommateurs et la consommation
privée. Pourtant, les enquêtes les plus récentes montrent que le sentiment des
entrepreneurs dans les services et la confiance des consommateurs commencent à
céder. Notre scénario central table sur une activité mondiale nettement affaiblie, la
croissance du PIB des pays avancés ralentissant à 1.2% en 2020 et 0.8% en 2021
contre 1.7% en 2019. Dans les économies en développement, on s’attend à ce que
l’expansion se modère également, alors que la Chine est en perte de vitesse.
Plusieurs facteurs alimentent le ralentissement à l’échelle mondiale. En Chine, le
resserrement passé de la politique économique et les tensions commerciales avec
les États-Unis représentent des facteurs défavorables. De plus, compte tenu du
niveau élevé d'endettement, les autorités chinoises adoptent une approche
prudente en matière d'assouplissement du policy mix.
Aux États-Unis, le cycle de profit des entreprises se retourne et les efforts visant à
rétablir les marges devraient peser sur l'investissement et l'emploi. La politique
budgétaire devrait également donner moins d’impulsion à l’économie américaine et
nous ne voyons que peu de place pour un changement de politique majeur dans ce
domaine avant l’élection présidentielle de 2020.
Le ralentissement du commerce mondial pèse lourdement sur le secteur
manufacturier de la zone euro. L’incertitude liée au Brexit constitue un obstacle
supplémentaire, de même que les tensions commerciales et les incertitudes
géopolitiques en cours. En outre, nous notons un retournement du cycle des profits
dans plusieurs grandes économies de la zone euro.
Les évolutions spécifiques de nombreux marchés émergents, dont l’Argentine, qui a
récemment fait face à une forte volatilité de sa devise, accentuent le ralentissement.
Renforçant l’incertitude, les tensions au Moyen-Orient se sont récemment
intensifiées.
ÉCONOMIES AVANCEES
Aux États-Unis, la croissance du PIB a ralenti au deuxième trimestre 2019, passant de
3,2 % au premier trimestre 2019 à 2 % (taux annualisé). La fin de la relance
budgétaire à la mi-2019 et la baisse des résultats des entreprises – la hausse des
3ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
droits de douane et des coûts du travail induisant une contraction des marges – vont
peser sur l’économie.
Il existe un risque grandissant que la prochaine vague de mesures protectionnistes,
qui couvrira les biens de consommation, freine les dépenses des ménages.
L’économie américaine devrait progresser à un rythme de 2,3 % en 2019, avant de
ralentir à 1,5 % en 2020 et à 0,8 % en 2021.
Dans la zone euro, le rythme d’activité devrait se réduire d’un tiers de son niveau de
2019 en 2021 alors que le secteur manufacturier continue de se contracter. Les
tensions commerciales peuvent se répercuter sur les chaînes d’approvisionnement
mondiales et pénaliser les entreprises multinationales, y compris celles situées dans
la zone euro. L’éventualité d’un Brexit sans accord pèse également sur le sentiment
du marché. La croissance des services demeure solide, au profit des marchés du
travail, mais les incertitudes croissantes pourraient se traduire par une baisse de la
confiance des consommateurs. La croissance devrait diminuer et s’établir à 0,7 % en
2020 et 0,4 % en 2021, contre 1,1 % cette année. Sur fond de difficultés mondiales,
l’économie française reste robuste et devrait dépasser l'Allemagne en termes de
croissance, mais avec des finances publiques plus faibles et des rigidités
structurelles dont la résolution n’est que très progressive.
L’économie britannique fait face à une volatilité politique sans précédent. Notre
scénario central est compatible avec soit un Brexit « coopératif » sans accord, dans
lequel le Royaume-Uni et l'UE27 cherchent à minimiser les dégâts, soit un accord sur
le Brexit qui laisse toujours une incertitude significative sur les relations futures avec
l'UE27 et sur la politique domestique. La croissance du PIB du Royaume-Uni devrait
s’établir à 0,9 % en 2019 et à 0,2 % seulement en 2020.
Au Japon, la consommation privée reste forte, mais les tensions commerciales
pèsent sur la confiance des entreprises. Les chiffres indiquent une forte diminution
des exportations vers l’Asie. La hausse imminente de la taxe à la consommation
devrait en outre peser sur le pouvoir d’achat. L’activité devrait ralentir au cours des
deux prochaines années, poussant la croissance en deçà de son potentiel d’ici à
2021.
MARCHES EMERGENTS
Les effets négatifs des droits de douane et le ralentissement de la demande
mondiale ont accentué la pression sur l’économie chinoise, déjà aux prises avec un
ralentissement structurel. La Chine a engagé des mesures d’assouplissement
monétaire et budgétaire pour soutenir l’activité et éviter un atterrissage brutal, tout
en gardant un œil sur la stabilité future. Nous anticipons un ralentissement de la
croissance du PIB à 5,8 % et 5,5 % en 2020 et 2021, contre 6,2 % en 2019.
4ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
Les difficultés résultant du ralentissement du commerce affaiblissent la croissance
dans les économies émergentes d’Asie, même si cette région continue d’enregistrer
la plus forte croissance dans le monde. L’expansion devrait se tasser en Europe
émergente, sauf en Turquie, où un rééquilibrage est déjà en cours et pèse sur
l’activité. La croissance de l’Amérique latine et de l’Afrique subsaharienne devrait
légèrement progresser en 2020-2021.
Bien que les conditions financières demeurent favorables, surtout après
l’assouplissement monétaire opéré aux États-Unis, les entreprises des marchés
émergents sont confrontées à d’importantes échéances entre 2019 et 2021 et restent
vulnérables à l’évolution de la confiance des marchés. Sur fond de doutes sur sa
capacité à rembourser sa dette, l’Argentine a fait face à une forte volatilité de sa
devise et a introduit des restrictions sur les sorties de capitaux.
BANQUES CENTRALES
La Fed a jusqu’à présent abaissé ses taux de 50 pb depuis juillet à 1.75-2 % et nous
pensons qu’elle réduira progressivement les coûts d’emprunt à 0-0.25% en 2021. Le
17 septembre, et pour la première fois en dix ans, la Fed a injecté des liquidités sur
le marché monétaire à court terme, après une hausse de près de 10% des taux de
repo j /j. Cela suggère un manque de réserves excédentaires dans le système,
laissant entrevoir une probabilité croissante que la Fed reprenne les achats d'actifs
et élargisse davantage son bilan, qui pourrait également se justifier du fait de la taille
du déficit budgétaire.
La BCE mène aussi une politique accommodante et a abaissé son taux de dépôt le
12 septembre. Elle a également annoncé de nouvelles opérations de refinancement
à long terme ciblées (TLTRO) et d’autres mesures d’assouplissement quantitatif. A
l’avenir, de nouveaux assouplissements sont attendus. Dans un contexte de taux
d’intérêt déjà bas, l’inquiétude plus générale réside dans le fait qu’un nouvel
assouplissement stimulera peu l’économie réelle. Il n’est donc pas surprenant que
même la BCE ait appelé à un rôle accru de la politique budgétaire.
La Banque du Japon devrait maintenir sa politique monétaire accommodante et
son programme d’assouplissement quantitatif jusqu’en 2021 au moins.
MARCHES FINANCIERS
L’appétit pour le risque sur les marchés mondiaux a augmenté en septembre, mais
les signes de retournement mondial et de forte incertitude sur le plan politique
devraient maintenir les rendements des obligations souveraines à des niveaux
historiquement bas, voire négatifs pour les actifs « sûrs » des principaux pays
européens et du Japon.
5ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
L’attitude conciliante des banques centrales et la baisse des rendements
obligataires dans les économies avancées favorisent les flux de capitaux vers les
marchés émergents. Pourtant, la forte incertitude à l’égard des tensions
commerciales et de la croissance mondiale reste un obstacle, laissant peu de
potentiel haussier pour les devises des marchés émergents. Le RMB perd du terrain
dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis et se négocie à la mi-
septembre à un niveau proche de USD/CNY 7.10. On pourrait s’attendre à une
volatilité plus marquée si les tensions commerciales s’intensifiaient.
Le dollar s’est redressé par rapport à la plupart des devises depuis la mi-juin 2019,
sur fond de signes de ralentissement de la croissance mondiale. Nous nous
attendons à ce que le dollar américain reste ferme au cours des deux prochaines
années. Le billet vert devrait se déprécier à partir de 2022 en prévision d’une reprise
cyclique de l’activité mondiale. D’importantes émissions de bons du Trésor
américain, liées à des déficits budgétaires élevés, contribueraient également à
affaiblir le dollar à long terme.
6ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
SOUTIEN A LA CROISSANCE, SOUTENABILITE
DES DETTES…
Malgré des taux d’intérêt historiquement bas et des injections de
liquidité massives depuis plusieurs années, la croissance mondiale
commence à s’affaisser avant même que les politiques monétaires
n’aient eu le temps de se normaliser. Ceci alimente les questions sur
la marge de manœuvre des banques centrales et sur les limites à la
baisse des taux d’intérêt.
Aujourd’hui les regards se tournent vers les gouvernements avec
l’idée que des politiques budgétaires plus expansionnistes pourraient
ou devraient accompagner les banques centrales.
Cependant, les ratios d’endettement public des pays développés
atteignent des niveaux jamais observés en temps de paix alors que les
ratios d’endettement des pays émergents sont en hausse. Là, le débat
se focalise sur la capacité des gouvernements à mener une relance
budgétaire.
AFFAISSEMENT DE LA CROISSANCE
Depuis la crise financière de 2008-2009, les grandes banques centrales ont
massivement baissé leurs taux directeurs et injecté des quantités inédites de
liquidités dans le système financier afin, entre autres, de couper court au risque
systémique, resolvabiliser les agents endettés et relancer la croissance via le crédit.
Ces injections ont alimenté divers débats sur les effets potentiels de telles politiques,
notamment sur les risques : trappe à liquidité, effets redistributifs avec hausse des
inégalités, bulles financières voire hyperinflation à terme. Le débat porte aujourd’hui
sur l’efficacité concrète des politiques monétaires dites « non conventionnelles »
ainsi que sur les limites d’un environnement de taux durablement bas voire négatifs.
L’économie mondiale lutte pour un nouveau souffle de croissance depuis le rebond
post Lehman. Ce souffle semblait être retrouvé à partir de la fin de 2016 sous l’effet
combiné de la reprise de l’investissement dans les pays développés, des effets d’un
prix du pétrole moins cher, de la relance budgétaire américaine, de la relance
chinoise et finalement, de la reprise du commerce mondial qui avait permis une
accélération synchronisée de la croissance mondiale. Cet environnement validait les
perspectives d’une normalisation des politiques monétaires. La Réserve Fédérale
des Etats Unis avait commencé à relever graduellement son taux directeur fin 2015
ainsi qu’à réduire son bilan début 2018. De son côté, la BCE avait annoncé la fin de
7ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
son programme d’achat net de titres pour la fin 2018 et laissait entrevoir un début
de hausse de taux pour 2019. Or la fin du cycle vertueux démarré en 2016 semble
avoir eu lieu plus rapidement que prévu avec la montée des incertitudes politiques
en Europe, la guerre commerciale entre les Etats Unis et la Chine et le Brexit. Le point
d’inflexion des politiques monétaires a eu lieu à la fin 2018 dans un environnement
de taux d’intérêt américains et de pétrole en hausse provoquant une baisse très
marquée des prix d’actifs. Les banques centrales semblent donc piégées dans une
situation dans laquelle l’efficacité du soutien monétaire à la croissance tend à
s’éroder alors que le niveau élevé de valorisation d’actifs financiers rend une
véritable normalisation dangereuse.
Croissance faible malgré les taux bas
Source : SG Etudes économiques et sectorielles Source : SG Etudes économiques et sectorielles
Dans ce contexte, les politiques monétaires sont redevenues expansionnistes
repoussant aux calendes les perspectives de normalisation. En zone euro
notamment, la politique monétaire redevient expansionniste avant même d’avoir
pu faire le moindre mouvement de normalisation. Les perspectives de baisse des
taux directeurs en zone euro ont provoqué des réactions du président américain
accusant la BCE de manipuler le taux de change. Ces débats autour de la guerre des
monnaies sont particulièrement intenses dans le contexte actuel de tensions
commerciales. Les marges de manœuvre de la politique monétaire semblent
aujourd’hui réduites.
LA PROVIDENCE FISCALE
Dans son discours de politique monétaire du 12 septembre dernier, Mario Draghi,
président de la BCE, a clairement appelé les gouvernements de la zone euro avec des
marges de manœuvre à stimuler la demande par un soutien budgétaire. Ce discours
faisait écho à son discours de Jackson Hole de 2014 où il mettait en garde contre les
politiques budgétaires procycliques qui ont contribué à la crise de dettes
souveraines démarrée en 2010. Depuis quelques temps aussi, l’ancien conseiller
économique du FMI, Olivier Blanchard, entre autres, recommande aux
8ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
gouvernements de profiter de l’environnement de taux bas voire négatifs pour
financer des programmes de relance. L’appui budgétaire pourrait cibler notamment
la hausse de l’investissement public dans les domaines de l’environnement, du
numérique et la R&D.
MAIS LA QUESTION DE LA SOUTENABILITE DES DETTES DEMEURE
D’autres voix comme le FMI dans son « Moniteur des finances publiques » d’avril
dernier, mettent en garde contre un excès de confiance, notamment dans les pays
développés, dans la mesure où l’environnement de taux bas n’a pas vocation à durer
et que la hausse de l’endettement public augmente la vulnérabilité des pays à des
hausses de coûts de financement si la perception des marchés sur la solvabilité des
gouvernements venait à se détériorer.
En effet, le niveau d’endettement public dans les pays développés est à des niveaux
record, jamais observés en temps de paix même si le service de la dette est à des
niveaux historiquement bas compte tenu du niveau des taux d’intérêt (c’est
l’argument qui sous-tend les défenseurs des politiques de relance). En revanche, du
côté des pays émergents, les ratios de dette publique sont plus faibles que pour les
développés mais en hausse constante avec un service de la dette qui a eu tendance
à augmenter.
La question est de savoir pour combien de temps les taux d’intérêt vont il rester à
ces niveaux-là dans le monde développé. Compte tenu de la difficulté devant
laquelle se trouvent les banques centrales à normaliser leurs politiques non
conventionnelles (faible croissance et dette élevée) l’environnement de taux bas
risque de durer (c’est notre scénario central).
Dans ce contexte, certaines voix s’élèvent, même si de manière plus marginale, pour
recommander le financement direct des gouvernements par leurs banques
centrales. On parle actuellement de « Modern Monetary Theory » (MMT) pour définir
ce courant d’opinion qui attribue le monopole de la monnaie au souverain. L’idée
derrière est que les bilans de la banque centrale et du gouvernement ne font qu’un
et que le déficit public peut toujours se financer par la création monétaire. Il n’y
aurait pas à se soucier excessivement de la solvabilité de l’Etat dans le cadre des
expansions budgétaires. La politique budgétaire défini ainsi l’arbitrage entre
inflation et chômage et la politique monétaire assure en permanence la solvabilité
de l’Etat. Il s’agit là d’une inversion des fonctions des outils de politique économique
actuels. En effet, la vision dominante est que le ciblage du couple optimal
inflation/chômage doit être effectué par la politique monétaire alors que la politique
budgétaire doit être en accompagnement tout en assurant le respect de la
contrainte de solvabilité inter-temporelle de l’Etat.
La MMT irait donc à l’encontre du credo développé dans les années 80 et qui
préconisait l’indépendance des banques centrales pour combattre l’inflation. Le
9ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
dérapage inflationniste des années 70 avait fait apparaître les limites de la passivité
des banques centrales dans le cadre d’un soutien trop importants de la croissance
par les politiques macro-économiques. Néanmoins, aujourd’hui, la lutte contre
l’inflation semble avoir été remportée et les grandes banques centrales des pays
développés détiennent déjà une part importante des dettes publiques de leurs pays
respectifs. Dans ce contexte, la MMT plaide en faveur d’un financement monétaire
direct du déficit budgétaire.
Sans aller jusque-là, de nombreuses questions restent en suspens comme l’impact
de politiques économiques durablement expansionnistes sur les niveaux de dette
globale (publique et privée), sur l’efficacité de ces politiques dans des économies
ouvertes et avec des régimes de changes flexibles et potentiellement volatiles.
Dans tous les cas, la question du soutien budgétaire se pose aujourd’hui et devrait
demeurer au centre des débats. Dans notre scénario central, nous envisageons un
léger soutien budgétaire sur l’horizon de prévision, essentiellement porté sur
l’investissement public. Un effort plus important et synchronisé des politiques
budgétaires pourrait nous amener à réviser nos prévisions à la hausse. Une relance
par l’investissement correctement ciblée pourrait augmenter la croissance
potentielle à moyen terme sans mettre a priori en danger les finances publiques. En
revanche, une politique plus agressive de soutien à la consommation conduirait à
une accélération à court terme mais n’aurait pas d’effet durable et conduirait à une
croissance plus faible et des ratios de dette en hausse.
Ratios de dette publique élevés ou en hausse
Economies développées
Economies émergentes
110 10 55 15
100 50
9 13
45
90
8 40 11
80
7 35 9
70
30
6 7
60 25
50 5 20 5
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Dette (% du PIB) Service de la dette (% des taxes, ech d) Dette (% du PIB) Service de la dette (% des taxes, ech d)
Source : SG Etudes économiques et sectorielles Source : SG Etudes économiques et sectorielles
10ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
PREVISIONS ECONOMIQUES
Croissance réelle du PIB (% GA) 2018 2019e 2020p 2021p 2022p
Marchés développés 2,2 1,7 1,2 0,8 1,3
Etats-Unis 2,9 2,3 1,5 0,8 1,4
Japon 0,8 1,0 0,5 0,4 0,7
Royaume-Uni 1,4 0,9 0,2 0,5 1,5
Euro zone 1,9 1,1 0,7 0,4 1,0
Allemagne 1,5 0,6 0,5 0,2 0,9
France 1,7 1,4 0,8 0,7 1,1
Italie 0,7 0,1 -0,1 0,0 0,7
Espagne 2,6 2,1 1,1 0,7 1,2
Marchés émergents 4,5 4,1 4,5 4,4 4,4
Asie 6,0 5,6 5,5 5,4 5,3
Chine 6,6 6,2 5,8 5,5 5,2
Inde 6,8 6,0 6,4 6,3 6,6
Europe Centrale & Orientale 3,0 1,3 2,2 2,2 2,3
Russie 2,2 1,6 1,5 1,5 1,5
Turquie 2,6 -2,5 2,5 3,0 3,0
Amérique Latine 1,7 1,6 2,4 2,8 2,8
Brésil 1,1 1,3 2,0 2,2 2,1
Moyen-Orient & Asie Centrale 0,8 0,7 3,2 2,4 2,3
Afrique 3,4 3,6 3,8 3,8 4,1
Monde 3,7 3,2 3,3 3,1 3,3
Toutes les moyennes (régionales, classification économique) sont calculées en utilisant des PIB
exprimés en parités de pouvoir d'achat (PPA), qui sont les taux de conversion monétaires qui
égalisent le coût d’un panier de biens normalisé dans les différents pays.
Indice des prix à la
2018 2019e 2020p 2021p 2022p
consommation (% GA)
Etats-Unis 2,5 2,0 2,1 1,7 2,1
Japon 1,0 0,9 1,6 0,5 0,5
Royaume-Uni 2,5 1,9 2,4 1,3 2,0
Euro zone 1,8 1,2 1,4 1,1 1,2
Allemagne 1,9 1,4 1,5 1,2 1,2
France 2,1 1,3 1,3 1,1 1,1
Italie 1,2 0,7 0,8 0,6 0,9
Espagne 1,7 0,9 1,4 1,1 1,3
Chine 2,1 2,5 2,5 2,0 2,1
11ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
fin de période 08/2019 2019p 2020p 2021p 2022p
Taux d'intérêt, %
États-Unis
Taux objectif des Fed funds (borne haute) 2,25 1,75 1,00 0,25 0,25
Emprunts d'État à 10 ans 1,62 1,45 1,15 1,30 1,90
Zone euro
Taux de refinancement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux de dépôt -0,40 -0,50 -0,60 -0,60 -0,60
Emprunts d'État à 10 ans
Allemagne -0,63 -0,65 -0,60 -0,40 0,20
France -0,34 -0,30 -0,20 0,05 0,60
Italie 1,40 1,00 1,90 2,10 2,70
Espagne 0,16 0,15 0,35 0,60 1,10
Royaume-Uni
Bank rate 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50
Emprunts d'État à 10 ans 0,49 0,75 0,80 0,95 1,50
Japon
Taux facilité de dépôt complémentaire -0,10 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07
Emprunts d'État à 10 ans -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux de change
EUR / USD 1,11 1,10 1,10 1,10 1,15
EUR / GBP 0,92 0,95 0,95 0,90 0,90
GBP / USD 1,22 1,16 1,16 1,22 1,28
EUR / JPY 118,2 115,5 115,5 115,5 126,5
USD / JPY 106,2 105,0 105,0 105,0 110,0
USD / CNY 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3
Prix pétroliers (Brent), USD/baril 59,8 65,0 65,0 65,0 65,0
12ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
ZONE EURO
La croissance a fléchi à 1,1 % en 2019 et ralentira de nouveau en 2020-
2021 avant de repartir en 2022
Face à l’assombrissement des perspectives, la BCE a adopté des
mesures de stimulus, dont la réactivation de ses achats nets d’actifs
Les risques restent majoritairement baissiers. L’éventualité d’une
relance budgétaire coordonnée est positive mais hautement
incertaine.
La croissance aura continué de ralentir en 2019, à 1,1 %, grevée par la décélération
synchrone des exportations et de l’industrie. Les effets de bords sur l’économie
domestique sont encore limités, mais seront plus mordants en 2020-2021,
entraînant un nouvel affaiblissement de la croissance (qui tombera à 0,4 % en 2021)
et une remontée du taux de chômage.
Le freinage des exportations continuera en 2020-2021 avec la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne, une croissance plus modérée de l’économie chinoise et le
retournement cyclique attendu aux Etats-Unis. Les exports repartiront en 2022 grâce
à la dissipation de l’incertitude liée au Brexit et au soutien des politiques
économiques.
Le fléchissement des exportations et de l’industrie aura des effets de bord sur le reste de
l’économie en 2020-2021
Exportations de la zone euro Croissance du PIB par secteur en zone euro
Volume, MM3m, GA, % Volume, GA, %
8 15
6 10
5
4
0
2 -5
0 -10
-2 -15
-20
-4 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
2015 2016 2017 2018 2019
Total
Total Etats-Unis
Royaume-Uni Turquie Manufacturier
Reste de l'UE28 Reste du monde Construction
Chine Services
Source: Refinitiv Datastream Source: Refinitiv Datastream
Source : Eurostat, SG Etudes économiques et sectorielles Source : Eurostat, SG Etudes économiques et sectorielles
Résiliente en 2019 grâce au dynamisme du marché du travail, une politique
budgétaire légèrement expansionniste et la vive croissance du crédit, la demande
intérieure marquera le pas en 2020-2021. Elle ne repartira que légèrement en 2022.
Affectés par le fléchissement de leurs revenus et l’incertitude persistante,
entreprises et ménages reporteront leurs dépenses d’investissement. La hausse du
chômage pèsera sur la consommation qui poursuivra en 2020-2021 le
ralentissement entamé en 2019. La demande publique restera globalement stable
13ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
sur l’horizon de prévision, reflétant l’orientation globalement expansionniste de la
politique budgétaire.
Avec le freinage de la demande globale, les entreprises répercuteront la modération
des coûts salariaux unitaires sur leurs prix. Par conséquent, l’inflation sous-jacente
ralentira sur l’horizon de prévision.
Face à l’assombrissement des perspectives, la BCE a adopté en septembre un
nouveau train de mesures. Elle a notamment abaissé son principal taux directeur de
10 pb à -0,50 % et annoncé la réactivation de son programme d’achat d’actifs, à
hauteur de 20 mds EUR par mois à partir de novembre et pour une durée
indéterminée. Un système de paliers sera mis en œuvre sur la rémunération des
réserves excédentaires à partir de novembre pour limiter l’impact des taux négatifs
sur le canal de transmission bancaire. Enfin, les conditions des TLTRO III ont été
assouplies et leur maturité rallongée.
Les risques entourant notre scénario sont majoritairement baissiers. En tête de liste,
un Brexit sans accord constitue un risque significatif. La situation politique en Italie
demeure une source majeure d’incertitude et la tenue d’élections anticipées en 2020
est un scénario qui ne peut être écarté. L’industrie (allemande notamment)
souffrirait fortement d’un rehaussement des tarifs douaniers sur les importations
américaines de véhicules. A l’inverse, une relance budgétaire coordonnée au sein de
l’Union monétaire améliorerait les perspectives de croissance. L’éventualité d’un tel
scénario reste toutefois très incertaine.
Zone euro 2018 2019p 2020p 2021p 2022p
PIB en volume, % GA 1,9 1,1 0,7 0,4 1,0
Consommation des ménages 1,3 1,2 0,9 0,6 0,7
Consommation publique 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3
Investissement 2,0 2,4 0,6 0,1 0,9
Exportations de biens & services 3,4 2,3 1,5 0,3 2,1
Importations de biens & services 2,6 2,7 2,1 0,9 2,0
Inflation, % 1,8 1,2 1,4 1,1 1,2
Inflation sous-jacente 1,0 1,0 1,1 0,8 0,7
Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA 1,6 2,2 1,3 1,1 1,1
Epargne des ménages, % du RDB 11,9 13,0 13,3 13,7 14,0
Chômage, % de la population active 8,2 7,7 7,8 8,1 8,2
Solde budgétaire, % du PIB -0,5 -0,3 -0,6 -1,0 -1,1
Dette publique, % du PIB 85,3 84,4 83,9 84,5 84,8
Solde courant, % du PIB 2,9 2,5 2,2 2,0 1,9
14ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
ALLEMAGNE
La croissance freinera en 2019-2021, avant de repartir en 2022 grâce
au rebond des exportations.
Avec l’affaiblissement de la demande globale, l’inflation sous-jacente
décélérera sur l’horizon de prévision.
Un Brexit sans accord et une guerre commerciale dans le secteur
automobile constitue le principal risque baissier à notre scénario.
Après avoir fortement ralenti en 2018, la croissance glissera sous son potentiel en
2019, à 0,6 %, grevée par une nouvelle décélération des exportations et le
déstockage des constructeurs automobiles. En 2020-2021, la transmission du
ralentissement global à l’économie domestique amplifiera le freinage de la
croissance et provoquera une remontée du taux de chômage.
En 2020-2021, la décélération du commerce mondial et de la production
manufacturière globale sera accentuée par la sortie du Royaume-Uni de l’UE, une
croissance plus modérée en Chine et le retournement cyclique attendu aux Etats-
Unis. Les exportations, en fort ralentissement en 2019, se contracteront à cet horizon
avant de repartir en 2022 sous l’effet du stimulus américain.
Les difficultés de l’industrie, très orientée à l’export, se transmettent à l’économie
Source : Refinitiv, SG Etudes économiques et sectorielles Source : Refinitiv, SG Etudes économiques et sectorielles
La demande intérieure restera vigoureuse en 2019, avant de marquer le pas en 2020-
2021. L’économie est au plein-emploi et le partage du revenu se fait dorénavant en
faveur des ménages. La consommation privée sera ainsi restée dynamique en 2019.
Toutefois, le recul des exportations et les difficultés de l’industrie se répercuteront
progressivement sur l’économie domestique, notamment par le canal de l’emploi.
Avec la hausse du chômage et le tassement du revenu des ménages, la
consommation privée perdrait ainsi en vigueur en 2020-2021.
15ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
Stable en 2019, la croissance de l’investissement freinera fortement en 2020 avant
de se contracter en 2021. Le recul de la profitabilité et de la demande, dans un
contexte d’incertitude forte, conduira les entreprises à reporter leurs dépenses. Du
côté des ménages, l’ajustement sur le marché du travail devrait modérer
l’investissement résidentiel. Enfin, même s’il restera dynamique, l’investissement
public ne compensera qu’en partie le recul de l’investissement privé, qui ne repartira
pas avant 2022.
Avec le ralentissement de la demande globale, il sera difficile pour les entreprises
d’augmenter leurs prix, même si les pressions salariales resteront vives en 2019-
2020. Par conséquent, l’inflation sous-jacente ralentira sur l’horizon de prévision.
Les risques entourant notre scénario sont nombreux. A court terme, un Brexit sans
accord et le rehaussement par les Etats-Unis des tarifs douaniers sur leurs
importations de véhicules pèserait lourdement sur la filière automobile, déjà en
difficulté depuis 2018. A l’inverse, le débat grandissant sur le bien-fondé d’une
relance budgétaire constitue un risque haussier à notre scénario. Son avènement
reste néanmoins hautement incertain.
Allemagne 2018 2019p 2020p 2021p 2022p
PIB en volume, % GA 1,5 0,6 0,5 0,2 0,9
Consommation des ménages 1,2 1,4 0,8 0,4 0,7
Consommation publique 1,4 2,0 1,5 1,3 1,2
Investissement 3,5 3,0 0,6 -0,1 1,1
Exportations de biens & services 2,3 0,9 -0,4 -0,1 1,8
Importations de biens & services 3,7 2,6 0,5 0,5 1,9
Inflation, % 1,9 1,4 1,5 1,2 1,2
Inflation sous-jacente 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8
Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA 1,9 1,7 1,4 -0,1 0,2
Epargne des ménages, % du RDB 11,0 11,3 11,8 11,3 10,9
Chômage, % de la population active 5,2 5,1 5,7 6,2 6,6
Solde budgétaire, % du PIB 1,5 1,0 0,5 -0,4 -0,6
Dette publique, % du PIB 61,1 59,1 58,2 58,2 58,2
Solde courant, % du PIB 7,6 6,8 6,2 5,6 5,0
16ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
FRANCE
La croissance décélérera à 1,4 % en 2019 avant de ralentir davantage
en 2020-2021 et rebondir en 2022
L’inflation sous-jacente fléchira sur l’horizon de prévision, reflétant
la décélération des coûts salariaux unitaires
Un regain de tensions sociales en réaction aux réformes à venir
grèverait davantage la demande intérieure
La croissance aura poursuivi sa décélération en 2019, à 1,4 %, sous l’effet
d’exportations moins vigoureuses et du freinage de l’investissement des ménages.
En 2020-2021, les effets de bord du ralentissement mondial sur l’économie
domestique et les délocalisations dans le secteur automobile grèveront davantage
la croissance, qui tombera à 0,7 % en 2021. L’activité repartira en 2022, tirée par le
rebond du commerce mondial et l’assouplissement des politiques économiques.
La dynamique du commerce extérieur se dégradera jusqu’en 2021. Un freinage des
exportations est attendu en 2020-2021, dans le sillage de la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne, de l’affaiblissement de l’économie allemande et du
retournement cyclique aux Etats-Unis. En parallèle, l’arrêt de la production par les
constructeurs français de plusieurs modèles automobiles dopera les importations
de véhicules en 2020. Ce n’est qu’en 2022 que les exportations repartiraient,
soutenues par la reprise progressive du commerce mondial.
Le fléchissement de la demande extérieure et de la production automobile pèsera sur la croissance
en 2020-2021
Exportations par destination Production automobile
Valeur, MM3m, T/T, % 60 3
5
4 40 2
3
2 20 1
1
0 0 0
-1
-2 -20 -1
-3
-4 -40 -2
2017 2018 2019
Total Etats-Unis -60 -3
Zone euro Chine et Hong-Kong 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Reste de l'UE, hors RU Reste de l'Asie Production automobile (% GA, éch. g)
Royaume-Uni Suisse Tendance récente de la production (enquête INSEE, normalisée)
Source: Refinitiv Datastream Source: Refinitiv Datastream
Source : INSEE, SG Etudes économiques et sectorielles Source : INSEE, SG Etudes économiques et sectorielles
Le fléchissement de la demande extérieure aura des effets de bord sur l’économie
domestique dès 2020, via l’emploi et l’investissement. Ce dernier marquera assez
rapidement le pas, notamment celui des entreprises, qui se contractera en 2021.
L’investissement en logement des ménages restera atone, particulièrement si le
recentrage des mécanismes de soutien public (Pinel, prêts à taux zéro…) se poursuit.
17ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
L’emploi freinera également dès 2020, contribuant à la remontée du taux de
chômage. La consommation des ménages se montrera résiliente dans un premier
temps, soutenue par les mesures socio-fiscales adoptées dans le sillage du
mouvement des gilets jaunes. Mais avec la dégradation des conditions sur le marché
du travail (le chômage avoisinera 9,5 % en 2022), les ménages ralentiront leurs
dépenses en 2021-2022. La consommation publique compensera en partie les effets
sur l’activité, le gouvernement exploitant des conditions de financement très
favorables en 2021-2022.
Avec l’affaiblissement de la demande globale et de la dynamique des coût salariaux
unitaires, les entreprises modéreront leurs prix de vente. L’inflation sous-jacente
diminuera donc sur l’horizon de prévision.
Avec la relance budgétaire attendue en 2021-2020 et la déviation du PIB de sa
trajectoire tendancielle, le déficit public se creusera pour atteindre 4 % en creux de
cycle. Le ratio de dette publique passerait ainsi au-dessus du seuil des 100 % sur
l’horizon de prévision.
Les risques sur notre scénario restent majoritairement baissiers. Notamment, la
demande intérieure pourrait de nouveau pâtir d’un regain de tensions sociales en
réaction à la réforme des retraites et de l’assurance-chômage. Par ailleurs, la filière
automobile souffrirait certainement de mesures protectionnistes américaines à
l’égard du secteur. En revanche, la consommation pourrait surprendre à la hausse,
les ménages ayant jusqu’à présent épargné une partie du revenu libéré par les
mesures socio-fiscales du gouvernement.
France 2018 2019p 2020p 2021p 2022p
PIB en volume, % GA 1,7 1,4 0,8 0,7 1,1
Consommation des ménages 0,9 1,2 1,0 0,7 0,7
Consommation publique 0,8 0,9 1,2 2,2 2,2
Investissement 2,8 2,6 1,2 0,3 1,0
Exportations de biens & services 3,5 2,6 2,3 0,6 3,2
Importations de biens & services 1,2 2,5 3,0 1,6 2,9
Inflation, % 2,1 1,3 1,3 1,1 1,1
Inflation sous-jacente 0,9 0,6 1,0 0,8 0,8
Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA 2,7 3,6 2,4 1,4 1,4
Epargne des ménages, % du RDB 14,2 15,1 15,2 15,0 14,9
Chômage, % de la population active 8,8 8,2 8,6 9,2 9,6
Solde budgétaire, % du PIB -2,5 -3,2 -2,6 -4,0 -4,1
Dette publique, % du PIB 98,4 98,9 99,4 101,8 103,8
Solde courant, % du PIB -0,6 -1,2 -1,2 -1,2 -1,1
18ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
ITALIE
Le PIB se contracterait légèrement en 2020 et stagnerait 2021, affecté
par l’incertitude politique et le ralentissement mondial
Le déficit budgétaire, stable en 2019, se dégraderait en 2020 du fait de
mesures fiscales expansionnistes et de la contraction du PIB
La situation politique reste très instable et de nouvelles élections sont
probables en 2020
L'économie italienne a stagné au T2 et l’on attend une croissance nulle pour les 2
prochaines années. En 2019, le commerce extérieur a fortement contribué à la
croissance, tandis que la demande intérieure pâtit d’un fort déstockage. En 2020 et
2021, la demande externe serait beaucoup plus faible du fait de la concrétisation du
Brexit et de l’intensification des tensions commerciales au niveau mondial. Le PIB
italien se redresserait en 2022 à 0,7 % avec la reprise du cycle européen.
La demande intérieure resterait atone sur les deux prochaines années. Le cycle
d’investissement prendrait fin à la fois pour des raisons d’offre et de demande. Côté
offre, les entreprises seraient bridées par de faibles taux de marge dans un contexte
où le taux d’utilisation des capacités de production a commencé à baisser. Et côté
demande, le climat des affaires resterait dégradé du fait de l’instabilité politique,
avec un risque élevé de nouvelles élections en 2020. L’investissement en biens
d’équipement se contracterait sur les deux prochaines années tandis que l’activité
serait atone dans le secteur de la construction.
Le commerce de détail résiste L’investissement se contracte
Source : Refinitiv, SG Etudes économiques et sectorielles Source : Refinitf, SG Etudes économiques et sectorielles
En 2020 et 2021, la consommation des ménages resterait positive mais ne
soutiendrait que très faiblement la croissance. Les ménages pâtiraient d’une hausse
du chômage (de 10,3 % en 2019 à 12,1 % en 2022), mais le revenu disponible
continuerait de progresser grâce à une légère hausse des salaires. Celle-ci serait
néanmoins à peine suffisante pour compenser la hausse des prix et le pouvoir
d’achat des ménages stagnerait. Le taux d’épargne, qui a sensiblement progressé en
19ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
2019, baisserait légèrement en 2020 et se stabiliserait en 2021. En 2022, la
consommation des ménages progresserait un peu plus rapidement grâce à la légère
hausse du pouvoir d’achat.
Côté finances publiques, le déficit budgétaire pour 2019 serait moins dégradé
qu’anticipé, bénéficiant notamment de meilleures rentrées fiscales suite au passage
à la facturation électronique pour la TVA au 1er janvier et la détente des taux longs au
S2-2019. De 2,2 % en 2019, le déficit se dégraderait à 2,7 % en 2020 et serait proche
de 3 % en 2021 et 2022. Dans ce contexte, la dette publique attendrait 136 % du PIB
en 2021 contre 132 % en 2018. La politique budgétaire garderait un caractère
expansionniste en 2020, avec une impulsion légèrement moindre que celle anticipée
avant le changement de gouvernement, grâce à un probable retour en arrière sur le
quota 100 pour les retraites et une réforme fiscale moins coûteuse que la flat tax. Le
nouveau gouvernement (Conte II) s’est engagé à annuler la hausse automatique de
la TVA (de 22 % à 25 %) qui interviendrait au 1er janvier 2020 en l’absence de mesures
budgétaires compensatoires, estimées à 15 Mds€.
La préparation du projet de budget qui doit être envoyé à Bruxelles avant le 15
octobre comporte un risque de tensions importantes au sein de la nouvelle coalition
entre le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles, qui pourraient se matérialiser en
2020 et donner lieu à de nouvelles élections. Les tensions pourraient également
résulter de la dégradation des perspectives de croissance qui pèsera sur les recettes
publiques et compliquera la tâche du gouvernement. Si le spread italien a perdu près
de 100bp entre juin et septembre, nous anticipons un retour à 250bp au cours de
l’année 2020 du fait de la détérioration des finances publiques et de l’instabilité
politique. En effet, le risque d’avoir aux prochaines élections (au plus tard en 2023)
un gouvernement d’extrême droite avec une forte composante eurosceptique reste
élevé.
Italy 2018 2019p 2020p 2021p 2022p
PIB en volume, % GA 0,7 0,1 -0,1 0,0 0,7
Consommation des ménages 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5
Consommation publique 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1
Investissement 3,2 1,8 -1,9 -0,9 0,7
Exportations de biens & services 1,4 3,2 1,7 0,1 1,6
Importations de biens & services 1,8 1,3 1,9 0,3 1,0
Inflation, % 1,2 0,7 0,8 0,6 0,9
Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA 0,7 1,0 0,1 0,4 0,7
Epargne des ménages, % du RDB 9,8 10,3 10,1 10,1 10,3
Chômage, % de la population active 10,6 10,2 11,2 11,9 12,1
Solde budgétaire, % du PIB -2,1 -2,2 -2,7 -2,9 -2,9
Dette publique, % du PIB 132,2 133,2 134,8 136,3 136,7
Solde courant, % du PIB 2,5 3,1 3,0 3,0 3,2
20ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
ESPAGNE
Après cinq ans de fort dynamisme, la croissance ralentirait à 1,1 % en
2020 et 0,7 % en 2021
L’inflation serait contenue en 2019 et 2020 malgré la hausse du salaire
minimum
Le paysage politique est très fragmenté et de nouvelles élections
auront lieu le 10 novembre
L’économie espagnole est restée très dynamique au premier semestre, bénéficiant
notamment d’un rebond du commerce extérieur. Le PIB devrait néanmoins ralentir
à 2,1 % cette année, puis 1,1 % en 2020 et 0,7 % en 2021. L’économie espagnole
pâtirait du ralentissement de la croissance en zone euro et des conséquences du
Brexit, notamment sur le secteur touristique, avant de rebondir en 2022 à 1,2 %.
La demande interne serait toujours le moteur principal de l’économie alors que les
tensions commerciales pèseraient sur les exportations. La consommation des
ménages ralentirait dès 2019 après plusieurs années de forte croissance, et ce
malgré la hausse du salaire minimum. En effet, les ménages espagnols ont
largement puisé dans leur épargne ces dernières années – notamment pour
financier l’achat de voitures et de biens durables – et profiteraient d’un regain de
pouvoir d’achat en 2019 pour redresser leur taux d’épargne. Le taux de chômage
toucherait son point bas à 14,1 % en 2019, proche de son niveau structurel, puis
progresserait à partir de 2020 avec le retournement du cycle de croissance. Il
atteindrait plus de 15 % en 2022.
Soutien du commerce extérieur au S1 Le taux de marge se dégrade
Source : Refinitiv, SG Etudes économiques et sectorielles Source : Refinitiv, SG Etudes économiques et sectorielles
L’investissement ralentirait sensiblement dès 2020 après six années de forte
progression, sur fond d’incertitude liée au Brexit et aux tensions politiques en Italie.
Enfin, la hausse des salaires proches du salaire minimum va continuer à éroder les
marges des entreprises et peser sur leurs capacités d’autofinancement. L’activité
dans le secteur de la construction serait également moins dynamique, après trois
21ScénarioÉco N° 36 | septembre 19
années de forte croissance de l’investissement. La délivrance de nouveaux permis
de construire stagne déjà depuis un an.
Le Brexit aurait un impact non négligeable sur l’économie de la péninsule. Le
Royaume-Uni est le quatrième marché d’exportation pour les produits espagnols,
principalement dans le secteur des transports (automobile, trains et aéronautique)
et de l’alimentaire (fruits et légumes). L’enjeu est de taille également pour le secteur
touristique puisque le pays a accueilli l’an dernier 16 millions de visiteurs
britanniques (premier marché). Enfin, il pourrait y avoir un impact migratoire
important : on estime entre 800,000 et 1 million le nombre de britanniques qui vivent
au moins une partie de l’année en Espagne. Ce sont principalement des personnes
retraitées sensibles à la question de l’accès aux soins médicaux qui pourrait être
rendu plus difficile après le Brexit.
Malgré une large victoire du PSOE aux élections du 28 avril, Pedro Sanchez n’a pas
réussi à mettre en place un gouvernement de coalition, qui aurait nécessité l’appui
de Podemos et des nationalistes basques, ainsi que l’abstention des catalans. La
position de Podemos sur le conflit catalan, partisans d’un referendum d’auto-
détermination, a constitué un facteur bloquant et les tensions sont susceptibles de
s’accroître à l’automne avec le verdict attendu de la Cour Suprême dans le procès
des indépendantistes. Les espagnols retourneront donc aux urnes le 10 novembre
2019, pour la quatrième fois en seulement cinq ans.
Le déficit public est revenu sous la barre des 3 % du PIB en 2018, alors qu’il était
encore à 10,5 % en 2012. La politique budgétaire resterait globalement neutre en
l’absence de mesures de relance majeures et le déficit se stabiliserait autour de 2,5 %
du PIB à l’horizon de notre prévision. La dette publique baisserait légèrement en
2019 et 2020 à 96 % du PIB et retrouverait en 2022 son niveau de 2018 (97 % du PIB).
Espagne 2018 2019p 2020p 2021p 2022p
PIB en volume, % GA 2,6 2,1 1,1 0,7 1,2
Consommation des ménages 2,3 1,6 1,3 0,9 1,1
Consommation publique 2,1 1,8 1,5 1,2 1,2
Investissement 5,3 2,4 0,4 0,2 1,1
Exportations de biens & services 2,3 1,7 1,5 0,3 1,9
Importations de biens & services 3,5 0,7 1,7 0,5 1,5
Inflation, % 1,7 0,9 1,4 1,1 1,3
Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA 1,7 2,6 1,5 0,9 1,3
Epargne des ménages, % du RDB 6,6 7,5 7,6 7,7 7,9
Chômage, % de la population active 15,3 14,1 14,4 15,1 15,4
Solde budgétaire, % du PIB -2,5 -2,1 -2,2 -2,5 -2,5
Dette publique, % du PIB 97,1 96,3 96,2 97,0 97,1
Solde courant, % du PIB 0,9 0,7 0,7 0,6 0,8
22Vous pouvez aussi lire