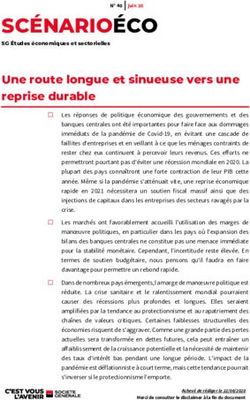Le confort d'été et la Simulation Thermique Dynamique - Conseil Départemental du Doubs
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Fiche 12
Rubriques concernées dans l’outil PEQEB :
Construction : 2.2.4 / 2.2.8
Rénovation : 2.2.3 / 2.2.7
Le confort d’été et la Simulation Thermique
Dynamique
Objectif
Assurer le confort thermique des occupants en saison chaude, sans avoir recours à des systèmes de
climatisation
Pourquoi c’est important ?
Le confort d’été est un enjeu majeur des bâtiments à faible consommation d’énergie. En effet, si les apports
solaires ou les apports thermiques internes sont mal maîtrisés, le bâtiment peut se comporter comme une vé-
ritable « boite thermos ». La question est d’autant plus préoccupante que le changement climatique en cours
conduit à prévoir une multiplication de la fréquence des épisodes caniculaires (les climatologues parlent d’un
été de type 2003 sur deux en 2050).
Les systèmes de rafraîchissement actifs (pompes à chaleur, climatiseurs…) sont de gros consommateurs d’éner-
gie et utilisent des fluides frigorigènes, puissants gaz à effet de serre lorsqu’ils sont libérés dans l’air. Leur inté-
gration architecturale est par ailleurs souvent négligée [12.1].
[12.1] : Impact négatif de la climatisation en ville sur l’esthétique des façades - source : Photo eEgénie
La bonne stratégie consiste donc à se protéger d’abord des surchauffes par une bonne conception du bâtiment
et des comportements individuels adaptés, avant de recourir à des systèmes de rafraîchissement.
Définitions utiles
Pour comprendre les phénomènes qui influent sur le confort thermique, les paramètres physiques les plus
importants sont les suivants :
> La température de l’air intérieur (mais pas seulement !),
> La température des parois de la pièce : le rayonnement thermique des personnes à proximité des murs
et des fenêtres, dont l’intensité dépend de la température et de la nature des parois, est responsable de la
sensation de « paroi froide »,
> L’humidité de l’air : une humidité de l’air trop basse (< 25%) entraine des gênes respiratoires, alors
qu’au-dessus de 50 à 60% d’humidité, la sensation de confort diminue,
>La vitesse de l’air : une augmentation de la vitesse de l’air de 1 m/s améliore la température de sensation de
confort d’été de 3 à 4°C. Les ventilateurs (qui consomment relativement peu d’énergie) sont donc de bonnes
solutions pour supporter un épisode de chaleur. Sans brassage d’air, il est en effet difficile de supporter une
température de plus de 28 °C lorsque l’air est sec (25% d’humidité) ; ce seuil s’abaisse à 26°C lorsque l’air est
humide (80% d’humidité).
60Le Diagramme de Givoni [12.2] propose une expression de la zone de confort thermique en fonction de la
température de l’air, de l’humidité et de la vitesse de l’air, dans le cas d’un habillement léger : l’objectif est de
rester dans le périmètre en couleur.
Mais le confort n’est pas une grandeur exacte, c’est plutôt une sensation subjective dont on peut mieux
cerner les contours à l’aide de ce graphe. Un certain nombre de paramètres socioculturels, psychologiques,
physiologiques ou encore comportementaux, vient s’ajouter en effet aux paramètres physiques décrits ici.
[12.2] : Zones de confort selon la température, l’humidité et différentes vitesses d’air (digramme de Givoni) -
source : Wikimedia Commons
Le free cooling est l’aptitude d’un système de renouvellement d’air à rafraîchir un bâtiment sans l’inter-
vention d’une machine de production de froid. Pour une VMC double-flux par exemple, le « free-cooling »
consistera à la faire fonctionner la nuit alors que la température extérieure est suffisamment fraîche, sans
intervention de la batterie froide, par simple introduction d’air frais (le débit pourra être augmenté, le cas
échéant).
Comment faire ?
Privilégier d’abord les mesures passives avant de faire appel au rafraîchissement actif. Dans le cas où un sys-
tème actif serait jugé indispensable, la plupart des recommandations données ci-après permettent une réduc-
tion de la consommation de climatisation.
En conception, 4 précautions
1) Favoriser l’inertie thermique (pour les bâtiments d’usage régulier ou permanent) :
L’isolation thermique répartie ou par l’extérieur favorise l’utilisation de la masse du bâtiment pour y « stoc-
ker du froid » pendant la nuit et en bénéficier pour le rafraîchir en journée. Mais attention, si un bâtiment à
forte inertie s’échauffe malgré tout du fait d’une mauvaise gestion (des baies non occultées le week-end, par
exemple), il est très difficile de le faire redescendre en température ensuite !
2) Prévoir des protections solaires extérieures [12.3] :
Il est indispensable de limiter les apports solaires directs, responsables de forts apports thermiques, mais
sans altérer le confort visuel pour autant.
Des protections solaires réglables à l’est et à l’ouest (de type brises soleil orientables (BSO), stores extérieurs,
volets coulissants…) permettent de gérer les apports de lumière sans insoler les vitrages et sans qu’il soit
nécessaire de recourir à l’éclairage artificiel en plein jour.
Des protections fixes (de type casquettes) sont la plupart du temps suffisantes au sud.
Casquette Brise soleil orientable (à l’extérieur)
61Volet coulissant Store toile
[12.3] : Différents types de protections solaires - source : Photos eEgénie
3) Elaborer une stratégie de ventilation naturelle nocturne, notamment :
Prise en compte des vents dominants.
Configuration traversante du bâtiment, favorisant les flux d’air à l’intérieur des pièces [12.4].
Dispositions prises afin que la circulation d’air soit effective : menuiseries oscillo-battantes, portes entre
bureaux maintenues ouvertes la nuit, etc.
[12.4] : Principe de la ventilation naturelle traversante dans un bâtiment - source : eEgénie
4) Prévoir des brasseurs d’air ou des ventilateurs pour supporter les épisodes caniculaires [12.5]
[12.5] : Exemple de brasseur d’air - source : Photo eEgénie
62En fonctionnement, 4 grands principes
1) Se protéger du rayonnement solaire en journée en utilisant les protections solaires extérieures.
2) Limiter autant que possible les apports thermiques internes (sèche-linge dans une crèche par
exemple).
3) Bien gérer les ouvrants de jour : l’été, lorsqu’il fait plus frais dehors que dedans, ouvrir les fenêtres pour
rafraîchir les bureaux. Mais dès que c’est l’inverse, penser à les refermer pour ne pas réchauffer le bâtiment !
4) Favoriser la ventilation nocturne des locaux entre les pièces et les circulations.
Réaliser une étude de confort d’été à l’aide d’un outil de Simulation Thermique Dynamique (STD)
La Simulation Thermique Dynamique (STD) permet d’évaluer finement les besoins de chauffage en hiver (voir
FICHE 07). Mais elle permet également d’étudier le confort d’été en fonction de différents scénarii de fonction-
nement et de différentes conditions météorologiques (conditions caniculaires ou moyennes) :
> Impact de la gestion des apports solaires (selon les protections solaires employées, selon le dimensionnement
des surfaces vitrées, etc.),
> Impact des apports internes (selon les horaires et volumes d’occupation, le dégagement de chaleur lié aux
installations d’éclairage et aux appareils installés, etc.),
> Impact de la stratégie de renouvellement d’air (free-cooling, ventilation naturelle, automatisation des ou-
vrants, etc.).
Un indicateur est retenu couramment pour témoigner des conditions de confort : le nombre d’heures où la
température dépasse 28°C au sein de locaux représentatifs du bâtiment et répartis selon un zonage représen-
tatif [12.6] [12.7].
[12.6] : Zonage thermique d’un bâtiment (STD Pléiades Comfie) - source : eEgénie
[12.7] : Exemple de résultats apportés par une STD - source : eEgénie
63Les erreurs à éviter
Ne pas informer suffisamment les occupants des principes d’utilisation du bâtiment.
Considérer que le respect de l’indicateur Tic de la RT2012 garantira de bonnes conditions de confort en
été ! Cet indicateur est simplement réglementaire et ne permet pas de juger des conditions de confort
propres au bâtiment. Seule une Simulation Thermique Dynamique, qui prend en compte les conditions
d’utilisation les plus proches de la réalité, permettra d’étudier dans le détail l’impact de plusieurs solu-
tions passives (et actives si nécessaire) de rafraichissement du bâtiment.
Prévoir de protéger des façades vitrées à l’est et à l’ouest par des casquettes : cette solution n’est efficace
qu’au sud ! A l’est et à l’ouest, le soleil est en effet plus bas et frappera le vitrage malgré la casquette.
Pour aller plus loin…
- La conception bioclimatique - des maisons confortables et économes, Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva,
Terre Vivante, 2006, ISBN : 978-2-914717-21-2
- Surventilation et confort d’été - guide de conception, FREEVENT, 2018
- Bâtir pour la santé des enfants, Suzanne Déoux, Medieco Editions, 2010, ISBN : 978-99920-1-776-0
- Fenêtres dimensionnement et performances, Cahier pratique, Le Moniteur n°5632, 11/2010
- site ressources du CEREMA sur la ventilation : www.batiment-ventilation.fr
64Fiche 13 Rubriques concernées dans l’outil PEQEB :
Construction et Rénovation : 2.2.9 et 2.3.5
L’éclairage naturel et artificiel
Objectif
Assurer le confort visuel des occupants au sein des espaces, tout en limitant les consommations
d’énergie
Pourquoi c’est important ?
Le confort visuel des occupants doit être adapté à leur activité spécifique, selon les usages des bâtiments. Les
locaux doivent être pensés avec soin en favorisant l’éclairage naturel et en raisonnant les équipements d’éclai-
rage artificiel en complément [13.1].
[13.1] : Exemple d’éclairage naturel généreux en bureau apporté par les parois vitrées extérieures et aussi inté-
rieures - source : Architecte : Tectoniques - Photo : eEgénie
L’éclairage naturel est très important pour l’équilibre psychologique et physiologique de chaque individu :
Les vues sur l’extérieur sont bénéfiques, en donnant des repères temporels et climatiques, et permettent de
reposer la vue lors de l’observation d’un objet éloigné. L’absence de vues provoque une sensation de confine-
ment (remarque : la vue à l’horizontale est une exigence du code du travail).
L’absence ou l’insuffisance de lumière naturelle perturbe la sécrétion de la mélatonine, hormone fixant le
rythme circadien (rythme jour/nuit) et la qualité du sommeil s’en ressent. De plus, les cas de dépression
augmentent toujours à l’arrivée de l’hiver.
L’éclairage naturel permet aussi de limiter les consommations d’éclairage artificiel. Mais pour être source de
confort, son abondance et son contraste doivent être maîtrisés et adaptés.
La lumière peut également être un véritable outil architectural, notamment en participant à la création de
sous-espaces adaptés aux différents usages du bâtiment, sans utilisation de cloisons.
Définitions utiles
Facteur de lumière du jour (FLJ) : c’est le rapport entre le niveau d’éclairement naturel reçu par ciel couvert
dans une pièce et le niveau d’éclairement mesuré à l’extérieur, simultanément.
Cette valeur exprimée en %, est un bon indicateur pour juger la qualité de l’éclairement naturel. Communé-
ment, il est d’usage de définir un plan de travail horizontal à 75 ou 80 cm de hauteur pour lequel le FLJ est
calculé en tous points.
66Zone de premier rang - zone de second rang [13.2] : il est d’usage de considérer deux zones dans les pièces
étudiées :
> La « zone de premier rang » est la zone comprise entre la paroi extérieure où se trouve une baie et 2 fois la
hauteur sous plafond (à laquelle est soustraite la hauteur du plan d’étude).
> La « zone de second rang » est la zone comprise entre la zone de 1er rang et le fond de la pièce ; il est possible dans
certains cas que la hauteur sous plafond soit suffisamment élevée pour qu’il n’y ait pas de zone de second rang.
13.2] : Zones de premier et de second rang - source : Certivéa
Facteur de transmission lumineuse d’un vitrage (Tl) : c’est le rapport entre la quantité de lumière qui res-
sort d’un vitrage et la quantité de lumière qui y rentre. Il est de l’ordre de 0,7 pour un double vitrage clair
du fait de l’épaisseur des verres (0,8 pour les vitrages très clairs). Attention, ne pas confondre avec le facteur
solaire, qui est le rapport entre l’énergie qui traverse un vitrage et l’énergie incidente sur ce vitrage. Les 2
grandeurs sont liées, mais sont néanmoins différentes !
Lux : c’est une unité de mesure de l’éclairement lumineux (symbole lx) qui caractérise le flux lumineux reçu
par unité de surface. Ainsi, 1 lux est l’éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément
répartie, un flux lumineux de 1 lumen (symbole lm) par mètre carré.
Comment faire ?
Optimiser l’accès à la lumière naturelle
En effectuant dès l’esquisse une simulation d’éclairage naturel [13.3] sur un logiciel dédié afin de connaitre
le FLJ dans les parties les plus sensibles du bâtiment (zones d’usage fréquent les moins bien exposées notam-
ment).
[13.3] : Résultats de simulation de FLJ prenant en compte le premier et le second rang - source : eEgénie
67D’après l’analyse des résultats de ce type de calcul, un travail d’optimisation peut être mené, portant sur la
géométrie des pièces, l’emplacement et la taille des baies, le choix du type de vitrage, l’organisation des zones
de travail, etc.
Dans les zones non suffisamment éclairées (pièces borgnes, fond de salle, …), il est possible d’utiliser des disposi-
tifs pour amener de l’éclairage naturel là où il y en a besoin : simple lanterneau voile-voute (protégé des apports
solaires directs), tube de lumière, concentrateur de lumière naturel à fibre optique, … [13.4].
Voile voûte Tube de lumière
[13.4] : Différentes solutions pour conduire la lumière naturelle au sein des bâtiments - source : Photos eEgénie
Dimensionner l’éclairage artificiel de manière optimale
L’éclairement artificiel doit donc être optimisé [13.5] pour répondre aux exigences réglementaires, sans pour
autant sur-éclairer et donc surinvestir, surconsommer et alourdir le programme de maintenance, au risque de
créer des conditions d’éblouissement inconfortables.
[13.5] : Cartographie des niveaux d’éclairement artificiel en fonction du positionnement des luminaires (iso-lux
dans un bureau, respectivement avec 2 et 3 luminaires) - source : eEgénie
L’objectif est de répondre à plusieurs réglementations et avis : la réglementation du travail, la réglementation
accessibilité, l’avis de l’AFE (Association Française de l’Eclairage, qui regroupe de nombreux professionnels de
l’éclairage mais aussi les fabricants et les fournisseurs d’énergie, ce qui rend son discours moins neutre).
Il faut également prendre en compte les perceptions individuelles qui diffèrent suivant les individus, leur âge,
leur sensibilité, leur activité, … Pour autant, il possible de s’appuyer sur les recommandations suivantes :
Recommandations de niveaux d’éclairement
Salle de classe 350 lux
Bureau 200 lux en ambiance,
400 lux sur plan de travail (éclairage d’appoint)
Salle de restaurant 300 lux
Séjour et cuisine d’un logement 200 à 250 lux
Circulation horizontale 100 lux
Escalier 150 lux
68Choisir du matériel d’éclairage performant
Commande de l’allumage / modulation de l’éclairage artificiel par des sondes crépusculaires et détecteurs
de présence, afin d’obtenir une modulation de la puissance d’éclairage en appoint de l’éclairement naturel.
Lampes à faible consommation et à longue durée de vie : LED à haut rendement (> 80 lumens/W) [13.6].
[13.6] : Lampes à leds remplaçant désormais les éclairages à incandescence
(interdits à la vente depuis le 01/09/2018)
Eclairage ponctuel par luminaire individuel sur mât, combiné à un éclairage d’ambiance, plutôt qu’un éclai-
rage uniforme identique en tout point [13.7].
Les erreurs
à éviter
Omettre de vérifier le facteur de transmis-
sion lumineuse des vitrages mis en œuvre
sur le chantier : bien souvent, cette caracté-
ristique du vitrage est bien prescrite dans le
CCTP mais n’est pas vérifiée par la maîtrise
d’œuvre pour les produits proposés par l’en-
treprise. Il arrive donc que les vitrages posés
[13.7] : Exemple de mât d’éclairage en bureau aient une moins bonne transmission lumi-
- source : Photo eEgénie neuse que celle exigée, ce qui nuit à la quali-
té de l’éclairage naturel.
Oublier de prendre en compte le risque
d’éblouissement dans le dimensionnement
des ouvertures vitrées, dans l’agencement
des postes de travail et dans la conception de
l’éclairage artificiel.
Pour aller plus loin…
- La conception bioclimatique - des maisons confortables et économes, Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva,
�Terre Vivante, 2006, ISBN : 978-2-914717-21-2
- Bâtir pour la santé des enfants, Suzanne Déoux, Medieco Editions, 2010, ISBN : 978-99920-1-776-0
- Construire avec la lumière naturelle : concevoir un bâtiment en fonction de la lumière naturelle, Pascale
Avouac, Marc Fontoynont, Michel Perraudeau, CSTB, 2011, ISBN : 978-2-86891-487-3
- Bureaux, écoles : mieux s’éclairer à coûts maîtrisés, ADEME / Syndicat de l’éclairage / AFE :
www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1439/guide-efficacite-eclairage-tertiaire.pdf
- Rénovation de l’éclairage dans les bâtiments tertiaires, ADEME, 2011 :
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79518_fichiers_ref_7198-bassedef.pdf
- Éclairage des parties communes des bâtiments tertiaires et résidentiels : économies d’énergie et sécurité,
ADEME, 2012 : www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/86033_7200-pdfavec-liens.pdf
- Portail d’information belge Energie+ : www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16957&L=0
69Fiche 14 Rubriques concernées dans l’outil PEQEB :
Construction et Rénovation : 2.2.4
Le renouvellement d’air
Objectif
Assurer la qualité de l’air au sein des bâtiments, en limitant la dépense énergétique associée
Pourquoi c’est important ?
Le renouvellement d’air est une nécessité absolue pour garantir un air sain (voir FICHE 15). En effet, l’extraction
de l’air vicié compensée par l’apport d’air neuf permet :
> le maintien du taux d’oxygène nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme,
> l’évacuation de la pollution d’origine biologique : moisissures, bactéries, virus, etc.,
> l’évacuation de la pollution chimique émise par les peintures, sols, produits entretiens, meubles, etc.
> l’évacuation de l’humidité, du gaz carbonique (CO2) et des odeurs.
Les importants débits d’air à mettre en œuvre pour garantir un renouvellement d’air suffisant génèrent des
déperditions thermiques considérables. Il faut en effet chauffer l’air entrant pour l’amener à température am-
biante. Aussi, il est indispensable de maîtriser les systèmes de ventilation afin de limiter autant que possible
les consommations énergétiques associées à ce poste (à la fois les consommations de chauffage et d’électricité
associée au fonctionnement des ventilateurs).
Dans le cas de bâtiments existants, le bâti est souvent très peu étanche à l’air, et le renouvellement d’air est as-
suré par les infiltrations d’air non maîtrisées, ce qui est source d’inconfort et de fortes déperditions thermiques.
Dans le cadre d’une rénovation thermique, on va chercher à rendre le bâtiment plus étanche (changement des
fenêtres par exemple), et il faudra alors absolument penser à mettre en place un système de renouvellement
d’air maîtrisé.
Comment faire ?
Garantir une bonne étanchéité à l’air (voir FICHE 11)
Une excellente étanchéité à l’air du bâtiment permet de réellement maîtriser les flux d’air entrant et sortant du
bâtiment, de façon à garantir le confort des occupants et à limiter la dépense énergétique. Le renouvellement
d’air sera ainsi entièrement assuré par le système de ventilation (naturelle ou mécanique) mis en place.
Mettre en œuvre des débits de renouvellement d’air adaptés à l’usage des locaux
Les débits de renouvellement d’air seront adaptés à l’activité des occupants et au nombre d’occupants. Les
débits minimaux réglementaires sont définis dans le règlement sanitaire départemental du Doubs. Toutefois,
lorsque cela est possible, la mise en œuvre de débits plus importants est conseillée, pour une meilleure qualité
d’air. Un débit de 25 m3/h par personne au minimum (sans faire de différence entre adultes et enfants) semble
être un bon compromis entre qualité de l’air et dimensionnement de l’installation de renouvellement d’air.
Des systèmes asservis à une détection de présence , une sonde CO2 et/ou une programmation horaire sont in-
téressants pour limiter les consommations énergétiques. Toutefois, on veillera à conserver un débit minimum
en inoccupation en journée, pour garantir l’évacuation des polluants non liés à l’occupation (polluants émis par
les revêtements intérieurs, l’ameublement, etc.).
70Choisir un système de ventilation efficace à la fois en termes de qualité de l’air intérieur et de maî-
trise de la consommation énergétique, et adapté au projet
Ventilation naturelle :
En ventilation naturelle, aucun ventilateur n’intervient. L’air se déplace grâce au différentiel de pression qui
existe entre les façades du bâtiment exposées différemment au vent, et grâce à la différence de masse volu-
mique de l’air en fonction de sa température (c’est le tirage thermique ou l’effet cheminée).
Il existe plusieurs types de ventilation naturelle : par conduit de tirage thermique débouchant en toiture
avec entrée d’air en façade, par ouverture des fenêtres automatisée ou non, par tourelle de ventilation natu-
relle automatisée selon le taux de CO2 et la température extérieure et intérieure [14.1].
Avec un dimensionnement traversant, il est possible d’atteindre de très importants débits de renouvelle-
ment d’air, favorables à la qualité de l’air intérieur, mais également au confort d’été : en effet, ventiler la nuit
permet d’évacuer avec efficacité la chaleur accumulée dans le bâtiment la journée et rafraichir de façon
passive les locaux.
[14.1] : Tourelle de ventilation naturelle double-flux - source : Photo eEgénie
Les + : la ventilation entièrement naturelle ne demande aucune consommation électrique. Les éléments de
ventilation naturelle nécessitent généralement très peu d’entretien et ne comprennent pas de ventilateurs
bruyants.
Les - : la ventilation naturelle étant liée aux phénomènes naturels de mouvement de l’air, la qualité de l’air
risque de ne pas être garantie dans tous les locaux en tout temps. Le renouvellement d’air peut être fortement
perturbé par le vent, par l’ouverture de fenêtres, ... Par ailleurs, la récupération de chaleur sur l’air extrait n’est
pas possible ou compliquée.
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple-flux [14.2] :
On parle de ventilation simple-flux lorsque l’évacuation d’air (extraction) est réalisée grâce à un ventilateur.
Il se crée alors un mouvement de circulation de l’air dans le bâtiment, de telle sorte que l’air neuf entre na-
turellement par les fenêtres des locaux «propres» (bureaux, salle de classe, ...) et que l’air est extrait par un
ventilateur au niveau des pièces «humides» (sanitaires, buanderies, WC, cuisines, ...).
Les VMC simple-flux sont de 3 types : autoréglable (le débit est toujours le même), hygroréglable A (le débit
dépend du taux d’humidité dans la pièce), hygroréglable B (le débit dépend du taux d’humidité dans la
pièce et à l’extérieur).
[14.2] : Principes comparés de ventilation simple-flux et double-flux - source : «La ventilation, indispensable pour
un logement confortable et sain» - ADEME, 2018
71Les + : le débit de renouvellement d’air est assuré quelles que soient les conditions extérieures.
Les - : un débit important de renouvellement d’air induira des surconsommations de chauffage, auxquelles
s’ajoute la consommation électrique du ventilateur.
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double-flux avec récupération de chaleur [14.3] :
On parle de ventilation double-flux lorsque les flux entrant et sortant se croisent (sans se mélanger) dans
un échangeur de chaleur. L’air neuf capté à l’extérieur est donc réchauffé par l’air extrait des pièces dites
«humides» (le rendement peut atteindre les 90%), avant d’être insufflé dans les locaux.
[14.3] : Double-flux utilisée dans un groupe scolaire d’une dizaine de classes - source : Photo eEgénie
Les + : le débit de renouvellement d’air est assuré quelles que soient les conditions extérieures et peut être très
important sans générer pour autant une augmentation des besoins de chauffage.
Les - : la consommation électrique est plus importante que pour une simple-flux (présence de 2 réseaux de ven-
tilation et perte de charge de l’échangeur) et la maintenance accrue (nettoyage de l’échangeur et changement
régulier du filtre, nettoyage du réseau d’insufflation d’air neuf). Le volume occupé par la centrale de traitement
d’air peut être important.
Les erreurs à éviter
Croire que la pollution de l’air intérieur est seulement liée à l’occupation des locaux ! Elle est liée aussi
aux peintures et revêtements, au mobilier, aux produits d’entretien, … et les besoins de ventilation sont
donc permanents.
Mal choisir l’emplacement de la bouche d’aspiration extérieure dans le cas d’une ventilation double-
flux : si celle-ci est mal placée (par exemple pour une école, à proximité de la zone d’attente des parents
(qui fument !) ou de dépose des bus, c’est l’ensemble du bâtiment qui va souffrir de la pollution.
Ne pas remplacer les filtres de la ventilation double-flux suffisamment tôt : un encrassement des filtres
induit une augmentation des pertes de charge et donc de la consommation électrique du ventilateur,
et ne permet pas d’assurer la qualité de l’air au sein des locaux.
Ne pas souscrire de contrat de maintenance : un système de ventilation s’entretient pour durer dans le
temps et assurer pleinement ses fonctions !
Oublier de communiquer aux usagers les recommandations d’utilisation : nettoyage régulier des
bouches d’extraction dans les logements [14.4], ouverture appropriée des fenêtres selon le type de ven-
tilation (naturelle ou mécanique), etc.
[14.4] : Exemple de bouche d’extraction de VMC n’ayant pas été nettoyée
depuis longtemps -source : Photo eEgénie
72Pour aller plus loin…
- La conception bioclimatique - des maisons confortables et économes, Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva,
Terre Vivante, 2006, ISBN : 978-2-914717-21-2
- Bâtir pour la santé des enfants, Suzanne Déoux, Medieco Editions, 2010, ISBN : 978-99920-1-776-0
- Malette ECOL’AIR, ADEME, Alphéeis, PBC, Atmo France, Atmo PACA et Air Normand, 2011, ISBN :
978-2-358380-38-6 http://www.ademe.fr/ecolair-etablissement-respire-cest-bon-lavenir
- Portail d’information belge Energie+ : www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16957&L=0
- Guides gratuits du CETIAT, laboratoire d’études, d’essais et d’étalonnages dans les domaines de l’aéraulique,
de la thermique et de l’acoustique : http://www.cetiat.fr/fr/publicationsveille/servezvous/guidesgratuits/
- Santé et conforts dans les bâtiments, Villes et Aménagement durable, 2017 :
www.ville-amenagement-durable.org/IMG/pdf/dossier_sante.pdf
- Construire sain - guide à destination des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la construction et la
rénovation, DGALN, 2013 : www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/guides_construire_sain_2015.pdf
73Fiche 15 Rubriques concernées dans l’outil PEQEB :
Construction et Rénovation : 2.2.4
La qualité de l’air intérieur
Objectif
Tenir compte de la santé des occupants dans les projets de bâtiments performants
Pourquoi c’est important ?
Si la pollution de l’air extérieur constitue une problématique prise au sérieux depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, la qualité de l’air intérieur est quant à elle trop souvent négligée.
On sait pourtant que nos modes de vie nous amènent à passer de plus en plus de temps dans des bâtiments.
La pollution peut être d’origine biologique (moisissures, pollen, bactéries, virus, …). Certains matériaux et pro-
duits de construction ou de finition, ainsi que l’ameublement et certains produits d’entretien et de nettoyage,
émettent une quantité non négligeable de substances chimiques qui peuvent être dangereuses pour la santé
(développement d’allergies, divers maux bénins, mais aussi asthme, perturbation du système endocrinien, …).
La présence de radon, gaz radioactif naturel mais cancérigène, peut également constituer un réel enjeu de
santé public, selon la nature du sous-sol et sa concentration dans les bâtiments, notamment dans le Doubs qui
est classé département sensible.
Garantir une bonne qualité de l’air intérieur est donc un enjeu fondamental de la construction neuve et de la
réhabilitation, d’autant plus important que l’étanchéité à l’air du bâtiment est à rechercher pour rendre les
bâtiments performants du point de vue énergétique.
Pour les bâtiments destinés à accueillir des enfants, qui constituent une population particulièrement sensible
du fait de leur système respiratoire immature et du temps passé dans des lieux clos, cette question doit être
traitée avec soin.
Voici une liste non-exhaustive des multiples sources de pollutions que l’on peut trouver à l’intérieur des bâti-
ments [15.1] :
[15.1] : Différentes sources de pollution de l’air intérieur - source : «Guide de la pollution de l’air intérieur» -
INPES, 2016
74Sources extérieures Equipements Matériaux, Autres sources internes
du bâtiment ameublement
Air extérieur pollué Eléments de chauffage et Matériaux • Laboratoires scienti-
• Pollens, particules de ventilation • Micro-organismes qui fiques
• Spores fongiques • Micro-organismes qui se développent sur les • Zones d’art technique
• Emissions industrielles se développent dans les matériaux souillés ou • Zones de photocopie et
• Emissions de véhicules conduits et humidifica- endommagés par l’eau d’impression
teurs (Légionellose) • Matériaux et revête- • Zones de préparation
Sources proches • Mauvaise extraction ments émettant des et de consommation
• Zones de chargement des produits de combus- composés organiques d’aliments
• Véhicules en stationne- tion volatils (COV) • Zones fumeurs (inter-
ment • Poussières, débris ou • Matériaux contenant dites)
• Odeurs de bennes à fibres dans les conduits des composés inorga- • Matériel de nettoyage
ordure ou dans les revêtements niques • Emissions des déchets
• Débris insalubres ou de conduits • Matériaux qui pro- • Pesticides
rejets gazeux près des • Trappes de plomberie duisent des particules • Odeurs ou composés
entrées d’air extérieures ou puisards organiques volatils (COV)
(poussières) ou des fibres,
•Tabagisme près des dont l’amiante de joints ou colles
prises d’air, des entrées et Autres équipements • Matériaux ou sous-sol • Occupants ayant des
des ouvrants • Emissions d’équipe- contenant des radioélé- maladies contagieuses
ments de bureau : com- ments et émettant du • Marqueurs et feutres
Sources souterraines posés organiques volatils radon • Insectes et autres ani-
• Radon (COV), particules fines, maux nuisibles
• Pesticides ozone Ameublement et • Produits de soins per-
• Fuite des réservoirs • Emissions des labora- décoration sonnels, parfums
enterrés d’entreposage toires, des processus de • Emissions des nou- • Animaux
d’hydrocarbures nettoyage veaux meubles ou • Matériel de classe ou
• Gaz dans le sol • Atriums et autres en- textiles entreposage de matériel
droits humides • Emissions des peintures • Produits d’entretien et
et vernis de nettoyage
• Micro-organismes qui • Activités de rénovation
se développent sur ou • Emission de gaz carbo-
dans l’ameublement nique (CO2) des occu-
souillé ou endommagé pants
par l’eau
En application des articles L. 221-8 et R. 221-30 à R. 221-37 du code de l’environnement, depuis le 1er janvier
2018, une évaluation des moyens d’aération et de ventilation, ainsi que la mise en œuvre au choix, d’une cam-
pagne de mesures de certains polluants (formaldéhyde, benzène, dioxyde de carbone et tétrachloroéthylène si
l’établissement est contigu à une installation de nettoyage à sec) ou d’une autoévaluation (avec un kit de me-
sures indicatives de la qualité de l’air disposant d’une attestation de conformité délivrée par l’INERIS et remplis-
sage de questionnaires simples sur les pratiques de l’établissement assorti de l’élaboration d’un plan d’actions),
sont obligatoires dans les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans (écoles maternelles,
crèches, …) et les écoles élémentaires. L’échéance réglementaire est fixée au 1er janvier 2020 pour les accueils
de loisirs et les établissements d’enseignement du second degré, et au 1er janvier 2023 pour les autres établis-
sements. La qualité de l’air intérieur doit alors être appréciée au regard de valeurs-guides et de valeurs-limites.
La problématique particulière du radon dans le Doubs
Le code de la santé publique (articles R 1333-28 à R 1333-36) impose que les établissements d’enseignement,
d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’héberge-
ment (hôpitaux, maisons de retraite,…), thermaux et pénitentiaires effectuent des mesures de radon tous les
dix ans, et lors de travaux entraînant une modification substantielle de la ventilation ou de l’étanchéité des
bâtiments.
Les mesures doivent être réalisées par des professionnels agréés, et conformément aux normes en vigueur.
Si l’activité volumique dépasse le niveau de référence de 300 becquerels (désintégrations par seconde) par
mètre cube d’air (Bq/m3) en valeur moyenne annuelle, des mesures correctives simples doivent être prises. Si
une mesure dépasse 1 000 Bq/m3, des travaux doivent être entrepris pour réduire l’exposition au radon au ni-
veau le plus bas possible. Ces travaux sont définis après des investigations complémentaires et ils font ensuite
l’objet d’un contrôle d’efficacité.
Le radon est un gaz issu de la radioactivité naturelle du sous-sol qui présente une forte capacité de diffusion.
Les voies d’infiltration dans les bâtiments sont multiples [15.2].
75[15.2] : Voies d’entrée du radon dans les bâtiments - source : www.irsn.fr
En raison d’un sous-sol karstique qui conduit, selon les endroits, à des émanations parfois importantes, le
Doubs fait partie des 31 départements définis comme prioritaires en matière de problématique radon [15.3].
En Franche-Comté, les études épidémiologiques laissent à penser que la mortalité induite par les cancers des
poumons dus au radon serait équivalente à celle des accidents de la route.
[15.3] : Zonage du potentiel d’exhalation du radon en France métropolitaine - source : www.irsn.fr
La situation est très variable selon les communes [15.4] et, au sein d’une commune, selon la zone considérée
et la typologie des bâtiments. Aussi, il est recommandé de procéder de manière volontaire à un dépistage sys-
tématique à l’occasion d’un projet de rénovation (notamment en cas de changement des fenêtres, de mise en
place d’un système de ventilation ou d’intervention au niveau du plancher de rez-de-chaussée), par l’exposition
d’un dosimètre passif [15.5] pendant une période de quelques mois durant la saison de chauffe. Le coût de
ce dépistage est modique : quelques dizaines d’euros comprenant l’analyse. Il sera suivi d’un diagnostic plus
complet réalisé par un professionnel si la valeur mesurée est élevée, afin de déterminer les actions correctives
à mettre en œuvre ou les travaux d’assainissement à engager.
[15.4] : Carte en ligne pour connaître le potentiel radon des communes - source : www.irsn.fr
76[15.5] Exemple de dosimètre de dépistage du radon dans les bâtiments - source : Département du Doubs
Comment faire ?
Il convient de prendre en considération l’ensemble des sources potentielles de pollution de l’air intérieur, à la
fois en conception et en exploitation.
En conception :
Proscrire dans les espaces extérieurs, les végétaux allergisants de niveau 2 et supérieurs selon l’échelle du
Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
Au minimum, faire le choix de produits de classe A+ conformément au décret du 23 mars 2011 relatif à l’éti-
quetage [15.6], pour les revêtements de mur ou de sol, les peintures et vernis. Si les fournisseurs tardaient
à proposer de tels produits, on se reportera à l’Ecolabel européen ou aux labels étrangers suivants [15.7] :
Ange Bleu (Allemagne), Natureplus (international), ICL (Danemark), M1 (Finlande), « Indoor Air Comfort –
Eurofins» Standard ou Gold (international).
[15.6] : Etiquette d’émissions COV des produits de construction, de revêtement et de décoration
- source : www.cohesion-territoires.gouv.fr
[15.7] : Différents labels de qualité de l’air intérieur
Garantir des débits d’air neuf de 25 à 30 m3/h par personne pour les systèmes de ventilation.
Pour limiter les nuisances, on veillera à ce que les flux d’air soient correctement orientés et ne soient pas
source de bruit (vitesse de l’air dans les gaines < 4 m/s).
On veillera aussi à mettre en œuvre un débit minimal de renouvellement quelle que soit l’occupation des
locaux, puisque les polluants intérieurs ne sont pas uniquement liés à l’occupation, et doivent être évacués
autant que possible.
77Proscrire les revêtements de sol en PVC, surtout sur un plancher chauffant. A l’inverse, privilégier les revê-
tements de sol de type caoutchouc ou linoléum naturel [15.8]. Ceux-ci feront au minimum l’objet d’une
variante dans la consultation des entreprises.
[15.8] : Revêtement de sol en linoléum naturel - source : Photo eEgénie
Prévoir des trappes d’accès au réseau de ventilation et des gaines rigides permettant leur nettoyage aisé
(attention à leur fixation, elles ne doivent pas être perforées par des vis).
Prendre en compte le potentiel radon de la commune dans la conception de la liaison entre le bâtiment et
le sol (pose d’une membrane d’étanchéité sous la dalle en prévention) et réaliser un dépistage volontaire
dans les bâtiments existants exposés. Si besoin, faire réaliser un diagnostic par un professionnel agréé qui
préconisera des travaux de remédiation pour réduire la concentration de radon [15.9]. Il s’agira générale-
ment d’étanchéifier l’interface sol/bâti (traitement des surfaces et des points de pénétration), d’améliorer le
système de ventilation (équilibrage des flux d’air pour ne pas mettre le bâtiment en dépression et assurer
un bon débit de renouvellement, ou mettre la zone occupée en surpression par une VMC double-flux) et de
traiter le soubassement (mise en dépression du sous-sol ou ventilation par balayage naturel).
[15.9] : Traiter la pollution au radon - source : www.irsn.fr
En exploitation :
Avant la mise en service du bâtiment, vérifier l’état d’empoussiérage des réseaux de ventilation et d’encras-
sage des filtres [15.10]. Et si besoin, dégraisser et nettoyer les gaines et changer les filtres. Sur-ventiler les
locaux avant leur occupation.
[15.10] : Filtre encrassé d’une VMC causant pertes de charge et réduction des débits de renouvellement d’air -
source : Photo eEgénie
Opter pour un mobilier qui ne nuise pas à la qualité de l’air intérieur : bois massif, verre, métal, ... On évitera
le mobilier en bois aggloméré (panneaux de particules) à moins qu’il ne justifie d’un label sans composés
organiques volatils (COV).
78Préférer le nettoyage à la vapeur, qui est plus efficace et moins polluant, bien qu’il augmente la consomma-
tion énergétique. Dans le cas contraire, on optera pour des produits d’entretien justifiant au minimum de
l’Ecolabel européen.
On veillera à toujours rincer les surfaces si l’on choisit d’utiliser des détergents, même si le produit est répu-
té « sans rinçage », on évitera autant que possible les arômes dans les produits d’entretien et on proscrira
ceux de type muscs nitrés et muscs polycycliques.
Organiser la gestion des périodes de pic de pollution extérieure (prise en compte du dispositif d‘alerte pré-
fectoral, activités adaptées dans le cadre scolaire ou d’accueil petite enfance).
Réaliser régulièrement les mesures de qualité de l’air intérieur prescrites par la réglementation, ainsi qu’à
l’occasion de travaux pour ce qui concerne la problématique du radon dans les secteurs sensibles.
Les erreurs à éviter
Négliger dans le choix des matériaux, des revêtements, de la décoration et du mobilier le critère d’émis-
sion de polluants susceptibles de dégrader significativement la qualité de l’air intérieur.
Limiter les débits d’air pour réaliser des économies, au détriment de la santé des occupants.
Par exemple, en choisissant une ventilation simple flux de type « Hygro » (A ou B) : ce type de système
module le flux d’air selon l’hygrométrie des locaux, dépendant de l’occupation, et a été conçu pour limi-
ter les débits et réaliser des économies d’énergie. Les retours d’expérience montrent que les débits ven-
tilés sont faibles et ne permettent pas d’évacuer suffisamment les polluants intérieurs. Les polluants
ne sont pas dégagés uniquement en occupation, et si la ventilation n’est pas adaptée, ils s’accumulent
dans les locaux ! Dans ce cas, il est recommandé d’aérer les pièces 10 minutes chaque matin ou durant
les périodes d’interclasses après avoir pris soin de fermer les vannes thermostatiques des radiateurs.
Ne pas adapter les pratiques d’entretien courant des locaux.
Par exemple, en ne choisissant pas des produits nettoyants à faible impact sur la qualité de l’air inté-
rieur, le bénéfice des efforts faits en termes de conception soignée serait contrecarré par la pollution
régulière des locaux ainsi générée.
Oublier d’entretenir les systèmes de renouvellement d’air (bouches d’aération, gaines de ventilation,
filtres des échangeurs).
Ne pas tenir compte de la présence potentielle de radon dans le bâtiment (gaz radioactif non détec-
table sans recourir à une mesure spécifique).
Pour aller plus loin…
- Site du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rubrique relative à la qualité de l’air intérieur :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur
- Observatoire de la qualité de l’air intérieur : www.oqai.fr
- Site du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) : www.pollens.fr/accueil.php
- Bâtir pour la santé des enfants, Suzanne Déoux, Medieco Editions, 2010, ISBN : 978-99920-1-776-0
- Guide de la pollution de l’air intérieur, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_inpes_pollution_de_l_air_interieur.pdf
- Pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants - Guide pratique, MEDDE, 2017 :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf
- Malette ECOL’AIR - Les outils pour une bonne gestion de la qualité de l’air dans les écoles, Alphéeis, PBC, ADEME, 2018,
ISBN : 9791029710414 : www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ecolair-2018-010490.pdf
- Gestion de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public - Guide pratique, DGS & InVS, 2010 :
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf
- Site d’information Le cartable sain du Conseil départemental de la Gironde :
www.cartable-sain-durable.fr
- Site de la Démarche pluraliste Qualité de l’air intérieur / Radon en Bourgogne Franche-Comté :
www.radon-qai-fcomte.fr
- Site de l’Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), rubrique relative au radon :
www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/Le-radon.aspx
- Site du CSTB sur le radon : http://extranet.cstb.fr/sites/radon
- Guide pour la gestion du risque lié au radon à destination des collectivités territoriales, Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), 2016 : www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/Guides-sur-la-gestion-du-risque-du-radon/
Guide-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon-a-destination-des-collectivites-territoriales
- Boite à outils franco-suisse sur le radon : https://jurad-bat.net/ 79Fiche 16 Rubriques concernées dans l’outil PEQEB :
Construction et Rénovation : 2.3.2 / 2.3.3
Les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire
efficaces : production, distribution, régulation
Objectif
Minimiser les pertes d’énergie liées aux équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire
Pourquoi c’est important ?
La réalisation d’un système de chauffage efficace vient compléter les efforts de conception sur l’enveloppe du
bâtiment.
Les pertes d’énergie liées à la production, à la distribution, à l’émission et à la régulation du chauffage peuvent
représenter de l’ordre de 20 à 25% des consommations totales de chauffage.
Dans le cas d’une production d’eau chaude sanitaire (ECS) centralisée avec un bouclage maintenu en tempé-
rature pour garantir l’absence de développement de bactéries de type Légionnelle, la part représentée par ces
pertes sur les consommations d’ECS peut monter à 60%, voire plus.
La « matière grise » est le principal surcoût à dépenser pour des systèmes réellement efficaces ! En effet, il est
nécessaire de bien réfléchir au choix de systèmes adaptés au projet, sans chercher à tout prix une technologie
de pointe très coûteuse.
Définitions utiles
- Le rendement de production noté η d’un équipement de chauffage désigne le rapport entre la quantité
d’énergie utile (produite par le système) et la consommation d’énergie à l’entrée du système (énergie contenue
dans le combustible).
- Dans le cas d’une pompe à chaleur (PAC), l’efficacité de l’équipement (en mode chauffage) est désignée par le
COefficient de Performance (COP). C’est le rapport entre l’énergie utile (chaleur restituée pour le chauffage) et
l’énergie consommée (électrique) pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Un COP égal à 3 signifie que 3 kWh
d’énergie thermique utile sont restitués en chauffage pour 1 kWh d’énergie électrique consommé. Ce constat
favorable doit néanmoins être mis en relation avec la production d’électricité au niveau national : il faut en effet
brûler 2,58 kWh de combustible fossile (uranium, fioul, gaz, charbon) pour fournir 1 kWh électrique au comp-
teur des consommateurs (valeur admise par convention mais supérieure en réalité).
- Quelques ordres de grandeur de performances des chaudières :
Type de chaudière Rendement de production ƞ
Chaudière fioul ou gaz à haut rendement 90-95%
Chaudière fioul ou gaz à condensation* 101-105%
Chaudières à bois Bois bûches : 60-80%
Plaquettes : 80-90 %
Granulés : > 90%
* Une chaudière à condensation [16.1], en plus d’utiliser l’énergie dégagée lors de la combustion, récupère l’éner-
gie latente de la vapeur d’eau contenue dans les fumées. Ce qui explique son rendement supérieur à 100%. Les
émetteurs de chaleur doivent alors fonctionner à basse température pour permettre une condensation effective
du niveau de la chaudière.
80Vous pouvez aussi lire