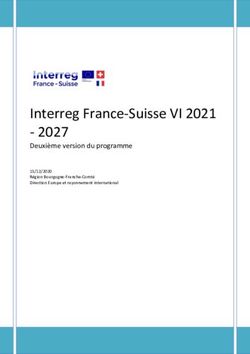SOLID'ACTION 65 hautespyrenees.fr - Schéma des Hautes-Pyrénées solidaires - Département des Hautes-Pyrénées
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
SOLID’ACTION 65
Schéma des Hautes-Pyrénées solidaires
hautespyrenees.fr
SCHÉMA de
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
2017 - 2022Sommaire
5 E ito r i a l :
d oi un Schéma d
pourqu
e D év e loppeme
nt Social ?
6
?
: t Social
m b u le loppeme
n
Préa qu’un Schéma d e D év e
qu’est-ce
9 : p ris ?
p a r t i e s ’y est-on
Premirècrheeet la méthode = co
m m e n t
la déma
15 m e p a r tie : ?
Deuxioèstic = d’où part-on
le diagn
23 i è m e
• Mobilit
p
é
a
/
rtie : és ?
Trois es = quelles prioritoximité
les 5 ax T ra
e / Éduc
n sports /
ation
Pr
ESS
• Jeuness éveloppement /
/D
• Emploi e
iqu nce
• Numér t é / G ouverna
n e
• Citoyen
27 Q a t
u ons
les ac
• Qu
r
e
i
t
l
è
i
le
m e par
t ra duction
tie :
par p
n par a
o
x
l
e
it
s
iq
p
traductio sur les territoires
u
r
e s publiqu
ioritaires
?
?
es ?
• Q u e l le n
traductio
• Quelle
36 i è
• Quelle
m e
Cinquen œuvre
La mise
a
p
r
artie :
t
arte
ic u
n
s autres
la
ar
t
ia t s
chantier
ion avec
le
s?
à établir
?
• Quels p v ernance
?
l le g o u
• Que
40 Conclusi
o n
3Éditorial
PAR MICHEL PÉLIEU ES
ENT DES HAUTES-PYRÉNÉ
PRÉSIDENT DU DÉPARTEM
tre capacité de vivre
Mais pour préserver no
s en plus fragilisée, la dra accompagner le
Dans une société de plu ensemble, il nous fau
nature. A la vulnérabilité its d’un développement
question sociale a changé de développement de ces dro
s’ajoute désormais une ment de l’Etat, des
économique et matérielle de l’engagement. Engage
ve, celle des relations iété civile, mais aussi
vulnérabilité toute aussi gra Collectivités, de la soc
r la solitude, le repli sur nnes concernées elles-
aux autres, qui se traduit pa l’engagement des perso
à apporter doit aller au- vie, dans leur parcours,
soi, l’isolement. La réponse mêmes dans leur projet de
ons, elle doit recréer du
delà de l’attribution d’allocati dans leur environnement.
on : elle doit consolider
lien, du collectif, de la cohési
le vivre-ensemble. sociales ne pourront
Bien-sûr, les politiques
tâche. C’est pourquoi
se décrète pas. Il se assumer seules cette lourde
Mais, le vivre ensemble ne ment social met en
t le concours de chacun ce Schéma de développe
construit. Et il nécessite surtou ces vives, des acteurs
uoi il faut aujourd’hui synergie l’ensemble des for
pour s’épanouir. Voilà pourq s territoires au service
mais aussi des habitants de
iale en l’impliquant à
décloisonner l’action soc de cette ambition.
ues publiques. C’est le
l’ensemble de nos politiq
oppement social. à rassembler, participera
sens de ce Schéma de dével Le Schéma, par sa capacité
notre territoire, d’une
nous d’un dispositif en outre à l’attractivité de
Il ne s’agit pas pour l’aide à l’aménagement
manière certes différente de
n vrai un changement ne manière toute aussi
supplémentaire mais d’u et à l’équipement, mais d’u
collectivité à inventer tribuera à créer un
d’attitude qui invite notre importante parce qu’il con
l’intervention sociale. vivre ici, ensemble et
une nouvelle pratique de cadre propice au désir de
iale ne doit pas être rche s’inscrit dans la
Parce que la politique soc d’entreprendre. Cette déma
veloppement territorial rritoire et témoigne du
la voiture balai du dé continuité du Projet de Te
ceux restés au bord et de mobilisation que
destinée à s’occuper de pouvoir d’entraînement
permettre à chacun, devons avoir.
du chemin. Nous devons nous pouvons et que nous
difficultés, ses fragilités
quelles que soient ses
i…), de trouver sa place nt a la vocation d’être la
collectivité
(l’âge, le handicap, l’emplo collectif Le Dé pa rteme
dans la société et de partic
iper au projet ions, de ces alliances,
qu artier, instigatrice de ces coopérat
: l’im me ub le, le tinuer à faire
quel que soit son niveau rteme nt… à tou s les niveaux. Il doit con
le village, la vallée, le can
ton, le dé pa nges qui favorisent le
vivre les espaces d’écha
Car c’est avant tout leur dro
it. uire des ponts et non
décloisonnement, à constr
pas des murs.
4 5engagée à l’interne depuis guichet. En réalité, son premier
Le Schéma de novembre 2015. but est d’aider chacun, en
Mesurer l’efficacité
de la démarche
développement fonction de ses besoins, à se
En intégrant la solidarité donner une vie autonome et à
social c’est : à toutes ses politiques pu- vivre en société.
La solidarité, en accompagnant
ceux que leurs conditions de vie
bliques, le Département op-
•
La recherche permanente ont fragilisés, crée aussi du bien-
timise son investissement
d’un impact social maximal Mobiliser tout le territoire être, du dynamisme et de la ri-
social sur le territoire. Il privi- chesse économique sur le terri-
de toutes les politiques pu-
légie une logique de partena- toire. Le Département a choisi
bliques locales (partenariat Fidèle à sa démarche habituelle
riat à une logique de guichet. de mesurer cette valeur ajoutée
entre services) ; d’associer le plus possible d’or-
ganismes publics et associatifs sociétale, sa capacité à bonifier
Le Département est donc le chef l’argent qu’il dépense sur les
•
La coordination renforcée et d’acteurs économiques à ses
de file de la solidarité sur son Hautes-Pyrénées, son aptitude
entre acteurs publics et pri- politiques en faisant abstraction
territoire. De la petite enfance à infléchir son action en fonction
Préambule : vés de l’économie et de la
solidarité (partenariat entre à la dépendance du grand âge, de toute appartenance parti-
des indicateurs.
il accompagne toute la vie des sane, le Département a voté
Définition du Schéma de Développement Social acteurs du territoire) ; Il a acquis Biom, un outil de
haut-pyrénéens. Ses services lors de sa séance du 21 juin
calcul qui mesure en euros, à
maillent tout le territoire : ils 2016 le principe de l’élaboration partir d’un examen comptable
Prévu par la Loi du 27 janvier 2014, le Schéma de dévelop- • La solidarité comme investis-
pement social est la traduction du rôle de « chef de file » de sont proches de chacun, per- du Schéma à l’unanimité. quantitatif et qualitatif des
sement collectif de proximité
l’action sociale, du développement social, et de l’autonomie. sur les projets personnels et la sonne n’est jamais loin d’eux. comptes et des pratiques, ce
En résumé, la loi donne aux Départements le rôle de coor- cohésion sociale (partenariat Comme le Projet de Territoire, que le Schéma apportera au ter-
donner l’action de tous les acteurs (Etat, Régions, Métropoles, entre acteurs et individus). L’organisation de la solidarité a le Schéma de développement ritoire en termes d’emplois, de
Intercommunalités, Communes, Associations, Professionnels) été longtemps trop cloisonnée : social a été bâti en concertation services publics et de préserva-
autour d’objectifs communs visant à redonner à chaque pu- un problème - une aide - un avec plus de 200 partenaires. tion de l’environnement.
blic fragile une dignité, une place équitable dans la société, un Dans un contexte socio-éco-
parcours apte à l’intégrer au mieux dans son quartier ou son nomique complexe et de fi-
village. nances publiques contraintes,
Le Décret N° 2017-877 sur 6 mai 2017 précise par ailleurs la le Département, au lieu de
définition du travail social de manière officielle. diminuer par fatalité son ap-
pui aux solidarités, a choisi
Ces démarches de développement social s’appuient sur d’initier une réflexion desti-
quelques fondamentaux essentiels à la solidarité au quotidien née à inscrire l’action sociale
pour tous et dans tous les territoires : au cœur de l’ensemble de ses
• Une valorisation des capacités de chaque personne et la re- politiques. Le fruit de ces ré-
connaissance de sa dignité et de ses droits d’accès à toutes flexions conduit le Départe-
les facettes de la vie en société (habitat, mobilité, santé, tra- ment à avoir aujourd’hui l’am-
vail, vie culturelle) ; bition d’intégrer des objectifs
• Le positionnement de la personne au centre de l’action qui de développement social à
la concerne, plutôt que l’obliger à réaliser un « parcours du tous les projets départemen-
combattant » pour obtenir ses droits fondamentaux ; taux et à toutes les politiques
• L’inscription de chacun dans une logique de parcours indivi- publiques.
duel facilité par un accompagnement adapté ;
• La redynamisation des solidarités de proximité au service de C’est une initiative innovante
la Solidarité et de la Fraternité ; et une volonté politique forte
• La mobilisation de toutes les politiques publiques et de tous qui visent à réinventer l’action
les acteurs au service de l’inclusion la plus forte possible de sociale parce que la solidarité
chaque personne, personne âgée ou handicapée, personne ne doit pas être cantonnée
à la recherche d’emploi, jeune enfant ou enfant en difficulté, à un pan de compétences
familles en grandes difficultés… mais doit être la finalité des
missions du Département.
Le Département est au cœur des solidarités. La redistribution La rédaction d’un Schéma
des allocations profite aux bénéficiaires comme à tout le terri- de développement social
toire. Elle crée du lien social, suscite de nouveaux métiers, par- s’impose donc pour traduire
ticipe à la croissance économique. cette volonté.
La démarche s’inscrit dans
la poursuite de la méthode
6 participative et transversale
7La démarchee
et la méthod
dynamique
Une démarche innovante et
de développement
et
tiraillé entre contraintes
Au cœur d’un contexte un Sch ém a
décidé d’engager
projets, le Département a Bie n au -
oppement social.
départemental de dével ob liga tio ns
on des nouvelles
delà de la stricte applicati
mb lée conçu comme un outil
légales, ce schéma est d’e er
portunité pour accompagn
de développement, une op et loc ale s
s départementales
et démultiplier les initiative
jets.
de développement de pro
que
ité de traitement de cha
C’est une ambition d’égal à l’œ uvr e.
e territoire qui est
habitant-usager et de chaqu
e
engager à cette occasion un
Le Département a souhaité rs tan t po ur
puyée sur les acteu
démarche dynamique, ap des
on que pour l’élaboration
le diagnostic de la situati diffi cul tés
pas de gommer les
pistes d’action. Il ne s’agit ipa tif tou t
gnostic a été partic
bien au contraire. Le dia e les ha uts -
jectif. Parce qu
autant que sincère et ob at com me
les services de l’Et
pyrénéens, leurs élus et
t bie n que c’est de l’avenir du
du Département saven de
. C’est pourquoi l’ancrage
département dont il s’agit ire gar an tit
vives du territo
la démarche sur les forces
une démarche réaliste.
8 9Une démarche intégrée Une approche
élus/services/consultant sur mesure
Les élus du Département, tous les élus, ont C’est une approche sur mesure que le
été associés à l’élaboration progressive de ce Département a exprimé de ses vœux. Une
Schéma, notamment pas plusieurs séminaires approche tenant compte respectueusement
spécifiques sur le sujet. Les services du de tout le travail engagé et de toutes les
Département ont engagé un lourd travail d’état compétences en présence. Une approche
des lieux à partir de leurs propres données, privilégiant la co-construction avec ceux qui sont
extrêmement riches et variées. Ils l’ont complété les initiateurs de la démarche et qui en sont les
en poursuivant et reconfigurant les groupes garants ultérieurs de la pérennité : services de
internes au sein de la Direction de la Solidarité l’Etat, du Département, élus départementaux,
Départementale. Plus largement, la Direction structures intercommunales, tant sur le
Générale elle-même s’est impliquée fortement plan politique qu’administratif, porteurs de
dans l’animation de séminaires de toutes les projets, acteurs privés porteurs de services
directions, garantissant la transversalité du indispensables aux habitants, et habitants eux-
Schéma. Le travail du consultant a ainsi été mêmes, qui ont été appelés à se prononcer sur
grandement facilité par cette démarche intégrée, ce projet.
garante de pérennité.
Une démarche participative Un schéma ancré dans une démarche progressive
Chacun a été associé, mobilisé, appelé à s’exprimer dans le respect des différences et des avis
de longue date
éventuellement divergents. Le schéma final s’est ainsi appuyé sur la réalité des initiatives locales ou des Dès 2012, et avant même que le Département ne soit donc identifié par la loi comme chef de file du
projets formulés par les acteurs locaux pour l’avenir. C’est d’ailleurs au travers de ces projets locaux développement social, les équipes sociales des Hautes-Pyrénées approfondissent le texte co-signé
que le schéma trouvera toutes ses chances de vivre et de se pérenniser : la combinaison des projets et par 34 directeurs généraux de services départementaux sur la question du développement social.
l’intelligence collective sont un gage plus efficace que tout dispositif technique de contrôle pour garantir Ce texte rencontre les aspirations fortes des équipes à une autre prise en compte du social dans les
l’efficience et la pérennité du développement social dans les Hautes Pyrénées. stratégies départementales. Une occasion de redonner le sens recherché par l’équipe de direction
et les travailleurs sociaux dans une action quotidienne de plus en plus soumise à la contrainte et au
nombre croissant de sollicitations.
Une démarche source de développement La Direction de la Solidarité Départementale s’engage alors dans un travail de rénovation du travail
social avec un certain nombre de chantiers internes sur les thématiques les plus déterminantes
Enfin, l’ambition affichée par quels moyens ? en articulation développement social ainsi pour l’avenir de l’action sociale. En 2015, elles expriment à la Direction Générale et à l’exécutif le
le Département dépasse la avec quels acteurs ? en mobi- engagées seront l’occasion à besoin d’un élargissement à toute la collectivité puis à tous les partenaires de cette préoccupation
stricte mise en œuvre légale de lisant quelles ressources lo- chaque fois de l’émergence du développement social. C’est ainsi que la démarche lancée fin 2015, conduira à l’élaboration pro-
ses compétences. Il s’agit bien cales,… ? d’une nouvelle initiative de gressive, collégiale et partenariale de ce Schéma de développement social.
entendu d’abord et avant tout développement. Avec toutes
d’une approche de mise en œuvre C’est tout l’enjeu de ce Schéma. leurs retombées induites. Et Le Département a voulu prendre le temps de la maturation interne puis de l’association large des
politique et professionnelle Bien entendu, assurer sa mission en veillant à leur ancrage local, partenaires et usagers. C’est pourquoi il a d’abord orchestré un travail en amont depuis décembre
des nombreuses compétences première d’accompagnement notamment en s’appuyant sur 2015. Grâce à une forte mobilisation des services et de tous les élus autour de la dynamique lancée
légales du Département dans le et de soutien aux personnes les capacités et le dynamisme par la Présidente de la Commission Solidarités Sociales avec l’appui de la Direction de la Solidarité
domaine des solidarités. concernées par les politiques des acteurs locaux et notamment Départementale, un certain nombre d’objectifs ciblés ont été dégagés pour intégrer des objectifs de
sociales : petite enfance, enfance des personnes concernées solidarité à toutes les politiques publiques.
Mais au-delà d’une approche en danger, personnes âgées appelées à retrouver un pouvoir
exclusivement légale et tech- ou handicapées, personnes en d’agir sur leur propre parcours C’était une première étape essentielle. Il s’agissait ensuite d’inscrire dans le temps et de démultiplier
nique, il s’agit de faire de chaque insertion, familles fragilisées. individuel. ces objectifs, au travers d’un plan d’actions pour cinq années, de 2017 à 2021 compris, véritable
manque ou insuffisance repérés Mais au travers des actions qu’il marqueur de la volonté politique de ne laisser personne au bord du chemin dans les ambitions de
une opportunité de développe- générera, c’est une nouvelle développement que le Département porte pour les Hautes-Pyrénées.
ment : qui sera en mesure de impulsion de développement
combler ce manque ou cette local et départemental qui est
insuffisance ? comment ? avec attendue. Les démarches de
10 11Pour parvenir à cet ambitieux objectif, il a été convenu : L’approche territoriale
• d’approfondir les axes et la concertation ; La stratégie de développement social n’a de sens et d’effectivité que si elle s’articule étroitement avec
les stratégies de développement territorial. C’est pourquoi son élaboration s’est fortement appuyée,
• de décliner les axes retenus en programme d’actions ;
d’une part sur les conseillers départementaux, tous les conseillers départementaux, qui connaissent
• de proposer une répartition des rôles permettant l’opérationnalité du schéma ; particulièrement bien les territoires sur lesquels ils ont été élus, et sur une concertation approfondie
avec tous les acteurs du territoire.
• de mobiliser tous les acteurs sociaux ou non, et les habitants pour co-construire chacun des axes du
schéma ;
On ne le dira jamais assez : c’est dans l’alchimie de l’invention quotidienne au plus près des habitants que
• de vérifier et favoriser les articulations avec tous les acteurs possibles des objectifs du développement les objectifs de solidarité peuvent trouver leur pleine intégration aux autres objectifs de développement
social. local, rural comme urbain.
Cette concertation a abouti à une première identification d’actions très concrètes, territoire par territoire,
que nous décrivons plus loin. Bien au-delà d’une simple exemplarité, il s’agit d’encourager l’invention
permanente d’un nouveau mode de lien social dans les territoires, associant le plus harmonieusement
possible les objectifs légitimes de développement économique et de respect de l’environnement à ceux
tout aussi essentiels de la dignité individuelle et du développement humain.
Phase 1 Le choix des grands axes du Schéma
• Séminaire de direction générale élargie
La mise en œuvre du Schéma s’appuiera donc de la même manière sur la combinaison entre objectifs
et projets de développement territorial d’une part, entre objectifs de développement social et parcours
• Séminaire des élus, tous groupes confondus individuels d’intégration des personnes concernées d’autre part.
• Délibération décidant le lancement de l’élaboration du Schéma départe-
mental de développement Social : juin 2016
L’approche de la participation des personnes concernées
Phase 2 L’approfondissement des axes et la concertation
• préparation de la phase de concertation
La marque spécifique de fabrique de ce Schéma de développement social consiste à considérer
chaque personne concernée comme un habitant à part entière de son territoire, et plus encore,
comme un citoyen à part entière. Quelles que soient les difficultés de la vie, grand âge, handicaps,
• Travail en interne sur chacun des axes retenus du Schéma
• Concertation avec les partenaires pertes d’autonomies diverses, recherche durable d’emploi, enfance fragilisée, situation sociale d’ex-
• Reprise en interne des propositions des partenaires et co-construction clusion, toute femme, tout homme, tout enfant, dispose d’un droit imprescriptible et intégral à la
de chacun des axes du projet dignité, à la considération, à la bienveillance.
Ce respect passe notamment par la conviction que chacun doit être jugé digne, dans la mesure de
ses capacités, de décider de son propre parcours, d’exprimer son propre projet de vie, de jouer un
rôle dans son environnement et plus largement dans la société dont il fait partie. La voie est étroite
Phase 3 L’écriture et la validation du Schéma
• Écriture des grandes lignes du Schéma
et semée d’obstacles, tant les représentations sont fortes, les « modèles » tenaces. Seul compte le
modèle républicain : « Chacun contribuera à la chose publique en fonction de ses capacités contri-
butives » nous rappelle en substance la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Cette
• Séminaire de direction générale élargie ambition vise les citoyens, tous les citoyens. Faire le pari de la capacité individuelle et de la com-
• Séminaire d’élus
pétence de chacun comme de la cellule familiale ne relève pas de l’utopie mais simplement de la
• Vote du Schéma : juin 2017
devise républicaine.
Le schéma de développement social intégrera ainsi au maximum toutes les personnes concernées
aux projets individuels et collectifs qui les concernent.
12 13Chiffres cl é s Le diagnostic
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES L’action sociale en chiffres ente 64% des dépenses
de
470 communes tio n soc iale s’é tab lit à 180,4 M d’€ et représ
s de l’ac
17 cantons L’ensemble des dépense
en t du bu dg et du Département.
8 communautés de fonctionnem
communes Montant total
1 communauté Bénéficiaires (CA 2016)
rti tio n de s pri nc ipa les dépenses
d’agglomérations Répa 81.3 M €
15 000
lles de sol ida rité
Les 3 allocations individue 8790
43,2 M €
DENSITÉ APA : allocation personnalis
ée d’autonomi e
7,6 M €
841
DE POPULATION PCH : prestation de compe
nsa tio n du ha nd ica p
34 M €
5441 foyers
51,2 habitants/km2 1,5 M €
(insee) Insertion 2675 foyers
SUPERFICIE Logement
40,3 M €
1500
TOTALE Aide Sociale Hébergement
ation de handicap)
(personnes âgées et en situ
4 464 km2 HABITANTS Aide sociale enfance et 25 M €
(insee) ter ne lle et Inf an tile
DE PLUS DE 60 ANS Enfance Protection Ma
1 habitant sur 3 le domaine des
llen t au plu s prè s de s haut-pyrénéens dans
(insee 2016)
partementaux travai
Plus de 700 agents dé
solidarités.
HABITANTS
DE MOINS DE 20 ANS Les retombées
t le devenir des
im po rta nts con cer nent d’abord et avant tou
1 sur 5 de ces engagem en ts la qualification
Les premières retombées pa rle r ici d’in ves tiss ement humain : loin de
(insee 2016)
On peut assuréme nt s concitoyens les
personnes elles-mêmes. eu ro en gag é pour le soutien de no
POPULATION comptable de dépenses
de fonctionnemen t, cha qu e
de no s agents, constitue une vér
itable dépense
pro fes sio nn el l’investissement
TOTALE compagnement cernées. Et à travers elles,
plus fragiles et avec l’ac de vie de s pe rso nn es con
ir et sur la qualité
d’investissement sur l’aven ne.
228 567 habitants s de la société haut-pyrénéen
pour un véritable progrè
(insee - 01/01/2016) emplois à temps
soc iale s du Co nse il dé pa rtemental génèrent 4 100
que, les dépenses
Sur un plan plus économi
s en Hautes-Pyrénées, dont :
plein non-délocalisable
nnes âgées : 2 524
• hébergement des perso
• aides à domicile : 1 202
• accueil familial : 219
de la situ at io n so ci ale dans le département
Diagnostics croisés schémas ou nts documents,
réa lisé s au travers des différe lle
De nombreux éléments
de dia gn ost ic on t été la situation sociale à laque
ici qu elq ue s ext rai ts qu i éclairent le diagnostic de
citons
contrats récents. Nous en
on dre le Sch ém a de développement social.
souhaite rép
14 15un appui dans l’accès à la formation, à l’emploi, à lité socio-culturelle de certains services (vocabulaire
Extraits du diagnostic du Schéma Départemental l’orientation vers des établissements et services, et administratif, barrière linguistique,…).
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public facilite les démarches des personnes handicapées
et de leur famille.
Ces MDS disposent d’accueils permanents et pro-
posent également des entretiens sociaux et/ou
(SDAASP 2016) nfin, concernant le public précaire, une offre
•E PMI sur rendez-vous, dans des points d’accueil ou
d’hébergement d’urgence permet d’accueillir les des centres médico-sociaux, permettant ainsi d’ac-
Le diagnostic de l’accessibilité des services sociaux aboutit au constat d’un secteur en mutation. plus démunis, notamment à Tarbes et Lourdes. Des cueillir le public et d’assurer un service de proximité.
La majorité des services sociaux sont concentrés dans l’agglomération tarbaise (CARSAT, CPAM, MSA, places complémentaires sont ouvertes en période Selon le Schéma départemental des services aux fa-
centres d’accueil…). Il existe également des permanences dans le reste du département, hétérogènes hivernale. Les dossiers en matière de prévention milles (2016-2019), plus de 27000 entretiens indivi-
selon les opérateurs et les services qu’ils rendent : Lannemezan, Trie-sur-Baïse, Lourdes, Vic-en-Bigorre, Ba- d’expulsion locative sont gérés dans les sous-pré- duels ont été réalisés par les professionnels des Mai-
gnères-de-Bigorre,… fectures et les questions de droit au logement op- sons Départementales de la Solidarité. 20% de ces
Comme pour d’autres services, la coopération avec des territoires limitrophes est aussi un enjeu important posable par la commission DALO de Tarbes. On ne entretiens concernent les questions liées à l’enfance
pour les services sociaux du Département, qui peuvent être sollicités par des usagers des départements voi- relève pas de déficit majeur sur ces services, suffi- et l’éducation.
sins. Après leur avoir donné un premier niveau d’information, ils orientent si nécessaire ces usagers vers les samment organisés sur le département. Par ailleurs, les travailleurs sociaux des MDS effec-
services du département qui peuvent traiter leur demande ou leur dossier de manière complète. tuent des visites à domicile dans les communes du
Les principales évolutions observées ou envisagées chez les opérateurs de services sociaux se rattachent à : Le niveau de présence territoriale de certains Département (219 communes concernées en 2014
• La promotion de l’accès internet aux services offerts ; opérateurs de services sociaux est disparate sur sur les 472 que compte le Département).
• l’accompagnement à l’utilisation des téléservices ; le département. En particulier, les territoires du Enfin, depuis 2011, des téléguichets sont installés
• le développement de l’accueil sur rendez-vous ; sud du département, en zone de montagne, sont sur le département des Hautes-Pyrénées, dans le
• la participation à des points mutualisés de services, notamment des Maisons de Services au Public (MSAP). éloignés de nombreux services sociaux (CAF, CPAM, cadre d’un réseau mis en place par le Conseil Régio-
MSA,…). Sur ces territoires, la saisonnalité des acti- nal. Les objectifs de ce réseau sont de simplifier les
Avec le développement de l’offre de services numé- domicile aux personnes âgées; c’est le cas en par- vités et les variations de population sont un frein à démarches administratives et permettre le dialogue
riques et la réduction des plages horaires pour l’ac- ticulier de l’ADMR et de Pyrène Plus qui couvrent l’ouverture à l’année de permanences ou sites pour avec les agents du service public à distance.
cueil sans rendez-vous, la question se pose de l’ac- chaque canton. certains opérateurs de services sociaux, en raison du Les téléguichets reliés via Internet sont installés
cès aux droits pour les personnes en difficultés. rapport coût/activité des sites pour les partenaires. d’une part dans les antennes ou agences des orga-
Le rôle joué par les Maisons Départementales de So- • c oncernant l’offre en capacité d’accueil des enfants Par ailleurs, d’autres territoires du département sont nismes fournisseurs de services au public, dans les-
lidarité (MDS) est particulièrement important dans ce de moins de 6 ans, le Schéma départemental de touchés par l’éloignement de certains opérateurs quels des agents sont présents et peuvent assurer
contexte en complément des initiatives et réflexions services aux familles (2016-2019) indique que les de services sociaux (pointe nord, est,…). Les usagers des rendez-vous à distance, et d’autre part dans des
menées par les opérateurs. Les Centres Commu- deux modes de garde permanents agréés (crèche de ces services sont obligés de se tourner vers les lieux d’accueil mis en place par des collectivités lo-
naux d’Action Sociale (CCAS) sont aussi des relais et assistante maternelle) assurent une couverture guichets à Tarbes ou, en cas d’empêchement, se cales, dans lesquels les usagers se déplacent. Les
importants sur le territoire et des lieux ressources théorique des besoins classiques à l’équilibre pour tournent vers des services de proximité (souvent les bornes interactives permettent de simuler un entre-
de proximité. Autre acteur clef du département, les les familles actives du département (107,92%), MDS et CCAS, voire des associations caritatives) qui tien présentiel (avec ou sans rendez-vous), en ayant
Centres Locaux d’Information et de Coordination confortée par le recours au congé parental (20%). aident les personnes à rentrer en contact avec ces la possibilité d’échanger des documents entre un
(CLIC) permettent notamment aux personnes âgées Néanmoins, il signale des déséquilibres territo- services. Un autre enjeu lié à la saisonnalité touris- usager et un service public grâce à un scanner et une
de disposer d’une aide pour l’accès à leurs droits. riaux qui concernent le pays des Coteaux et le Val tique concerne les difficultés d’hébergement pour imprimante.
d’Adour. les travailleurs saisonniers, qui ont notamment re-
Concernant les services sociaux dédiés aux publics cours à l’hébergement social. Il existe 2 Points Visio Public implantés sur le dé-
spécifiques (personnes âgées, personnes handica- Des projets sont à l’étude actuellement sur ces deux partement en partenariat avec les Communautés de
pées, petite enfance), les schémas départementaux territoires, en conformité avec l’objectif public de En matière de services aux personnes âgées, les bas- communes :
et données INSEE fournissent des indications sur rééquilibrage territorial. sins gérontologiques de l’agglomération tarbaise • 1 à Trie-sur-Baïse ;
l’offre existante sur le département et ses limites : et du Haut-Adour sont les territoires les moins • 1 à Luz-Saint-Sauveur, mis en place en juillet 2011.
•selon le Schéma départemental gérontologique Les principaux équipements et services pour
• bien équipés du département avec en conséquence
2012-2016, le taux d’équipement en places d’hé- enfants et adultes handicapés sont situés à un manque de lits pour personnes âgées sur l’axe Les services accessibles aux usagers via ce disposi-
bergement pour personnes âgées en Hautes-Py- proximité de Tarbes, Lourdes, Lannemezan et Tarbes-Bagnères. tif incluent la CAF, la CPAM, la Banque de France, la
rénées est inférieur à la moyenne nationale et Maubourguet. La population concernée se situe MSA, Pôle Emploi, la CARSAT, les missions locales et
régionale (3232 places en 2011 pour le départe- principalement en milieu urbain, notamment à Les MDS jouent un rôle structurant important le Conseil départemental d’accès au droit.
ment). Ce schéma va être remplacé par le Schéma Tarbes. Le redéploiement de places d’hébergement dans l’accessibilité des services au public. Ouvertes Un premier regard sur ce dispositif permet de no-
départemental de l’autonomie, qui est en cours situées en zone rurale vers Tarbes est d’ailleurs à à tous, elles accueillent notamment des publics ter qu’il a connu des dysfonctionnements techniques
d’élaboration. Des données plus actuelles (INSEE l’étude, pour répondre aux besoins identifiés dans confrontés à des difficultés. Leurs équipes de pro- (perte de connexion du fait de la relocalisation de
2012) indiquent un taux d’équipement plus bas, du l’agglomération. Le Schéma Départemental des fessionnels et travailleurs médico-sociaux les infor- bornes chez les opérateurs,…) et fait face à des dif-
fait du vieillissement de la population départe- Personnes en situation de Handicap indique en ment et conseillent sur une variété de sujets incluant ficultés d’ordre budgétaire. Il constitue néanmoins
mentale. Le taux d’équipement régional a suivi la effet des difficultés à trouver une place d’héber- la gestion du budget, le logement, l’insertion, l’édu- une initiative accueillie positivement par les opéra-
même tendance à la baisse. Cette baisse apparait gement pour les personnes adultes handicapées cation, la garde d’enfants, la prévention santé, l’accès teurs (MSA,…), avec des sollicitations nombreuses
problématique au regard de l’augmentation du dans les Hautes-Pyrénées, bien que le taux d’équi- aux soins, les formalités administratives. pour certains d’entre eux (Pôle Emploi, CARSAT).
nombre de personnes âgées sur le département, pement soit supérieur à la moyenne nationale. Sur Dans un contexte de dématérialisation croissante
qui devrait se poursuivre. Notons en revanche que le département, la Maison Départementale des des services, les MDS permettent une assistance et
les organismes d’aide à domicile sont présents sur Personnes Handicapées (MDPH) réalise une éva- un contact humain pour les démarches en ligne.
tout le territoire et offrent une palette de services à luation globale de la situation du handicap, propose Elles contribuent à répondre à l’enjeu de l’accessibi-
16 17Synthèse du diagnostic SDAASP pour la partie sociale Extraits du diagnostic du Contrat de Ville du Grand Tarbes
Les analyses sur les services sociaux conduites au niveau départemental et infra-départemental mettent en
(2015)
évidence plusieurs points forts, notamment l’importance du réseau d’acteurs présents sur le département
Tarbes et son agglomération ont longtemps été considérées comme un territoire parmi les villes moyennes
(MDS, CCAS, CLIC, organismes d’aide à domicile, MDPH,…), la bonne organisation des services d’hébergement
de Midi-Pyrénées de par leur caractère industriel reconnu et leur éloignement géographique de Toulouse.
d’urgence, la mise en place de téléguichets,…
Cette situation les a préservées de l’influence métropolitaine de Toulouse.
Depuis quelques années, l’agglomération tarbaise tend à se rapprocher du profil type des villes moyennes.
Elles soulignent par ailleurs :
Elle axe son développement économique principalement sur le domaine du tertiaire et des services ; elle
- l’enjeu de l’accompagnement des personnes en difficultés pour permettre leur accès à certains opéra-
s’appuie sur le pôle universitaire qui compte aujourd’hui plus de 5 000 étudiants pour
teurs de services sociaux, ces publics étant prioritairement concernés par les services sociaux mais aussi
développer la recherche et l’innovation.
les moins en capacité (physique, matérielle, financière, socio-culturelle,…) de s’adapter aux évolutions que
connaissent ces services, y compris le développement des téléprocédures.
Ville de culture ouvrière au passé militaire, Tarbes subit encore les conséquences des mutations industrielles
- des déficits en termes d’équipements et services pour les publics spécifiques :
(fermeture d’établissements industriels importants de production comme Hugues Tool, ou le GIAT en 2006).
• personnes âgées (dans les bassins de Tarbes et de Bagnères-de-Bigorre),
La perte d’attractivité économique liée à la disparition des grands pôles industriels
• personnes handicapées (dans l’agglomération tarbaise),
n’est pas compensée par le secteur des PME, malgré son dynamisme. Bien qu’en constante augmentation
• petite enfance (pays des Coteaux et Val d’Adour–réflexions en cours sur l’implantation de micro-crèches),
au niveau de l’aire urbaine (+0,2 % entre 2006 et 2011), la population désaffecte la ville de Tarbes (42 000
• travailleurs saisonniers.
habitants) depuis 30 ans (- 8 000 habitants soit une évolution annuelle de -0,7 %) et s’installe à la périphérie
entraînant une périurbanisation très marquée.
Concernant les places d’hébergement pour
personnes âgées, l’appel à projet pour l’ou-
La population tarbaise vieillit : 28 % des personnes sentent que 24% du parc locatif.
verture d’un EHPAD a été lancé en 2016, et
ont plus de 60 ans et la part des +75 ans augmente L’inadéquation entre la taille des ménages tarbais et
le début des travaux devraient intervenir
significativement (13 % de la population tarbaise la taille des logements accentue encore les tensions
en 2017, ce qui permettra de créer de nou-
contre 8,5 % sur le département). budgétaires liées au coût du logement. On note une
velles places d’accueil.
La part des très jeunes (0-14 ans) est en baisse forte augmentation des situations d’impayés de
- un éloignement de certains territoires
constante tout comme celle des jeunes ménages. loyer, de charges et surtout des factures d’énergie. »
(sud du département, pointe nord, est,…)
Tarbes se positionne parmi les cinq communes fran- Tarbes concentre 30 % des logements sociaux de
de certains opérateurs de services sociaux.
çaises appartenant à la même strate démographique l’agglomération tarbaise, soit 6 600 logements répar-
- la nécessité d’être présent dans les es-
ayant un nombre de personnes par ménage aussi tis principalement sur les trois quartiers prioritaires
paces mutualisés (participation à des
faible. Ces éléments témoignent donc d’un vieillis- retenus dans la nouvelle géographie prioritaire de
MSAP ou présence dans les locaux de par-
sement accéléré de la population, mais aussi d’une la politique de la ville : Tarbes Nord, Tarbes Ouest,
tenaires départementaux ou intercommu-
sous-représentation des familles avec enfants. Tarbes Est.
naux, sur leur invitation) et de mettre en
Au niveau des mouvements migratoires, on note que
place une vraie synergie avec l’ensemble
Tarbes est attractive pour les jeunes qui viennent S’y ajoute le quartier « en veille active » des Cèdres/Ar-
des acteurs.
suivre une formation après le bac. Mais elle attire reous/Courreous sur la commune d’Aureilhan : avec
- la coopération avec les départements
également des personnes seules (notamment les bé- environ 550 habitants, les différents indicateurs de
limitrophes pour faciliter l’accès aux ser-
néficiaires de minima sociaux) et les familles mono- précarité amènent à maintenir une veille et à ac-
vices et la prise en compte de la demande
parentales. On observe une augmentation de 15 % compagner ce quartier en pleine évolution :
/ du besoin – notamment pour les per-
du nombre de mono-parents entre 1999 et 2007 :
sonnes résidant dans les intercommuna-
la ville concentre 75% des familles monoparentales •U n revenu fiscal de 10 632 € par an, en deçà du
lités regroupant des communes de deux
du Grand Tarbes (alors que 55 % des familles de ce seuil de bas revenus ;
départements.
territoire y habitent). • Un taux élevé de familles monoparentales (24 %) ;
En outre, comme un grand nombre de villes, la ville • L’indicateur de jeunesse le plus élevé (2.37) après
est confrontée à une augmentation du chômage. celui de Solazur (3.84) ;
En effet, la population active de la commune est en • 47 % de ménages isolés (32 % sur la ville d’Aureil-
baisse (65 % en 2011 contre 68 % en 2006). han) ;
Le revenu médian est faible (15 900€ pour 17 200€ • 26 % de personnes inactives chez les plus de 25 ans,
pour le département). Les personnes isolées (per- 52 % chez les 16 / 25 ans.
sonnes vivant seules et monoparents) sont plus ex-
posées que les autres à la pauvreté : 7 familles mo-
noparentales sur 10 sont en dessous du seuil de bas
revenus.
En termes de logements, l’offre ne correspond pas
complètement aux besoins d’une partie de la popu-
lation, tant quantitativement que qualitativement. En
effet, 8 ménages sur 10 sont des familles de deux
personnes ou moins tandis que les T1 /T2 ne repré-
18 19Extraits du diagnostic du Contrat de Ville de Lourdes (2015) Extraits du diagnostic du Contrat Régional Unique
« Bien que son territoire bénéficie d’une renommée internationale générée par le tourisme cultuel, l’attracti-
Coteaux/Nestes
vité résidentielle permanente de la ville de Lourdes décline progressivement et certains quartiers se paupé-
Si la densité démographique est très faible (25 hab/km²), au regard des moyennes départementales et ré-
risent. Lourdes est la 2ème ville des Hautes-Pyrénées. La commune ne connaît pas une nette augmentation
gionales, sa population connaît une légère croissance, notamment grâce au solde migratoire qui traduit une
de sa population contrairement aux villes voisines. Après avoir stagné depuis 1999, sa population augmente
certaine attractivité du territoire. Elle est hétérogène avec un territoire globalement rural. Moins de 17 % de
en effet légèrement (+0,2 %/an), essentiellement dû au solde migratoire. Lourdes est par ailleurs une ville
la population vit dans des zones à dominante urbaine. Elle est plus importante sur 4 zones : au nord-est avec
avec un revenu médian modeste (16 300 €/ unité de consommation) qui reste bien en deçà du niveau dé-
une influence de l’agglomération tarbaise, autour de l’agglomération de Lannemezan, de la zone urbaine
partemental (18 400 €) ou régional (19 300€). C’est également la porte d’entrée des vallées des Gaves
d’Arreau-Saint-Lary et de Loures-Barousse. Ces 4 zones concentrent une part importante des emplois et des
permettant d’accéder par la rocade de Lourdes au plus important ensemble touristique du massif pyrénéen
services.
(Cirque de Gavarnie, Cauterets/Pont d’Espagne, Col du Tourmalet/Pic du midi de Bigorre, Parc National des
Comme dans de nombreux secteurs, entre 1990 et 2012, le poids des classes d’âges inférieurs à 40 ans a glo-
Pyrénées, six stations de ski) qui totalise près de 6 millions de nuitées annuelles.
balement diminué sur l’ensemble du territoire alors que celui des personnes âgées d’au moins 40 ans a net-
tement progressé. Ainsi, son indice de vieillissement croit ces dernières années. De plus, le nombre d’inactifs
Autre caractéristique forte, sa spécificité cultuelle d’un vieillissement accéléré de la population. On
a augmenté entre 1990 et 2012. En particulier, le nombre de retraités s’est accru de presque 4300 personnes.
a façonné son développement spatial, économique note également une augmentation du nombre de
Le territoire compte près de 15500 retraités en 2012, soit 31% de sa population contre 24% en 1990.
et social. L’hôtellerie, la restauration et le commerce familles monoparentales, composées souvent de
d’objets de piété sont un secteur économique impor- femmes au foyer qui n’arrivent pas à travailler faute
tant de la ville. 3500 saisonniers y travaillent, dont d’une formation suffisante. Lourdes dispose de 8
environ 80 % résident à l’année sur Lourdes. La ville 800 logements en 2009 (dont 3600 en location)
de Lourdes compte le 2ème parc hôtelier de France. En alors que la commune en comptait 7700 en 1999, Extraits du diagnostic du Contrat Régional Unique
2013, la ville a reçu 643 000 pèlerins qui ont généré
2 159 000 nuitées dans les hôtels de la ville. 650 000
soit une augmentation annuelle de 1,4 % pour un
besoin réel annuel de 0,9 %. Ainsi, depuis 1990, la
Plaines et Vallées de Bigorre
nuitées ont toutefois été perdues entre 2009 et 2014. vacance de logements ne cesse d’augmenter (+ C’est un territoire attractif enregistrant une augmentation de sa population de 4 % entre 1999 et 2011,
Le secteur du tourisme est un employeur important 45 % entre 1990 et 2009). Ils représentent 12,2 % du notamment grâce à l’arrivée de nouveaux ménages. Toutefois, cette attractivité est à nuancer selon les com-
mais la majorité des emplois reste peu qualifiée, ce parc total de logements en 2009 contre 10.1 % pour munes, certaines d’entre elles ont en effet enregistré une baisse de leur population sur la même période.
qui se traduit par une surreprésentation des em- le département. Comme les cinq principales villes du En effet, sur le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves la population a diminué pour revenir à son niveau
ployés et ouvriers (32%) par rapport aux références département, ces logements vacants sont plus parti- de 1999 avec des situations contrastées ; ce sont en effet les noyaux urbains qui perdent de la population
régionales. L’activité saisonnière s’étale au maximum culièrement localisés dans le centre-ville. Ils peuvent (Lourdes, Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur notamment). Seule la partie nord du territoire affiche globale-
sur une période de sept mois : depuis quelques an- cependant occasionnellement être occupés par des ment un solde démographique positif.
nées, se développent des contrats de travail à durée travailleurs saisonniers, l’offre traditionnelle pour L’évolution démographique disparate du territoire (gain de population pour la zone de plaine et de coteaux
déterminée morcelés et renouvelés pour des courtes cette catégorie de population étant devenue rare et située entre les agglomérations de Tarbes et Lourdes; vieillissement de la population) entraîne une évolution
durées par les mêmes employeurs. L’environnement vétuste (depuis 2012, 24 logements ont fait l’objet rapide des besoins et une nécessité d’adapter l’offre notamment dans les domaines suivants : services à la
économique du département ne permet pas d’être d’un arrêté préfectoral d’insalubrité). personne (petite enfance, personnes âgées etc.) ; santé rurale ; sports, loisirs, culture; transports.
dans une pluri-activités pour un aussi grand nombre
de travailleurs saisonniers. Conséquence de cette La typologie de l’offre de logements sur Lourdes
spécificité, la ville attire des personnes en grande pré- est inadaptée à la demande : 42 % des ménages
carité, des personnes fragiles psychologiquement et lourdais sont des ménages d’une personne et les
d’autres en recherche d’emploi. Ce contexte impacte logements d’une ou deux pièces ne représentent Extraits du diagnostic du Contrat Régional Unique
financièrement et socialement la commune, qui se
trouve confrontée à des problématiques lourdes
que 19 % de l’offre. Ainsi, malgré la stabilisation de
la population, la combinaison de la pression foncière
Plaines et Vallées de Bigorre
et complexes, en matière de santé, de pathologies exercée par le tourisme et du desserrement des mé- Le territoire est structuré en réseau de petites villes (Vic-en Bigorre, Maubourguet, Rabastens) réparties har-
mentales, d’errance ou encore de précarité (même nages rend le marché immobilier de la commune re- monieusement, contribuant à donner à l’espace rural son armature de proximité.
pour certains travailleurs). lativement «tendu». Cependant, il est important, mal- Les bourgs-centres garantissent des liens infra-territoriaux qui renforcent la cohésion de ce territoire en
gré cette typologie de ménages, de ne pas tendre captant les populations des cantons gersois et béarnais tout en maintenant l’accessibilité aux services et
Sa population vieillit. Les plus de 60 ans sont sur- vers une offre constituée uniquement de petits équipements, pour lesquels les collectivités locales ont réalisé des efforts importants au cours des dernières
représentés par rapport aux références régionales logements, mais de conserver de la diversité. » années. Dans un contexte où l’influence des agglomérations voisines (Tarbes, Pau) s’exerce chaque jour da-
et la proportion des plus de 75 ans augmente for- vantage, un maillage territorial équilibré autour des bourgs-centres reste affirmé et primordial.
tement (+ 30 % en 10 ans), alors que les moins de Sur le plan de l’offre de santé, et à l’instar de nombreuses zones rurales, le Pays du Val d’Adour est marqué
29 ans restent en deçà des indicateurs régionaux par une offre de premier recours globalement faible et une démographie médicale préoccupante à court
et diminuent (-12% en 10 ans). Les ménages d’une terme sur certaines zones. Si le programme LEADER précédent a permis de soutenir la création de maisons
personne représentent 42 % des ménages (3 013) en pluri-professionnelles de santé ( MSP de Lembeye, MSP de Marciac) lesquelles offrent un cadre d’exercice
2006 contre seulement 35 % (2 332) en 1999. attractif pour les candidats à l’installation, il n’en demeure pas moins que la question de l’offre médicale reste
Cette augmentation du nombre de personnes un défi pour l’avenir afin que l’accès aux soins soit possible pour tous.
seules correspond au vieillissement de la popula-
tion locale et à l’arrivée de personnes âgées seules
venant s’installer du fait de l’attractivité cultuelle de
la ville. La taille moyenne des ménages est passée
de 2,2 en 1999 à 2 en 2009. Ceci témoigne là encore
20 21Vous pouvez aussi lire