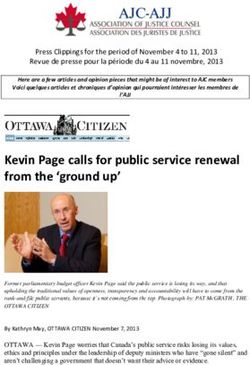Survol annuel de Blakes - Lois et règlements en droit de l'environnement au Québec en 2019
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Les avocats de Blakes adoptent une approche disciplinée, centrée sur le travail
d’équipe et axée sur le succès de votre entreprise. Ils travaillent à partir de
bureaux situés au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en
Chine, à Toronto, Calgary, Vancouver, Montréal, Ottawa, New York, Londres,
Bahreïn et Beijing. Blakes est l’un des cabinets d’avocats les plus respectés au
monde et possède de l’expertise dans presque tous les secteurs du droit des
affaires.
En droit des affaires, Blakes s’impose.Survol annuel de Blakes :
lois et règlements en droit de
l’environnement au Québec en 2019
Le Survol annuel de Blakes sur les lois et règlements en droit de l’environnement au
Québec de 2019 (le « guide ») ne se veut qu’un survol des principaux sujets
susceptibles de vous intéresser. Il est préférable d’obtenir des conseils plus ciblés en ce
qui concerne toute opération en particulier. Si vous avez des questions relativement à ce
guide, veuillez communiquer avec Charles Kazaz, associé de notre bureau de Montréal,
par téléphone en composant le 514-982-4002 ou par courriel à l’adresse
charles.kazaz@blakes.com. Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. fait
régulièrement paraître des rapports ainsi que des publications spéciales à propos des
nouveautés en matière juridique au Québec. Pour obtenir plus de renseignements au
sujet de ces rapports et de ces publications, veuillez communiquer avec le service
Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l’adresse
communications@blakes.com.
Table des matières
1. Introduction .......................................................................................... 3
2. Développements législatifs et réglementaires récents ..................... 5
2.1 Québec ........................................................................................................... 5
2.2 Canada ........................................................................................................... 8
3. Lois et règlements en droit de l’environnement au Québec ............ 9
3.1 Loi sur la qualité de l’environnement ............................................................... 9
3.2 Protection des eaux....................................................................................... 14
3.3 Conservation du territoire et développement durable .................................... 15
3.4 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables .............................................. 16
3.5 Gestion des déchets...................................................................................... 17
3.6 Loi sur les mines ........................................................................................... 17
3.7 Loi sur les pesticides ..................................................................................... 18
3.8 Loi sur les produits pétroliers et Loi sur le bâtiment ....................................... 18
3.9 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et Loi sur
l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents................................... 19
3.10 Loi sur le développement durable .................................................................. 19
3.11 Code civil du Québec .................................................................................... 20
4. Lois et règlements en droit de l’environnement fédéral ................. 20
4.1 Loi canadienne sur la protection de l’environnement ..................................... 20
4.2 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ........................ 23
4.3 Loi sur les produits dangereux....................................................................... 24
i Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.4.4 Loi sur les produits antiparasitaires ............................................................... 24 4.5 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ............................. 25 4.6 Loi sur les pêches ......................................................................................... 26 4.7 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ......................................... 27 4.8 Loi sur la responsabilité en matière maritime................................................. 28 4.9 Loi sur la protection de la navigation ............................................................. 28 4.10 Loi sur les océans ......................................................................................... 29 4.11 Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada .................. 29 4.12 Loi sur les espèces en péril ........................................................................... 29 4.13 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ................. 30 4.14 Loi sur les parcs nationaux du Canada.......................................................... 31 4.15 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ........ 31 4.16 Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement ................. 31 4.17 Droit criminel ................................................................................................. 31 4.18 Loi sur l’Office national de l’énergie ............................................................... 32 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. ii
Le groupe Environnement de Blakes à Montréal
Les membres du groupe Environnement de Blakes offrent des conseils juridiques sur tous les
aspects du droit de l’environnement et de l’énergie, notamment :
les opérations commerciales touchant à des questions environnementales et à la
vérification diligente;
les litiges, contestations de nature civile, administrative (sanction pécuniaire ou
ordonnance) ou pénale, poursuites, audiences et appels;
les examens de la conformité et l’évaluation des impacts environnementaux;
l’exploitation des ressources naturelles et le développement de l’énergie renouvelable, y
compris la participation des Premières Nations;
la responsabilité des administrateurs et dirigeants;
les évaluations environnementales fédérales et provinciales;
la responsabilité et la réhabilitation de sites contaminés;
les formations en matière d’environnement;
les espèces menacées ou en voie de disparition;
la réglementation en matière de changements climatiques et les opérations sur le marché
du carbone;
l’énergie renouvelable et les technologies propres.
Pour obtenir une liste détaillée de nos services, veuillez consulter la rubrique « Services
juridiques en environnement de Blakes » ci-après.
Les avocats en environnement de Blakes possèdent une vaste connaissance des lois
environnementales et d’étroits liens avec les autorités de réglementation, ce qui leur permet
d’offrir rapidement des conseils pertinents aux clients œuvrant dans ce domaine complexe. Ils ont
notamment pris part au développement de projets d’envergure dans de nombreux secteurs, au
réaménagement d’anciens terrains industriels, à l’élimination de déchets dangereux, à
l’aménagement de sites d’enfouissement, à l’importation et à l’exportation de substances
toxiques et non toxiques, ainsi qu’à la réhabilitation de sites contaminés. En outre, ils détiennent
un savoir-faire inégalé dans les secteurs de l’énergie (classique et renouvelable), de la foresterie,
des pâtes et papiers, des mines et de l’aménagement du territoire. Nous concentrons nos efforts
sur les nouvelles occasions qu’offrent les technologies propres, de même que sur les défis que
pose la réglementation en matière de changements climatiques. Notre groupe Environnement
s’est taillé une expertise en prestation de conseils sur divers aspects des projets d’énergie de
remplacement, de la conformité réglementaire et des marchés émergents du carbone. En outre,
nous aidons régulièrement des entreprises à présenter au gouvernement des commentaires
concernant des projets de lois environnementales ou la modification de lois existantes.
Nos avocats sont souvent appelés à défendre les intérêts de sociétés et de particuliers accusés
de graves infractions environnementales en vertu de lois fédérales, provinciales et municipales.
Les membres de notre groupe Environnement travaillent de près avec leurs collègues des
groupes Immobilier commercial, Services financiers, Droit commercial et des sociétés,
Foresterie, Pétrole et gaz, Énergie, Électricité, Droit des Autochtones et Restructuration et
insolvabilité dans le but de fournir à leurs clients des conseils en environnement exhaustifs. Nous
avons d’ailleurs supervisé des évaluations environnementales de sites et des examens de
conformité dans le cadre d’opérations commerciales de grande envergure ciblant de multiples
terrains partout au Canada et dans le monde.
Page 1 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.La pratique de Charles Kazaz touche à tous les aspects du droit de
e
l’environnement au Québec et en Ontario. M Kazaz conseille des clients
des secteurs commercial, industriel, minier et de la gestion des déchets. Il
compte également parmi ses domaines de compétences l’obtention de
permis relatifs aux ressources naturelles et la conformité à la
e
réglementation minière et forestière. M Kazaz a conseillé plusieurs
importantes sociétés minières dans le cadre d’acquisitions, de cessions,
de restaurations et de fermetures de mines, ainsi que de dossiers de
droits miniers. En outre, il a participé à la négociation d’ententes avec les
Premières Nations.
Courriel : charles.kazaz@blakes.com; Téléphone : 514-982-4002
La pratique d’Anne Drost couvre divers aspects du droit de l’énergie et du
droit de l’environnement, dont les changements climatiques et la
réglementation. Elle conseille des multinationales exerçant des activités
au Québec quant à des questions de responsabilité sociale des
entreprises, de lobbying et d’éthique. En outre, elle pratique dans le
domaine du droit des Autochtones. Grâce à sa vaste expérience dans le
e
domaine de l’environnement, M Drost conseille des clients notamment sur
la conformité et les approbations réglementaires, ainsi que dans le cadre
d’opérations d’acquisition ou de cession de terrains.
Courriel : anne.drost@blakes.com; Téléphone : 514-982-4033
La pratique d’Anne-Catherine Boucher est principalement axée sur le
droit de l’environnement, de l’énergie, des Autochtones ainsi que sur le
e
droit minier. De plus, M Boucher offre des conseils liés à des questions
d’ordre général en droit commercial et des sociétés, au droit administratif
e
et à d’autres questions relatives à la réglementation. M Boucher conseille
les clients sur leurs obligations environnementales en général, de même
que sur des questions relatives aux diverses exigences d’obtention de
permis et aux processus d’évaluation environnementale, aux obligations
concernant les émissions de gaz à effet de serre et au système de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du
Québec.
Courriel : annecatherine.boucher@blakes.com; Téléphone : 514-982-4133
La pratique de Mathieu Nolin est axée sur le droit de l’environnement,
des Autochtones, de l’énergie, des changements climatiques ainsi que sur
le droit minier. Il s’intéresse également aux questions de responsabilité
e
sociale des entreprises, de lobbying et d’éthique. M Nolin fournit
également des conseils en droit commercial et des sociétés en plus
d’intervenir à plusieurs étapes d'opérations de fusion et acquisition. Dans
e
le cadre de sa pratique en droit de l’environnement, M Nolin conseille des
clients sur les exigences environnementales et réglementaires, y compris
les obligations concernant les émissions de gaz à effet de serre, les
exigences relatives à la protection du territoire agricole, la réglementation
sur la gestion des déchets et des substances dangereuses ainsi que les
obligations en matière d’efficacité énergétique, tant à l’échelle provinciale
que fédérale.
Courriel : mathieu.nolin@blakes.com; Téléphone : 514-982-4291
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. Page 21. Introduction
Alors que les Canadiens sont de plus en plus conscients de l’état de l’environnement et
soucieux que les contrevenants aux lois environnementales soient tenus responsables de
leurs gestes, nous avons pu constater une augmentation significative de la réglementation
visant à protéger l’environnement. L’environnement est devenu un enjeu si crucial qu’il est
important que toute personne œuvrant dans le milieu des affaires soit informée de ce qui est
permis et interdit par les lois environnementales applicables et de la façon dont elle doit
répondre aux demandes du gouvernement et du public.
Tous les paliers de gouvernement au Canada ont adopté des lois qui réglementent les
répercussions des activités commerciales sur l’environnement. Ces lois et règlements sont
non seulement complexes, mais aussi souvent mis en œuvre avec discrétion par les
autorités gouvernementales. Les tribunaux se sont montrés actifs en élaborant de nouveaux
principes et de nouvelles normes afin d’interpréter le cadre législatif. En outre, les poursuites
civiles en matière d’environnement (y compris les actions collectives) sont désormais
monnaie courante devant les tribunaux canadiens.
La Constitution canadienne ne traite pas précisément de l’environnement, c’est pourquoi ni le
gouvernement fédéral ni les gouvernements provinciaux ne possèdent de compétence
exclusive à ce sujet. Ce sont donc des « domaines de compétence » précis, tels que le droit
criminel, les pêches ou les ressources naturelles, qui sont invoqués au besoin afin de justifier
le pouvoir de légiférer d’un palier de gouvernement en particulier. Pour de nombreuses
questions qui ne sont pas spécifiquement attribuées par la Constitution et qui entrent dans la
catégorie générale de l’« environnement », tant le gouvernement fédéral que les
gouvernements provinciaux peuvent exercer leur compétence à cet égard. Il s’agit d’une
« compétence concurrente », ce qui, pour les chefs d’entreprise, signifie que les entreprises
doivent se conformer autant à la réglementation fédérale qu’à la réglementation provinciale.
Historiquement, les provinces ont pris en charge la conservation et la protection de
l’environnement. Cependant, le rôle du gouvernement fédéral ne cesse de croître, de même
que celui de certaines municipalités, par l’intermédiaire de leurs règlements municipaux.
Les lois environnementales créent des infractions, en cas de non-conformité, qui peuvent
mener à des sanctions, notamment des amendes importantes et/ou des peines
d’emprisonnement. Nombre d’entre elles prévoient qu’une amende maximale est doublée en
cas d’infractions subséquentes et qu’elle peut être imposée pour tous les jours pendant
lesquels l’infraction se poursuit. Certaines prévoient également d’importantes amendes
minimales. La plupart des lois environnementales imputent la responsabilité aux
administrateurs, aux dirigeants, aux employés ou aux agents d’une entreprise lorsqu’ils
autorisent, permettent ou acceptent la perpétration d’une infraction, que l’entreprise soit
poursuivie ou non. Les entreprises et les personnes physiques peuvent échapper à toute
responsabilité environnementale si elles démontrent qu’elles ont pris toutes les mesures
raisonnables pour prévenir l’infraction. Certaines lois créent des sanctions administratives,
qui consistent en des pénalités imposées par un organisme de réglementation
gouvernemental plutôt que par un tribunal. Les agents chargés de l’application de la loi sont
généralement autorisés à visiter les lieux, à ordonner, notamment, la suspension des
travaux, à enquêter en cas de non-conformité et à obtenir des mandats de perquisition, de
même qu’à saisir toute chose pouvant être pertinente en cas d’infraction alléguée.
Plusieurs projets réalisés au Québec, particulièrement ceux visant l’exploitation de
ressources naturelles et le développement des énergies renouvelables dans le nord de la
province, doivent également être examinés en tenant compte des répercussions potentielles
sur les droits des Premières Nations, qui font l’objet d’une protection constitutionnelle au
Canada. Ce domaine de droit s’est rapidement développé au cours de la dernière décennie,
Page 3 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.et tant le gouvernement québécois que le gouvernement fédéral y exercent une certaine
compétence. Bien que les considérations propres à ce domaine dépassent le cadre de ce
guide, nous notons que les gouvernements doivent mener des consultations auprès des
Premières Nations en plus de les accommoder, lorsque nécessaire. La portée de ce
processus est modulée selon la nature des impacts potentiels d’une activité ou d’un projet
sur les droits des Premières Nations. Au Québec, un processus particulier s’applique pour la
région de la Baie-James et du Nord québécois, et requiert la participation accrue des peuples
cris et des Inuits.
Le présent guide vise à aider le lecteur à démystifier la réglementation environnementale
québécoise et fédérale, mais ne doit pas être interprété comme des conseils juridiques ou
professionnels. Les lecteurs devraient obtenir des conseils juridiques spécifiques sur toute
question particulière qui les concerne. Pour plus d’information sur la manière dont nous
pouvons vous aider à atteindre vos objectifs d’affaires, visitez notre site Web à l’adresse
www.blakes.com ou communiquez avec un membre du groupe Environnement de Blakes à
Montréal.
À moins d’indication contraire, le droit sur lequel se fonde ce guide est celui qui
prévaut en date du 15 janvier 2019.
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. Page 42. Développements législatifs et réglementaires
récents
2.1 Québec
2.1.1 Modification de la Loi sur la qualité de l’environnement
Mise à jour de la LQE et du régime d’autorisation environnementale
En mars 2017, l’Assemblée nationale du Québec a sanctionné le projet de loi 102, Loi
modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement, qui apporte des modifications importantes à
la Loi sur la qualité de l’environnement (la « LQE »), notamment à son processus
d’autorisation environnementale. Alors que certaines modifications apportées à la LQE sont
entrées en vigueur dès son adoption, plusieurs sont entrées en vigueur un an après celle-ci,
soit le 23 mars 2018.
Le nouveau régime d’autorisation qui est entré en vigueur le 23 mars 2018 classifie les
projets selon quatre niveaux de risque :
Risque élevé : Les projets à risque élevé demeurent assujettis à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, et une autorisation
délivrée par le gouvernement doit être obtenue pour ces projets. La liste de ces
projets figure dans le Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur
l'environnement de certains projets, également entré en vigueur le 23 mars 2018.
Risque modéré : Les projets à risque modéré continuent d’être assujettis à
l’obtention d’une autorisation ministérielle.
Risque faible : Les projets à risque faible forment une nouvelle catégorie de projets
visés par la LQE et seront énumérés dans un règlement qui sera publié
ultérieurement. Afin d’entreprendre ce type d’activités, le promoteur n’aura pas à
obtenir une autorisation ministérielle; il devra plutôt déposer une déclaration de
conformité et pourra amorcer ses activités 30 jours après le dépôt de celle-ci. Entre-
temps, certaines activités particulières sont admissibles à ce mécanisme.
Risque négligeable : Les activités qui seront déterminées par règlement comme
étant à risque négligeable seront exemptées de l’obligation d’obtenir une autorisation
et de toute autre formalité.
Depuis le 23 mars 2018, sous réserve de quelques exceptions, une seule autorisation est
émise par projet, et les autorisations peuvent être cédées de plein droit, sur un simple
préavis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(le « MELCC »). Précédemment, une telle cession nécessitait l’autorisation du MELCC, ce
qui pouvait prendre en moyenne plus de quatre mois. Les promoteurs ne sont également
désormais plus soumis à l’obligation d’obtenir un certificat de conformité aux règlements
municipaux afin de soumettre leur demande d’autorisation.
Les modifications apportées à la LQE visent également à accroître la transparence et
l’accessibilité de l’information faisant partie du processus d’approbation environnementale. Le
MELCC prévoit publier les documents considérés publics en vertu de la LQE dans un registre
accessible sur son site Web (ces documents sont maintenant disponibles sur demande). Ces
documents comprennent notamment les demandes d’autorisation, du dépôt jusqu’à la
décision finale, ainsi que les documents connexes, les plans de réhabilitation et l’information
Page 5 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.sur les projets à risque faible assujettis à une déclaration de conformité. En ce qui concerne
les renseignements inclus dans une demande d’autorisation, le demandeur de l’autorisation
peut s’opposer à leur divulgation en identifiant les renseignements qu’il considère être un
secret industriel ou commercial confidentiel et en justifiant cette prétention.
De plus, les considérations liées aux changements climatiques dans le régime d’autorisation
provincial ont gagné en importance lors de la modernisation de la LQE. En effet, dans les cas
prévus par règlement, la ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (la « Ministre ») a le pouvoir de tenir compte des considérations liées aux
émissions de GES attribuables à un projet ainsi que des mesures de réduction que celui-ci
peut nécessiter dans son analyse d’un projet. La Ministre peut également prendre en
considération les risques et les impacts anticipés des changements climatiques sur le projet
et sur le milieu où il sera réalisé ainsi que des mesures d’adaptation que ce projet pourrait
nécessiter. Ces considérations, généralement désignées comme étant le « test climat »,
seront précisées par la publication d’un règlement d’application.
Par ailleurs, la LQE confère désormais au gouvernement le pouvoir, de manière
exceptionnelle, d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement des projets ne figurant pas sur la liste établie par règlement dans les cas où
1) ces projets comportent des enjeux environnementaux majeurs et que les préoccupations
du public le justifient; 2) ces projets impliquent une technologie nouvelle ou un nouveau type
d’activités au Québec pour lesquels les impacts appréhendés sur l’environnement sont
majeurs; ou 3) ces projets comportent des enjeux majeurs en matière de changements
climatiques.
Ce changement a considérablement modifié le régime québécois d’évaluation
environnementale qui limitait précédemment le pouvoir discrétionnaire de la Ministre puisqu’il
reposait sur une liste exhaustive de projets.
Finalement, la LQE accorde maintenant des pouvoirs élargis à la Ministre relativement à la
réhabilitation de terrains. Ces pouvoirs lui permettent, entre autres, d’exiger une étude de
caractérisation dans le cadre d’une demande d’autorisation et d’imposer des conditions
relativement au retrait, au traitement ou au confinement de contaminants dans certaines
circonstances.
Des règlements mettant en œuvre les nombreux changements apportés à la LQE sont
toujours attendus afin de finaliser la réforme de la LQE.
Mise à jour du régime de protection des milieux humides et hydriques
En juin 2017, l’Assemblée nationale du Québec a sanctionné le projet de loi 132, Loi
concernant la conservation des milieux humides et hydriques, qui modifie le cadre législatif
applicable à la protection des milieux humides et hydriques au Québec.
Le projet de loi 132 modifie notamment la Loi affirmant le caractère collectif des ressources
en eau favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés et la Loi sur la
conservation du patrimoine naturel afin de renforcer la protection des milieux humides et
hydriques, de confier un rôle accru dans la gouvernance de ces milieux aux gouvernements
de proximité, de favoriser la mise en œuvre de programmes de protection et de faciliter la
désignation de ces milieux comme aires protégées. Ces modifications sont en vigueur.
Ce projet de loi a aussi modifié la LQE, également en mars 2018, afin de modifier le régime
d’autorisation concernant les projets susceptibles d’avoir un impact sur les milieux humides
et hydriques. Les promoteurs de tels projets doivent désormais fournir une compensation
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. Page 6financière ou réaliser des travaux de restauration, dans les cas prévus par règlement, avant qu’une autorisation leur soit délivrée par la Ministre. La Ministre a maintenant le pouvoir discrétionnaire de refuser de délivrer une autorisation, notamment : 1) s’il n’a pas été démontré à sa satisfaction que le projet ne peut éviter de porter atteinte aux milieux humides ou hydriques; 2) si elle est d’avis que les mesures proposées ne permettent pas de réduire au minimum les impacts du projet sur ces milieux; ou 3) si elle est d’avis que le projet porte atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité de ces milieux. Sous l’ancien régime, la règle générale voulait que la perte de milieux humides et hydriques doive généralement être compensée par la restauration, la création, la protection ou la valorisation écologique d’un milieu humide ou hydrique ou d’un milieu terrestre à proximité d’un milieu humide ou hydrique. La LQE prévoit maintenant qu’une contribution financière devra généralement être payée à titre de compensation, sous réserve des exceptions prévues par règlement. À noter que la contribution financière doit être entièrement payée avant qu’une autorisation puisse être délivrée, sinon la demande pourrait être rejetée. Depuis le 20 septembre 2018, le régime d’autorisation de projets situés en milieux humides et hydriques est complété par le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques. Ce règlement prévoit les modalités associées au paiement d’une contribution financière et précise, notamment : 1) les activités soustraites à l’obligation de compenser, 2) la formule pour calculer le montant de la compensation, et 3) les situations où la compensation peut s’effectuer par la réalisation de travaux de compensation. 2.1.2 Adoption de la Loi sur les hydrocarbures La Loi sur les hydrocarbures a été adoptée en décembre 2016 et est considérée comme la pierre angulaire de la modernisation de l’encadrement réglementaire relatif à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures au Québec, précédemment régi par la Loi sur les mines. La Loi sur les hydrocarbures a pour objectif de régir le développement et la mise en valeur des hydrocarbures tout en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource, et ce, en conformité avec les cibles de réduction des émissions de GES établies par le gouvernement. Afin d’atteindre cet objectif, elle prévoit la mise en place d’un régime de licence et d’autorisation applicable à l’exploration, à la production et au stockage d’hydrocarbures, qui inclut un régime d’autorisation de certaines activités connexes. De plus, elle prévoit l’obligation de soumettre pour approbation un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoirs et de restauration de site pour tout titulaire lors de la demande d’une autorisation de forage. Une garantie du montant des coûts anticipés des travaux prévus par ce plan doit également être soumise. La construction et l’utilisation d’un pipeline intraprovincial sont également réglementées par la Loi sur les hydrocarbures. Les normes réglementant ces activités sont, depuis le 20 septembre 2018, régies par trois règlements d’application, soit 1) le Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et autorisation de construction ou d’utilisation de pipeline; 2) le Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre; et 3) le Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique. Page 7 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
2.1.3 Adoption de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules
automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et autres polluants
La Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (la « LVZE ») ainsi
que les règlements définissant son champ d’application sont applicables au Québec depuis
er
le 1 janvier 2018. Le Québec devient ainsi la première province canadienne à mettre sur
pied un cadre législatif incitant les constructeurs automobiles à accroître la fabrication et
l’offre de véhicules à zéro émission.
La LVZE prévoit trois catégories de constructeurs automobiles, soit 1) les « grands
constructeurs », dont la moyenne des ventes et des locations pour une année modèle est
supérieure à 20 000, 2) les « moyens constructeurs », lorsque cette moyenne se situe entre
4 501 et 20 000, et 3) les « petits constructeurs », lorsque cette moyenne est égale ou
inférieure à 4 500. Seuls les moyens et grands constructeurs sont soumis aux normes
prévues par la LVZE et à l’obligation d’accumuler des crédits, dont le nombre variera pour
chaque constructeur et est déterminé suivant les paramètres, les règles de calcul et les
conditions fixés par règlement. Les petits constructeurs, pour leur part, ont le choix de
participer ou non à ce régime.
Les crédits requis par la LVZE peuvent être accumulés au moyen de la vente ou de la
location de véhicules zéro émission ou de véhicule automobile à faibles émissions. Dès
2020, cependant, un certain pourcentage de crédits devant être accumulés par les « grands
constructeurs » devra nécessairement se faire par l’intermédiaire de la vente ou de la
location de véhicules zéro émission. L’année 2018 est la première année modèle pour
laquelle l’obligation d’accumuler des crédits s’appliquera, mais les constructeurs pourront
également obtenir rétroactivement des crédits pour les véhicules vendus ou loués des
modèles 2014, 2015, 2016 et 2017 qui satisfont aux critères de la LVZE.
La LVZE établit un système flexible d’échange de crédits, similaire à celui de plafonnement et
d’échange de droits d’émission du Québec, et permet aux constructeurs visés de vendre ou
d’acheter des crédits d’autres constructeurs (incluant les « petits constructeurs »). Dans le
cas où certains d’entre eux auraient accumulé un nombre de crédits supérieur au seuil établi
par le MELCC, ils pourront également les conserver afin de les utiliser ou de les vendre
ultérieurement. Les constructeurs n’atteignant pas leur cible de crédits calculée sur une
période de trois ans seront tenus de payer une redevance, dont la valeur est fixée par
règlement. Des obligations d’information et de déclaration sont également prévues à la
LVZE.
2.2 Canada
2.2.1 Examen des processus réglementaires fédéraux (projets de loi C-68
et C-69)
En février 2018, le gouvernement fédéral a déposé les projets de loi C-68 et C-69 énonçant
les modifications proposées au processus d’évaluation environnementale, à la protection de
l’habitat des poissons, à la modernisation de l’Office national de l’énergie et à la protection de
la navigation.
S’il est adopté dans sa forme actuelle, le projet de loi C-69 révisera en profondeur le régime
fédéral d'évaluation environnementale en abrogeant la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale (2012) et en la remplaçant par la Loi sur l’évaluation d’impact. Celle-ci
prévoit un processus d’évaluation des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. Page 8économiques des projets désignés en vue de prévenir certains effets négatifs et de favoriser
la durabilité. Le projet de loi C-69 abrogera également la Loi sur l’Office national de l’énergie
et la remplacera par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Au nombre des
changements connexes figure la création de la Régie canadienne de l’énergie (la « Régie »),
laquelle remplacera l’Office national de l’énergie et sera structurée de manière à séparer la
gouvernance et les fonctions quasi judiciaires de la Régie. Les facteurs dont la Régie devra
tenir compte pour l’octroi des certificats d’utilité publique seront grandement élargis et
comprendront expressément les enjeux environnementaux et les droits des peuples
autochtones. En outre, le projet de loi C-69 propose de nouvelles mesures pour réglementer
les projets susceptibles d’avoir des répercussions sur les eaux navigables par l’intermédiaire
de modifications à la Loi sur la protection de la navigation (qui sera renommée Loi sur les
eaux navigables canadiennes).
S’il est adopté dans sa forme actuelle, le projet de loi C-68 modifiera la Loi sur les pêches en
y ajoutant une nouvelle catégorie de projet désigné, ainsi qu’une interdiction d’exploiter un
ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité compris dans un projet désigné, sauf
conformément à un permis délivré au promoteur en vertu de la Loi sur les pêches. Le projet
de loi C-68 modifie également la disposition relative aux dommages au poisson, en y
restituant le libellé utilisé avant les modifications de 2012. En particulier, le projet de loi C-68
interdira tout ouvrage, entreprise ou activité pouvant causer la mort du poisson, ou la
détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson (soit la « disposition
DDP »).
2.2.2 Changements climatiques
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) (la
« Loi »), qui établit le cadre juridique et les pouvoirs découlant du régime fédéral de
tarification du carbone, a reçu la sanction royale en juin 2018. En vertu de la Loi, le
gouvernement fédéral est habilité à appliquer et à mettre en œuvre un régime de tarification
du carbone à deux volets, seulement dans les provinces et les territoires qui ne respectent
pas les exigences du modèle fédéral prévu par la Loi ou qui choisissent d’adopter
volontairement ce régime.
Aux termes de la partie 1 de la Loi, l’Agence du revenu du Canada appliquera une «
redevance » sur les combustibles dans les provinces assujetties suivantes : la
Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario, à compter d’avril 2019, de
même qu’au Yukon et au Nunavut, à compter de juillet 2019.
Aux termes de la partie 2 de la Loi, Environnement et Changement climatique Canada est
responsable de l’application d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les
grands émetteurs industriels en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, à l’Île-du-
Prince-Édouard et en Saskatchewan, depuis janvier 2019, de même qu’au Yukon et au
Nunavut, à compter de juillet 2019. Un régime d’application transitoire a été mis en œuvre à
er
la fin de l’année 2018 afin d’assurer l’entrée en vigueur de cette partie de la Loi au 1 janvier
2019. Des règlements d’application définitifs sont attendus plus tard en 2019.
3. Lois et règlements en droit de
l’environnement au Québec
3.1 Loi sur la qualité de l’environnement
La LQE est la principale loi en matière d’environnement au Québec. Elle établit, grâce à ses
multiples règlements d’application, un cadre réglementaire régissant notamment le processus
Page 9 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.d’autorisations environnementales, le régime d’évaluation des impacts environnementaux, la
protection des ressources en eaux, l’assainissement de l’atmosphère et la lutte contre les
changements climatiques ainsi que la protection et la réhabilitation de terrains contaminés.
D’autres lois et règlements provinciaux, mentionnés aux sections 3.2 à 3.11 du présent
guide, viennent compléter ce cadre.
3.1.1 Autorisations environnementales
L’article 20 de la LQE interdit à quiconque de rejeter ou de permettre le rejet de contaminants
dans l’environnement au-delà des limites prescrites par règlement ou d’une façon qui serait
susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de
l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à
la végétation, à la faune ou aux biens. Aux termes de l’article 21 de la LQE, quiconque rejette
accidentellement l’un de ces contaminants doit en aviser la Ministre sans délai.
La LQE oblige également toute personne qui prévoit entreprendre une activité susceptible de
résulter en une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans
l’environnement à obtenir préalablement une autorisation ministérielle. Tel qu’il est mentionné
à la section 2.1.1, des dispositions particulières s’appliquent aux projets nuisant aux milieux
humides ou hydriques. Une autorisation n’est cependant pas requise pour certaines activités,
dont une liste exhaustive est prévue dans le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la
qualité de l’environnement.
Le contrôle des émissions atmosphériques ainsi que le matériel de traitement des eaux
usées sont généralement visés par des autorisations devant être émises par le MELCC aux
termes de la LQE. Cependant, si une installation est située sur l’île de Montréal, elle est alors
assujettie, en ce qui concerne les émissions atmosphériques, aux normes prévues par les
règlements de la Communauté métropolitaine de Montréal (la « CMM »). De plus, en ce qui
concerne les rejets d’eaux usées dans les réseaux d’égouts ou l’environnement, les
installations situées sur le territoire de la CMM sont assujetties aux normes prévues par les
règlements de la CMM.
Finalement, aux termes de la LQE, les exploitants d’un établissement industriel exerçant des
activités dans l’un des secteurs industriels prévus par règlement doivent faire l’objet d’une
autorisation ministérielle relativement à l’exploitation d’un établissement industriel
(anciennement, une « attestation d’assainissement »), à savoir un type de permis
d’exploitation environnementale globale devant être renouvelé tous les cinq ans. Les trois
premiers secteurs qui ont été assujettis à cette exigence sont les usines de pâtes et papiers,
l’industrie minière ainsi que l’industrie des métaux de base. Les normes en matière
d’émissions contenues dans les attestations d’assainissement sont établies en fonction de
l’installation en question et de son milieu récepteur. Les titulaires des attestations doivent
payer des frais en fonction de leurs émissions, et ils sont tenus de surveiller l’incidence de
leurs émissions sur le milieu environnant. Un nouveau règlement est attendu afin de mettre
en œuvre les modifications récemment apportées à la LQE en ce qui concerne ce régime
d’autorisation particulier.
Tel qu’il est indiqué à la section 2.1.1, des modifications importantes ont récemment été
apportées à la LQE et, plus précisément, au régime d’autorisation environnementale qu’elle
établit. Nous vous invitons à vous reporter à cette section pour obtenir un aperçu de ces
changements, dont la majorité sont entrés en vigueur en 2018. L’adoption de modifications
réglementaires est attendue afin de mettre en application ces changements. Ces
modifications pourraient avoir un impact sur l’information présentée ci-dessus.
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. Page 103.1.2 Procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement
Certains types de projets, énumérés au Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des
impacts sur l'environnement de certains projets, doivent être soumis à une évaluation des
impacts sur l’environnement avant que le gouvernement du Québec puisse délivrer une
autorisation ministérielle.
Le processus d’évaluation environnementale comprend notamment la publication d’un avis
de projet, la préparation d’une étude d’impact sur l’environnement, une période d’information
du public, et, dans certains cas, peut aussi comprendre des audiences publiques devant le
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (le « BAPE »). Les recommandations du
BAPE doivent être prises en compte par le gouvernement du Québec lorsqu’il choisit
d’autoriser ou de refuser un projet et lorsqu’il établit les conditions d’une autorisation
ministérielle. La LQE prévoit aussi un processus d’évaluation des impacts sur
l’environnement et le milieu social distinct pour la région de la Baie-James et du Nord
québécois, lequel nécessite la participation de représentants cris ou inuits au processus
d’approbation.
Fait à noter, un registre des projets assujettis à la procédure d’évaluation des impacts sur
l’environnement est maintenant rendu public par le MELCC, où l’on retrouve l’ensemble des
documents transmis par les promoteurs, sous réserve de certaines exceptions.
Depuis le 23 mars 2018, le gouvernement peut exceptionnellement, à sa discrétion et sur
recommandation de la Ministre, appliquer cette procédure dans les cas suivants :
- Si les enjeux environnementaux que suscite le projet sont majeurs et que les
préoccupations du public le justifient;
- Si le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d’activités au
Québec pour lesquels les impacts appréhendés sur l’environnement sont majeurs;
- Si le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changements climatiques.
Ce changement a modifié considérablement le régime québécois d’évaluation
environnementale qui limitait précédemment le pouvoir discrétionnaire de la Ministre puisqu’il
reposait sur une liste exhaustive de projets.
3.1.3 Protection des ressources en eau
Sous réserve de certaines exceptions, la LQE prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir des
autorisations pour tout prélèvement d’eau de 75 000 litres ou plus. Ces autorisations sont
généralement valides pour une période de 10 ans. Les décisions du gouvernement quant à la
délivrance et au renouvellement des autorisations doivent tenir compte, de manière
prioritaire, de l’environnement et des besoins en matière de santé publique. Certaines
exceptions sont toutefois prévues, notamment en ce qui concerne l’eau embouteillée.
Par ailleurs, certains règlements imposent des frais pour les prélèvements d’eau excédant
75 mètres cubes par jour. Ces frais sont de 0,0025 $ CA par mètre cube, sauf pour
l’extraction de pétrole ou de gaz ou les industries où l’eau fait partie du produit final (par
exemple, le secteur de l’eau embouteillée), pour lesquelles les frais s’élèvent à 0,07 $ CA par
mètre cube.
De plus, les municipalités ont le pouvoir d’adopter des règlements en matière d’égouts qui
restreignent habituellement ce qui peut être rejeté dans les égouts séparatifs ou les égouts
pluviaux locaux et, dans certains cas, qui peuvent exiger des plans de prévention de la
Page 11 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.pollution. À cet effet, toute personne qui rejette des liquides dans ces types d’égouts devrait
avoir une connaissance des règlements municipaux applicables.
3.1.4 Assainissement de l’atmosphère et lutte contre les changements
climatiques
Une partie importante de la réglementation québécoise en matière d’assainissement de
l’atmosphère et de lutte contre les changements climatiques a été adoptée dans le cadre de
la LQE et de ses règlements. Tel qu’il est mentionné à la section 2.1.1, certaines
modifications à la LQE qui sont entrées en vigueur en mars 2018 prévoient une
augmentation des pouvoirs de la Ministre relativement aux considérations liées aux
changements climatiques et aux émissions de GES. Un règlement est attendu afin de
confirmer de quelle façon les changements climatiques, par l’intermédiaire d’un « test
climat », seront pris en compte dans le régime d’autorisation environnementale au Québec.
Le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère prévoit les normes d’émissions de
contaminants dans l’atmosphère au Québec. Ce règlement s’applique à tout le Québec à
l’exception de l’île de Montréal, pour laquelle la CMM a adopté certains règlements distincts
en matière de qualité de l’air. Le règlement prévoit également diverses mesures de contrôle
et plusieurs normes propres à certaines sources de contamination.
En vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants
dans l’atmosphère, toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui émet dans
l’atmosphère un contaminant prévu par règlement dans une quantité qui atteint ou excède le
seuil réglementaire doit remplir une déclaration. Cette déclaration doit identifier la quantité de
chacun des contaminants visés, ainsi que les méthodes de calcul ou d’évaluation utilisées à
ces fins. En ce qui concerne les GES visés par le Règlement, le seuil d’émission annuelle est
fixé à 10 000 tonnes métriques d’équivalents de dioxyde de carbone (CO 2). Cependant, les
distributeurs de carburants et de combustibles fossiles qui distribuent annuellement une
quantité supérieure à 200 litres sont tenus de déclarer à la Ministre toutes les émissions de
GES attribuables à leur combustion ou à leur utilisation.
Le gouvernement du Québec a également adopté un système de plafonnement et d’échange
de droits d’émission de GES (le « SPEDE ») conformément au Règlement concernant le
système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (le
« Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange »). Le SPEDE vise toute
personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant partie d’un secteur réglementé et
émettant plus de 25 000 tonnes d’équivalents de CO2 par année. Il est également possible de
s’inscrire au SPEDE sur une base volontaire. Les entreprises assujetties doivent couvrir
chacune des tonnes d’équivalents de CO2 émises avec des droits d’émissions. Le SPEDE
prévoit plusieurs mécanismes qui permettent aux entreprises assujetties de s’y conformer :
Allocations gratuites : Les droits d’émissions distribuées annuellement et
gratuitement par le gouvernement conformément au Règlement concernant le
système de plafonnement et d’échange;
Vente aux enchères ou de gré à gré : Le Règlement concernant le système de
plafonnement et d’échange permet aux émetteurs d’acheter des unités d’émission
soit par vente aux enchères, ou par une transaction de gré à gré avec le
gouvernement ou avec un autre émetteur visé;
Crédits compensatoires : Les droits d’émissions qui sont obtenus lorsqu’une
entreprise effectue un projet qui diminue ses émissions de GES dans un secteur non
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. Page 12Vous pouvez aussi lire