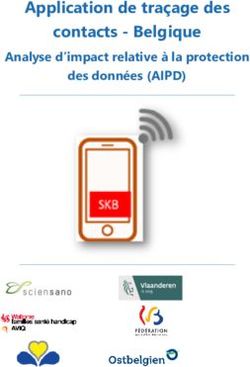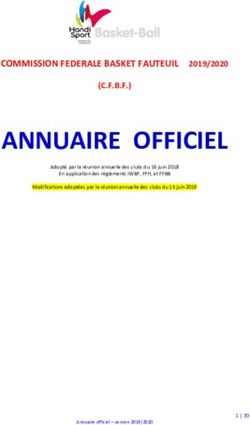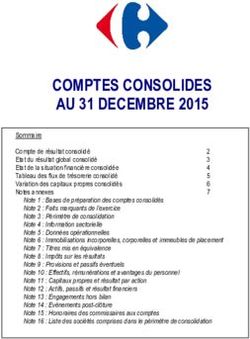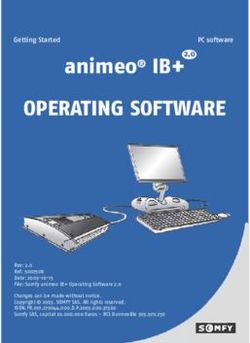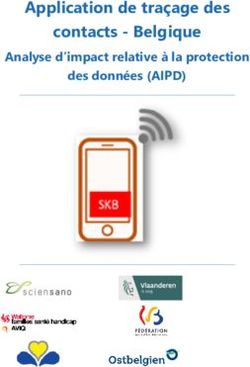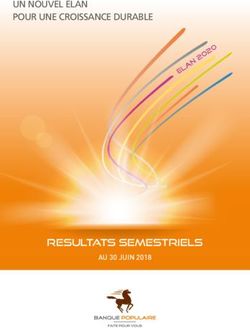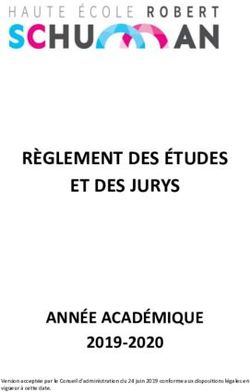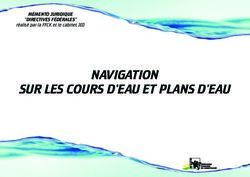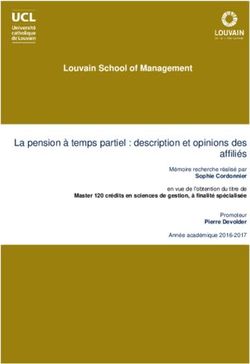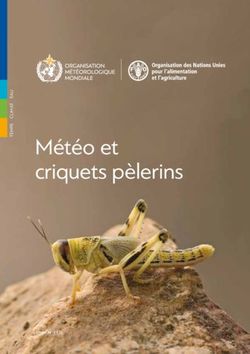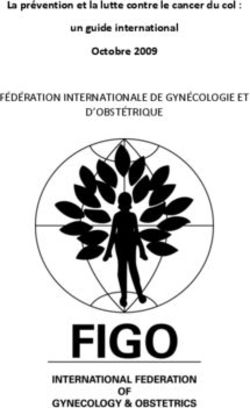TCHAD Note sur la situation de l'économie et de la pauvreté au temps de la COVID-19 - World Bank Document
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
Printemps 2020
la COVID-19
au temps de
de la pauvreté
de l’économie et
Note sur la situation
TCHADTchad
Note sur la situation de l’économie et de la
pauvreté en temps de la COVID-191
Printemps 2020
1 Élaboré par Fulbert Tchana Tchana (économiste principal, EA2M1), Olanrewaju Kassim (économiste, EA2M1), Aboudrahyme Savadogo
(consultant ET, EA2PV), Aissatou Ouedraogo (consultante ET, EA2PV), et Mohamed Coulibaly (consultant, EA2PV), sous la direction de Jean-
Pierre Chauffour (chef de programme, EA2DR) et la supervision générale de Lars Moller (directeur du pôle d’expertise mondial en
Macroéconomie, investissement et commerce) et Andrew Dabalen (directeur du pôle d’expertise mondial Pauvreté). L’équipe a bénéficié
des contributions de : Silvana Tordo (spécialiste principale en énergie, IEEX), Nicolas Rosemberg (économiste spécialiste de la santé, HAFH2),
Rebecca Lacroix (spécialiste principale en charge des questions de fragilité, violences et conflits, GTFOS), Kandi Magendo (spécialiste en
gestion financière, EA2G1), Michel Mallberg (spécialiste senior du secteur public, EA2G1), Zacharie Ngueng (spécialiste en éducation, HAFE2),
Ziva Razafintsalama (spécialiste senior en agriculture, SAFA4), Teymour Abdel Aziz (spécialiste senior du secteur financier, EA2F1).TABLE DES MATIÈRES
Abréviations et acronymes ......................................................................................................................................... i
Résumé analytique .................................................................................................................................................... 1
Situation de l’économie ............................................................................................................................................. 4
2.1. Évolution et perspectives économiques récentes ........................................................................................ 4
2.1.1.Secteur réel : Depuis 2018, l’économie tchadienne poursuit sa modeste reprise progressive ..... 4
2.1.2.Finances publiques : excédents budgétaires modérés et espace budgétaire amélioré................. 5
2.1.3.Accorder la priorité aux problèmes de la dette : restructuration de la dette et amélioration .......
de sa gestion ont permis de réduire le risque de surendettement ............................................... 8
2.1.4. Situation monétaire : inflation modérée dans le cadre d’un durcissement de la
politique monétaire ....................................................................................................................... 8
2.1.5. Position extérieure : réduction du déficit du compte courant grâce à l’augmentation des
exportations de pétrole et au durcissement de la politique monétaire ........................................ 9
2.2. Perspectives économiques en temps de la COVID-19 ................................................................................ 11
2.2.1. Les perspectives sont tributaires de la pandémie de COVID-19 et des chocs pétroliers ............. 11
2.2.2. Risques associés aux perspectives économiques ........................................................................ 16
Situation de la pauvreté .......................................................................................................................................... 19
3.1. Évolution récente de la pauvreté................................................................................................................ 19
3.1.1. À quel point les Tchadiens sont-ils pauvres ? .............................................................................. 19
3.1.2. Qui sont les pauvres au Tchad ? .................................................................................................. 20
3.1.3. Où vivent les pauvres du Tchad ? ................................................................................................ 21
3.1.4. Les pauvres ont-ils accès aux services de base au Tchad ? .......................................................... 22
3.1.5. La pauvreté diminue-t-elle au Tchad ? ........................................................................................ 23
3.1.6. Comment les pauvres gagnent-ils leurs revenus ? ...................................................................... 26
3.1.7. Il existe de nombreuses perspectives d’augmentation des revenus ruraux ................................ 28
3.1.8. Obstacles à la croissance des revenus ruraux .............................................................................. 29
3.2. Perspectives de la pauvreté en temps de la COVID-19 ............................................................................... 33
3.2.1. Impact sur le revenu du travail .................................................................................................... 36
3.2.2. Impact sur le revenu non lié au travail ........................................................................................ 36
3.2.3. Perturbations du marché (prix/quantités) ................................................................................... 37
Politiques Economiques Visant A Atténuer Les Risques Structurels Et L’impact De La COVID-19 ........................... 39
4.1. Protéger les vies.......................................................................................................................................... 39
4.2. Protéger les moyens de subsistance ........................................................................................................... 40
4.3. Protéger l’avenir ......................................................................................................................................... 41
4.4. Soutenir la reprise....................................................................................................................................... 42
Annexes ................................................................................................................................................................... 43LISTE DES FIGURES
Figure 1. : La croissance du PIB du Tchad est de plus en plus soutenue par le secteur non lié
aux hydrocarbures .................................................................................................................................... 4
Figure 2. : Sélection de pays exportateurs de pétrole – croissance estimée du PIB entre 2003 et 2019 .................. 4
Figure 3. : Tchad – Croissance du PIB réel : 1990 à 2019 et évènements historiques ............................................... 5
Figure 4. : Tchad – situation budgétaire (% du PIB non pétrolier), 2014 à 2016 ....................................................... 6
Figure 5. : Tchad – dépenses publiques (% du PIB non pétrolier), 2014 à 2019 ........................................................ 6
Figure 6. : Tendances de la dette publique (en pourcentage du PIB) ........................................................................ 8
Figure 7. : Tchad et CEMAC – Dynamique de l’inflation 2013 à 2022........................................................................ 9
Figure 8. : Tchad – Balance commerciale, 2013 à 2019 ........................................................................................... 10
Figure 9. : Tchad et CEMAC – Comptes financiers, comptes courants et réserves .................................................. 10
Figure 10. : Tchad – Nombre de cas de COVID-19 rapportés .................................................................................. 12
Figure 11. : Afrique de l’Ouest – Nombre de cas de COVID-19 rapportés ............................................................... 12
Figure 12. : Évolution économique du Tchad dans le scénario de référence, en six diagrammes ........................... 15
Figure 12.1. : Dynamique des prix des principales matières premières du Tchad
(exportations et importations) .......................................................................................................... 15
Figure 12.2. : L’épidémie de COVID-19 aura un impact sur la croissance, principalement à cause de la baisse
des prix pétroliers et des mesures de confinement .......................................................................... 15
Figure 12.3. : La réduction de la pauvreté sera par conséquent difficile en 2020 ................................................... 15
Figure 12.4. : Le déficit budgétaire se creusera à moyen terme à cause de la baisse des recettes du pétrole ...... 15
Figure 12.5. : L’accumulation des arriérés augmentera de manière marginale ...................................................... 16
Figure 12.6. : Tandis que le déficit extérieur se creusera considérablement .......................................................... 16
Figure 13. : Répartition du taux national de pauvreté par zone de résidence ......................................................... 19
Figure 14. : Part de la consommation totale par quintile et zone de résidence ...................................................... 19
Figure 15. : Répartition du taux de pauvreté par niveau d’instruction du chef de ménage (pourcentage
de personnes)....................................................................................................................................... 21
Figure 16. : Répartition du taux de pauvreté par secteur d’activité du chef de ménage (pourcentage
de personnes) ....................................................................................................................................... 21
Figure 17. : Pauvreté par zone de résidence ........................................................................................................... 22
Figure 18. : Taux de pauvreté par région ................................................................................................................. 22
Figure 19. : Pauvreté et accès aux services de base (pourcentage des ménages) ................................................... 23
Figure 20. : Accès à des conditions de logement amélioré (pourcentage des ménages) ........................................ 23
Figure 21. : Possession d’actifs (pourcentage des ménages) ................................................................................... 23
Figure 22. : Tendance de la pauvreté internationale (1,9 dollar EU, PPA de 2011) ................................................. 24
Figure 23. : Tendance de la pauvreté multidimensionnelle ..................................................................................... 25
Figure 24. : Dominance stochastique de l’indice de pauvreté multidimensionnelle ............................................... 25
Figure 25. : Indice de pauvreté multidimensionnelle par région ............................................................................. 26
Figure 26. : Composition des revenus (% du revenu) .............................................................................................. 26Figure 27. : Part des terres consacrées aux principales cultures ............................................................................. 26
Figure 28. : Rendements des cultures selon la pauvreté ......................................................................................... 26
Figure 29 : Répartition des activités sectorielles ..................................................................................................... 28
Figure 30. : Secteurs avec enregistrement formel/main-d’œuvre salariée ............................................................. 28
Figure 31. : Effectifs des migrants en pourcentage de la population ...................................................................... 30
Figure 32. : Faible pénétration des TIC au Tchad avec de fortes inégalités entre les sexes ..................................... 32
Figure 33. : Nombre de cas de COVID-19 confirmés au 18 mai 2020 (à droite) et taux de mortalité (à gauche) .... 33
Figure 34. : Canaux de transmission des impacts de la COVID-19 sur le bien-être des ménages ............................ 35
Figure 35. : Types de chocs conduisant à des stratégies d’adaptation irréparables ................................................ 36
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Tchad – Sélection d’indicateurs économiques avant la COVID-19 et projections avec la COVID-19..... 11
Tableau 2 : Dépenses militaires en pourcentage du PIB .......................................................................................... 18
Tableau 3 : Comparaison des estimations de la pauvreté entre les pays sahéliens ................................................ 20
Tableau 4 : Sélection de caractéristiques sociodémographiques des pauvres ........................................................ 21
Tableau 5 : Simulation de l’impact de la COVID-19 sur le bien-être des ménages .................................................. 35
Tableau 6 : Mesures de confinement et d’atténuation ........................................................................................... 43
Tableau 7 : Indicateurs économiques sélectionnés dans les scénarios de référence et pessimiste ........................ 44
LISTE DES ENCADRÉS
Encadré 1 : Aperçu du mécanisme de gestion des recettes pétrolières .................................................................... 6
Encadré 2 : Tchad – Problèmes de sécurité régionaux ............................................................................................ 17
Encadré 3 : Imputation enquête à enquête ............................................................................................................. 24ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
AVD Analyse de la viabilité de la dette
BAD Banque africaine de développement
BCEAO Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
BOAD Banque ouest-africaine de développement
CERC Composantes d'intervention d'urgence conditionnelle
COVID-19 Maladie à coronavirus 2019
DPO Opérations de la politique de développement
EHCVM Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages
EMC Enquête multisectorielle continue
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FCR Facilité de crédit rapide
FEC Facilité élargie de crédit
FIES Insécurité alimentaire fondée sur l'expérience vécue
FMI Fonds monétaire international
ICH Indice de capital humain
IDE Investissement direct à l'étranger
INSD Institut national de la statistique et de la démographie
IPC Indice des prix à la consommation
IUTS Impôt unique sur les traitements et salaires
KNOMAD Partenariat mondial pour la connaissance sur la migration et le développement
MPME Micro, petites et moyennes entreprises
NFC Communication en champ proche
OEC Observatoire de la complexité économique
OMS Organisation mondiale de la santé
ONEA l’Office national de l’eau et de l’assainissement
PADL-B Projet d'appui au développement de l'élevage au Burkina
PAPSA Projet d’amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire
PDI Personnes déplacées internes
PGE Publique et garantie par l’État
PIB Produit intérieur brut
PNDES Plan national de développement économique et social
PNP Prêts non performants
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PPA Parité de pouvoir d’achat
PRECA Projet de résilience et de compétitivité agricole
PUS/BF Programme d'urgence pour le Sahel/Burkina Faso
SFI Société financière internationale
SICA Système interbancaire de compensation automatisé
SONAGESS Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire
TIC Technologies de l'information et de la communication
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
WDI Indicateurs du développement dans le monde
WISN Indicateurs de la charge de travail besoin en personnel
Tchad iRÉSUMÉ ANALYTIQUE
1. Jusqu’en février 2020, l’économie tchadienne poursuivait sa reprise progressive, bien que modeste, soutenue
par une augmentation significative de la production pétrolière et agricole. À la suite de la récession sévère de
2016-2017, la croissance s’est redressée à 2,4 % en 2018 et 3,2 % en 2019. Cette reprise a principalement été
attribuée à l’accroissement de la production pétrolière et agricole (en particulier le coton en raison de la
privatisation de CotonTchad ou Société cotonnière du Tchad société nouvelle). La croissance du Produit intérieur
brut (PIB) non pétrolier est également passée de -0,9 % en 2017 à 2,2 % en 2019 avec la reprise du secteur des
services.
2. Des programmes réussis d’assainissement des finances publiques ont contribué à l’amélioration de l’équilibre
budgétaire et à la soutenabilité de la dette. Suite au choc pétrolier de 2014, la baisse des recettes pétrolières et
des dépenses publiques a motivé la mise en place d’un programme d’assainissement budgétaire. Les autorités
ont contenu la masse salariale et intensifié leurs efforts de mobilisation des recettes non pétrolières. Le déficit
budgétaire global a ainsi diminué de -5,8 % du PIB non pétrolier en 2015 à -0,8 % en 2019. L’État a également
restructuré sa dette à l’égard de Glencore, ce qui a permis le rétablissement de la liquidité et la soutenabilité de
la dette. La dette publique a diminué, passant du niveau record de 54,8 % du PIB atteint en 2016 à 44,3 % en
2019, même si le risque de surendettement reste élevé.
3. L’inflation est demeurée volatile, avec un durcissement de la politique monétaire. Le resserrement de la
politique monétaire régionale, entrepris depuis 2018 pour soutenir l’accumulation de réserves régionales, a
permis de contenir les pressions inflationnistes. Malgré le rétrécissement progressif du déficit de production,
l’inflation enregistrait qu’une baisse de 1 % en 2019, reflétant les prix modérés des transports et de
l’alimentation. En dépit d’une légère amélioration de sa position de liquidité, le secteur bancaire présente encore
d’importantes vulnérabilités en raison du volume élevé des prêts non performants. Le taux d’intérêt directeur
s’est maintenu à 3,50 %, permettant aux réserves régionales officielles d’atteindre 3,3 mois d’importations en
2019.
4. Le déficit du compte courant s’est creusé en raison d’une augmentation des importations liées à
l’investissement direct étranger (IDE) destiné à plusieurs champs pétrolifères en cours de développement. En
termes réels, la croissance des exportations a atteint 6 % grâce à l’accroissement de la production pétrolière de
la China National Petroleum Corporation (CNPC), le principal producteur de pétrole du Tchad. En parallèle, la
CNPC développait plusieurs champs pétrolifères pour accroître la production à moyen terme, ce qui s’est traduit
par une augmentation des importations de matériaux et autres intrants. Les importations ont, par conséquent,
grimpé de 4 %. Le déficit a été financé par des dons pour des projets et par des IDE, qui ont augmenté à 4,3 % du
PIB en 2019.
5. Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a radicalement changé les perspectives macroéconomiques du
Tchad, comme dans le reste du monde. Même si le nombre de cas de la COVID-19 était encore faible à la fin avril
2020, les effets néfastes de la pandémie ne concernent pas tant la contagion directe que la récession économique
mondiale et l’effondrement des prix internationaux du pétrole qu’elle a déclenché. Le secteur pétrolier du Tchad,
qui représente 90 % des exportations et 40 % des recettes publiques, a été sévèrement touché. La baisse de
la demande des exportations, la réduction des apports des IDE, la fermeture des frontières, et les mesures
de distanciation sociale risquent de replonger le Tchad dans une récession en 2020, avec une contraction
de l’économie projetée à 0,2 % (par rapport au taux de croissance de 4,8 % prévu avant la COVID-19). Le déficit
Tchad 1Résumé Analytique
du compte courant se creusera, les recettes budgétaires et les dépenses publiques diminueront, alors que
l’accumulation accrue des arriérés devrait se poursuivre. Si l’impact de la crise de la COVID-19 s’atténuait dans
les mois à venir, un rebond de la croissance est prévu à hauteur de 4,7 % en 2021 avec l’accélération de la
production dans les nouveaux champs pétrolifères, le rétablissement des prix du pétrole et si les mesures de fin
de confinement étaient assouplies.
6. Les perspectives économiques du Tchad ont non seulement été assombries, mais elles présentent encore des
risques importants de ralentissement. Tout d’abord, les conflits régionaux peuvent mettre le budget de l’État à
rude épreuve avec l’arrivée de nouveaux réfugiés des pays voisins. Ensuite, les élections législatives et
présidentielles provisoirement prévues au quatrième trimestre de 2020 et au deuxième trimestre de 2021
pourraient peser sur les finances publiques. Enfin, la persistance de l’épidémie de COVID-19 et la chute des prix
du pétrole pourraient provoquer une grave récession à moyen terme et creuser les déficits budgétaires et ceux
du compte courant. Cela pourrait également entraîner une accumulation des arriérés intérieurs et accroître la
vulnérabilité du secteur financier. La fermeture prolongée des frontières pourrait diminuer l’approvisionnement
en biens essentiels et entraîner une hausse des prix, qui pourrait impacter les populations les plus pauvres et plus
vulnérables. Le Tchad pourrait atténuer ces risques en renforçant le secteur de la santé afin d’éviter une nouvelle
vague de la COVID-19 et en améliorant la mobilisation des recettes non pétrolières. À moyen terme, le
Gouvernement devrait mettre en œuvre des politiques favorables aux affaires afin d’encourager la diversification
économique et une croissance durable.
7. Bien que le taux de pauvreté a diminué au cours des quinze dernières années, il reste néanmoins élevé dans
le pays. Environ 6,5 millions de Tchadiens (42 % de la population) vivent en dessous du seuil national de pauvreté.
Les ménages pauvres ont davantage d’enfants, peu d’instruction, et travaillent dans le secteur agricole avec des
conditions de production défavorables. Malgré une amélioration de la situation non monétaire des Tchadiens,
les conditions de vie des pauvres continuent à se détériorer et sont exacerbées par un faible accès aux services
de base tels que l’eau potable, l’assainissement et l’électricité, ainsi qu’un accès limité aux actifs.
8. Il existe une forte disparité dans la distribution de la pauvreté selon les régions, le nord étant moins confronté
à la pauvreté que les autres régions, à l’exception de la capitale. En plus de la pauvreté, les Tchadiens souffrent
de fortes inégalités dans la répartition du bien-être : les 20 % les plus riches représentent plus de 40 % de la
consommation totale contre 8 % pour les 20 % les plus pauvres. Les politiques de lutte contre la pauvreté à
mettre en œuvre devraient prévoir des investissements dans les services de base. Elles devraient également
cibler le secteur informel qui emploie la majeure partie des citadins pauvres, et s’attaquer aux différentes
contraintes qui entravent la croissance des revenus ruraux, telles que le manque d’infrastructures, le faible capital
humain, l’absence de services complémentaires, les disparités entre les sexes, les chocs et la fragilité.
9. À court terme, il est urgent de soutenir la population la plus pauvre et vulnérable qui pourrait être touchée
de manière disproportionnée par la crise de la COVID-19, en particulier les personnes fortement tributaires des
envois de fonds intérieurs. Afin d’atténuer les effets de cette crise, le Gouvernement est encouragé à renforcer
la qualité et l’accès des services de santé, en particulier de la population pauvre. Il est également recommandé
de prévoir des systèmes de filets sociaux ciblant les plus pauvres et les personnes vulnérables pour atténuer
l’impact des pertes de revenus d’emplois et d’autres sources de revenus et celui d’une potentielle inflation des
prix des biens essentiels qui découlent des perturbations sur les marchés.
2 TchadRésumé Analytique
10. Pour atténuer les effets négatifs de la COVID-19 au Tchad, les autorités ont annoncé, au cours des derniers
mois, des mesures économiques et sociales destinées à soutenir les ménages et les entreprises privées. Les
autorités devraient continuer de renforcer certaines de ces mesures tout en introduisant de nouvelles visant à
protéger les vies, les moyens de subsistance et l’avenir. Pour protéger les vies, elles devraient améliorer l’aptitude
à tester et traiter les patients atteints de la COVID-19 et renforcer la sensibilisation de la population. Pour
protéger les moyens de subsistance, elles devraient diminuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19
sur le revenu des ménages, en garantissant le paiement des salaires des fonctionnaires, en améliorant les
programmes de filets de sociaux, et en renforçant la sécurité alimentaire. Pour protéger l’avenir, elles devraient
évaluer la capacité des entreprises publiques d’assurer une fourniture continue des services de base (en
particulier, l’eau et l’électricité) aux citoyens pendant la crise et maintenir le fonctionnement des services
financiers publics essentiels. En outre, elles devraient atténuer l’impact des chocs extérieurs sur l’économie
tchadienne en élargissant l’assiette fiscale, renforçant la capacité de recouvrement des administrations fiscales
et douanières, et en adoptant des réformes audacieuses et favorables aux affaires afin d’accélérer la
diversification économique.
Tchad 3SITUATION DE L’ÉCONOMIE
Évolution et perspectives économiques récentes
2.1.1. Secteur réel : Depuis 2018, l’économie tchadienne poursuit sa modeste reprise progressive
11. En 2016 et 2017, le choc pétrolier de 2014 a entraîné une récession sévère. Au Tchad, l’effondrement des
prix d’exportation du pétrole de 98 dollars EU/baril en 2014 à 49,4 dollars EU/baril en 2017 a entraîné une baisse
cumulée du PIB de 9,5 % au cours de la période (figure 1). Les recettes budgétaires liées au pétrole ont chuté de
11,7 % du PIB non pétrolier en 2014 à 3,5 % en 2016. Le déficit budgétaire s’est creusé de 3 % du PIB non
pétrolier, malgré une forte diminution des investissements avec financement intérieur (de 9,8 % à 1,7 % du PIB
non pétrolier). Le compte courant extérieur a également augmenté pour atteindre 9,2 % du PIB. La récession a
été aggravée par la faible diversification économique, la pauvreté généralisée et les problèmes de sécurité. En
2016, le Gouvernement tchadien a lancé un plan d’assainissement budgétaire d’urgence, y compris une
budgétisation basée sur la trésorerie, qui a conduit à une nette amélioration de l’équilibre fiscal en 2017. Durant
la même année, le pays a, néanmoins, eu des difficultés pour rétablir de son économie qui est restée en
récession.
12. La croissance a repris pour atteindre 2,4 % en 2018, et est estimée à 3,2 % en 2019. Le Tchad est sorti de la
crise en 2018 avec une forte reprise dans la production pétrolière qui a augmenté de 11,1 % (figure 1). La
croissance positive du PIB s’est poursuivie en 2019 en raison d’une nouvelle hausse de la production pétrolière
et d’une reprise significative du secteur non pétrolier. Le secteur primaire (essentiellement les sous-secteurs
agricole et pétrolier) reste le principal moteur de l’économie, contribuant pour environ deux tiers au taux de
croissance de 2019. Les contributions des secteurs secondaire et tertiaire (principalement les services liés au
pétrole) s’établissaient respectivement à 0,1 et 0,7 point de pourcentage. Alors que l’écart négatif de production
se comble, l’inflation a diminué pour passer de 4 % en 2018 à -1 % en 2019, reflétant la baisse des prix du
transport et de l’alimentation.
Figure 1. : La croissance du PIB du Tchad est de Figure 2. : Sélection de pays exportateurs de
plus en plus soutenue par le secteur non lié pétrole – croissance estimée du PIB entre
aux hydrocarbures 2003 et 2019
35 PIB lié aux hydrocarbures 2004-2014 2015-2017 2018-2019
30 10
PIB non lié aux hydrocarbures 8
25
6
20 PIB réel 4
% évolution
15 2
0
10
-2
5 -4
0 -6
-8
-5
Tchad
Gabon
Rép. du Congo
Angola
Cameroun
Guinée équatoriale
ASS
Nigeria
-10
-15
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019e
2020p
2021p
2022p
Source : Estimations des autorités tchadiennes et du Source : Perspectives de la macro-pauvreté de la Banque
personnel de la Banque mondiale. mondiale.
4 TchadSituation de l’Économie
13. En termes structurels, la reprise s’est appuyée sur les deux principaux moteurs historiques de la croissance
du Tchad : la stabilité politique et les bons résultats de la production pétrolière. Au cours des trois dernières
décennies, la croissance a été principalement définie par le pétrole et l’insécurité (figure 3). Entre 1990 et 2002
(l’année précédant le début de la production pétrolière), la production a progressé en moyenne de 4 % par an.
Le boom pétrolier du début des années 2000 a permis au Tchad de stimuler son PIB par habitant, qui est passé
de 220,8 dollars EU en 2002 à 660,2 dollars EU en 2005 ; ce qui l’a ainsi rapidement démarqué des autres pays à
faible revenu et a réduit l’important écart de revenus avec la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Plusieurs
périodes d’insécurité nationale et régionale sont venues s’ajouter à une incapacité générale à porter la croissance
à des niveaux plus rapides et durables. Enfin, à cause de la dépendance continue à l’égard du pétrole, l’économie
est moins diversifiée, moins compétitive et plus vulnérable aux chocs exogènes.
Figure 3. : Tchad – Taux de croissance du PIB réel : 1990 à 2019 et événements historiques
50
Accord Début de la
de paix production
40 260 millions d'USD pétrolière
Pourcentage (%)
d'allégement Stabilité
30 de la dette politique
Conflits Chute des prix
20 Conflit intérieur intérieurs pétroliers
Rébellion Sécheresse
10 armée
0
2005
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
-10
-20
Phase 1 : période prépétrolière
Phase 2 : période postpétrolière
`
Source : Banque mondiale.
2.1.2. Finances publiques : excédents budgétaires modérés et espace budgétaire amélioré
14. En 2019, l’assainissement budgétaire a stagné, mais les soldes budgétaires sont restés compatibles avec la
stabilité macroéconomique. Le solde budgétaire global (dons compris) est passé d’un excédent de 1,9 % du PIB
non pétrolier en 2018 à un déficit de -0,8 % en 2019. Les recettes budgétaires totales ont diminué en raison d’une
baisse des dons destinés au budget ainsi que des recettes pétrolières. De plus, les dépenses totales ont augmenté
de presque 2 % du PIB non pétrolier, principalement en raison d’une croissance de 12 % de la masse salariale et
d’une augmentation des dépenses de sécurité (voir figure 4).
15. Malgré une meilleure mobilisation des recettes non pétrolières, les recettes budgétaires ont diminué en
2019 en raison d’une baisse des dons destinés au budget et des recettes pétrolières. D’une part, les recettes non
pétrolières ont augmenté de 8,1 % du PIB non pétrolier en 2018 à environ 9,4 % en 2019 grâce à deux réformes.
Premièrement, le seuil de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a augmenté pour les grandes entreprises, et un
service est désormais dédié au traitement de la TVA. Accompagnée d’une pénalité de 15 % en cas de non-respect,
cette mesure a amélioré le recouvrement et la conformité de l’impôt. Deuxièmement, les impôts sont désormais
payés par les banques commerciales, réduisant ainsi les coûts de transaction pour les contribuables. D’autre part,
la baisse des prix pétroliers a entraîné une légère baisse des recettes pétrolières de 6,7 % du PIB non pétrolier en
2018 à 6,4 % en 2019. L’appui budgétaire a également diminué de plus de 2 points de pourcentage à cause des
décaissements retardés à la fois par la Banque mondiale et de l’Union européenne.
Tchad 5Situation de l’Économie
Figure 4. : Tchad – situation budgétaire Figure 5. : Tchad – dépenses publiques (% du PIB
(% du PIB non pétrolier), 2014 à 2016 non pétrolier), 2014 à 2019
Dépenses totales Dépenses d'investissement
Recettes totales Dépenses courantes
Solde budgétaire total (échelle de droite)
Dépenses totales
Recettes liées aux hydrocarbures
40 Salaires et rémunérations
100 5.0
Pourcentage du PIB
Pourcentage du PIB
30
0.0
50 20
-5.0
10
0 -10.0 0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020p
2021p
2022p
2019e
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020p
2021p
2022p
2019e
Source : Estimations des autorités tchadiennes et du Source : Estimations des autorités tchadiennes et du
personnel de la Banque mondiale personnel de la Banque mondiale.
16. Malgré un accroissement de la masse salariale dû à l’augmentation des indemnités des fonctionnaires, les
dépenses publiques ont été contenues en 2019. Le total des dépenses publiques a augmenté de 16,5 % du PIB
non pétrolier en 2018 à 18 % en 2019, augmentation principalement attribuable à la masse salariale. En
octobre 2018, le Gouvernement a accepté d’augmenter les primes et indemnités des fonctionnaires de 15 points
de pourcentage à la suite d’une grève qui a duré 5 mois. Cet accord est entré en vigueur en janvier 2019. En
outre, le Gouvernement a complètement rétabli les indemnités du personnel militaire. La masse salariale totale
(5,4 % du PIB) est néanmoins restée dans les limites recommandées dans le programme de Facilité de crédit
élargie du Fonds monétaire international (FMI) visant à maintenir la soutenabilité financière. Par ailleurs, les
investissements de capitaux ont augmenté de 4,5 % du PIB non pétrolier en 2018 à 5,6 % en 2019 (voir figure 5).
En même temps, la rationalisation des dépenses fiscales pourrait permettre de réaliser des économies estimées
à environ 0,7 % du PIB par an.
Encadré 1. : Aperçu du mécanisme de gestion des recettes pétrolières
L’objectif du mécanisme de gestion des recettes pétrolières (ORMM – Oil Revenue Management Mechanism)
est d’introduire une dimension contracyclique dans la gestion des recettes pétrolières afin d’éviter une
volatilité budgétaire excessive. Par exemple, une baisse inattendue, en 2015, des recettes pétrolières a suivi
le choc pétrolier et a entraîné une grave crise économique et financière, y compris un manque de liquidité, un
surendettement et une forte récession. Sans mécanisme de stabilisation en place, le Gouvernement n’a eu
d’autres choix que d’absorber l’impact de ces chocs par des réductions importantes des dépenses
accompagnées d’une accumulation des arriérés.
Le Gouvernement a créé l’ORMM avec deux missions. La première consiste à mettre en réserve des recettes
pétrolières en vue d’amortir l’impact budgétaire qui découle directement de la baisse inattendue de ces
recettes. La deuxième consiste à fournir une assurance contre le risque de baisses inattendues des recettes
pétrolières au-delà de 10 % du montant des revenus pétroliers prévus dans le budget. De telles baisses sont
plus ou moins induites par les prix du pétrole qui étaient tombés sous les 5 dollars EU/baril, événement dont
la probabilité d’occurrence était estimée à 19 %. Le record historique de plus de la moitié des chutes des prix
du pétrole confirme qu’elles n’ont jamais été supérieures à 5 dollars EU/baril.
L’ORMM est un fonds de stabilisation (FS) ayant i) une règle d’épargne (entrées) ; ii) une règle de dépense
(sorties) ; et iii) une formule pour l’estimation des recettes pétrolières dans le budget.
6 TchadSituation de l’Économie
Règle d’épargne :
• Un montant de 10 milliards de francs CFA sera versé chaque année dans le FS à l’aide de paiements
trimestriels.
• De plus, si le montant des recettes pétrolières réelles dépassait celui prévu dans le budget, 20 % de
cet excédent sera versé dans le FS à hauteur d’un montant maximum de 10 milliards de francs CFA.
Par conséquent, l’apport financier annuel peut donc atteindre un montant qui se situe entre 10 et
20 milliards de francs CFA.
• Le solde maximum du FS est plafonné à 40 milliards de francs CFA. En l’absence de retraits, le FS
maintiendra sa pleine capacité pendant au moins deux ans et pour une période maximum de 4 ans.
• Le solde maximum du FS sera alors alimenté par le ministre des Finances après deux ans de mise en
œuvre.
Règle de dépense :
• Les retraits du FS sont automatiquement réalisés lorsque les recettes pétrolières réelles sont
inférieures de 10 % (ou plus) aux recettes pétrolières prévues dans le budget.
• Les baisses des recettes pétrolières inférieures à 10 % des recettes pétrolières budgétisées seront
compensées par des ajustements de dépenses.
• Les baisses supérieures à 10 % des recettes pétrolières budgétisées seront compensées en fonction
des ressources disponibles dans le FS.
• Le FS peut uniquement être utilisé pour financer des dépenses prévues dans budget d’une année
fiscale donnée. Il ne peut régler aucune dette souveraine ou commerciale de l’État ni générer des
intérêts légaux ou bénéficiaires.
Critères à utiliser pour l’estimation des recettes pétrolières dans le budget
Les recettes pétrolières budgétisées doivent être estimées à l’aide d’hypothèses prudentes : les prix du pétrole
seront fixés à minimum 3 dollars EU/baril de moins que ceux du pétrole brut publié dans les Perspectives
économiques mondiales du FMI. Le volume de production correspondra à un volume de production réduit
d’un maximum de 10 % par rapport à celui déjà estimé par les compagnies pétrolières actives au Tchad.
Source : Banque mondiale, 2020.
17. Le Gouvernement a promulgué la création d’un mécanisme de gestion des recettes pétrolières pour
promouvoir la stabilisation fiscale.2 Les principaux objectifs de ce mécanisme sont de mettre en réserve des
recettes pétrolières en vue d’amortir l’impact budgétaire de baisses inattendues de ces recettes et de fournir
une assurance contre le risque de baisses inattendues des recettes pétrolières qui dépasseraient de 10 % celles
qui sont déjà prévues dans le budget. Dans l’ensemble, ce mécanisme est un fonds de stabilisation doté d’une
règle d’épargne, d’une règle de dépense et d’une formule pour l’estimation des recettes pétrolières dans
le budget.
2 La loi 0040/PR/2019 sur le lissage des prix et de la production de pétrole, qui comprend le nouveau mécanisme de gestion des recettes
pétrolières, a été promulguée le 27 novembre 2019.
Tchad 7Situation de l’Économie
2.1.3. Accorder la priorité aux problèmes de la dette : restructuration de la dette et amélioration de
sa gestion ont permis de réduire le risque de surendettement
18. Après une décennie de forte augmentation, la dette publique du Tchad a diminué au cours des dernières
années. L’encours de la dette a culminé à 51,4 % du PIB en 2016, après une forte augmentation de la dette
intérieure qui a depuis diminué en pourcentage du PIB grâce à une croissance significative enregistrée par le PIB
et à une politique budgétaire plus prudente (figure 9). En 2019, la dette totale a été estimée à 44,4 % du PIB. La
dette extérieure a diminué grâce à la restructuration du prêt garanti par le pétrole de Glencore, tandis que la
dette intérieure a diminué, puisque le Tchad a cessé d’emprunter à la Banque des États de l’Afrique centrale
(BEAC) à la suite de la restructuration des avances de la BEAC en 2017.
Figure 6. : Tendances de la dette publique (en pourcentage du PIB)
60
51.4 49.7
50 48.2
43.8 44.2
40 24.4 24.6 23.1
18.3 19.8
30
20
25.5 27 25.1 25.1 24.4
10
0
2015 2016 2017 2018 2019
Dette extérieure Dette intérieure Dette totale
Source : Estimations des autorités tchadiennes, de créanciers choisis, de la Banque mondiale et du FMI.
19. Depuis 2018, le Gouvernement a fait des progrès considérables dans le règlement des arriérés extérieurs,
alors que l’audit des arriérés intérieurs était achevé. Au cours des deux premiers trimestres de 2018, des
déclarations erronées du service chargé de la dette ont entraîné une accumulation temporaire d’arriérés
extérieurs. Cependant, en mai 2018, le Tchad a signé un accord de principe avec la Libyan Foreing Bank en vue
d’apurer les arriérés et de rééchelonner le remboursement, y compris un délai de grâce de 18 mois. Le
Gouvernement a également apuré tous les arriérés dus à la Banque islamique de développement, réduisant ainsi
ses arriérés de paiements extérieurs à 63 millions de dollars EU. Des discussions sont en cours sur le règlement
des arriérés avec la République du Congo (le principal créancier des 55 millions de dollars EU), la Guinée
équatoriale et la Mega Bank. Les arriérés de paiements extérieurs ont été résorbés suite à la signature d’une
convention de dette avec l’Angola en juin 2019.
2.1.4. Situation monétaire : inflation modérée dans le cadre d’un durcissement de la politique
monétaire
20. La politique monétaire régionale a été durcie au cours des dernières années afin de soutenir l’accumulation
de réserves régionales. En 2019, la BEAC a maintenu son taux directeur à 3,5 %, qui affiche une augmentation
par rapport aux 2,95 % d’octobre 2018. Les réserves brutes ont par conséquent été estimées à l’équivalent de
3,3 mois en 2019. L’assainissement budgétaire au niveau régional et la politique de rapatriement des réserves
ont également aidé à soutenir l’accumulation de réserves. Néanmoins, la couverture des importations par les
réserves reste toutefois en deçà des niveaux requis (5 mois d’importation) pour une union monétaire riche en
ressources.
8 TchadSituation de l’Économie
21. L’inflation a été volatile et a fortement baissé au second semestre 2019. À la suite d’une importante baisse
de la demande intérieure, l’inflation a fortement diminué en 2016 et 2017, pour se stabiliser à environ -1 %. Elle
a commencé à remonter avec la reprise économique, pour s’établir à 4 % en 2018. Une inflexion de l’inflation a
toutefois été observée au cours du deuxième semestre 2019, principalement en raison de la baisse modérée des
prix du transport et de l’alimentation qui découlent directement de la chute des prix du pétrole et des coûts de
production. L’inflation annuelle s’est donc établie à -1 % en 2019 (figure 5), mais toujours en dessous des critères
de convergence de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).
22. Malgré une légère amélioration de la position de liquidité, les vulnérabilités du secteur bancaire restent
importantes. Par rapport à fin 2018, l’activité bancaire s’est redressée avec une augmentation de 4,6 % des
crédits et de 25,7 % des dépôts en 2019. Bien que toujours élevée, la part des prêts non performants (PNP) par
rapport au nombre total des prêts, est passée à 27 % en 2019 contre 31,4 % à la fin décembre 2018. La liquidité
du secteur bancaire a continué de s’améliorer et le refinancement de la BEAC a chuté de 160 milliards de francs
CFA en décembre 2018 à 93,7 milliards de francs CFA en 2019.
Figure 7. : Tchad et CEMAC – Dynamique de l’inflation 2013 à 2022
5.0
4.0
moyenne périodique
% d'évolution,
3.0
2.0
1.0
0.0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019e
2020p
2021p
2022p
-1.0
-2.0
Source : Estimations des autorités tchadiennes et du personnel de la Banque mondiale.
23. Les autorités font des progrès pour corriger les vulnérabilités du système bancaire, renforcer la position des
banques publiques, et améliorer l’aptitude du secteur bancaire à contribuer efficacement à la croissance. En
juin 2019, les autorités ont examiné et élaboré des plans pour réorganiser les activités des deux banques
publiques en difficulté. Les organes de décision compétents ont adopté ces plans en décembre 2019. De plus, les
autorités se sont engagées à corriger toutes les faiblesses identifiées et à améliorer la structure de gouvernance
de ces deux banques. La priorité absolue est de remédier au niveau élevé des PNP.3
2.1.5. Position extérieure : réduction du déficit du compte courant grâce à l’augmentation des exportations de
pétrole et au durcissement de la politique monétaire
24. Le déficit du compte courant s’est légèrement creusé en 2019, en raison d’une augmentation des
importations liées aux IDE destinés à plusieurs champs pétrolifères en développement. Les exportations ont
augmenté pour atteindre 6 % grâce à l’accroissement de la production pétrolière de la CNPC, le principal
producteur de pétrole du Tchad. En même temps, les importations se sont accélérées pour atteindre 4 % avec le
redressement de la consommation intérieure et l’achat d’équipement pour le développement des nouveaux
3
FMI, 2019. « Tchad – Cinquième examen de l’accord au titre de la facilité élargie de crédit et examen des garanties de financement »,
décembre 2019.
Tchad 9Vous pouvez aussi lire