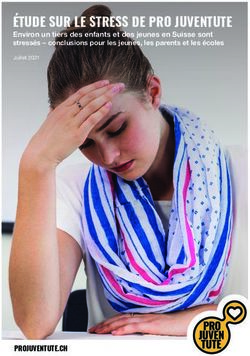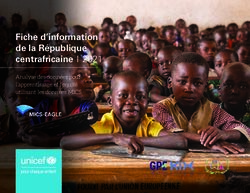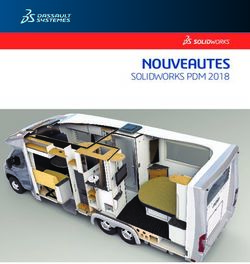Étude de la voie des polyols dans le placenta en prééclampsie - Mémoire Catherine Routhier Maîtrise en physiologie-endocrinologie - Corpus UL
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Étude de la voie des polyols dans le placenta en
prééclampsie
Mémoire
Catherine Routhier
Maîtrise en physiologie-endocrinologie
Maître ès sciences (M. Sc.)
Québec, Canada
© Catherine Routhier, 2014Résumé
La prééclampsie (PE) est une pathologie obstétricale complexe associée à un défaut de placentation. Selon la
littérature, le placenta anormalement développé libèrerait des facteurs qui induiraient une dysfonction
endothéliale maternelle. Nous avons émis comme hypothèse qu’une accumulation de sorbitol, un sucre
hyperosmotique produit par la voie des polyols, pourrait induire la libération par le placenta de sFlt-1, un
facteur anti-angiogénique antagoniste du VEGF en PE. Nous avons comparé les niveaux d’expression
d’ARNm et de protéines de AKR1B1 et SORD, les deux enzymes impliquées dans la voie des polyols, dans
les placentas de mères ayant eu une grossesse normotensive (groupe témoin) ou prééclamptique par RT-
PCR quantitatif et par immunobuvardage respectivement. Nous les avons ensuite localisées par
immunohistochimie. Nos résultats suggèrent que la voie des polyols serait altérée au niveau de la membrane
amniochorionique des placentas issus de grossesses prééclamptiques, ce qui pourrait favoriser une
accumulation de sorbitol à l’interface fœto-maternelle.
iiiAbstract
Preeclampsia (PE) is a complex obstetrical pathology associated to a defective placentation. The abnormally
developed placenta is believed to release factors causing a maternal endothelial dysfunction. We
hypothesized that an accumulation of sorbitol, a hyperosmotic sugar produced through the polyol pathway,
could induce the release by the placenta of sFlt-1, an antagonist of the angiogenic factor VEGF in PE. We
compared mRNA and protein expression levels of AKR1B1 and SORD, the two enzymes of the polyol
pathway, in placentas from normotensive (control) and PE pregnancies by quantitative RT-PCR and
immunoblotting respectively. Then, we localized the two enzymes by immunohistochemistry. Our results
suggest that polyol pathway is altered in amniochorionic membranes from PE pregnancies, and that this
phenomenon would promote sorbitol accumulation at the foeto-maternal interface.
vTable des matières
Résumé ............................................................................................................................................................. iii
Abstract.............................................................................................................................................................. v
Table des matières .......................................................................................................................................... vii
Liste des tableaux ............................................................................................................................................ xi
Liste des figures ............................................................................................................................................. xiii
Liste des abréviations..................................................................................................................................... xv
Remerciements .............................................................................................................................................. xix
Avant-propos .................................................................................................................................................. xxi
Chapitre 1 : Introduction................................................................................................................................... 1
1.1) Les troubles hypertensifs de la grossesse .............................................................................................. 1
1.2) Définition de la prééclampsie .................................................................................................................. 2
1.3) Les facteurs de risque ............................................................................................................................. 2
1.4) Les causes de la pathologie .................................................................................................................... 4
1.5) Le placenta .............................................................................................................................................. 5
1.5.1) Anatomie du placenta humain ......................................................................................................... 6
1.5.1.1) Plaque basale ........................................................................................................................... 6
1.5.1.2) Plaque chorionique ................................................................................................................... 6
1.5.1.3) Espace intervilleux et les villosités choriales ............................................................................. 7
1.5.2) Les fonctions du placenta ................................................................................................................ 8
1.6) Les deux stades de la prééclampsie ....................................................................................................... 8
1.6.1) La placentation normale versus la placentation en prééclampsie ................................................... 8
1.6.2) Libération de facteurs circulatoires et dysfonction endothéliale..................................................... 10
1.7) Conséquences de la prééclampsie ....................................................................................................... 11
1.7.1) Hypertension ................................................................................................................................. 12
1.7.2) Éclampsie ...................................................................................................................................... 12
1.7.3) Syndrome HELLP .......................................................................................................................... 13
1.7.4) Atteinte rénale ............................................................................................................................... 13
1.7.5) Conséquences à long terme.......................................................................................................... 13
1.8) Prévention ............................................................................................................................................. 14
1.9) Le stress osmotique .............................................................................................................................. 14
1.10) La voie des polyols .............................................................................................................................. 15
1.10.1) L’aldose réductase ...................................................................................................................... 16
1.10.1.1) Le rôle de AKR1B1 au niveau de l’osmorégulation ............................................................... 18
1.10.1.2) AKR1B1 en tant que prostaglandine synthase...................................................................... 19
vii1.10.1.3) AKR1B1 dans la réduction des aldéhydes ............................................................................ 20
1.10.1.4) AKR1B1 dans le métabolisme des catécholamines .............................................................. 21
1.10.1.5) AKR1B1 dans le métabolisme des stéroïdes ........................................................................ 21
1.10.2) La sorbitol déshydrogénase ......................................................................................................... 21
1.10.3) Le transport du sorbitol ................................................................................................................ 22
1.10.4) Les rôles physiologiques de la voie des polyols .......................................................................... 22
1.10.4.1) Filtration glomérulaire ............................................................................................................ 24
1.10.4.2) La voie des polyols dans le tissu oculaire ............................................................................. 24
1.10.4.3) La voie des polyols dans le système nerveux ....................................................................... 25
1.10.4.3) La voie des polyols dans le tissu reproducteur...................................................................... 26
1.10.5) La voie des polyols durant la grossesse ...................................................................................... 26
1.10.6) Implication dans la maladie du diabète ........................................................................................ 27
1.10.6.1) La formation d’AGEs ............................................................................................................. 27
1.10.6.2) Activation de la voie de la Protéine Kinase C (PKC) ............................................................. 28
1.11) Problématique et objectifs ................................................................................................................... 28
Chapitre 2 : The polyol pathway is altered in the preeclamptic placenta................................................... 31
2.1) Résumé ................................................................................................................................................. 31
2.2) Abstract ................................................................................................................................................. 33
2.3) Introduction ............................................................................................................................................ 34
2.4. Methods ................................................................................................................................................. 35
2.4.1) Patients recruitment ....................................................................................................................... 35
2.4.2) Placenta samples collection .......................................................................................................... 35
2.4.3) Quantitative RT-PCR ..................................................................................................................... 35
2.4.4) Western blot analysis..................................................................................................................... 36
2.4.5) Immunohistochemistry ................................................................................................................... 37
2.4.6 Statistical analysis........................................................................................................................... 37
2.5) Results................................................................................................................................................... 38
2.5.1) Characteristics of the study population .......................................................................................... 38
2.5.2) AKR1B1 and SORD mRNA expression in the placenta................................................................. 38
2.5.3) AKR1B1 and SORD protein expression in the placenta ................................................................ 38
2.5.4) AKR1B1/SORD expression ratios.................................................................................................. 38
2.5.6) AKR1B1 and SORD immunolocalization in placental layers.......................................................... 39
2.6) Discussion ............................................................................................................................................. 39
2.7) Acknowledgments ................................................................................................................................. 40
2.8) References ............................................................................................................................................ 40
2.9) Figures legends ..................................................................................................................................... 42
Chapitre 3 : Discussion................................................................................................................................... 51
viii3.1 Retour sur les méthodes ........................................................................................................................ 51
3.1.1 Échantillonnage .............................................................................................................................. 51
3.1.2 Mode d’accouchement.................................................................................................................... 51
3.1.3 RT-PCR quantitatif.......................................................................................................................... 52
3.1.4 Immunobuvardage .......................................................................................................................... 53
3.1.5 Immunolocalisation ......................................................................................................................... 53
3.2 Retour sur les résultats........................................................................................................................... 54
3.2.1 AKR1B1 .......................................................................................................................................... 54
3.2.2 SORD ............................................................................................................................................. 54
3.3 Comparaisons avec la littérature ............................................................................................................ 55
3.4 Perspectives ........................................................................................................................................... 57
Bibliographie ................................................................................................................................................... 61
Annexe 1 : Tables d’ANOVA........................................................................................................................... 69
Annexe 2 : Dosage de l’expression génique de Gadd45α par RT-PCR quantitatif. .................................. 73
Annexe 3 : Analyse de SORD par immunobuvardage (gels 1D et 2D) ....................................................... 75
ixListe des tableaux
Chapitre 1
Tableau 1 : Les troubles hypertensifs de la grossesse ................................................................................. 1
Tableau 2 : Facteurs de risque de la prééclampsie....................................................................................... 3
Tableau 3 : La prééclampsie légère vs sévère ............................................................................................ 12
Tableau 4 : Les principaux osmolytes ......................................................................................................... 15
Tableau 5 : Inhibiteurs de l'aldose réductase .............................................................................................. 17
Chapitre 2
Table 1 : Characteristics of the recruited patients ...................................................................................... 43
Table 2 : mRNA and protein expression ratio AKR1B1/SORD in normotensive and preeclamptic
placentas .................................................................................................................................... 44
Chapitre 3
Tableau 1 : Table de corrélation entre PGF2α et AKR1B1 .......................................................................... 59
xiListe des figures
Chapitre 1
Figure 1 : Physiopathologie de la prééclampsie ............................................................................................ 4
Figure 2 : Le placenta humain ....................................................................................................................... 5
Figure 3 : Anatomie du placenta humain ....................................................................................................... 6
Figure 4 : La section centrale du placenta hémochorial humain ................................................................... 7
Figure 5 : La placentation normale vs en prééclampsie .............................................................................. 10
Figure 6 : La voie des polyols...................................................................................................................... 16
Figure 7 : Synthèse des prostaglandines .................................................................................................... 20
Figure 8 : Les voies métaboliques du glucose ............................................................................................ 23
Figure 9 : La voie des polyols et la réduction du glutathion......................................................................... 24
Figure 10 : La voie Gadd45α-MKK3-p38 en prééclampsie ......................................................................... 29
Chapitre 2
Figure 1 : The polyol pathway ..................................................................................................................... 45
Figure 2 : Mean AKR1B1 mRNA expression in amnion-chorion (A, B) and villi (C, D) in placentas from
normotensive (NOR) and preeclamptic (PE) pregnancies.......................................................... 46
Figure 3 : Mean SORD mRNA expression in amnion-chorion (A, B) and villi (C, D) in placentas from
normotensive (NOR) and preeclamptic (PE) pregnancies.......................................................... 47
Figure 4 : AKR1B1 normalized integrated optical density (IODn) in placental amnion-chorion and villi of
normotensive (NOR) and preeclamptic (PE) pregnancies in presence (A, C) and in absence
(B, D) of labor ............................................................................................................................. 48
Figure 5 : SORD normalized integrated optical density (IODn) in placental amnion-chorion and villi of
normotensive (NOR) and preeclamptic (PE) pregnancies in presence (A, C) and in absence
(B, D) of labor ............................................................................................................................. 49
Figure 6 : Immunohistochemistry on paraffined sections of in term placentas. (A,C) amnion-chorion and
(B,D) villi ..................................................................................................................................... 50
xiiiListe des abréviations
4- HNE 4-hydroxynonenal
ADNc Acide désoxyribonucléique complémentaire
AGEs Produits de glycation avancée
AKR1B1 Membre B1 de la famille 1 des aldo-céto réductases (ou Aldose réductase)
ARNi Acide ribonucléique interférant
ARNm Acide ribonucléique messager
AT1-AA Auto-anticorps circulants contre le récepteur AT1 de l’angiotensine II
COX-1 Cyclo-oxygénase-1
COX-2 Cyclo-oxygénase-2
DAG Diacylglycérol
DHAP Dihydroacétone phosphate
DHPG 3,4- dihydroxyphénylglycol
DOPEGAL 3,4-dihydroxyphénylglycolaldéhyde
FDA Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux
Gadd45α Protéine «Arrêt de la croissance cellulaire et des dommages à l'ADN» 45α
GAPDH Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase
GLUT Transporteur de glucose
GSH Forme réduite du glutathion
GSSG Forme oxydée du glutathion
H2O2 Peroxyde d'hydrogène
HELLP Syndrome d'hémolyse, enzymes hépatiques élevées et diminution des plaquettes
hPL Hormone lactogène placentaire humaine
HUVEC Cellule endothéliale de la veine ombilicale humaine
IL-1β Interleukine 1β
KO Knock-out (invalidation génique)
LC-MS/MS Chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem
LDL Lipoprotéine de basse densité
MAPK Protéine kinase activée par des mitogènes
MKK3 Protéine kinase activée par des mitogènes kinase
NAD+ Nicotinamide adénine dinucléotide
NADPH Forme réduite du nicotinamide adénine dinucléotide phosphate
NFAT5 Facteur nucléaire des cellules T activées 5
ORE Élément de réponse osmotique
PE Prééclampsie
PGF2α Prostaglandine F2α
PGFS Prostaglandine F synthase
PGH2 Prostaglandine H2
PKC Protéine kinase C
PLA2 Phospholipase A2
PlGF Facteur de croissance placentaire
xvPOVPC 1-palmitoyl-2-(5-oxovaleroyl)-sn-glycéro-3-phosphocholine ROS Dérivé réactif de l'oxygène RT-PCR Réaction en chaîne de la polymérase en temps réel SDHA Sous-unité A du complexe succinate déshydrogénase sEng Endogline soluble sFlt-1 Tyrosine kinase « fms-like » soluble-1 SORD Sorbitol déshydrogénase TGFb Facteur de croissance de transformation de type bêta TonEBP Protéine facilitant la liaison protéique selon la tonicité VEGF Facteur de croissance vasculaire endothélial YWHAZ Protéine 14-3-3 zêta/delta xvi
Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit.
François de La Rochefoucauld
xviiRemerciements
J’aimerais tout d’abord remercier mon directeur de recherche Jean-François Bilodeau. Il m’a accueillie dans
son laboratoire pour mon dernier stage au baccalauréat en 2011, et m’a ensuite fait plonger dans le monde de
la recherche fondamentale. Il m'a guidée tout le long du processus de ma maîtrise, en m’encourageant à avoir
davantage confiance en moi. Aussi, il m’a permis d’en apprendre énormément sur les domaines de la
reproduction, la grossesse et de l’obstétrique, pour lesquels j’ai développé une soif d’apprendre et de l’intérêt
pour ma future carrière.
Ensuite, j’aimerais remercier Vanessa Moisan, qui m’en a appris beaucoup sur les méthodes qui m’ont permis
de récolter les résultats qui figurent dans ce mémoire. Elle m’a guidée dans les premiers mois de mes études
graduées, et a été présente pour m’aider à perfectionner mes premières présentations. Merci également à
Jessica Larose pour son support et ses nombreux conseils au cours de ma rédaction.
J’aimerais aussi remercier Robert Sullivan et les membres de son équipe, tout particulièrement Gilles Frenette
et Olivier D’Amours qui ont toujours été disponibles pour apporter des points de réflexions et des idées
d’expérimentations afin de tenter de résoudre les mystères qui entourent la protéine SORD. Gilles, l’homme
qui sait tout, je pense que tout Centre de Recherche devrait avoir un professionnel de recherche avec ton
expérience, car tu es un atout indéniable.
Enfin, j’aimerais remercier Daniel, mon amoureux et meilleur ami, qui a toujours su me supporter tout au long
de ma maîtrise, et qui m’a toujours encouragé à persévérer malgré les difficultés.
xixAvant-propos
L’objectif global de mon projet a été de faire l’étude de la voie des polyols dans le placenta en prééclampsie.
Le texte qui suit résume les travaux que j’ai effectués au cours d’un stage à l’été 2011 alors que j’étais au
baccalauréat, ainsi que durant ma maîtrise.
Le premier chapitre correspond à un survol de la littérature afin de faciliter la compréhension des chapitres
subséquents. Il résume entre autres les événements physiologiques qui entourent le développement
placentaire et la prééclampsie. Il sera ensuite question de la réponse cellulaire au stress osmotique, d’une
description des rôles de la voie des polyols au sein du métabolisme ainsi que de son implication dans
plusieurs symptômes du diabète. Enfin, les hypothèses de recherches seront décrites à la fin du chapitre.
Le deuxième chapitre correspond à l’article scientifique relatant la majorité des résultats obtenus au cours de
ma maîtrise. Il est en préparation pour être soumis au Journal Placenta. Je suis la première auteure de
l’article, et j’ai réalisé toutes les expérimentations qui ont permis d’obtenir les résultats qui y sont présentés.
J’ai été assistée en premier temps par Dre Vanessa Moisan, qui m’a guidée dans la réalisation des dosages
par RT-PCR quantitatif ainsi que pour les techniques d’immunohistochimie. Aussi, j’ai été conseillée par Gilles
Frenette, professionnel de recherche au sein de l’équipe de Robert Sullivan, pour la réalisation des
immunobuvardages de type Western. Enfin, Drs Jean-François Bilodeau et Robert Sullivan ont participé à la
mise en place du projet ainsi que dans la correction de l’article.
Enfin, la dernière section de ce mémoire comporte une discussion sur les méthodes et techniques utilisées
lors des analyses, des méthodes alternatives, les résultats obtenus (publiés ou non), une comparaison avec la
littérature ainsi que des perspectives pour la continuité du projet.
Le mémoire comporte également trois annexes, qui incluent des résultats qui n’ont pas été publiés pour le
moment. L’Annexe 1 comprend les tables d’ANOVA produites lors des analyses statistiques réalisées sur les
résultats présentés dans le Chapitre 2. L’Annexe 2 correspond aux résultats obtenus lors du dosage de
l’expression génique (ARNm) de Gadd45α par RT-PCR quantitatif dans les placentas issus de grossesses
normotensives et prééclamptiques. L’Annexe 3 illustre le résultat d’immunobuvardage de type Western Blot
obtenus à partir de deux gels d’électrophorèse (1D et 2D) qui ont été préparés pour des analyses de la
protéine SORD.
xxiChapitre 1 : Introduction
1.1) Les troubles hypertensifs de la grossesse
De manière générale, on observe habituellement une diminution de la tension artérielle durant la grossesse.
Au cours du 2e trimestre, elle diminuerait d’environ 10 mm Hg par rapport à la situation prégestationnelle, puis
elle remonterait jusqu’à la fin de la grossesse pour atteindre la pression sanguine prégestationnelle (1).
Cependant, certaines femmes enceintes éprouvent des problèmes d’hypertension au cours de leur grossesse,
qui sont résumés dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Les troubles hypertensifs de la grossesse
Hypertension gestationnelle
- Hypertension induite par la grossesse
e
- Hypertension détectée après la 20 semaine de gestation, en absence de protéinurie
- Les symptômes disparaissent dans les premiers mois suivant la grossesse
Prééclampsie
e
- Hypertension et protéinurie détectées après la 20 semaine
- Les symptômes disparaissent après l’accouchement
Hypertension chronique
e
- Hypertension détectée avant la grossesse ou avant la 20 semaine de gestation, qui se
poursuit après la grossesse
Hypertension chronique, avec prééclampsie surajoutée
e
- Apparition de symptômes de la prééclampsie après la 20 semaine de gestation chez une
femme souffrant déjà d’hypertension chronique
Inspiré de (2)
Pour commencer, l’hypertension gestationnelle est caractérisée par une hausse de la pression artérielle
(pression systolique ≥140 mmHg, pression diastolique ≥90mmHg) durant la grossesse, qui disparaît quelque
temps après l’accouchement. Lorsqu’on détecte la présence de protéines dans les urines (protéinurie) en plus
de l’hypertension, il est alors question de prééclampsie. Cette pathologie de grossesse est parfois
accompagnée de complications sévères (ex. éclampsie, syndrome HELLP), dont il sera question plus tard
dans le texte. Enfin, des femmes souffrant d’hypertension chronique (apparue avant la grossesse pour la
plupart) peuvent alors développer ou non des symptômes associés à la prééclampsie.
11.2) Définition de la prééclampsie La prééclampsie est une pathologie observée chez une femme enceinte, caractérisée par une pression systolique supérieure à 140 mmHg ainsi qu’une pression diastolique supérieure à 90 mmHg, alors que l’hypertension n’était pas présente en dehors de la grossesse. De plus, la protéinurie (≥0,3g/24h), synonyme d’une atteinte rénale, est aussi présente chez les femmes souffrant de prééclampsie (3). L’œdème était autrefois un critère de diagnostic de la pathologie, mais a toutefois été mis de côté à cause de son manque de spécificité. La prééclampsie est généralement diagnostiquée au 2e trimestre de gestation, et elle affecte entre 3 et 5% des grossesses (4). Encore aujourd’hui, on la surnomme « maladie des hypothèses », puisque les causes exactes des symptômes observés restent encore inconnues. Plusieurs études ont démontré qu’une placentation inadéquate serait au cœur de la pathologie. 1.3) Les facteurs de risque Parmi les facteurs de risque associés à la prééclampsie, certains d’entre eux sont connus depuis longtemps et ont été observés à plus d’une reprise. On pense par exemple à l’obésité prégestationnelle, l’âge maternel ou encore l’hypertension présente avant la grossesse. Cependant, quelques-uns d’entre eux sont encore sujets de discorde, puisque les études se contredisent. Le Tableau 2 résume les principaux facteurs de risques encore en vigueur depuis 2008. Il existe trois catégories de facteurs de risque, soit les facteurs de risques prégestationnels, les facteurs de risques associés à la grossesse en tant que telle ainsi que les facteurs de risques associés au père biologique. 2
Tableau 2 : Facteurs de risque de la prééclampsie
Facteurs prégestationnels
- IMC > 25 (avant la grossesse)
- Ethnicité (race noire)
- Âge maternel (≥ 40)
- Facteurs héréditaires
- Conditions médicales préexistantes (diabète insulinodépendant, hypertension, maladies
rénales, maladie auto-immune chronique)
Facteurs associés à la grossesse
- Primiparité
- Prééclampsie lors de la grossesse précédente
- Grossesse multiple
- Môle hydatiforme
- Temps écoulé entre les grossesses
Facteurs paternels
- Exposition restreinte au sperme du père
- Facteurs héréditaires
Inspiré de (5, 6)
En plus des facteurs énumérés ci-dessus, des études épidémiologiques ont montré que l’alimentation de la
mère aurait un impact sur le développement de la prééclampsie. Une étude norvégienne effectuée entre 1994
et 1996 avec des femmes enceintes recrutées au premier trimestre ou au début du deuxième indiquait que
l’alimentation durant la grossesse pouvait augmenter les chances de développer la prééclampsie. Ces
dernières devaient remplir un questionnaire en indiquant les aliments qu’elles consommaient quotidiennement
ainsi que les quantités. L’équipe en a conclu qu’une alimentation très calorique, riche en sucrose et en acides
gras polyinsaturés entre autres, avait comme effet d’augmenter la fréquence de développement de la
pathologie. Selon l’équipe, le sucrose serait l’élément qui aurait le plus d'influence sur l’apparition de la
prééclampsie, puisqu’il aurait un impact sur l’intégrité endothéliale en induisant l’hyperglycémie (7). D’autre
part, il est surprenant de constater que certaines études démontrent que fumer la cigarette diminuerait
l’incidence d’apparition de la prééclampsie (8).
31.4) Les causes de la pathologie Les phénomènes exacts responsables des symptômes constatés en prééclampsie sont encore aujourd’hui méconnus. Une multitude de mécanismes pouvant expliquer certains symptômes de la prééclampsie ont été avancés. À cet égard, le modèle de la physiopathologie en deux étapes le plus couramment utilisé est résumé dans la Figure 1. Pour commencer, divers événements occasionneraient un défaut de la placentation (Stade 1). On pense par exemple au stress oxydatif, à des facteurs inflammatoires ou génétiques, qui pourraient avoir un impact négatif sur le bon déroulement du développement placentaire. Le placenta qui en résulte est moins efficace lors des échanges entre la mère et le fœtus, entre autres à ce qui a trait à l’apport en oxygène (4). D’autre part, ce placenta libèrera dans la circulation maternelle des médiateurs favorisant une dysfonction endothéliale, affectant plusieurs organes (Stade 2). Figure 1 : Physiopathologie de la prééclampsie Inspiré de (4) Par ailleurs, l’implication du placenta en prééclampsie est connue depuis longtemps. Les premiers récits décrivant l’éclampsie datent de l’époque de l’Égypte ancienne, alors qu’un médecin avait observé que des convulsions survenaient de façon rapide et imprévisible chez certaines femmes enceintes, et que les symptômes cessaient peu après l’accouchement (9). Puisque la parturition est le moment où la mère est libérée du placenta et que les symptômes de la prééclampsie disparaissent par la suite, il a été déduit plus 4
tard que le placenta pouvait être impliqué dans la pathologie. Outre cette évidence, la possibilité de
développer la prééclampsie lors d’une grossesse molaire, où une structure placentaire se développe en
absence de fœtus, vient corroborer le fait indéniable de l’implication du placenta en prééclampsie (10). La
section suivante résume les principales caractéristiques anatomiques et physiologiques de cet organe
indispensable à la grossesse.
1.5) Le placenta
Figure 2 : Le placenta humain
Tiré de (11)
Le placenta est un organe transitoire hautement spécialisé. Sa présence est primordiale pour tout le
déroulement de la grossesse, et toute anomalie placentaire peut avoir des conséquences néfastes sur le
développement du fœtus. Sa formation est hautement coordonnée, et nécessite des interactions entre les
tissus maternels et fœtaux. Le placenta humain est de type hémochorial, dont l’invasion des tissus maternels
est relativement profonde, et elle implique aussi une invasion des artères spiralées par les trophoblastes. De
plus, les villosités placentaires sont directement en contact avec le sang maternel (12).
51.5.1) Anatomie du placenta humain La Figure 2 illustre une représentation d’un placenta humain, montrant les deux façades placentaires. Le côté fœtal ou chorial est tapissé par l’amnios, un tissu transparent permettant de voir les vaisseaux sanguins reliés au cordon ombilical situés dans le chorion. D’autre part, le côté maternel du placenta est en contact avec la caduque basale. Le placenta proprement dit comporte diverses sections que nous verrons dans les prochains paragraphes. Figure 3 : Anatomie du placenta humain Modifié de (13) 1.5.1.1) Plaque basale La plaque basale correspond à la portion du placenta qui est rattachée à la paroi utérine. Elle est essentiellement formée de trophoblastes, recouverts par une couche fibrinoïde. On y retrouve les cotylédons, soit des espaces intervilleux subdivisés par les septa intercotylédonaires, tel qu’illustré par la Figure 3 (14). 1.5.1.2) Plaque chorionique Il s’agit de la section fœtale du placenta qui est en contact avec la cavité amniotique. Elle comporte principalement la membrane amniochorionique, comprenant de l’amnios qui entoure le placenta ainsi que le chorion. L’amnios est composé d’un épithélium simple et d’un mésenchyme avascularisé. Pour sa part, le chorion comprend une couche mésenchymaire, ainsi que des trophoblastes extravillositaires. C’est dans la membrane amniochorionique que le cordon ombilical est attaché. En effet, les deux artères ainsi que la veine ombilicale se divisent en multiples vaisseaux cheminant dans le mésenchyme chorionique, qui alimentent les capillaires sanguins des villosités (voir Figure 3) (15). 6
1.5.1.3) Espace intervilleux et les villosités choriales
L’espace intervilleux comprend tout ce qui est situé entre le chorion et la plaque basale. Cet espace est
constitué entre autres des villosités chorioniques ainsi que des chambres intervilleuses. Les villosités
chorioniques, illustrées dans la Figure 4, sont les unités structurales et fonctionnelles du placenta et
contiennent des vaisseaux sanguins fœtaux permettant les échanges entre les sangs de la mère et du fœtus.
On parle souvent d’arbres villositaires lorsqu’il est question de la description de la structure des villosités (voir
Figure 4B). Alors que les villosités flottantes baignent dans le sang maternel, les villosités ancrées sont
implantées dans la paroi utérine. Les couches tissulaires qui composent les villosités chorioniques forment la
barrière placentaire, tel qu’illustré dans la Figure 4C représentant la coupe transversale d’une villosité. La
couche externe des villosités est un syncytium formé par la fusion de syncytiotrophoblastes, et est en contact
direct avec le sang maternel accumulé dans les chambres intervilleuses. Sous cette couche, on retrouve par la
suite des cytotrophoblastes. Ces dernières sont surtout présentes au niveau des villosités dites « souches »,
situées à la base des arbres villositaires, ainsi que dans les villosités présentes en début de grossesse. Pour
leur part, les villosités terminales, situées à l’extrémité des arbres villositaires, ne contiennent que très peu de
cytotrophoblastes (15). Enfin, le tissu stromal et le tissu endothélial entourant les capillaires fœtaux sont
également des composantes de la barrière placentaire.
Figure 4 : La section centrale du placenta hémochorial humain
Modifié de (16)
71.5.2) Les fonctions du placenta Le placenta est le lieu d’interaction entre le sang de la mère et du fœtus. Il s’agit d’un filtre sélectif, où les échanges se font par canaux ioniques, diffusion simple ou facilité, via des récepteurs membranaires ou par endocytose. Le placenta permet donc le passage des acides aminés maternels, qui serviront à la synthèse des protéines par le fœtus. De plus, le glucose est la principale source d’énergie du conceptus, et son transport vers la circulation fœtale est assuré par des transporteurs de type GLUT. Les acides gras libres ainsi que les vitamines sont aussi transportés de la mère au fœtus (17, 18). D’autre part, le placenta a une fonction protectrice envers le bébé. Il permet par exemple le passage des anticorps de la mère au fœtus, qui lui seront fortement utiles durant les premières semaines de sa vie. Par ailleurs, il empêche le passage de plusieurs médicaments, produits toxiques et agents infectieux, ainsi que le passage des cellules sanguines maternelles. Enfin, le placenta a une fonction endocrine importante. En effet, il produit la plupart des hormones stéroïdes et protéiques, des neurotransmetteurs, des facteurs de croissances ainsi que des cytokines, essentiels au bon déroulement de la grossesse (17). Par exemple, la progestérone, produite en début de grossesse par le corps jaune gestatif, est par la suite sécrétée par le placenta vers la 8e semaine (19). Aussi, la synthèse de facteurs de croissance par le placenta, par exemple le VEGF, dont il sera question un peu plus loin, est importante pour le bon fonctionnement de l’implantation du blastocyste et de la vascularisation du placenta (20). Enfin, le placenta sécrète l’hormone placentaire lactogène (hPL) ou sommatomammotrophine chorionique humaine, qui joue un rôle dans le métabolisme des glucides et des lipides en stimulant la sécrétion d’insuline par le pancréas et en favorisant la présence d’acides gras libres dans la circulation sanguine maternelle, dans le but de fournir des éléments essentiels au conceptus (21). 1.6) Les deux stades de la prééclampsie Tel que mentionné précédemment, un modèle comprenant deux stades a été imaginé afin de mieux cerner la physiopathologie de la prééclampsie. Pour commencer, une placentation inadéquate serait à l’origine de la prééclampsie. L’insuffisance placentaire qui en découle induirait alors la libération de médiateurs causant une dysfonction endothéliale chez la mère. Les deux sections qui suivent décrivent les deux stades de la pathologie. 1.6.1) La placentation normale versus la placentation en prééclampsie Au cours des premières semaines de gestation, au moment de l’implantation du blastocyste, les syncytiotrophoblastes érodent le tissu endométrial, permettant l’ancrage du blastocyste dans la paroi utérine ainsi que le développement des membranes extra-embryonnaires et des vacuoles extracytoplasmiques, qui formeront plus tard les chambres intervilleuses. En se développant, les syncytiotrophoblastes fusionneront et 8
formeront un syncytium recouvrant l’embryon en entier (22). La couche de syncytiotrophoblastes ainsi formée
a un rôle important au niveau du transport placentaire ainsi que dans la fonction endocrine du placenta. Le
développement des villosités chorioniques débutera par la suite, soit par la migration des cytotrophoblastes
au-delà du syncytium, formant alors des extensions villositaires autour du conceptus (23).
Alors que les cytotrophoblastes villositaires resteront au niveau des villosités, les cytotrophoblastes
extravillositaires vont envahir la muqueuse utérine ainsi que les artères spiralées qui s’y trouvent, puis
envahiront le myomètre vers la fin du premier trimestre. On observe alors la formation de bouchons
trophoblastiques intravasculaires, qui obstruent la terminaison des artères, et ce jusqu’à la 12 e semaine de
gestation. Ce phénomène aurait pour but d’induire des conditions hypoxiques temporaires, essentielles à la
régulation des fonctions des cytotrophoblastes au début de la grossesse (23). L’invasion des artères spiralées
maternelles par les cytotrophoblastes extravillositaires est illustrée dans la partie supérieure (A) de la Figure 5.
Ces derniers vont adopter un phénotype endothélial, exprimant des molécules d’adhésion spécifiques des
cellules endothéliales vasculaires. Ce phénomène a pour but de remodeler les vaisseaux maternels afin qu’ils
deviennent davantage perméables, favorisant ainsi les échanges entre la mère et le fœtus (24). Les artères
remodelées auront aussi une capacité accrue à faire face à un important débit sanguin (4). Les vaisseaux qui
en résultent ne répondront plus aux mécanismes normaux du contrôle neurovasculaire et aux médiateurs du
tonus vasculaire. Les bouchons trophoblastiques persisteront jusqu’à la 12e semaine de gestation, filtrant le
plasma qui pourra atteindre les chambres intervilleuses au cours des premières semaines (25).
Cependant, le remodelage des artères spiralées n’est pas complété dans les cas de prééclampsie, tel
qu’illustré dans la partie inférieure de la Figure 5. Les cytotrophoblastes ne sont alors retrouvés que dans la
portion des vaisseaux situés au niveau de la partie superficielle de la décidue. Ces derniers n’expriment peu
ou pas de molécules d’adhésion, et sont donc moins efficaces pour l’invasion des artères spiralées. Les
vaisseaux sont donc plus étroits et moins perméables, conservant une vasoconstriction réactionnelle aux
hormones vasopressives (4). Le placenta est alors moins bien perfusé, et donc moins efficace pour les
échanges entre la mère et le foetus. On observe alors un phénomène d’ischémie-reperfusion utéro-
placentaire, résultant de l’insuffisance d’adaptation du débit sanguin et causant la libération de molécules
oxydantes par les mitochondries. Les lésions vasculaires du placenta qui en résultent mèneront
éventuellement au relâchement de facteurs qui mèneront à de l’hypertension chez la femme enceinte vers le
2e trimestre.
9Figure 5 : La placentation normale vs en prééclampsie Modifié de (4) 1.6.2) Libération de facteurs circulatoires et dysfonction endothéliale Le placenta ayant une perfusion inadéquate libère des médiateurs divers, dont certains sont responsables d’une dysfonction endothéliale maternelle (26). On pense par exemple à sFlt-1, le récepteur soluble de VEGF, aussi appelé sVEGFR-1. Ce médiateur agit comme antagoniste de VEGF, en inhibant son activité pro- angiogénique. Maynard et ses collègues (2003) ont montré que le niveau de sFlt-1 relâché par le placenta est augmenté en prééclampsie par rapport à une grossesse normotensive (27). Les causes de l’augmentation du 10
niveau de relâchement de sFlt-1 en prééclampsie sont encore aujourd’hui inconnues, et il s’agit du sujet
d’investigation de plusieurs équipes œuvrant dans la recherche sur l’origine de la prééclampsie. sFlt-1 est la
version soluble de la protéine Flt-1, dont la section transmembranaire est manquante. Il s’agit d’une tyrosine
kinase impliquée dans le contrôle de la prolifération cellulaire (28), synthétisée dans les cellules
trophoblastiques pour ensuite être libérée dans la circulation maternelle (26). D’un autre côté, sEng, un co-
récepteur du TGF-β, serait lui aussi plus abondant dans la circulation sanguine en prééclampsie, et aurait un
rôle à jouer dans la pathologie. En effet, sEng jouerait un rôle similaire à sFlt-1 dans la pathologie de la
prééclampsie en inhibant la vasodilatation en plus de bloquer l’action de TGF-β (29). Aussi, il semblerait que
l’administration d’adénovirus exprimant sFlt-1 et sEng chez le rat induirait des symptômes très similaires à
ceux détectés chez la femme prééclamptique, contrairement à ce qui est observé lorsque les adénovirus
n’expriment qu’un seul de ces facteurs (4).
Pour sa part, VEGF joue un rôle clef dans l’élaboration des réseaux vasculaires essentiels au bon
développement du fœtus lors du développement embryonnaire. Cependant, lorsque VEGF est en excès, cela
peut s’avérer être nuisible, par exemple au niveau de la perméabilité des vaisseaux (30), ou bien dans le cas
de la présence d’une tumeur cancéreuse. Pour ce qui est de son niveau d’expression en prééclampsie, les
études se contredisent à savoir si VEGF est augmenté ou diminué (31-34).
Le rôle de sFlt-1 est donc de contrôler l’activité angiogénique de VEGF par liaison avec ce dernier. Plusieurs
équipes de recherches se sont penchées sur la question des facteurs modulant la libération de VEGF et de
sFlt-1, afin de déterminer les raisons d’une augmentation du relâchement de sFlt-1 en prééclampsie qui sont
cependant jusqu’ici encore inconnues. Par exemple, Xiong et ses collègues (2009) ont démontré que des
conditions extracellulaires stressantes, par exemple un milieu hyperosmotique, pouvaient induire la libération
de sFlt-1 in vitro au niveau de cellules ombilicales de type HUVEC (35).
1.7) Conséquences de la prééclampsie
Il existe deux degrés de sévérité de la pathologie, à savoir la prééclampsie dite « légère » et celle dite
« sévère ». L’impact du moment de l’apparition des symptômes (précoce, avant 34 semaines et tardive, après
34 semaines) sur la sévérité est encore controversé (36). Néanmoins, une étude récente montre que la
prééclampsie précoce serait associée à une augmentation plus rapide de la concentration de sFlt-1 dans la
circulation maternelle, comparativement à la prééclampsie tardive (37). Les critères permettant de discriminer
les prééclampsies légère ou sévère sont présentés dans le Tableau 3.
11Vous pouvez aussi lire