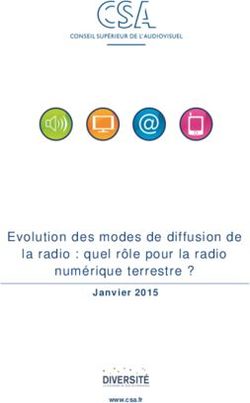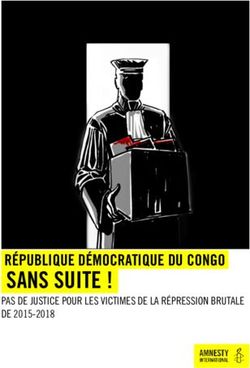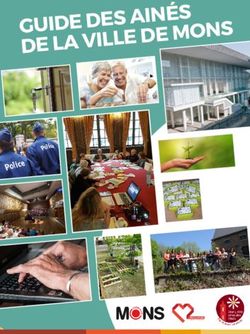Un travail écrit : "Quels sont les changements apportés par l'article 17 de la directive 2019/790 au régime de responsabilité des hébergeurs ?"
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
http://lib.uliege.be https://matheo.uliege.be
Un travail écrit : "Quels sont les changements apportés par l'article 17 de la
directive 2019/790 au régime de responsabilité des hébergeurs ?"
Auteur : Hermesse, Marie
Promoteur(s) : Cabay, Julien
Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en gestion
Année académique : 2018-2019
URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/7838
Avertissement à l'attention des usagers :
Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément
aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger,
copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les
indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation
relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.
Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre
et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira
un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que
mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du
document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.Quels sont les changements apportés par l’article 17 de la
directive 2019/790 au régime de responsabilité des
hébergeurs ?
Marie HERMESSE
Jury Année académique 2018-2019
Promoteur :
Julien CABAY, Chargé de cours
Lecteurs : Mémoire présenté en vue de
l’obtention du diplôme de
André BLAVIER, Professeur ordinaire
Master en droit, à finalité
Bernard VANBRABANT, Professeur spécialisée en gestion
ordinaireREMERCIEMENTS
Mes remerciements vont tout d’abord au professeur Julien Cabay qui, par sa disponibilité, ses
remarques, sa précision et son enthousiasme donne raison à Hegel qui affirme que « rien de
beau ne s’est accompli dans ce monde sans passion ».
Au vu de son emploi du temps chargé, je tiens également à remercier le professeur André
Blavier qui a pu m’orienter et me conseiller pour la partie gestion de ce travail. Je remercie
également le professeur Bernard Vanbrabant, qui a accepté d’être mon second lecteur.
Rien n’aurait été possible sans l’aide de Pierre-Yves Potelle, qui a su répondre à mes
nombreuses questions et me diriger dans mes recherches. Je l’en remercie grandement.
Toute ma gratitude va également à ma famille et à mes amis qui ont su trouver les mots pour
m’aider, m’encourager et prendre le temps de me relire. Sans leur présence et leurs conseils, ce
travail ne serait pas ce qu’il est. Merci à également à Xavier Ghuysen.
Il me faut aussi remercier tout particulièrement mes compagnons du master droit-gestion, qui
ont été toujours été là pour me soutenir au cours de ces deux dernières années.
N’oubliant pas que nous ne sommes rien sans l’aide des autres, je tiens à dire merci à tous ceux
qui m’ont aidée de près ou de loin à la réalisation de ce travail.
1NOTE DE SYNTHESE
Ce travail tentera de répondre à la double question suivante : quels sont les changements
apportés par l’article 17 de la directive (UE)2019/790 du Parlement européen et du Conseil du
17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique au régime de responsabilité
des hébergeurs et ces changements permettent-ils à la Commission d’atteindre ses objectifs
initiaux?
Pour répondre à cette question, le contexte général du droit d’auteur sur Internet a été exposé.
Cela a permis de constater que le régime de responsabilité des hébergeurs actuellement en place
était dépassé depuis le passage au Web 2.0. Il était nécessaire de le revoir. Pour ce faire, la
Commission s’était fixé trois objectifs : renforcer la collaboration entre les titulaires de droits
et les plateformes dans la lutte contre la contrefaçon, rendre plus équitable la rémunération des
auteurs et modifier le régime de la responsabilité applicable à ces plateformes dans le but de
l’adapter aux réalités nouvelles du numérique.
Une tentative de réponse est apportée par l’article 17 de la directive du 17 avril 2019, dont le
parcours législatif a été, en raison de ses nombreux enjeux, particulièrement long et semé
d’embuches.
Après avoir confronté le régime actuellement en vigueur pour les fournisseurs d’accès à celui
prévu par l’article 17 de la directive, il a été possible de conclure que les plus gros changements
étaient situés au niveau de la consécration législative du fait que les actes posés par les
fournisseurs de services sont des actes de communication au public. Par conséquent, le système
de la responsabilité des fournisseurs d’accès a été modifié. Ceux-ci passent d’un régime
d’exonération permis par l’article 14 de la directive e-Commerce (2000/31/CE) à la mise en
cause de leur responsabilité en cas de chargement par leurs utilisateurs de contenus non
autorisés.
La mise en cause de leur responsabilité n’est plus basée sur le critère de connaissance des
contenus illicites mais plutôt sur les actions que les hébergeurs prennent pour en éviter la
diffusion. Il leur est possible de s’exonérer de cette responsabilité de deux manières. Tout
d’abord, ils doivent démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts afin d’obtenir
l’autorisation des titulaires de droits. S’ils n’y sont pas parvenus, ils doivent démontrer qu’ils
ont fourni leurs meilleurs efforts pour prendre des mesures afin de retirer les contenus non
autorisés et d’empêcher qu’ils ne soient mis ou remis en ligne. Ces mesures de « notice-and-
take-down » et de « notice-and-stay-down » passeront presque inévitablement par le recours
aux techniques de reconnaissance de contenus, ce qui est source de tensions.
Ce travail se termine par une grille de recommandations à destination des plateformes ayant
pour objectif de les orienter et de les aider à se conformer au nouveau régime.
2ABSTRACT
This paper tries to answer to the two following questions: what changes have been made to the
liability regime for hosting providers by the Article 17 of the Directive (UE)2019/790 of the
European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the
Digital Single Market and do these changes enable the Commission to achieve its initial
objectives?
To answer this question, the general context of copyright on the Internet was presented. This
revealed that the current liability regime for hosting providers has been inadequate since the
transition to Web 2.0. It was thus necessary to review it. To do so, three objectives had been set
by the Commission: to strengthen collaboration between rights holders and platforms in the
fight against copyright infringement, to make authors' remuneration more equitable and to
modify the liability regime applicable to these platforms in order to adapt it to the new digital
realities.
Article 17 of the Directive of 17 April 2019, whose legislative path has been, because of its
many challenges, particularly long and fraught with many obstacles, tries to provide an answer
that meets these three objectives.
After comparing the current regime for access providers with the one provided by Article 17 of
the directive, it was possible to come to the conclusion that the biggest changes lie in the
recognition that access providers carry out an act of communication to the public. Therefore,
the liability regime of access providers had to be modified. Through those changes, they have
shifted from an exemption regime allowed by Article 14 of the e-Commerce Directive
(2000/31/CE), to the questioning of their liability in the event of unauthorized content being
uploaded by their users.
The questioning of their liability is no longer based on the criterion of their knowledge of the
illegal contents but rather on the action they take to avoid them. They can be exonerated from
this responsibility in two ways. First of all, they must demonstrate that they have made their
best efforts to obtain the authorization from the rights holders. If they couldn’t obtain such an
authorization, they must demonstrate that they have made their best efforts to take measures to
remove unauthorized content and prevent them from being posted or put back online. These
notice-and-take-down and notice-and-stay-down measures will almost inevitably involve the
use content recognition technologies, which is a source of tension.
This work ends with a set of recommendations for services providers that are intended to guide
them and help them to comply with these new requirements.
3TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ............................................................................................... 6
PARTIE I : LE DROIT D’AUTEUR A L’ÈRE D’INTERNET -
CONTEXTE GENERAL.................................................................................... 8
CHAPITRE I : LES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION....8
CHAPITRE II : LE DROIT D’AUTEUR A L’ÈRE D’INTERNET .................................................10
PARTIE II : L’ARTICLE 17 DE LA DIRECTIVE 2019/790 ...................... 13
CHAPITRE I : LE REGIME JURIDIQUE ACTUEL DES PLATEFORMES COLLABORATIVES ......14
Section I : La responsabilité des plateformes numériques ............................................................14
a) Sous-section I : Définition de l’hébergement ...................................................................15
b) Sous-section II: Mise en cause de la responsabilité de l’hébergeur ................................17
c) Sous-section III : Injonctions contre les intermédiaires...................................................18
d) Sous-section IV : Interdiction d’obligation générale de surveillance ..............................21
Section II : Droit de communication au public .............................................................................22
a) Sous-section I : La communication au public ..................................................................22
b) Sous-section II : L’hyperlien ............................................................................................23
c) Sous-section III: Développements récents........................................................................24
d) Sous-section IV : Incidence de la qualification en acte de communication au public .....25
e) Sous-section V : Les second level agreements – un palliatif ? .........................................26
Section III : État de lieux - Remarques conclusives ......................................................................27
CHAPITRE II : LA PROCEDURE LEGISLATIVE......................................................................28
CHAPITRE III : L’ARTICLE 17 ..............................................................................................31
Section I : Champ d’application ....................................................................................................31
Section II : Qualification en acte de communication au public .....................................................34
Section III : Mise en cause de la responsabilité de la plateforme..................................................36
a) Sous-section I: Volet I – Conclusion d’accords ...............................................................36
1. L’accord .................................................................................................................................... 36
2. Rôle des sociétés de gestion collective ...................................................................................... 39
b) Sous-section II : Volet II – Mise en place de mesures ......................................................40
1. Les mesures ............................................................................................................................... 40
2. Quid de l’interdiction de l’obligation de surveillance générale ? .............................................. 45
3. Quid des exceptions et limitations au droit d’auteur ? .............................................................. 48
4. Allègement ................................................................................................................................ 49
Section IV: Mécanismes de recours ..............................................................................................51
Section V : Mécanismes de coopération .......................................................................................53
CHAPITRE IV : GRILLE DE RECOMMANDATIONS A DESTINATION DES PLATEFORMES ......54
Section I : Accord ..........................................................................................................................56
Section II : Rémunération..............................................................................................................57
Section III : Mesures .....................................................................................................................58
Section IV : Recours......................................................................................................................59
CONCLUSION .................................................................................................. 61
4BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................ 64
ANNEXE I : TABLEAU COMPARATIF DES DIFFERENTES
VERSIONS DE L’ARTICLE 17 ..................................................................... 73
ANNEXE II : LES DIFFERENTES VERSIONS DE LA DIRECTIVE
2019/790 .............................................................................................................. 84
ANNEXE III : CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE
YOUTUBE ......................................................................................................... 91
5INTRODUCTION
Depuis la fin du XXe siècle, le développement des nouvelles technologies impacte
profondément notre manière de communiquer et de créer. Les contenus sont à présent copiables,
modifiables et partageables beaucoup plus facilement. Le temps des livres, des CDs et des
DVDs est en grande partie révolu. La majorité des œuvres est désormais partagée sur le Web.
L’e-Book, Spotify, YouTube, Netflix et consorts ont vu le jour. La naissance de ces plateformes
a suscité un grand nombre de questions. Comment vérifier qu’un auteur a autorisé la diffusion
de son œuvre ? Comment rémunérer les auteurs pour la diffusion de leurs œuvres sur Internet ?
Quel régime de responsabilité appliquer en cas de violation du droit d’auteur en ligne ?
Il a rapidement fallu se rendre à l’évidence : le cadre juridique mis en place au niveau européen
n’était plus satisfaisant. La question de la responsabilité des hébergeurs faisait particulièrement
débat et a donné de l’eau au moulin de la Cour de Justice de l’Union européenne. Pour tenter
de pallier les défaillances du système, le législateur européen a adopté le 17 avril 2019 une
directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique1. L’article 17 de celle-ci a pour
ambition de résoudre l’épineuse question de la régulation des plateformes de partage de
contenus, telles que YouTube.
Cette disposition a trois objectifs. Tout d’abord, elle tente de renforcer la collaboration entre les
titulaires de droits et les plateformes dans la lutte contre la contrefaçon. Ensuite, elle essaye de
rendre plus équitable la rémunération des auteurs dont les revenus sont extrêmement faibles au
regard des recettes accumulées par les plateformes partageant leurs contenus. Enfin, elle
modifie le régime de la responsabilité applicable à ces plateformes dans le but de l’adapter aux
réalités nouvelles du numérique.
Même si ses objectifs sont louables, cet article 17 est loin de faire l’unanimité. Rarement une
disposition a suscité autant de discussions. Deux camps sont rapidement apparus : d’un côté les
partisans de cette disposition, dont les grandes entreprises culturelles ; de l’autre, les défenseurs
des libertés numériques et les géants du Web. Ces derniers crient à la censure, à la fin de la
créativité ainsi qu’à la mort des plateformes et de l’Internet d’aujourd’hui.
Dès lors, ce mémoire aura pour vocation de répondre à la double question suivante : quels sont
les changements apportés par l’article 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique au régime de
responsabilité des hébergeurs et ces changements permettent-ils à la Commission d’atteindre
tous ses objectifs initiaux ?
Ce travail se limite à l’analyse du régime de responsabilité proposé par l’article 17 de la
directive 2019/790, qui s’inscrit dans la stratégie de la Commission pour un marché unique
numérique. L’objectif sera de voir comment il change le régime de responsabilité actuellement
en place. Au vu des débats que cet article a suscités, l’hypothèse est faite que la réponse apportée
ne convient pas et ne permet à la Commission d’atteindre pleinement ses objectifs. Afin de
1
Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits
voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, J.O.U.E., n° 130/92
du 17 mai 2019.
6comprendre pourquoi, l’ancien et le nouveau régimes seront comparés, les défauts de ce dernier
ainsi que ses incohérences avec la jurisprudence antérieure seront soulignés.
Ce travail est composé de deux parties. La première partie plantera le décor dans lequel s’inscrit
l’article 17 et posera le cadre général du droit d’auteur sur Internet suite au passage au Web 2.0.
La seconde partie se concentrera sur l’article 17. Elle se décomposera en quatre chapitres. Le
premier exposera le régime actuellement en vigueur pour les plateformes collaboratives et en
soulignera les lacunes. Les notions d’hébergeur, de communication au public, la question de
leur responsabilité ou encore le système des injonctions aux prestataires de services seront
notamment discutés.
Ensuite, dans le deuxième chapitre, la procédure législative ayant mené à l’adoption du texte
sera détaillée et la mise en évidence des principaux enjeux de celle-ci permettra de comprendre
pourquoi elle fut si laborieuse.
Dans le troisième chapitre, l’article 17 sera analysé en profondeur. Son champ d’application, la
conclusion d’accords, les mesures à mettre en place, le système de responsabilité ainsi que les
voies de recours qu’il prévoit seront développés et analysés de manière critique afin de détecter
les améliorations et les éventuelles incohérences avec l’ancien régime.
Enfin, le quatrième et dernier chapitre proposera une grille de recommandations à destination
des plateformes afin de leur permettre de se conformer au nouveau cadre établi par l’article 17
et d’ainsi continuer à prospérer.
7PARTIE I : LE DROIT D’AUTEUR A L’ÈRE D’INTERNET -
CONTEXTE GENERAL
Le contexte du droit d’auteur sur Internet a beaucoup changé et évolué depuis le début des
années 20002. Si au début du millénaire, Internet était constitué de pages statiques et à vocation
purement informative3, le passage au Web 2.0 a changé la donne4. Les sites sont devenus
interactifs et les échanges entre internautes ont été rendus possibles5. La manière de créer, de
produire, de diffuser ou d’exploiter du contenu créatif a par conséquent changé
fondamentalement offrant ainsi de nouvelles modalités d’accès aux contenus, de nouvelles
utilisations transfrontalières de ceux-ci, de nouveaux acteurs, mais également de nouveaux
modèles économiques. Tous ces changements résultent principalement de l’apparition et de
l’évolution rapide des nouvelles technologies.
Cette partie du travail a pour objectif d’exposer les évolutions technologiques de la société de
l’information qui ont favorisé l’émergence des nouveaux défis du droit d’auteur à l’ère
d’Internet.
CHAPITRE I : LES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE LA SOCIETE DE
L’INFORMATION
Les plateformes en ligne sont un des points principaux d’accès à l’information. Les activités
qu’elles proposent, en plus du simple hébergement, sont des activités commerciales, de partage
de biens et de services6. Elles permettent de relier des milliards d’utilisateurs et d’échanger des
volumes colossaux de contenus. Leur rôle dans la société est central7 et ce, auprès de toutes les
catégories d’âge8. Mais quelles évolutions ont permis un tel succès ?
Premièrement, l’évolution des équipements peut expliquer ce succès. Vers la fin des années 90,
l’accès au téléphone portable s’est démocratisé pour devenir aujourd’hui le moyen de
communication le plus utilisé au monde. A titre d’exemple, 94% des Français en possèdent
2
M. BEHAR-TOUCHAIS, L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’Internet, tome 63, volume 1,
Bibliothèque de l’IRJS - André Tunc, Paris, IRJS éditions, 2015 p. 6.
3
F. GUILLAUME, Droit et Internet : de la logique internationaliste à la logique réaliste, Collection Thèse Droit
privé, Paris, Éditions Mare & Martin, 2016, p. 25.
4
Notion créée en 2004 par Tim O’Reilly, qui a toujours refusé de la définir.
5
F. GUILLAUME, Droit et Internet : de la logique internationaliste à la logique réaliste, Collection Thèse Droit
privé, Paris, Éditions Mare & Martin, 2016, pp. 25 et 26.
6
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique,
2018/C 331/19, 15 juin 2017, disponible sur http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-
0272_FR.html?redirect (dernière consultation : 4 août 2019).
7
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au comité des régions, Lutter contre le contenu illicite en ligne – Pour une responsabilité accrue des
plateformes en ligne, COM(2017) 555 final, Bruxelles, 28 septembre 2017, p. 2, disponible sur
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-555-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF (dernière
consultation : 2 août 2019).
8
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique,
2018/C 331/19, 15 juin 2017, pt. 17, disponible sur http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-
0272_FR.html?redirect (dernière consultation : 4 août 2019).
8désormais un, contre 11% en 19989. Si au départ, les fonctionnalités et applications de ces
téléphones étaient limitées, elles se sont multipliées et perfectionnées avec la naissance du
smartphone vers 201010, offrant ainsi plus de possibilités de création et d’accès aux contenus.
Les smartphones représentent aujourd’hui trois-quarts des téléphones et seront d’ici 2020,
l’outil de communication le plus utilisé. En 2018, en Belgique, le smartphone était le moyen de
communication le plus utilisé par 82% de la population11. Les autres outils pour accéder aux
contenus en ligne ont moins la cote car ils sont moins facilement transportables et se connectent
moins facilement à la 4G12.
Deuxièmement, leur succès peut s’expliquer aussi par l’évolution des moyens de connexion.
En 2018, 75% des Français se sont connectés à un réseau fixe, contre 78% en 2017 13. Ce taux
semble être en diminution, ce qui s’explique par l’évolution que connaît actuellement la
connexion à un réseau mobile, utilisée par 55% des internautes en 2018 contre 35% en 201414.
En Belgique, le développement de la 4G a commencé en 2010, où 22,51% des belges avaient
accès aux connexions mobiles, contre 63,77% en 201815. Son taux de pénétration était d’ailleurs
de 90,20% en 201716. Cet essor est dû à son développement et à une diminution de son coût. La
4G rend les utilisations d’Internet plus simples et plus agréables. Les citoyens sont donc
devenus des êtres « connectés ». Ainsi, la France approche de la couverture totale avec 88%
d’internautes en 2018, contre 52% en 200517. La Belgique en compte 89% en 201818.
D’ici 2020, le smartphone et les connexions mobiles devraient représenter 80% du trafic
Internet total et mener ainsi à l’avènement de l’Internet rapide19. La combinaison du smartphone
et de la 4G permet d’accéder à un contenu plus facilement peu importe l’endroit où son
9
Mission société numérique, « Baromètre du numérique en 2018 », 2018, p. 39, disponible
sur https://labo.societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/12/barometredunumerique2018.pdf (dernière
consultation : 7 août 2019).
10
Mission société numérique, op cit., p. 39.
11
SPF ECONOMIE - STABEL, « Utilisation des TIC auprès des ménages belges », 2017, disponible sur
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/utilisation-des-tic-aupres-des-menages#news (dernière consultation : 7
août 2019).
12
Par exemple, le nombre de personnes possédant un ordinateur est en diminution : en 2012, 83% de la population
en possédait un alors qu’aujourd’hui, ce n’est plus le cas que de 78% en France ; Mission société numérique,
« Baromètre du numérique en 2018 », 2018, p. 37, disponible sur https://labo.societenumerique.gouv.fr/wp-
content/uploads/2018/12/barometredunumerique2018.pdf (dernière consultation : 7 août 2019).
13
Mission société numérique, op. cit., p. 87.
14
Mission société numérique, op. cit., p. 87.
15
OCDE Stat, « Accès et utilisation des TIC par les ménages et les individus », disponible sur
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=ICT_HH2&lang=fr (dernière consultation : 7 août19).
16
SPF ECONOMIE - STABEL, « Utilisation des TIC auprès des ménages belges », 2017, p. 59, disponible sur
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/utilisation-des-tic-aupres-des-menages#news (dernière consultation : 7
août 2019).
17
Mission société numérique, « Baromètre du numérique en 2018 », 2018, p. 80, disponible
sur https://labo.societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/12/barometredunumerique2018.pdf (dernière
consultation : 7 août 2019).
18
SPF ECONOMIE - STABEL, « Utilisation des TIC auprès des ménages belges », 2017, p. 30, disponible sur
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/utilisation-des-tic-aupres-des-menages#news (dernière consultation : 7
août 2019).
19
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique
numérique, 2018/C 331/19, 15 juin 2017, pt. 17 disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0272_FR.html?redirect (dernière consultation : 4
août 2019).
9utilisateur se trouve. C’est désormais l’équipement privilégié par 82% d’individus pour
naviguer sur Internet20. Mais une fois connectés que font concrètement les individus?
Tout d’abord, en 2017 Internet est utilisé par 82% des individus pour se connecter aux
plateformes donnant accès aux réseaux sociaux, à leurs contenus ainsi qu’à leurs services de
messagerie21. Les deux tiers de la population y sont d’ailleurs présents, contre 50% en 2012.
Internet est utilisé majoritairement pour rechercher des informations, ensuite pour lire
l’actualité en ligne et enfin pour écouter de la musique22. Internet a tendance à remplacer la
télévision, surtout chez les plus jeunes. Alors que le temps moyen passé par semaine devant la
télévision était de vingt heures en 2012, il a diminué à dix-huit heures en 201823. En parallèle,
le temps passé sur Internet augmente : en 2013, le temps moyen était de treize heures par
semaine et il est désormais de vingt et une heures par semaine24. Dix de ces heures sont en
moyenne consacrées chaque semaine à regarder des films, des vidéos et autres programmes
audiovisuels sur des plateformes donnant accès à des contenus, contre six seulement en 201625.
CHAPITRE II : LE DROIT D’AUTEUR A L’ÈRE D’INTERNET
Grâce à l’évolution du smartphone et de la 4G, l’internaute est devenu de plus en plus actif et
s’est transformé en créateur de contenus. Ainsi, l’Internet d’aujourd’hui est caractérisé par
« une contribution dynamique des internautes au contenu et par l’interaction des internautes
entre eux »26. Ces derniers sont devenus acteurs dans le processus de création et de diffusion
d’informations constamment accessibles27. Le Web 2.0, dominé par quelques géants, est devenu
un phénomène social28. Il est aussi un outil économique indispensable29, basé sur le financement
publicitaire, ce qui permet aux plateformes de fournir leurs services « gratuitement »30.
Néanmoins, tout n’est pas rose31. Tout d’abord, chaque internaute peut être créateur de contenus
potentiellement illicites. Internet est devenu un outil efficace pour commettre des actes non
20
SPF ECONOMIE - STABEL, « Utilisation des TIC auprès des ménages belges », 2017, p. 30, disponible sur
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/utilisation-des-tic-aupres-des-menages#news (dernière consultation : 7
août 2019).
21
SPF ECONOMIE, « Baromètre de la société de l’information 2018 », octobre 2018, p. 33, disponible sur
https://economie.fgov.be/fr/publications/barometre-de-la-societe-de (dernière consultation : 9 août 2019).
22
SPF ECONOMIE, op. cit., p. 33.
23
Mission société numérique, « Baromètre du numérique en 2018 », 2018, p. 182, disponible
sur https://labo.societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/12/barometredunumerique2018.pdf (dernière
consultation : 7 août 2019).
24
Mission société numérique, op. cit., p. 185.
25
Mission société numérique, op. cit., p. 188.
26
M. DEGUELDRE, H. JACQUEMIN, Z. PREUMON et M. TRUSGNACH, Responsabilités et numérique, Jeune barreau
de Namur, Limal, Anthemis, 2018, p. 19.
27
M. DEGUELDRE, H. JACQUEMIN, Z. PREUMON et M. TRUSGNACH, op. cit., p. 210.
28
T. VERBIEST et E. WÉRY, Droit de l’internet et de la société de l’information, Création information
communication, Bruxelles, Larcier, 2001, p. 3.
29
F. GUILLAUME, Droit et Internet : de la logique internationaliste à la logique réaliste, Collection Thèse Droit
privé, Paris, Éditions Mare & Martin, 2016, p. 26.
30
F. GUILLAUME, op. cit., pp. 126-127.
31
D. BAHU-LEYSER et P. FAURE, Ethique et société de l’information, Groupe des écoles des
télécommunications, Paris, La Documentation française, 2000, p. 13.
10autorisés, ce qui a pour conséquence un accroissement du nombre d’atteintes potentielles au
droit d’auteur32.
Ensuite, le passage au Web 2.0 a augmenté le nombre de situations conflictuelles entre les droits
fondamentaux, tels que la propriété intellectuelle33, la liberté d’expression et d’information34
ou la liberté d’entreprise35. Ces libertés ne sont pas protégées de manière absolue et intangible
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne36. Il est nécessaire de les mettre
en balance et de réaliser une analyse au cas par cas, afin de parvenir à un juste équilibre sur le
Net.
A cela s’ajoute le fait qu’aujourd’hui, Internet repose essentiellement sur les intermédiaires
techniques. Grâce aux infrastructures qu’ils mettent à disposition, il est possible d’accéder au
réseau et de poster des contenus37. Internet n’étant pas une zone de non-droit38, il revient à ces
intermédiaires techniques de réguler le réseau, comme l’attestent les procédures de fournitures
d’informations, d’injonctions ou encore de blocage des contenus39. Ils ont donc un pouvoir
juridique, technique ainsi qu’un rôle d’opérateur et de régulateur40. Certains de ces
intermédiaires techniques sont bien implantés et ont aujourd’hui un rôle central. Il s’agit des
GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple). Leur position dominante leur permet de faire
pression sur les artistes mais également sur le législateur, ce qui rend la matière encore plus
difficile à réglementer.
Pour finir, les législations ne semblent pas adaptées à ce nouveau contexte. Les sources du droit
d’Internet sont multiples et se trouvent dans différentes branches du droit national, européen et
international. Il y a une prolifération de règles spécifiques 41. De plus, des notions telles que
celles d’hébergeur, de public ou encore de communication se sont élargies. Le droit a donc dû
être flexible afin de pouvoir s’adapter à ces changements que le législateur ne pouvait prévoir42.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a joué un rôle clé dans
l’interprétation et la « mise à jour » du droit43. Elle a eu la difficile tâche d’essayer de trouver
32
F. GUILLAUME, Droit et Internet : de la logique internationaliste à la logique réaliste, Collection Thèse Droit
privé, Paris, Éditions Mare & Martin, 2016, p. 7.
33
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 2000/C 364/01, J. O. C. E., 18 décembre 2000, art. 17.
34
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 2000/C, op. cit., art. 11.
35
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 2000/C, op. cit., art. 16.
36
C.J.U.E., C-70/10, Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM),
24 novembre 2011, paragraphe 43 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 2000/C 364/01, op.
cit., art. 52.
37
F. GUILLAUME, Droit et Internet : de la logique internationaliste à la logique réaliste, Collection Thèse Droit
privé, Paris, Éditions Mare & Martin, 2016, p. 29.
38
C. CASTETS-RENARD, Cours Droit de l’Internet, Montchrestien, Paris, Lextenso éditions, 2010, p.1.
39
F. GUILLAUME, Droit et Internet : de la logique internationaliste à la logique réaliste, Collection Thèse Droit
privé, Paris, Éditions Mare & Martin, 2016, p. 29.
40
F. GUILLAUME, op cit., p. 29.
41
M. DEGUELDRE, H. JACQUEMIN, Z. PREUMON et M. TRUSGNACH, Responsabilités et numérique, Jeune barreau
de Namur, Limal, Anthemis, 2018, p. 4.
42
M. DEGUELDRE, H. JACQUEMIN, Z. PREUMON et M. TRUSGNACH, op. cit., p. 9.
43
M. DEGUELDRE, H. JACQUEMIN, Z. PREUMON et M. TRUSGNACH, op. cit., p. 10.
11un équilibre entre les droits de l’auteur et les libertés fondamentales44, rendant très difficile
l’interprétation des concepts du droit d’auteur sur le Web.
Le régime en place, façonné par diverses décisions jurisprudentielles et ponctué d’interventions
législatives sectorielles, est un pis-aller45. Une intervention législative était indispensable au
niveau européen pour adapter et clarifier le régime46.
Dans ce contexte, la Commission a présenté sa proposition - et désormais directive - sur le droit
d’auteur dans le marché unique numérique47 par laquelle elle tente d’abord de moderniser et
d’adapter le régime des exceptions et des limitations au droit d’auteur, qui n’avaient pas été
envisagées dans le cadre d’une application numérique. Ensuite, la directive tâche d’élargir la
possibilité d’accès en ligne aux contenus protégés par le droit d’auteur dans l’Union et veut
permettre de toucher de nouveaux publics, tout en facilitant l’accès transfrontalier aux œuvres48.
Enfin, avec l’article 17, la Commission a tenté de fixer un cadre plus équitable, destiné à
stimuler la création de contenus et à améliorer le fonctionnement du marché du droit d’auteur.
Elle entend offrir une rémunération plus juste aux auteurs dans le but de restreindre le value
gap49, également renforcer la position des titulaires de droits lors de la conclusion de contrats
de licence et accentuer la coopération entre les plateformes et les titulaires de droits dans
l’exploitation des œuvres afin de lutter de manière plus efficace contre la contrefaçon50.
44
M. BEHAR-TOUCHAIS, L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’Internet, tome 63, volume 1,
Bibliothèque de l’IRJS - André Tunc, Paris, IRJS éditions, 2015, p. 6.
45
P. VAN CLEYNENBREUGEL, « Jusqu’ici tout va bien : les plateformes numériques face au droit européen », Revue
de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2019/01, Liège, Larcier, 2019, p. 4.
46
M. DEGUELDRE, H. JACQUEMIN, Z. PREUMON et M. TRUSGNACH, Responsabilités et numérique, Jeune barreau
de Namur, Limal, Anthemis, 2018, p. 10.
47
Dans une communication de mai 2015 dévoilant ses orientations politiques, la Commission, présidée par Jean-
Claude Juncker, a mis au point une stratégie en trois piliers pour un marché numérique unique en Europe. Un
second communiqué de décembre 2015 a quant à lui présenté des actions ciblées permettant de moderniser le droit
d’auteur en Europe. Parmi celles-ci se trouvait la proposition et désormais directive du Parlement européen et du
Conseil sur le droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique ; Communiqué de presse de la
Commission européenne, Un marché unique numérique pour l’Europe: la Commission définit 16 initiatives pour
en faire une réalité, Bruxelles, 2015, disponible sur: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_fr.htm
(dernière consultation : 4 août 2019); Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions, Vers un cadre moderne et plus européen pour le
droit d’auteur, COM(2015) 626 final, Bruxelles, 9 décembre 2015, disponible
sur https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-626-FR-F1-1.PDF (dernière consultation : 2
août 2019).
48
Proposition de directive du Parlement et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique,
COM(2016) 593 final, disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN (dernière consultation : 3 août 2019).
49
Le value gap « n’est autre que la manifestation d’un fossé entre les pratiques d’usage massif d’œuvres ou autres
contenus protégés rendues possibles grâce aux grands acteurs d’Internet – les plateformes – et les flux de
rémunération, peu significatifs, découlant de ces usages pour les producteurs « de la valeur » » ; V-L. BENABOU,
Distorsion de valeur et distorsions des droits : Le « Value Gap » : pataquès, galimatias, et finalement, amphigouri,
Doctrine du droit d’auteur, France, Stradalex, 2017, p. 1.
50
Proposition de directive du Parlement et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique,
COM(2016) 593 final, disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN (dernière consultation : 3 août 2019).
12PARTIE II : L’ARTICLE 17 DE LA DIRECTIVE 2019/790
Les services de partage en ligne de contenus sont devenus la source principale d’accès aux
contenus dans la société de l’information. Ils sont présents partout, pour tous et pour tout. Même
s’ils offrent des avantages, ils causent des difficultés dans les cas où un contenu est téléchargé
par un utilisateur sans autorisation du titulaire de droits51. La réponse à la question de savoir si
ces fournisseurs de services procédaient à des actes de communication au public et devaient dès
lors obtenir une autorisation des titulaires de droits pour les contenus non autorisés téléchargés
par les utilisateurs n’était pas claire. C’était source de nombreuses insécurités juridiques et avait
pour conséquence qu’il était difficile pour les titulaires de droits de connaître les utilisations qui
étaient faites de leurs œuvres et d’obtenir une rémunération. Un renforcement de la sécurité
juridique et une harmonisation du droit d’auteur étaient indispensables en la matière52. Il fallait
renforcer la collaboration entre les titulaires de droits et les plateformes, essayer de rendre plus
équitable la rémunération des auteurs et adapter le régime de la responsabilité aux réalités
nouvelles du numérique.
L’article 17 tente de rencontrer ces objectifs de la manière suivante. Il qualifie clairement les
actes posés par les hébergeurs en acte de communication au public. Par conséquent, le régime
de responsabilité en place est revu et rend responsable l’hébergeur en cas de publication non
autorisée d’un contenu protégé. Afin d’éviter de voir sa responsabilité engagée, le fournisseur
de services doit conclure des contrats de licence dans lesquels les titulaires de droits53 pourraient
négocier une rémunération appropriée ainsi que les conditions de mise en ligne de leurs œuvres
et le contrôle de ces utilisations54. S’il n’y parvient pas, l’hébergeur devra mettre en place des
mesures destinées à empêcher la diffusion des contenus non autorisés.
Avant d’étudier en profondeur l’article 17, un premier chapitre analysera le régime actuellement
en vigueur pour les plateformes collaboratives et en soulignera les lacunes. Ensuite, dans un
second chapitre, la procédure législative ayant mené à l’adoption de l’article 17 sera expliquée
afin de mettre en évidence les points qui ont fait débat et les enjeux sous-jacents. Dans un
troisième chapitre, l’article 17 sera examiné en profondeur ce qui permettra de mettre en
exergue les réponses qu’il apporte. Enfin, dans un quatrième et dernier chapitre, une grille de
recommandations sera proposée. L’objectif de celle-ci sera de voir comment les plateformes
pourraient se conformer au prescrit de l’article 17.
51
Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits
voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, considérant 61,
J.O.U.E., n° 130/92 du 17 mai 2019.
52
Commission des affaires juridiques, Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil
sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, 2016/0280(COD), 10 mars 2017, p. 53, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245_FR.html?redirect (dernière consultation : 29
juillet 2019).
53
R. M. HILTY et V. MOSCON, « Contributions by the Max Planck Institute for Innovation and Competition in
response to the questions raised by the authorities of Belgium, the Czech Republic, Finland, Hungary, Ireland and
the Netherlands to the Council Legal Service regarding Article 13 and Recital 38 of the Proposal for a Directive
on Copyright in the Digital Single Market », 8 septembre 2017, p. 100, disponible sur
https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/Answers_Article_13_2017_Hilty_Moscon-rev-
18_9.pdf (dernière consultation : 31 juillet 2019).
54
R. M. HILTY et V. MOSCON, op. cit., p. 100.
13CHAPITRE I : LE REGIME JURIDIQUE ACTUEL DES PLATEFORMES
COLLABORATIVES
Dans la première section du présent chapitre, la question suivante sera posée: quelles sont les
activités qui peuvent être qualifiées d’activité d’hébergement et ainsi bénéficier du régime
d’exonération de la responsabilité prévu par la directive e-Commerce ? L’hébergement sera
d’abord défini (sous-section I). Son rôle s’est modifié suite aux évolutions d’Internet, ce qui
pose de nouvelles questions quant à l’opportunité de la qualification d’une activité en activité
d’hébergement. Pourtant l’enjeu d’une telle qualification est de taille. En effet, elle permet de
bénéficier du régime d’exonération de responsabilité qui sera ensuite détaillé (sous-section II).
Comme le rôle des hébergeurs est central et que ceux-ci occupent une position privilégiée, il
n’est pas étonnant que le législateur européen les ait mis à contribution dans sa lutte contre la
contrefaçon sur le Web. Ainsi, le mécanisme des injonctions contre les hébergeurs (sous-section
III) qui est à mettre en lien avec l’interdiction de surveillance généralisée (sous-section IV) sera
expliqué. Le système de fourniture d’informations sera également brièvement développé (sous-
section V).
La seconde section tentera de répondre à la question suivante : les actes posés par les hébergeurs
sont-ils des actes de communication au public, qui par conséquent nécessiteraient une
autorisation du titulaire de droits ainsi qu’une rémunération de ce dernier ? L’opportunité de la
qualification en acte de communication au public des activités d’hébergement au vu des
évolutions de leurs activités sera analysée (sous-section I). Cela est à mettre en corrélation avec
la question des hyperliens (sous-section II) et les développements récents de la jurisprudence
de la Cour de Justice (sous-section III). On exposera encore en quoi cette qualification en acte
de communication au public est importante pour la rémunération de l’auteur (sous-section IV)
avant de mettre en avant le mécanisme des second level agreements (sous-section V).
Section I : La responsabilité des plateformes numériques
S’il semble aisé, dans la plupart des cas, d’identifier l’auteur d’une infraction dans le monde
physique, il n’en va pas de même sur Internet, où les contenus et activités illicites sont fréquents.
Trouver qui se cache derrière une publication ou un commentaire injurieux relève souvent de
l’exploit, car il n’est pas rare que l’internaute soit anonyme, à l’étranger ou insolvable55. Le
législateur européen a donc décidé, lorsqu’il a adopté la directive 2000/3156, de prévoir trois
cas d’exonération de la responsabilité57. Il craignait que les intermédiaires, soucieux de ne pas
voir leur responsabilité engagée trop facilement, quittent le marché numérique ou mettent en
55
M. DEGUELDRE, H. JACQUEMIN, Z. PREUMON et M. TRUSGNACH, Responsabilités et numérique, Jeune barreau
de Namur, Limal, Anthemis, 2018, p. 63.
56
Directive 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services
de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, J.O.C.E., L178/1
du 17 juillet 2000.
57
F. GEORGE et J-F. HUBIN, « Les prestataires intermédiaires de la société de l’information face au droit commun
de la responsabilité extracontractuelle », Bruxelles, Larcier, 2017/3, p. 209.
14place au préalable des mécanismes de censure58, ce qui portait ainsi préjudice à la libre
circulation des contenus et au développement du Web59 60.
L’un de ces trois cas d’exonération retient particulièrement l’attention dans le cadre de ce
travail ; il concerne les hébergeurs. Il est envisagé à l’article 14 de la directive e-Commerce61,
transposée en droit belge par la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services
de la société de l’information et, fait aujourd’hui l’objet de l’article XII19 du Code de droit
économique.
a) Sous-section I : Définition de l’hébergement
Selon l’article 14 de la directive e-Commerce, l’activité d’hébergement consiste à « stocker des
informations fournies par un destinataire du service »62. Pour pouvoir qualifier une activité
d’activité d’hébergement, celle-ci doit répondre aux exigences du critère de neutralité, qui
suppose que l’activité de l’hébergeur soit « limitée au processus technique d’exploitation et de
fourniture d’un accès à un réseau de communication », ce qui « revêt un caractère purement
technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de
l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations stockées »63.
Si à l’origine, le rôle de l’hébergeur était purement passif et neutre, les choses ont changé.
Désormais, les hébergeurs réalisent des prestations complémentaires au stockage, telles que la
diffusion de vidéos, d’images ou de textes64. Ils s’intéressent aux contenus en eux-mêmes et à
des manières de les rendre plus attractifs afin d’accroitre leurs profits et leur renommée 65. Ces
activités complémentaires sont problématiques au regard du critère de neutralité. Elles mettent
en péril la qualification d’activité d’hébergement et, par conséquent, le bénéfice de l’article 14
de la directive e-Commerce. Cela a donné naissance à un important contentieux et conduit la
Cour de Justice de l’Union européenne à rendre plusieurs arrêts66 dans lesquels le critère de
neutralité était au centre des débats.
La première intervention de la Cour de Justice a lieu en 2010, dans le cadre de l’affaire jointe
Google France et Google67. Il s’agissait de qualifier le rôle de Google quant à son service de
publicité en ligne nommé « AdWords » qui diffusait des messages publicitaires en lien avec la
58
M. DEGUELDRE, H. JACQUEMIN, Z. PREUMON et M. TRUSGNACH, Responsabilités et numérique, Jeune barreau
de Namur, Limal, Anthemis, 2018, p. 65.
59
F. GUILLAUME, Droit et Internet : de la logique internationaliste à la logique réaliste, Collection Thèse Droit
privé, Paris, Éditions Mare & Martin, 2016, p. 581.
60
F. GEORGE et J-F. HUBIN, « Les prestataires intermédiaires de la société de l’information face au droit commun
de la responsabilité extracontractuelle », Bruxelles, Larcier, 2017/3, p. 209.
61
Directive 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur, J.O.C.E., L178/1 du 17 juillet 2000.
62
Directive 2000/31/CE, op. cit,, art. 14.
63
Directive 2000/31/CE, op. cit., considérant 42, J.O.C.E., L178/1 du 17 juillet 2000.
64
M. BEHAR-TOUCHAIS, L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’Internet, tome 63, volume 1,
Bibliothèque de l’IRJS - André Tunc, Paris, IRJS éditions, 2015, p. 6.
65
F. GUILLAUME, Droit et Internet : de la logique internationaliste à la logique réaliste, Collection Thèse Droit
privé, Paris, Éditions Mare & Martin, 2016, p. 585.
66
Notamment, C.J.U.E., C-236/08 à C-238/08, aff. jointes Google France et Google, 23 mars 2010 ; C.J.C.E., C-
324/09, L’Oréal SA c/eBay, 12 juillet 2001; C.J.U.E., C-484/14, Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment
Germany GmbH, 15 septembre 2016.
67
C.J.U.E., C-236/08, Google France SARL et Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA, 23 mars 2010.
15Vous pouvez aussi lire