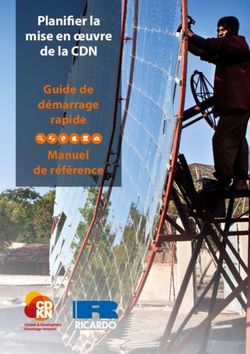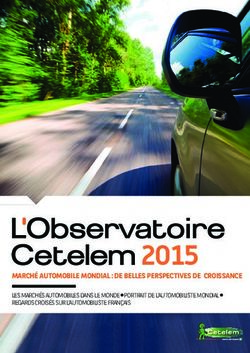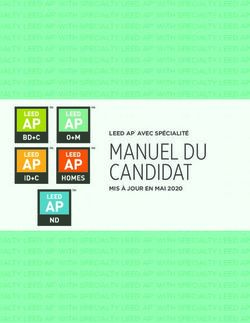ÉVALUATION INDEPENDANTE DES OPERATIONS D'APPUI PROGRAMMATIQUE DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT EVALUATION GROUPEE DE ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Évaluation indépendante du
développement
Banque africaine de développement
ÉVALUATION INDEPENDANTE DES OPERATIONS D’APPUI
PROGRAMMATIQUE DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT
EVALUATION GROUPEE DE
L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR PRIVEii
Remerciements
Chef de projet Clément Bansé
Membre(s) de l’équipe Penelope Jackson, Samson Houetohossou, Stéphanie
Yoboué
Consultant(s) Particip GMBH – Chef d’équipe : Tino Smail
Pair évaluateur interne Oswald Agbadome
Pair évaluatrice externe Ann Bartholomew, Consultante indépendante
Groupe de référence interne de la Carina Sugden et Regis Lakoue Derant, (ECGF) ; Fabrice
Banque Sergent (AHHD) ; Rhoda Mshana (PESR) ; Namawu Alolo
(SNSP) ; Pietro Toigo (COMZ) ; Alain Niyubahwe (PISD) ;
Emmanuel Diarra (PIFD) ; Bruno Boedts (RDTS) ; Solomane
Kone (RDVP).
Chargés de gestion du savoir Télésphore D. Somé et Jacqueline Nyagahima
Autres concours / contributions Henda AYARI ; Myrtha DIOP ; Anasthasie Blandine GOMEZ et
Adzobu-Agbare RUBY.
Remerciements particuliers IDEV tient à remercier particulièrement tous les chefs de
projet, bureaux extérieurs, représentants gouvernementaux
et autres parties prenantes qui ont été interrogés, et qui ont
répondu aux questionnaires d’enquête ou participé aux
groupes de discussions.
Chef de division (OIC) Foday Turay
Évaluateur général Rakesh Nangia
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privéiii
Table des matières
RÉSUMÉ ANALYTIQUE .................................................................................... v
INTRODUCTION ................................................................................................ 1
Contexte .......................................................................................................... 1
Objectives ........................................................................................................ 1
Méthodologie et limites .................................................................................... 2
CONTEXTES NATIONAUX ET QUALITÉ DES MECANISMESD’OAP .............. 2
Les contextes nationaux .................................................................................. 2
Qualité des mécanismes de l’OAP ................................................................... 4
CONTRIBUTION DES OAP AUX EFFETS INTERMÉDIAIRES ET FINAUX ...... 8
Effets intermédiaires ........................................................................................ 8
Effets finaux ................................................................................................... 12
Durabilité ....................................................................................................... 13
OBSERVATIONS SUR L’ENSEMBLE DES QUESTIONS D’ÉVALUATION .... 14
Programmation, conception et gestion ........................................................... 14
Annexe 1 : Évaluations groupées – Méthodologie des études de cas ........ 23
Annexe 2 : Théorie du changement pour l’évaluation .................................. 39
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privéiv
Sigles et acronymes
ABG Appui budgétaire général
ABS Appui budgétaire sectoriel
ABRC Appui budgétaire en réponse aux crises
AT Assistance technique
BAD Banque Africaine de développement
BM Banque mondiale
CM Responsable pays
C-M-O Contexte – mécanisme - effet
CPO Chargé de programme pays
DSP Document de stratégie par pays
EGESP Programme d’appui à la gouvernance économique et à l’énergie
FMI Fonds monétaire international
GFP Gestion des finances publiques
GFPPSC Programme d’appui à la gestion des finances publiques et à la compétitivité du secteur
privé
IDEV Département de l’évaluation indépendante de la Banque
IPSDCP Programme inclusif pour l’environnement du secteur privé et la compétitivité
OAP Opérations d’appui programmatique
PACEM Programme d’appui à la compétitivité de l’économie marocaine
PAR Rapport d’évaluation de programme
PARGE Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique
PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière
PME Petites et moyennes entreprises
PMR Pays membre régional
PMR Pays membre régional
PPDR Revue du document du portefeuille du projet
PPP Partenariat public-privé
PRI Pays à revenu intermédiaire
ESP Environnement du secteur privé
RAP Rapport d’achèvement de projet
RMP Revue à mi-parcours
TdC Théorie du changement
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UC Unité de compte
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
WGI Indicateurs de la gouvernance dans le monde
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privév
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Introduction développement n’ont été satisfaisants qu’en
Égypte et au Ghana, mais pas dans les trois
Le présent rapport synthétise les principales autres pays. Dans le cas du Maroc et du Mali,
conclusions de l’évaluation d’un groupe de des opportunités ont été manquées pour
neuf Opérations d’appui programmatique améliorer la coordination avec les partenaires
(OAP) axées sur l’environnement du secteur de développement.
privé (ESP), approuvées et mises en œuvre
dans cinq pays (Égypte, Ghana, Mali, Maroc Dans l’ensemble, l’instrument d’OAP était
et Seychelles) entre 2012 et 2017 par la pertinent pour renforcer les réformes liées à
Banque africaine de développement (ci-après l’environnement du secteur privé et à la
« la Banque »). gouvernance. Cependant, la conception et la
mise en œuvre de l’instrument ont présenté
L’évaluation groupée de l’environnement du plusieurs lacunes, comme : i) l’absence de
secteur privé vise à déterminer la pertinence, perspectives solides à moyen terme ; ii) des
l’efficacité, l’efficience et la durabilité de ces cadres de résultats insuffisamment
OAP axées sur le ESP et à en tirer des hiérarchisés ; iii) un dialogue insuffisant sur
enseignements utiles pour la conception et la les politiques ; et iv) des objectifs trop
gestion des OAP futures. ambitieux. Des faiblesses dans la fourniture
de l’assistance technique ont également été
L’évaluation groupée de l’environnement du constatées, ce qui explique en partie
secteur privé fait partie des sept composantes certaines insuffisances du dialogue sur les
d’une évaluation plus large portant sur politiques.
l’utilisation des OAP par la Banque entre 2012
et 2017. Contribution des OAP aux réformes
capitales
Qualité des mecanismes de l’OAP
Dans l’ensemble, la performance des OAP
Il ressort de l’évaluation une image largement axées sur ESP en ce qui concerne les effets
satisfaisante de la pertinence des OAP axés intermédiaires a été jugée satisfaisante, des
sur l’environnement du secteur privé – au réformes audacieuses ayant été entreprises
regard de leur programmation, de leur par les pays membres régionaux (PMR) dans
conception et de leur large conformité à la la plupart des domaines d’effets ciblés passés
politique et aux directives de la Banque ainsi en revue. Dans certains cas (Égypte et
qu’aux bonnes pratiques internationales. Seychelles), les effets intermédiaires
observés dans les domaines de l’ESP et de
La qualité des OAP est jugée satisfaisante l’énergie se sont révélés plus positifs que
dans trois des cinq cas (Égypte, Ghana et ceux du domaine de la gestion des finances
Seychelles), les deux autres cas (Mali et publiques (GFP). Cela s’explique par le fait
Maroc) étant jugés insatisfaisants1. que l’OAP a été focalisée sur des réformes
spécifiques dans des sous-domaines du
Dans la plupart des cas, la programmation et secteur de la GFP, qui n’ont pas été
la conception étaient conformes aux considérés comme des changements de
directives internes, et les délais de politique capitale ; et dans certains cas, les
décaissement et les coûts de transaction sont résultats ont été mitigés dans ces sous-
jugés satisfaisants ou très satisfaisants. domaines.
Cependant, le dialogue sur les politiques et la Toutefois, l’influence des OAP sur ces effets
coordination avec d’autres partenaires de est jugée modeste. L’influence spécifique des
1 L’évaluation a utilisé une échelle à quatre niveaux
allant de « Très insatisfaisant » à « Très satisfaisant ».
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privévi
OAP s’est souvent limitée à aider à maintenir Enseignement 2 (centre d’intérêt des OAP) : La
les réformes « sur la bonne voie ». création d’un environnement favorable au
secteur privé commence par la garantie d’un
Les contributions les plus importantes des contexte macroéconomique stable, le
OAP ont été observées dans les cas où la renforcement de la gouvernance du secteur
public (y compris les règles de passation des
fourniture d’un appui financier a été
marchés) et l’amélioration de l’accès aux
accompagnée d’un engagement actif et infrastructures clés (telles que l’énergie).
continu dans le dialogue et de dispositifs
d’assistance technique adéquats (Égypte et Toutes les OAP passées en revue
Ghana). reconnaissent le caractère étroitement lié de
ces différentes dimensions. Le double centre
Les OAP, par leur soutien aux mesures d’intérêt des OAP évaluées, à savoir la
politiques, n’ont contribué que dans une gouvernance et l’ESP, était approprié.
mesure limitée au renforcement de l’évolution Toutefois, le cas du Ghana montre la difficulté
positive au niveau des effets finaux. Cela peut qu’il y a à maintenir l’équilibre entre ces
être lié à deux observations principales : i) la différentes dimensions, car les OAP ont
contribution de l’OAP aux changements de tendance à se concentrer sur les problèmes
politique n’a pas été substantielle dans de urgents de stabilisation macro budgétaire,
nombreux domaines ; et ii) les changements reléguant au second plan les problèmes
de politique n’ont pas produit des effets spécifiques de développement des PME/
positifs plus larges en raison de plusieurs d’environnement des affaires.
facteurs, notamment la complexité de
certains processus de réforme et des Enseignement 3 (appui soutenu à plusieurs
éléments défavorables dans certains niveaux) : la réalisation de réformes
structurelles à moyen et long terme nécessite
environnements institutionnels.
un appui soutenu et multiniveau en matière de
conception, de programmation, de mise en
Dans l’ensemble, la durabilité des OAP est œuvre et suivi après la mise en œuvre des
jugée insatisfaisante. Les scores sont faibles OAP.
dans trois cas sur cinq - une conséquence de
la complexité inhérente aux contextes La supervision et l’engagement continus dans
institutionnels en dépit d’une forte le dialogue sur les politiques ont été
appropriation par les pays dans la plupart des insuffisants pour accompagner les efforts à
pays. moyen terme des PMR en matière de
réformes politiques. Dans le même temps, les
contributions les plus importantes aux
Principaux enseignements tirés réformes des politiques ont été observées
dans les cas où la Banque a réussi à
Enseignement 1 (pertinence stratégique): les compléter son soutien financier en
OAP sont pertinents et font partie intégrante s’engageant activement dans le dialogue et
du portefeuille de la Banque, car ils peuvent en fournissant un appui technique
jouer un rôle stratégique pour satisfaire les complémentaire pertinent.
objectifs de développement de la Banque,
ainsi que ceux des PMRs et des PDs.
Enseignement 4 (capacités) : Un dialogue
En général, l'instrument OAP a été utile pour approprié et un appui technique sont
renforcer les réformes liées à l'ESP et à la importants pour l'utilisation systématique et
gouvernance, et a prouvé son potentiel pour stratégique de l'instrument OAP.
aider le continent à atteindre les High 5 en
Cela est également illustré par le fait que
soutenant les questions transversales de
certaines OAP ont enregistré de bons
GFP et d'ESP. Bien que le personnel du siège
résultats en dépit d’un contexte défavorable.
ait joué un rôle important, la capacité de la
Mais les études de cas montrent que les OAP
Banque à saisir les opportunités offertes par
constituent un instrument extrêmement
l’instrument dépend souvent de l’engagement
exigeant quel que soit le contexte et que,
des bureaux de pays / bureaux régionaux
dans l’ensemble, la capacité de la Banque à
concernés.
mener le dialogue et à fournir
l’accompagnement technique nécessaire a
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privévii
été insuffisante pour une utilisation plus
systématique et stratégique de cet
instrument. La manière dont la Banque
s’engage dans la conception et la mise en
œuvre joue un rôle important dans la réussite
de ces programmes.
Enseignement 5 (efforts de collaboration) : La
mise en œuvre réussie par le gouvernement de
réformes complexes dans des domaines clés
nécessite une collaboration adéquate entre les
partenaires de développement, y compris la
Banque.
Dans plusieurs cas, la Banque a su tirer parti
de son degré élevé de réactivité face aux
besoins des PMR et de sa longue expérience
en matière de partenariat pour unir avec
succès ses forces à celles des partenaires
internationaux, notamment la Banque
mondiale. Cependant, cette collaboration a
souvent diminué avec le temps, en partie à
cause du manque de temps dont disposait le
personnel pour assurer la supervision des
OAP après leur approbation (contrairement à
la phase d’identification et d’évaluation).
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privé1
INTRODUCTION
Contexte
L’évaluation groupée de l’environnement du secteur privé (ESP) fait partie des sept
composantes d’une évaluation plus large de l’utilisation des OAP - Opérations d’appui
programmatique (anciennement connues sous l’appellation d’« opérations à l’appui de réformes »).
Effectuée par le Département de l’évaluation indépendante du développement (IDEV) de la Banque
africaine de développement (BAD), cette évaluation porte sur neuf des OAP axées sur l’ESP
approuvées et mises en œuvre dans cinq pays (Égypte, Ghana, Mali, Maroc et Seychelles) sur la
période 2012-2017. Elle porte également sur tous les types d’OAP, notamment l’appui budgétaire
général (ABG), l’appui budgétaire sectoriel (ABS) et l’appui budgétaire en réponse aux crises
(ABRC).
L’évaluation vise à répondre aux trois questions fondamentales d’évaluation suivantes :
Dans quelle mesure la Banque programme-t-elle, conçoit-elle et gère-t-elle de façon
appropriée ses OAP ?
Quelles sont les données probantes concernant la performance des OAP, en particulier
pour la Banque dans les domaines prioritaires que sont l’énergie et l’environnement du
secteur privé (ESP) ?
À l’avenir, comment la Banque peut-elle s’assurer qu’elle optimise son utilisation des OAP,
notamment en l’aidant à réaliser les High 5 ?
Objectives
L’évaluation groupée de l’environnement du secteur privé vise à apprécier la pertinence,
l’efficacité, l’efficience et la durabilité des OAP axés sur l’environnement du secteur
privé mises en œuvre dans cinq pays2, en procédant à la synthèse des résultats obtenus
de façon à tirer des enseignements utiles pour la conception et la gestion future des OAP.
Ces enseignements sont pertinents tant pour l’organisation du travail sur l’ ESP dans son
ensemble que pour la conception et la gestion des OAP en général.
L’intérêt porté à l’environnement du secteur privé trouve sa justification dans le fait que les
OAPs dans ce secteur sont courantes et très pertinentes pour les priorités stratégiques de
la Banque pour l’avenir. L’ESP fait partie intégrante de la Stratégie du Groupe de la Banque pour
la période 2013-2022 et des High 5 où elle s’inscrit notamment sous la priorité d’« industrialiser
l’Afrique ». En effet, s’il est fait abstraction de toutes les OAP axées sur la gouvernance générale
ou la gestion des finances publiques (GFP) – qui ont un caractère transversal et peuvent également
être mises à profit pour « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique », la deuxième
priorité la plus financée parmi les High 5 est celle d’« industrialiser l’Afrique » (33 opérations),
principalement à travers l’appui au secteur privé. Elle offre par conséquent un centre d’intérêt
complémentaire à celui du secteur de l’énergie. L’ESP constitue également un pilier essentiel du
Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II 2014-2018) du Groupe de la
Banque.
L’évaluation groupée de l’environnement du secteur privé a appliqué une approche inspirée
de l’analyse des contributions et de la synthèse réaliste (de plus amples précisions figurent à
l’annexe 1 et à la sous-section suivante). Elle a retenu l’ESP comme centre d’intérêt thématique,
mais cela n’a pas empêché d’examiner les questions de GFP abordées par les OAPs analysées.
Deux études de cas - Égypte et Ghana - ont porté sur l’analyse des composantes à la fois
d’environnement du secteur privé et de l’énergie.
2 Se reporter à la section 2.4 pour de plus amples précisions sur la sélection des études de cas.
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privé2
Méthodologie et limites
L'évaluation applique une approche basée sur la théorie du changement. Elle a pris pour point
de départ une théorie du changement (TdC) reconstruite, qui a été élaborée sur la base de la
documentation de la Banque, des consultations et des références aux orientations d’évaluation
internationales pour l’appui budgétaire. La TdC a permis d’identifier les questions d’évaluation
importantes à partir de la compréhension du fonctionnement escompté de l’instrument d’OAP et
d’apporter des précisions sur la façon d’interpréter les résultats.
L’approche méthodologique nécessite l’évaluation du contexte de chaque opération (en tenant
compte à la fois des dimensions nationales et sectorielles du contexte), de la qualité du mécanisme
proprement dit (la conception et les modalités de mise en œuvre de l’OAP) et des effets obtenus
en termes de « reformes capitales»3 - de effets intermédiaires les plus importants (produits induits)
ciblés par les OAP - et les effets finaux. Les équipes d’étude, grâce à l’analyse de documents et à
une série d’entretiens avec des personnes et des groupes de discussion, ont utilisé un cadre
d’analyse des contributions pour évaluer le degré d’importance de la contribution de l’OAP aux
résultats obtenus. De plus amples précisions sur la méthodologie sont fournis en annexe au présent
rapport de synthèse, ainsi que sur la théorie du changement générique établie pour servir de base
à l’évaluation globale des OAP.
S’agissant des limites de la méthodologie en ce qui concerne son application pratique, deux
insuffisances majeures ont été constatées :
Premièrement, il existait des lacunes dans la disponibilité des pièces justificatives. Plus
précisément, dans la plupart des cas, en raison de l’achèvement relativement récent des
OAP, les rapports d’achèvement de programme (RAP) n’avaient pas encore été établis.
Cependant, des informations suffisantes ont été obtenues grâce à des entretiens et à des
rapports disponibles dans le pays qui devraient normalement être disponibles dans un RAP.
Une lacune plus importante – concernant toutes les études de cas - était que la durée d’une
semaine réservée au travail sur le terrain sur le terrain pour chaque étude de cas ne
permettait pas de disposer de suffisamment de temps pour la collecte de données
détaillées, ce qui limitait la robustesse de l'analyse de contribution.
Pour chaque étude de cas, les missions sur le terrain ne devaient durer qu’une semaine.
Bien que la plupart des missions aient été effectuées par des équipes de trois personnes
(2 consultants et 1 agent d’IDEV), cela n’a pas été suffisant pour émettre des hypothèses
précises sur la contribution des OAP, vérifier ces hypothèses et les hypothèses alternatives
potentielles, à travers des entretiens triangulés adéquats et des preuves documentaires
pour parvenir à de solides conclusions sur la contribution des OAP aux changements
institutionnels et politiques recensés. Les conclusions sur l’influence relative des OAP
devraient donc être considérées comme indicatives, mais non concluantes. Néanmoins,
cela n’a pas empêché de détecter certaines réussites manifestes et certaines lacunes et,
sur cette base, de dégager des enseignements essentiels pour l’avenir.
CONTEXTES NATIONAUX ET QUALITÉ DES MECANISMESD’OAP
Les contextes nationaux
Les contextes nationaux de chaque étude de cas ont été évalués en fonction de quatre dimensions.
Les performances par rapport à chacune d’entre elles ont été classées sur une échelle allant de 1
(« Très difficile », score le plus faible) à 4 (« Très favorable », score le plus élevé). Les quatre
dimensions étaient les suivantes : i) la situation socioéconomique, telle qu’évaluée par rapport à
l’indice de développement humain (IDH) du PNUD ; ii) la situation en matière de gouvernance
politique, évaluée par le classement par rapport aux trois dimensions pertinentes des Indicateurs
de la gouvernance dans le monde (WGI) ; iii) la situation de la gouvernance technique, telle
3 Les reformes capitales désignent les changements d’orientation, budgétaires ou institutionnels de fond ou influents
ciblés par les OAP dans l’ensemble des effets intermédiaires (produits induits) identifiés dans la théorie du changement
(voir les détails à l’encadré n°1).
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privé3
qu’évaluée par le classement par rapport aux trois dimensions pertinentes des WGI ; et iv) la qualité
des relations avec les partenaires de développement au niveau national.
Le tableau ci-dessous résumé les évaluations effectuées pour les cinq études de cas.
Tableau 1 : Vue d’ensemble du contexte national dans les cinq études de cas sur l’ESP
Dimension Égypte Ghana Mali Maroc Seychelles
(PRI) (PRI) (PFR) (PRI) (PRI/PHR)
Situation socioéconomique (IDH)4 3 2 1 2 4
Gouvernance politique (WGI)5 1 3 2 2 3
Gouvernance technique (WGI)6 2 3 2 3 4
Relations avec les partenaires de développement 7 3 3 3 4 2
Score global 2 3 2 3 3
Le tableau ci-dessous présente des éléments qualitatifs complémentaires pour chaque étude de
cas.
Tableau 2 : Informations complémentaires sur le contexte national des cinq études de cas de l’ESP
Pays Coopération pour le développement Contexte plus large du pays
Égypte Un pays « stratégique » (notamment pour des raisons Plusieurs défis après la révolution sur le plan
de sécurité et de migration) pour de nombreux politique et économique, dont des
partenaires, mais certains partenaires internationaux déséquilibres macro budgétaire importants.
hésitent à « intervenir ». Problèmes structurels de longue date (par
Programme du FMI en cours8: Non (Programme du FMI exemple, subventions énergétiques).
– 12 milliards USD – approuvé en novembre 2016, un
an après l’approbation de l’OAP).
Ghana Le cadre d’appui budgétaire multidonateur (MDBS) Des déséquilibres macro budgétaire croissants
s’est effondré en 2014. depuis 2011.
Changement marqué dans l’architecture de Réduction constante de la pauvreté sur le long
financement du développement depuis l’obtention du terme, mais persistance des inégalités.
statut de PRITI. Problèmes persistants de bonne gouvernance
Programme du FMI en cours : Oui (OAP approuvé en aux niveaux central et local
novembre 2015, quelques mois après l’approbation de
l’assistance du FMI).
Mali Principaux fournisseurs d’AB : BM, UE, BAD (les Le coup d’état de 2012 a engendré de sérieux
donateurs bilatéraux ont abandonné l’AB au cours des problèmes politiques et économiques.
dernières années). Directives/échéances de l’Union économique
Programme du FMI en cours : Oui (l’Accord au titre de et monétaire ouest-africaine (UEMOA) :
la Facilité de crédit rapide (janvier 2013) a précédé celui
Principaux moteurs des réformes politiques
au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) (Dec. (GFP).
2013) ; l’assistance a été temporairement gelée mi- Augmentation des taux de pauvreté depuis
2014). 2012.
Accord de paix Malien.
Maroc Relations solides avec les donateurs multilatéraux et Tendance positive de la lutte contre la
bilatéraux (7e pays d’Afrique en termes de volume corruption.
d’aide), avec des secteurs stratégiques de coopération Défis persistants dans les questions liées a
clairs. l’environnement du secteur privé: attractivité
4 1 = appartient au groupe des 20 % d’indices les plus faibles au classement des pays selon l’IDH ; 2 = 20-40 %, 3 = 40-60 %, 4 = groupe des
premiers 40 %.
5 Classement moyen des pays sur trois dimensions des indicateurs de gouvernance dans le monde (Voix et responsabilité ; Stabilité politique et
absence de violence ; Efficacité des pouvoirs publics) ; même base de notation que pour la note de l’IDH (1= groupe des 20 % les plus faibles au
classement des pays ; 2 = 20-40 %, 3 = 40-60 %, 4 = groupe des premiers 40%)
6 Classement moyen des pays sur trois dimensions des indicateurs de gouvernance dans le monde (Qualité de la réglementation ; Primauté du
droit ; Lutte contre la corruption) ; même base de notation que pour l’IDH.
7 1 = Pas de fournisseurs d’APD en dehors de la Banque ; 2 = Banque + quelques autres ; 3 = Large éventail de partenaires fournisseurs d’APD,
mais il existe des antécédents de tension ; 4 = Large éventail de partenaires + solides relations de longue date.
8 Programme en cours au moment de l'approbation de l’OAP.
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privé4
Pays Coopération pour le développement Contexte plus large du pays
Programme du FMI en cours : Oui (Ligne de précaution des investissements, indépendance du pouvoir
et de liquidité (LPL) en cours depuis 2012). judiciaire, accès des PME au financement, etc.
Seychelles Volume d’aide relativement faible et aucun mécanisme PRE depuis 2015 ; croissance économique +
formel de coordination des donateurs. diminution constante du fardeau de la dette.
Programme du FMI en cours : Oui (Accord au titre de la Démocratie multipartite dynamique.
Facilité élargie de crédit (FEC) en cours depuis juin
2014).
Dans l’ensemble, l’évaluation des contextes nationaux montre que :
La mise en œuvre des OAP s’est déroulée dans des environnements très difficiles:
L'instabilité politique était particulièrement prononcée dans deux pays (Mali, Egypt).
Les pays ont entrepris des réformes ambitieuses, illustrées par des cas comme le
Ghana ou le Mali, mais certaines d’entre elles ont buté sur des obstacles majeurs liés
à une dynamique institutionnelle complexe au niveau central comme local.
Dans la plupart des études de cas, le pays connaissait également une situation
macroéconomique difficile, marquée par le besoin crucial de combler un important
déficit budgétaire pour faire progresser le programme de réformes tout en maintenant un
environnement macroéconomique stable.
Ces cinq dernières années, des évolutions majeures ont eu lieu dans l’architecture du
financement du développement et dans les mécanismes de coordination des donateurs
dans tous les pays ayant fait l’objet de d’étude de cas.
En générale, on a assisté à la régression des mécanismes formels de coordination
des donateurs et à la réticence accrue de certains donateurs à financer la coopération
au développement sous la forme d’un appui budgétaire.
Dans le même temps, il existe des cas (Égypte et Ghana par exemple) où certains
partenaires internationaux, comme la Banque mondiale, ont entrepris des
programmes de grande envergure pour aider les pays à faire face à une situation
macro budgétaire difficile.
Dans presque tous les cas, un accord du FMI était en cours lorsque la Banque
approuvait l’OAP. Dans le cas de l’Égypte, le FMI avait commencé à fournir une
assistance quelques mois après le lancement du programme d’appui conjoint BAD-
BM.
Malgré la réduction générale du nombre de mécanismes formels de coordination, la
plupart des cas examinés concernent des pays qui, en général, ont bénéficié de
relations étroites avec des partenaires de développement, dont la BAD.
Pour ce qui est du Maroc, en dépit de ses bonnes relations avec les partenaires, le
pays semble préférer les relations bilatérales avec ses partenaires au détriment d’un
cadre de coordination des bailleurs de fonds sous l’égide du pays. Cela dit, les
partenaires prennent des initiatives pour mieux coordonner leurs interventions.
Qualité des mécanismes de l’OAP
La qualité des mécanismes de l’OAP a été évaluée suivant un système de notation similaire à celui
de l’évaluation du contexte national. Les scores globaux ont été obtenus à partir de moyennes
simples des notes sur l’échelle 1-4 par rapport à cinq critères : i) la programmation conformément
à la politique et aux directives relatives aux OAP ; ii) la conception conformément à la politique et
aux directives relatives aux OAP et aux bonnes pratiques établies ; iii) la qualité du dialogue dans
le cadre de la conception et de la mise en œuvre de l’OAP ; iv) la qualité de la coordination entre
la Banque et les autres partenaires de développement durant la formulation et la mise en œuvre ;
et v) le respect du calendrier des décaissements et les perceptions quant aux coûts de transaction.
Le tableau ci-dessous résume les notes obtenues dans les cinq études de cas.
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privé5
Tableau 3 : Vue d’ensemble de la qualité des mécanismes d’OAP dans les cinq études de cas de
l’ESP
Dimension Égypte Ghana Mali Maroc Seychelles
Programmation (conformité) 3 4 2 3 3
Conception (qualité) 3 3 3 2 3
Dialogue sur les politiques9 2 3 2 2 2
Coordination avec les autres partenaires10 4 3 2 2 2
Coûts de transaction / efficience11 4 4 2 3 3
Note générale 3 3 2 2 3
Dans l’ensemble, la qualité des mécanismes de l’OAP est jugée satisfaisante (3) dans trois des
cinq cas.
Presque tous les cas ont obtenu une bonne note en ce qui concerne le respect du calendrier
de décaissements et les coûts de transaction. Au Mali, les décaissements ont été prévus
au cours du dernier mois de l’année budgétaire, laissant peu de marge pour assurer le
paiement et, bien que la composante don ait été décaissée à temps, celle du prêt a été
décaissée avec plusieurs mois de retard.
L’approche programmatique adoptée dans la plupart des cas (Égypte, Ghana, Mali,
Seychelles12) a été considérée comme un élément positif de la conception par les parties
prenantes interrogées. En particulier, elle a permis de mieux faire face à l’évolution du
contexte et d’assurer une certaine continuité de l’appui de la Banque aux réformes de
moyen terme. Plusieurs parties prenantes interrogées, y compris les partenaires de
développement, ont souligné que le soutien aux types de réformes ciblés par les OAP aurait
été compliqué dans le cadre d’une opération unique.
Les éléments de conception décrits dans les rapports d’évaluation sont conformes à la
politique et aux directives sur les opérations d’appui programmatique, ce qui explique les
notes globalement positives pour la qualité de la conception.
Toutefois, aucune des OAP n’a obtenu la note la plus élevée sur les critères concernant la
qualité de la conception. La conception des OAP a souffert de faiblesses telles que des
cadres de résultats non ciblés et une profondeur insuffisante de l’analyse du contexte dans
les documents d’évaluation. Malgré l’utilisation d’une approche programmatique dans la
plupart des OAP analysées, les études de cas révèlent une faible planification à moyen
terme pour accompagner la séquence de réformes lancées par les PMR dans les domaines
ciblés par les OAP.
En outre, dans presque tous les cas, l’engagement de la Banque dans le dialogue sur les
politiques a été jugé insatisfaisant. Le dialogue sur les politiques a souvent fortement baissé
après l’approbation de l’OAP. Même dans le cas du Ghana, qui obtient la note la plus
élevée, l’étude de cas a identifié des insuffisances importantes quant à l’engagement de la
Banque dans le dialogue.
De manière générale, les liens avec les projets d’appui technique et d’investissement de la
Banque étaient limités. Certains liens avaient été établis dans des cas tels que le Mali.
9 1 = Absence de cadre formel pour un dialogue suivi sur les politiques ; 2 = Existence d’un cadre formel mais peu fonctionnel ou Absence de cadre
formel, mais des contacts ponctuels réguliers ; 3 = Existence d’un cadre formel, appuyé par des échanges informels réguliers ; 4 = Idem que 3,
mais appuyé par des travaux analytiques de la Banque et un engagement soutenu sur les enjeux questions de politique/d’ordre technique.
10 1 = Absence de cadre formel de coordination ; 2 = Absence de cadre formel, mais des communications régulières, ou existence d’un cadre formel
peu fonctionnel ; 3 = Existence d’un cadre formel, appuyé par des échanges informels réguliers ; 4 = Existence d’un cadre conjoint et réalisions de
missions conjointes.
11 Principaux critères utilisés : respect des délais pour le traitement des approbations / décaissements et perception des PMR par rapport aux coûts
de transaction élevés/faibles des processus d'évaluation et de gestion de la Banque.
12 Aux Seychelles, pour des raisons administratives, la Banque a utilisé une modalité programmatique avec décaissement par tranche dans le
cadre de la phase I de l’IPSDCP I et une OAP autonome dans le cadre de la phase II. Il existe une forte continuité entre les deux opérations et les
deux OAP prises ensemble peuvent être considérées comme mettant en œuvre une approche programmatique.
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privé6
Au Maroc et au Mali, les études de cas ont décelé un certain nombre d’occasions manquées
de coordination plus étroite avec d’autres partenaires de développement, particulièrement
lors de la mise en œuvre. Aux Seychelles, le niveau relativement faible de coordination avec
les autres partenaires de développement est davantage lié à l’absence d’équipes
permanentes dans le pays (de la BAD mais aussi pour la plupart des autres partenaires de
développement) et à un contexte de contraction du volume de l’aide conjugué à un besoin
moins pressant d’éviter les doubles emplois et de réaliser des synergies.
Le tableau ci-dessous présente des détails complémentaires pour chacune des dimensions
passées en revue.
Tableau 4 : Principaux constats relatifs à la qualité des mécanismes d’OAP dans les cinq études de
cas de l’ESP
Dimension Principaux constats
Les programmes ont largement respecté les directives de programmation, notamment
l’évaluation des critères d’éligibilité.
Toutefois, les liens avec les interventions antérieures et à venir n’ont pas toujours été décrits de
façon assez approfondie. Au Maroc, l’OAP PACEM a joué un rôle en comblant le fossé entre
deux cycles et jeté les bases pour une OAP ambitieuse (PAIIM13) axée sur l’appui à la stratégie
Programmation nationale d’industrialisation. Cependant, aucun plan explicite n’était prévu (dans la conception
(conformité) du PACEM) sur la manière dont l’OAP aurait dû jouer ce rôle de trait d’union et sur ce qui aurait
pu être l’orientation des futurs programmes de suivi pour assurer la continuité de l’appui. Au
Mali, l’analyse de la façon dont l’expérience tirée des OAP antérieures pourrait améliorer les
programmes futurs a été limitée.
En outre, une évaluation de la valeur ajoutée des OAP (par rapport au financement de projets)
fait souvent défaut dans les documents de programmation et de conception.
Dans l’ensemble, la plupart des éléments de conception présentés dans les rapports
d’évaluation sont conformes à la Politique et aux directives pour les opérations d’appui
programmatique.
o En particulier, les réformes politiques spécifiques à appuyer sont bien identifiées et
l’analyse des risques fiduciaires est correctement effectuée.
Toutefois, on note certaines insuffisances :
o Les cadres de résultats ont souvent une portée large et ne sont pas suffisamment
hiérarchisés (par exemple, Ghana, Mali, Maroc, Seychelles).
o La façon dont l’OAP (à travers ses cibles, ses actions préalables et le dialogue sur les
politiques y relatif et son appui technique) tient compte de la dimension souvent de long
terme des réformes politiques ciblées est rarement claire ; cadres de résultats ne sont
Conception (qualité) généralement pas bien intégrés dans les cadres stratégiques à moyen terme plus larges,
quoique cela ait été moins problématique pour les opérations programmatiques (par
exemple, Égypte, Ghana).
o La profondeur de l’analyse du contexte (par exemple, identification des besoins en
renforcement des capacités, évaluation de l’économie politique des processus de réforme
tels que dans le domaine du régime foncier au Mali) a été insuffisante au regard de
l’ambition de certains objectifs/ cibles des OAP.
o Au Ghana, la réforme ciblée par l’OAP directement liée au développement des PME est
une activité « en aval » consistant en l’inscription des PME à la bourse (alternative) du
Ghana; L’équipe a estimé que cela ne constituait pas une réforme stratégique ; cet
objectif apparait plutôt comme un « ajout » artificiel pour mieux se conformer à l’accent
initial mis sur l’environnement du secteur privé prévu dans le DSP.
La Banque a mis à profit, avec un certain degré de succès, les OAP pour renforcer le dialogue
avec les principales parties prenantes dans le contexte plus général de sa coopération au niveau
Dialogue sur les
national.
politiques
Cependant, le dialogue effectif sur les politiques concernant les réformes politiques ciblées a été
faible dans toutes les études de cas.
13 PAIIM : Programme d’appui à l’accélération de l’industrialisation du Maroc.
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privé7
Dimension Principaux constats
o Certains bureaux pays (par exemple, le Ghana et l’Égypte) ont eu une interaction très
active avec les parties prenantes nationales lors de la conception et de la mise en œuvre
des OAP (pour certains secteurs plus que d’autres).
o Dans certains cas, le dialogue a été perçu par les parties prenantes interrogées comme
riche lors de la phase d’évaluation ; mais, dans tous les cas, l’intensité et la qualité du
dialogue ont diminué après l’approbation de l’OAP.
o En général, la profondeur du dialogue sur les politiques a été insatisfaisante. Cela était
principalement dû au manque d’assistance technique d’accompagnement et à l’effectif
peu adéquat des ressources humaines, particulièrement au regard de l’ampleur des
réformes ciblées par les OAP. Un défi majeur était lié au fait que le dialogue après
l’approbation était souvent principalement mené par le chef de projet de l’OAP, qui était
souvent basé au Siège.
Dans l’ensemble, la coordination et la complémentarité avec les autres partenaires de
développement ont été satisfaisantes.
Coordination avec les Cependant, la coordination au niveau sectoriel est restée inégale ; Les échanges sur les
autres partenaires de questions stratégiques durant la mise en œuvre ont été insuffisants par rapport aux réformes
développement spécifiques ciblées par les OAP.
Les exemples de missions conjointes (Égypte) sont rares et la Banque rencontre souvent des
difficultés pour pérenniser ces expériences (Seychelles).
Dans l’ensemble, la prévisibilité et le respect du calendrier des décaissements des OAP ont été
d’un niveau élevé. Au Mali, les décaissements ont été prévus au cours du dernier mois de l’année
budgétaire, laissant peu de marge pour assurer le paiement et, bien que la composante don ait
été décaissée à temps, la partie prêt a été décaissée avec plusieurs mois de retard.
Le niveau des coûts de transaction a été jugé satisfaisant par les deux parties (gouvernement et
Banque) dans toutes les études de cas, à l’exception du Mali, où les parties prenantes nationales
Coûts de transaction / ont soulevé quelques préoccupations (notamment en ce qui concerne l’utilisation de cadres
efficience communs).
La flexibilité dont la Banque a fait preuve dans certains cas (par exemple, l’utilisation d’une
approche rationalisée/ renonciation à la note conceptuelle initiale en Égypte) était bien justifiée
et favorablement appréciée par les parties prenantes interrogées.
Dans certains cas (Mali, Maroc), l’absence de cadres communs renforcés avec les autres
partenaires de développement fournissant un appui budgétaire a été considérée comme une
occasion manquée pour renforcer l’efficacité.
Le tableau ci-dessous fournit des précisions complémentaires sur l’engagement de la Banque dans
le dialogue sur les politiques durant les phases de conception et de mise en œuvre des OAP dans
les cinq études de cas.
Tableau 5 : Observations complémentaires sur l’engagement de la Banque dans le dialogue sur les
politiques dans les cinq études de cas
Pays (OAP) Principaux constats sur le dialogue et les mesures d’accompagnement
Le dialogue a été mené de manière formelle et informelle (y compris à un haut niveau), mais pas
toujours de façon continue.
Le bureau pays de la Banque a joué un rôle important en soutenant le dialogue à un niveau
général (le chargé de programme pays a travaillé en étroite collaboration avec deux représentants
pays successifs).
Égypte
Le dialogue formel sur les politiques dans le cadre des OAP s’est principalement déroulé pendant
(EGESP I&II)
les phases d’évaluation des différentes tranches.
Le dialogue sur les politiques en matière d’énergie a été plus suivi, compte tenu de la présence et
du rôle actif du Chargé de l’énergie.
L’absence d’assistance technique a été perçue comme une opportunité manquée par la plupart
des parties prenantes interrogées.
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privé8
Pays (OAP) Principaux constats sur le dialogue et les mesures d’accompagnement
Dans l’ensemble, un dialogue continu a été maintenu avec les responsables gouvernementaux grâce
à un bureau extérieur très actif et, dans une certaine mesure, à la participation du personnel de haut
Ghana niveau du Siège.
(GFPPSC I&II) Mais un soutien technique limité a été fourni. Un projet d’appui institutionnel (PAI) a été mis en œuvre
dans le domaine du soutien aux PME (GAX), mais il s’agissait d’un sous-domaine très spécifique
dans un large éventail de réformes politiques soutenues par les OAP.
Dans l’ensemble, le temps et les ressources consacrés à l’évaluation, à la supervision et à un dialogue
sur les politiques plus stratégique dans les domaines ciblés sont limités.
L’engagement de la Banque dans le dialogue sur les politiques était étroitement axé sur certains
Mali
aspects de l’évaluation des OAP, tels que les conditions de décaissement.
(PARGE)
Accès limité à l’expertise sectorielle donnée par la Banque aux parties prenantes nationales.
La qualité du dialogue dans le cadre des examens budgétaires conjoints a baissé ces dernières
années, à la suite du retrait des donateurs bilatéraux et du changement de gouvernement.
Peu ou pas de dialogue sur les politiques (y compris sur les réformes ciblées) après l’approbation de
l’OAP.
Certains problèmes ont été rencontrés pour assurer la continuité du dialogue après le départ du chef
Maroc
de projet initial de l’OAP.
(PACEM)
Quelques synergies entre l’OAP et l’AT (par exemple PPP14), mais, dans l’ensemble, des liens plutôt
limités.
Le dialogue a été renouvelé à un niveau général lors de la conception de la nouvelle OAP (PAIIM).
Rôle important joué par le chef de projet des OAP, mais principalement durant la phase de conception
ou en relation avec des projets d’appui institutionnel spécifiques.
Bien que les projets d’appui institutionnel aient été pertinents, ils sont arrivés trop tard pour renforcer
le dialogue sur les politiques concernant les OAP et ont été confrontés à des problèmes d’efficacité
(ce qui a également réduit l’attrait de cet appui aux yeux des parties prenantes nationales, notamment
Seychelles par rapport aux occasions d’assistance technique offertes par d’autres partenaires de développement
(IPSDCP I&II) comme la Banque mondiale ou le FMI).
Dans l’ensemble, un dialogue sur les politiques limité pendant la mise en œuvre des OAP.
Rôle du Bureau régional de la Banque limité à des activités spécifiques (par exemple, Revue à mi-
parcours du DSP) et non lié au chef de projet basé au Siège.
Prévu dans la phase I de cette OAP, le dialogue conjoint sur les politiques avec les autres partenaires
de développement ne s’est jamais concrétisé.
CONTRIBUTION DES OAP AUX EFFETS INTERMÉDIAIRES ET FINAUX
Effets intermédiaires
Les cadres de résultats des OAPs passés en revue couvrent trois grands domaines d’effets
intermédiaires auxquels la Banque entendait contribuer, à savoir : l’ESP, GFP et, dans deux cas,
l’énergie. Dans chacun de ces domaines, l’équipe a évalué :
les progrès accomplis, y compris l' « importance » des réformes poursuivies (voir la
définition d'une « réforme capitale » - Encadré 1, annexe 1)15, et
le rôle joué par l’OAP de la Banque dans les évolutions observées.
Le tableau 6 présente un résumé des réalisations dans chacun des domaines de résultats visés
par les OAP (note 1-4) et l’influence de l’OAP sur ces réalisations (note 1-4).
PPP : Partenariat public-privé
15 Dans la « notation des résultats », un coefficient plus important a été attribué aux effets intermédiaires ciblés dans les OAP, qui ont été considérés
par les évaluateurs comme constituant des « reformes capitales ». Les critères permettant d’obtenir les notes allant de 1 à 4 pour les effets
intermédiaires sont les suivants : 1 = « Peu d’effets intermédiaires enregistrés, voire aucun » ; 2 = « Quelques effets intermédiaires, mais aucun
reforme capitale» ; 3 = « Quelques reformes capitales ont été réalisés » ; 4 = « Plusieurs reformes capitales ont été réalisés, comprenant la majorité
des reformes capitales ciblés ».
Évaluation groupée de l’environnement du secteur privéVous pouvez aussi lire