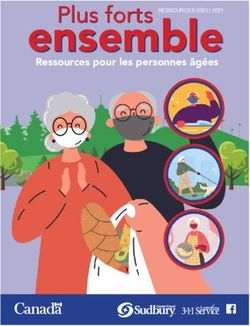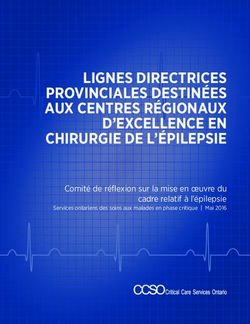VIRTUELS 2021 ÉTATS GÉNÉRAUX 20 ET 21 MAI - Au coeur de l'expertise infirmière - OIIQ
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Dossier d’information à l’intention des membres du jury citoyen 20 ET 21 MAI ÉTATS GÉNÉRAUX VIRTUELS 2021 Au cœur de l’expertise infirmière Contribuer pleinement, pour la santé des Québécois
RÉDACTION Direction, Bureau du président, OIIQ Colette Ouellet, Directrice Karina Sieres, Spécialiste Relations publiques Direction, Développement et soutien professionnel, OIIQ Caroline Roy, Directrice adjointe, Pratique infirmière avancée et relations avec les partenaires Joanie Belleau, Conseillère à la qualité de la pratique Institut du Nouveau Monde (INM) Florence Clermont Malorie Flon Nathalie Francès Nicolas Vazeille PRODUCTION Direction Stratégie de marque et communications Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 4200, rue Molson Montréal (Québec) H1Y 4V4 Téléphone : 514 935-2501 ou 1 800 363-6048 Télécopieur : 514 935-3770 Dépôt légal Bibliothèque et Archives Canada, 2021 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021 ISBN-OIIQ 978-2-89229-740-9 (PDF) © Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2021 Tous droits réservés Note – Le terme « infirmière » est utilisé à seule fin d’alléger le texte et désigne autant les infirmiers que les infirmières. 8527
Table des matières Introduction 3 I. Des États généraux pour faire le point sur le rôle de la profession infirmière 5 II. Votre participation au jury citoyen 9 III. La profession infirmière : une pluralité de compétences 13 IV. La profession infirmière au sein du système de santé 22 V. La profession infirmière face aux enjeux actuels de santé 26 Annexe 1 : Rétribution 33 Annexe 2 : À propos 34
Introduction
Croyez-vous que l’on peut mieux recourir aux compétences
infirmières pour mieux soigner ?
Si oui, à quelles conditions ? Si non, pourquoi ?
Vous allez participer aux mois de février et mars 2021 à un jury citoyen qui se penchera
sur la question de savoir s’il est possible de mieux recourir aux compétences infirmières au
Québec pour mieux soigner. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et
l’Institut du Nouveau Monde (INM) vous remercient sincèrement pour votre engagement
dans ce projet.
La profession infirmière, une profession indispensable…
Dans un contexte où les besoins en santé augmentent et se complexifient, notamment en
raison du vieillissement de la population et de la hausse des maladies chroniques, l’accès
aux soins de santé est plus que jamais un enjeu au Québec. Depuis plusieurs années, l’OIIQ
appelle à une évolution de la contribution des infirmières et infirmiers aux objectifs du
réseau de la santé. On les retrouve en ce moment même en première ligne face à la
pandémie de COVID-19, mettant ainsi au grand jour l’étendue de leurs connaissances
scientifiques, l’expertise de pointe des pratiques infirmières avancées dans la prévention
et le contrôle des infections et, plus généralement, leur importance dans le système de
santé.
…mais une expertise encore méconnue
Quatre-vingt-quatorze pour cent de la population québécoise dit avoir confiance dans le
travail effectué par les infirmières et infirmiers durant la première vague de la pandémie 1.
Pour autant, l’étendue des activités réalisées dans le cadre de leur profession, leurs
1
Sondage Léger mené pour le compte de l’OIIQ, septembre 2020
3 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENdifférentes spécialités et même leur formation restent méconnues du grand public et d’une
partie du réseau de la santé. Une réforme en matière d’offre de soins ne pourra pourtant
se faire sans une réflexion sur l’utilisation optimale des compétences des plus de 78 000
infirmières et infirmiers du Québec dans le système de santé.
Votre mandat en tant que membre du jury citoyen
L’OIIQ a pour mission d’assurer la protection du public par et avec les infirmières et
infirmiers, notamment en s’assurant de la compétence de ses membres, tout en veillant à
l’amélioration de la santé de la population québécoise. L’OIIQ souhaite aujourd’hui offrir
aux citoyens l’opportunité de se prononcer sur la manière dont nous pourrions mieux
recourir aux compétences infirmières pour mieux soigner au Québec. Votre mandat dans
le cadre de ce jury sera, après avoir reçu de l’information lors de séances avec des experts
du système de santé, de délibérer en groupe et de formuler un avis sur la question suivante
:
Croyez-vous que l’on peut mieux recourir aux compétences infirmières pour mieux soigner?
Si oui, à quelles conditions? Si non, pourquoi?
Vous serez soutenus dans cette démarche par l’INM, une organisation indépendante et
non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie
démocratique. L’INM aura pour mission de vous guider dans les délibérations avec les
autres membres du jury, de sorte que vous puissiez formuler en groupe un avis sur la
question posée.
Ce document d’information vise à vous présenter le contexte de l’organisation de ce jury
citoyen et à vous offrir une base d’information commune. Lisez-le attentivement avant la
rencontre de préparation des audiences d’experts et terminez par les questions de
réflexion en fin de document en vue de vous préparer à l’exercice.
Dates des rencontres du jury citoyen en ligne
• Mercredi 17 février de 19 h à 20 h 30. Rencontre d’information en ligne pour tous
les membres du jury.
• Samedi 20 février 2021 de 9 h à 12 h. Rencontre de préparation des audiences
d’experts.
• Mardi 9 mars 2021 de 18 h30 à 21 h. Première séance d’audiences d’experts.
• Mercredi 10 mars 2021 de 18 h 30 à 21 h. Deuxième séance d’audiences d’experts.
• Samedi 20 mars 2021 de 9 h à 12 h. Première séance de délibération du jury.
• Dimanche 21 mars 2021 de 9 h à 12 h. Deuxième séance de délibération du jury.
• Mercredi 31 mars 2021 de 18 h 30 à 21 h. Validation de l’avis du jury.
4 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENI. Des États généraux pour faire le
point sur le rôle de la profession
infirmière
Le jury citoyen constitue l’une des étapes de préparation des États généraux de la
profession infirmière organisés par l’OIIQ les 20 et 21 mai 2021. Trois grands thèmes
seront abordés dans le cadre de ces États généraux :
• Savoirs infirmiers et compétences infirmières : mieux y recourir pour mieux soigner;
• Innovation et spécialisation infirmières : une voie pour les soins de l’avenir;
• Formation infirmière : pour relever les défis du 21e siècle.
Les États généraux sont l’aboutissement d’une concertation élargie de l’ensemble du
personnel du secteur de la santé et de la population québécoise qui se tiendra au cours de
l’hiver et du printemps 2021. Tous sont conviés à faire entendre leur voix sur les trois
thèmes qui seront abordés lors des États généraux.
L’objectif général de la démarche est de susciter la prise de parole du plus grand nombre
de personnes possible autour des enjeux jugés prioritaires pour l’avenir de la profession
infirmière.
L’initiateur de la démarche : l’OIIQ
L’OIIQ a pour mission de protéger le public qui reçoit des services de la part de ses
membres. Les infirmières et infirmiers ont l’obligation d’être inscrits au Tableau de l’OIIQ
pour exercer leur profession. Avec ses 78 204 membres en date du 31 mars 2020, il est le
plus grand ordre professionnel du Québec.
Dans sa mission de protection du public, l’OIIQ contrôle l’accès à la profession, surveille et
réglemente son exercice, favorise son développement et traite les processus disciplinaires.
Auprès du public, l’OIIQ diffuse de l’information sur la profession et sur ses services, en
plus de contribuer à faciliter l’accès au système de santé et à améliorer les soins de santé.
L’OIIQ exerce un leadership reconnu, en collaboration avec ses partenaires pour relever les
défis en santé de la population, en s’assurant de la compétence professionnelle et de
l’intégrité de ses membres et en valorisant leur expertise.
5 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENL’OIIQ se considère comme une partie intégrante des rouages du système de santé au Québec et veille à l’intérêt général de sa population. Dans cette optique, il se tient à l’affût des enjeux sociétaux susceptibles d’avoir une incidence sur la protection du public et la profession, sur l’évolution des pratiques reconnues et émergentes, ainsi que sur les tendances dans le système de santé et dans le système professionnel à l’échelle provinciale, nationale et internationale. C’est un interlocuteur de premier plan dans le système professionnel et le système de santé. Les objectifs des États généraux Les États généraux sont le premier événement du genre en 25 ans et consistent en une démarche sur plusieurs mois qui vise à consolider la connaissance et la reconnaissance de l’expertise infirmière. Il s’agit également d’un projet de concertation des parties prenantes, du réseau de la santé comme de la population, ayant pour but de réfléchir à l’avenir de la profession infirmière et des soins à la population dans l’amélioration de la santé des Québécois. Les États généraux sont l’opportunité de tabler sur les contenus recueillis et d’identifier des consensus sur des pistes d'action en vue d’accroître la connaissance et la reconnaissance de l'expertise infirmière au Québec. Un rapport sur la reconnaissance de l’expertise infirmière au Québec sera rendu public. Une démarche en plusieurs étapes L’OIIQ a structuré sa démarche d’États généraux en quatre grandes étapes. 1- Prendre le pouls (automne 2020) Cette première étape s’est déroulée sous forme de groupes de discussion virtuels et de consultations en ligne auprès d'infirmières et infirmiers et de citoyens. L’objectif était de sonder les membres de l’OIIQ pour connaître leurs perceptions et impressions en lien avec la pandémie de COVID-19. L’OIIQ a récolté les préoccupations de ses membres et déployé les mesures nécessaires afin de pallier les difficultés vécues sur le terrain. 2- Concilier l’image publique et la réalité sur le terrain (novembre 2020) Cette deuxième étape s’est déroulée le 9 novembre 2020 sous forme de forum virtuel, intitulé « Au cœur de l’expertise infirmière », lequel était axé sur les enseignements à tirer de la pandémie. L’objectif était de réfléchir à la reconnaissance de l’expertise infirmière durant la pandémie, tant dans les milieux des soins qu’au plan de la perception populaire. Deux tables rondes se sont tenues lors du forum auquel ont assisté plus de 1 600 personnes, dont des citoyens. La première table ronde était composée de journalistes qui ont fait le point sur la couverture médiatique de la contribution du corps infirmier dans la lutte contre la COVID-19. Ils ont aussi partagé leurs perceptions de la contribution des infirmières et infirmiers dans la lutte contre la pandémie. Trois infirmières sont venues témoigner des réalités du terrain lors d’une seconde table ronde. 6 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
Dans son allocution, Luc Mathieu, le président de l’OIIQ, a mis en lumière le besoin d’un soutien populaire et d’une participation citoyenne pour l’avancement de la reconnaissance de l’expertise infirmière et de sa contribution dans les enjeux en santé. 7 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
3- Consulter et susciter la concertation (hiver 2021)
Cette troisième étape se déroule sous forme de consultations, d’une part auprès des
citoyens qui participent au jury, d’autre part auprès des divers acteurs du système de
santé, sous la forme d’un appel de commentaires, d’avis et de mémoires en ligne, et de
séances d’audiences publiques présidées par Francine Ducharme et Robert Salois. Pour
plus d'informations sur cet appel et les audiences publiques, auxquels les citoyens peuvent
aussi participer, visitez cette page sur le site de l’OIIQ.
Vous trouverez plus de détails sur le jury citoyen ci-après.
4- Mobiliser pour une reconnaissance de l’expertise infirmière
(printemps 2021)
Cette quatrième étape consiste en la tenue des États généraux les 20 et 21 mai 2021. Tous
les participants aux étapes précédentes seront invités à participer à cet événement pour
faire le point sur les apprentissages et pistes pour l’avenir. Les États généraux sont
présidés par Francine Ducharme et Robert Salois qui agissent à titre de commissaire.
Une activité de dévoilement de l’avis du jury citoyen aura lieu dans le cadre des États
généraux, non seulement pour aller chercher les réactions de l’ensemble des participants,
mais aussi pour produire une série de solutions ou de recommandations à l’intention des
deux commissaires
Pour aller plus loin
Planification stratégique 2020 - 2023 de l’OIIQ
Mission et vision de l’OIIQ
Consulter le site de l’OIIQ
Visionner la rediffusion du forum « Au cœur de l’expertise infirmière »
8 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENII. Votre participation au jury citoyen
Votre participation au jury citoyen est maintenant confirmée! Vous trouverez dans les
pages suivantes un rappel des étapes de votre participation au jury citoyen.
Qu’est qu’un jury citoyen?
« La méthode du Jury de citoyens permet de faire participer des citoyennes et citoyens
informés à la prise de décisions politiques. Le jury se compose de 12 à 20 citoyennes et
citoyens sélectionnés au hasard et informés de différentes perspectives, souvent par des
experts appelés « témoins ». Les membres du jury entament ensuite un processus de
délibération et des sous-groupes sont souvent formés en vue de se concentrer sur
différents aspects de la question. Enfin, les membres rendent une décision ou émettent des
recommandations au travers d’un rapport. L’organisme commanditaire [en l’occurrence
l’OIIQ] doit réagir à ce rapport soit en le mettant en œuvre, soit en expliquant pourquoi il le
désapprouve. Au cours d’un processus qui dure généralement de 4 à 5 jours*, le Jury de
citoyens a pour objectif de contribuer à une prise de décision plus démocratique. » 2
Votre mandat consiste à :
• vous renseigner, par ce document d'information et par des présentations d'experts
du système de santé, sur la profession infirmière et sur les enjeux associés à la
connaissance et la reconnaissance de l'expertise infirmière pour les soins de santé;
• délibérer sur la question suivante : Croyez-vous que l'on peut mieux recourir aux
compétences infirmières pour mieux soigner? Si oui, à quelles conditions? Si non
pourquoi?;
• formuler un avis comprenant des recommandations destinées à l'OIIQ.
2
Slocum, N., Elliott, J., Heesterbeek, S., & Lukensmeyer, C. J. (2006). Méthodes participatives : un guide pour
l’utilisateur. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin, p. 43.
9 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENLes étapes de votre participation
Votre participation suivra trois étapes principales : une étape de préparation, une étape
d’information et une étape de délibération du jury.
• La première vous permettra de faire connaissance avec vos collègues du jury et de
vous familiariser avec votre rôle et le déroulement des prochaines étapes. Vous
aurez l’occasion d’échanger sur le sujet, de prendre connaissance du programme
des audiences d’experts et de préparer des questions à leur poser.
• Des audiences d’experts du système de santé et de la profession infirmière vous
permettront d’approfondir le sujet et de poser des questions. La tenue d’audiences
d’experts a pour objectif d’aider les jurys à comprendre et à comparer différents
éléments d’information et points de vue sur le sujet traité.
• Finalement, vous vous livrerez à un exercice de délibération. L’objectif est de faire
émerger un consensus sur la question posée, de conduire le jury à formuler un avis
répondant à la question posée et à formuler des recommandations à l’OIIQ. L’INM
assistera le jury dans la rédaction de l’avis.
Étape 1. Préparation
L’objectif est d’introduire la démarche et les enjeux associés à la question posée au jury.
• Du 1er au 20 février 2021. Lecture (individuelle) de ce document d’information.
• Mercredi 17 février 2021 de 19 h à 20 h 30. Rencontre d’information sur la démarche
du jury (en ligne).
Cette rencontre en ligne sera l’occasion pour vous de faire connaissance avec les
autres membres du jury, de vous familiariser avec l’utilisation de Zoom et des autres
outils utilisés, et de poser toutes vos questions aux personnes de l’organisation. Les
objectifs et le déroulement des rencontres du jury vous seront présentés.
• Samedi 20 février 2021 de 9 h à 12 h. Rencontre de préparation des audiences
d’experts (en ligne).
Cette deuxième rencontre vous permettra de partager vos premières réflexions sur
la question posée à la lumière de la lecture du document d’information. Elle vous
permettra aussi de préparer en groupe les questions à poser aux experts lors des
audiences.
Étape 2. Information
Cette étape vise à vous fournir tous les éléments d’information nécessaires à votre
délibération.
• Mardi 9 mars et mercredi 10 mars 2021 de 18 h 30 à 21 h. Audiences d’experts (en
ligne).
• Les audiences d’experts du système de santé qui connaissent la profession
infirmière au Québec vous permettront d’approfondir le sujet et de poser des
questions. La tenue d’audiences a pour objectif de vous aider à comprendre et à
comparer différents éléments d’information et points de vue sur la question traitée.
10 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENÉtape 3. Délibération
Enfin, les membres du jury citoyen seront invités à un exercice de délibération en plusieurs
étapes. L’objectif est de faire émerger un consensus et de conduire le jury à formuler un
avis répondant à la question posée. Les membres du jury travailleront souvent en petits
groupes. Les animatrices et animateurs ont recours à diverses techniques pour favoriser
la participation de tous. Ces rencontres et échanges se dérouleront en français.
Les délibérations auront lieu en trois rencontres de trois heures (en ligne) :
• Samedi 20 mars 2021 de 9 h à 12 h. Premier exercice de délibération.
• Dimanche 21 mars 2021 de 9 h à 12 h. Deuxième séance de délibération du jury.
• Mercredi 31 mars 2021 de 18 h 30 à 21 h. Validation de l’avis du jury.
L’avis du jury envoyé à l’OIIQ contiendra une réponse du groupe à la question suivante :
Croyez-vous que l’on peut mieux recourir aux compétences infirmières pour mieux soigner?
Si oui, à quelles conditions? Si non, pourquoi?
Si la réponse du jury est oui, l’avis comprendra des recommandations.
Si la réponse est jury non, l’avis comprendra une argumentation par rapport à cette
réponse.
Si les membres du jury citoyen ne s’entendent pas sur le contenu de l’avis, des mécanismes
sont prévus pour leur permettre de s’exprimer, de formuler des options et de trouver les
éléments qui sont consensuels.
Participer en ligne
La majorité des exercices seront réalisés sur l’outil de vidéoconférence Zoom. Vous aurez
l’occasion de vous y familiariser lors de la première rencontre d’information. Pour
participer, vous devez avoir accès à un ordinateur équipé d’un microphone et d’une caméra
ainsi qu’à une connexion Internet haute vitesse, et vous munir d’écouteurs dans la mesure
du possible. L’utilisation de tablettes est possible, mais moins recommandée.
Pour plus d’informations sur l’outil de vidéoconférence Zoom, vous pouvez consulter le
guide d’utilisation suivant.
Les informations de connexion pour rejoindre la rencontre Zoom vous seront envoyées par
courriel avant chaque rencontre. Merci de vous connecter 10 minutes avant chacune de
ces rencontres.
Équipe d’accompagnement
Le jury sera accompagné dans ses délibérations par une équipe de l’INM. En plus de
coordonner les communications avec les membres du jury citoyen, l’animation et l’analyse
des activités, l’INM assistera le jury dans la rédaction de l’avis.
11 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENPour aller plus loin Valoriser une voix citoyenne en santé et en services sociaux, L’état du Québec 2020 12 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
III. La profession infirmière : une
pluralité de compétences
La profession infirmière est souvent évoquée de manière générale, sans faire de distinction
entre les différentes expertises détenues par ces professionnels. En effet, les infirmières et
infirmiers œuvrent dans une grande variété de milieux et occupent diverses fonctions au
sein du système de santé. De même, le champ d’exercice de la profession est extrêmement
vaste, l’un des plus vastes de tous les professionnels de la santé, ce qui leur permet ainsi
de pratiquer dans presque tous les domaines de la santé physique et mentale, et ce, auprès
de clientèle de tous âges.
Une profession pour différents rôles
Si l’on parle souvent des infirmières et infirmiers sans faire de distinction, il convient de
relever que cette profession offre un éventail de possibilités pour ce qui est de contribuer
à la santé de la population.
Le rôle infirmier
Les infirmières et infirmiers sont des professionnels de la santé qui assument la
responsabilité d’un ensemble de soins, au niveau des besoins tant physiques que mentaux
des patients ou des groupes de personnes. Ces professionnels sont appelés à pratiquer
auprès de diverses populations, dans une multitude de milieux et toute une variété de
domaines : d’un CHSLD au département des soins intensifs au sein d’un hôpital offrant des
soins ultraspécialisés, en passant par un centre d’injection supervisée ou un dispensaire
au nord du Québec. Ils interviennent aussi dans la communauté, en offrant entre autres
des soins à domicile, ce qui permet ainsi à la personne requérant des soins de demeurer
chez elle, dans un milieu rassurant et sécuritaire. Les infirmières et infirmiers se retrouvent
ainsi dans plusieurs milieux.
Les infirmières et infirmiers sont des professionnels ayant un rôle qui va au-delà de la prise
de tension artérielle ou des prélèvements sanguins. Lorsqu’ils exercent auprès de la
clientèle, ils procèdent à l’évaluation de l’état de santé et analysent la condition de santé
et les besoins de la personne par différents moyens. Selon leur jugement clinique, ils
peuvent décider de procéder à un examen clinique afin d’avoir un portrait plus clair de la
situation clinique. Ils questionnent et observent la personne afin d’identifier des signes et
13 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENdes symptômes devant faire l’objet d’une attention particulière et détectent les complications susceptibles de survenir. Ils prodiguent des soins et des traitements infirmiers et médicaux selon leur analyse, en plus de déterminer s’il est nécessaire de faire intervenir un autre professionnel lorsque la situation de santé dépasse leurs compétences. Agissant comme coordonnateurs de l’épisode de soins, ils occupent un rôle central et de pivot auprès du patient et de l’équipe de soins. Par exemple, ils sont fréquemment appelés à coordonner le retour de la personne à son domicile à la suite d’un séjour en centre hospitalier. Enfin, ils planifient les soins qui seront nécessaires et les suivis à effectuer. Les infirmières et infirmiers n’interviennent pas seulement auprès de gens malades; ils exercent aussi un grand rôle de promotion de la santé et de prévention de la maladie. En outre, ils jouent un rôle important en matière d’éducation à la santé. Autant lors de rencontres prénatales auprès de parents en devenir qu’auprès d’élèves du secondaire pour parler des sujets touchant la santé des jeunes, ils sont impliqués dans de nombreuses initiatives visant à éduquer la population sur la santé et à encourager les individus à apporter des changements dans leur comportement. Les infirmières et infirmiers peuvent également intervenir de manière indirecte auprès de la clientèle en jouant un rôle-conseil, où ils seront alors appelés à soutenir leurs collègues sur le terrain en s’inspirant des meilleures pratiques reconnues et en dispensant entre autres de la formation. Ils peuvent également être responsables d’orienter le nouveau personnel et participer à la formation des stagiaires. De plus, ils peuvent contribuer à la recherche, à développer et à implanter de nouvelles pratiques dans les milieux de soins, ce qui permet ainsi d’améliorer les soins offerts à la population. Comme mentionné précédemment, les membres de la profession infirmière peuvent pratiquer dans une grande variété de domaines et auprès de clientèles multiples. Ils interviennent auprès de la personne dans sa globalité, c’est-à-dire qu’ils tiennent compte d’une foule de composantes : l’état de santé de la personne, ses maladies, ses facteurs de risque, sa médication, son milieu de vie, son réseau de soutien, l’environnement dans lequel elle habite et les facteurs de vulnérabilité (situation socio-économique, statut d’immigration, niveau de scolarité). Le but du rôle infirmier est de maintenir la santé et de la rétablir, puis de prévenir la maladie auprès de personnes présentant des conditions de santé complexes et des contextes de soins l’étant tout autant. Pour offrir des soins de qualité et de haut niveau, les infirmière et infirmiers doivent se baser sur de solides compétences et connaissances scientifiques acquises en cours de formation. Le rôle en pratique avancée La pratique infirmière avancée se caractérise par des connaissances approfondies en sciences infirmières et des compétences additionnelles développées par un niveau de formation de 2e cycle universitaire. À l’international et ailleurs au Canada, deux types de pratiques infirmières avancées sont reconnues, soit les infirmières cliniciennes spécialisées (ICS) et les infirmiers cliniciens spécialisés (ICS), ainsi que les infirmières praticiennes spécialisées et les infirmiers praticiens spécialisés (IPS). Actuellement au Québec, seuls les IPS et les ICS en prévention et contrôle des infections (ICS-PCI) détiennent un titre de spécialiste. 14 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
D’autres infirmières et infirmiers ont un rôle en pratique avancée au Québec, mais le
système professionnel ne reconnaît pas leur titre. En effet, certains milieux comptent dans
leur rang des infirmières et infirmiers en pratique avancée qui jouent un rôle important
dans le développement des connaissances et compétences en sciences infirmières ainsi
que dans les soins à la personne et à sa famille, ce qui correspond ailleurs au Canada à un
rôle d’ICS. Compte tenu du contexte actuel où le manque de soutien clinique est flagrant
dans les milieux de soins, le rôle et l’expertise de ces infirmières et infirmiers au sein des
équipes de soins sont d’autant plus importants et bénéfiques pour la population. À cet
égard, l’intégration de la relève se fait plus difficilement depuis la récente réforme, qui a
réduit de manière considérable le nombre d’infirmières et infirmiers en pratique avancée
destinés à accompagner les équipes soignantes dans l’implantation des meilleures
pratiques et dans l’intégration de la main d’œuvre 3.
Ce type de pratique est en croissance partout dans le monde, 4 et ce, dans plusieurs
domaines d’intervention. La pratique infirmière avancée (ICS et IPS) démontre plusieurs
retombées positives pour la population 5, telles que la diminution de la durée de séjours
hospitaliers 6 et l’amélioration de l’état de santé et de la qualité de vie de personnes en
CHSLD (Donald et al., 2013).
Les ICS-PCI
Les ICS-PCI doivent surveiller les infections dans les milieux de soins et analyser le risque
infectieux présent ou appréhendé. Très sollicités depuis le début de la pandémie, ils sont
aussi en partie responsables de mener les enquêtes épidémiologiques au sein des
établissements de santé, en partenariat avec la santé publique. Ils sont aussi responsables
d’élaborer et de mettre en place des stratégies visant à prévenir et à atténuer les
complications, de même qu’à contrôler la transmission des infections.
Les IPS
Par leurs activités professionnelles, les IPS sont des infirmières et infirmiers qui possèdent
une expérience clinique auprès d’une clientèle visée par l’une des classes de spécialité et
qui ont reçu une formation avancée de 2e cycle en sciences infirmières et en sciences
médicales. Leur formation permet l’exercice d’activités additionnelles et plus complexes,
telles que : 1) diagnostiquer des maladies; 2) prescrire des examens diagnostiques; 3)
utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 4)
déterminer des traitements médicaux; 5) prescrire des médicaments et d’autres
substances; 6) prescrire des traitements médicaux; 7) utiliser des techniques ou appliquer
des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice; 8) effectuer le
suivi de grossesses.
Il existe cinq classes de spécialité :
• IPS en néonatalogie
• IPS en soins aux adultes
3
Comité jeunesse OIIQ. (2018). Avis : Vers une meilleure intégration de la relève infirmière
4
Morin 2018
5
Brooten et al., 2001, Kilpatrick et al., 2013
6
Bryant-Lukosius et al., 2015; Newhouse et al., 2011
15 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN• IPS en santé mentale
• IPS en soins pédiatriques
• IPS en soins de première ligne
Le rôle en gestion, enseignement et recherche
Des infirmières et infirmiers ont opté pour un parcours professionnel orienté vers
l’amélioration des services de santé ou l’avancement des connaissances en soins
infirmiers, et occupent donc un poste en administration, en recherche ou en enseignement.
On retrouve des personnes ayant étudié en sciences infirmières dans des postes de
gestionnaires dans le réseau de la santé, où elles doivent organiser et optimiser les soins
infirmiers et s’occuper de la gestion des ressources humaines.
Des infirmières et infirmiers, souvent détenteurs d’un doctorat en sciences infirmières, se
tournent vers l’enseignement et la recherche; d’une part pour former une nouvelle
génération de professionnels, d’autre part pour participer à l’amélioration des pratiques
dans un avenir proche.
Un champ d’exercice très vaste
Les infirmières et infirmiers du Québec œuvrent dans tous les domaines de la santé
physique et mentale. D’après la Loi sur les infirmières et les infirmiers, « [l]’exercice infirmier
consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins
et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux
dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son
environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs. » 7
Leur expertise amène les infirmières et infirmiers à exercer auprès de différentes clientèles
présentant des besoins de santé plus ou moins complexes et en constante évolution. Leurs
compétences leur permettent d’apporter une réponse personnalisée à chaque individu.
Pour évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique, les
infirmières et infirmiers ont un champ d’exercice et d’activité réservé qui les pousse à faire
preuve de beaucoup d’autonomie.
7
Loi sur les infirmières et les infirmiers, article 36. Repéré à : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/i-8
16 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENLes soins sont de plus en plus complexes et la profession infirmière exige de développer des habiletés à résoudre des problèmes de santé complexes de façon autonome, à se former et à apprendre tout au long de la vie professionnelle. La démarche clinique de l’infirmière et de l’infirmier constitue une démarche scientifique. 17 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
18 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
Une dualité de voies d’accès à la profession infirmière Le Québec fait exception au Canada quant à la formation des infirmières et infirmiers. Alors que les autres provinces et territoires requièrent une formation universitaire, deux niveaux de formation donnent accès au même permis au Québec. Il est donc possible d’accéder à la profession à la suite de l’obtention d’un diplôme d’études collégiales dans un programme technique ou d’un baccalauréat au niveau universitaire. 19 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
Ainsi, un enjeu de crédibilité persiste, car la profession infirmière est la seule à vivre cette situation dans le système professionnel. Deux parcours de formation donnent accès au même permis d’exercice. Toutefois, l’examen qui mène au droit de pratique n’évalue que les compétences acquises au DEC, ce qui signifie que l’examen n’évalue pas les connaissances spécifiques de la formation universitaire : soins critiques, soins à domicile, collaboration professionnelle, gestion des équipes, approche familiale, et autres. Cette situation est grandement préoccupante. Formation collégiale Les cégeps sont une distinction québécoise en Amérique du Nord. Les cégeps offrent à la fois de la formation générale pré-universitaire et des programmes techniques qui conduisent les étudiants directement sur le marché du travail. Le DEC en soins infirmiers permet d'exercer la profession infirmière. Il s’obtient généralement au bout de trois années d’études au cégep. Ce type de formation prépare essentiellement à l’exercice de fonctions techniques. Les infirmières et infirmiers qui détiennent un DEC en soins infirmiers pratiquent principalement en centre hospitalier, mais on peut également les retrouver dans d’autres milieux de soins. Formation universitaire Le baccalauréat en sciences infirmière permet d’exercer la profession infirmière. Il est possible d’accéder au baccalauréat par le biais d’un diplôme d’études collégiales en sciences de la nature; la durée sera de trois ans. Il est également possible pour les personnes possédant un DEC en soins infirmiers de compléter un baccalauréat, où la durée sera alors de deux ans (passerelle DEC-BAC). Ce type de formation leur permet d’acquérir un sens critique et des savoirs cliniques dans des domaines d’intervention tels que les soins critiques, et la santé communautaire. Poursuite des études Il est également possible de poursuivre des études supérieures dans le domaine des sciences infirmières afin de développer des connaissances approfondies et des compétences de niveau avancé. Par exemple, le microprogramme de 2e cycle en prévention et contrôle des infections donnant accès au titre d’ICS-PCI, le diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences infirmières (DESS), la maîtrise en sciences infirmières et le doctorat en sciences infirmières sont tous des cheminements que peuvent emprunter les infirmières et infirmiers une fois leur formation initiale complétée. La maîtrise en sciences infirmières est également un programme de 2e cycle s’étalant sur deux années, qui permet à une personne ayant un baccalauréat en sciences infirmières de poursuivre sa formation afin de développer des connaissances et des compétences avancées en sciences infirmières, en vue de jouer un rôle en pratique infirmière avancée, notamment à titre d’IPS. Pour occuper un poste en recherche, que ce soit au sein d’une université, dans un centre de recherche ou dans un institut, il convient d’obtenir un doctorat en sciences infirmières dont la durée varie de trois à cinq ans. Une maîtrise est requise pour pouvoir postuler au doctorat. 20 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
Pour aller plus loin
OIIQ :Champ d’exercice et activités réservées de l’infirmière
OIIQ :Websérie : Stagiaire d’un jour
OIIQ : Infirmière en prévention et contrôle des infections
La Presse+ : Professionnels en soins : 6 faits intéressants à connaître
La Presse+ : Infirmières et infirmiers : des professionnels de la santé indispensables
La Presse+ : Mieux accompagner les parents endeuillés
La Presse : Être à la maison le plus longtemps possible
La Presse : Étienne Boucher, infirmier en santé mentale
La Presse : Alexis Parent, assistant-infirmier chef
La Presse : Infirmières praticiennes spécialisées : enfin autonomes dès janvier
Le Devoir : Les services en santé mentale peuvent-ils se passer de l’expertise des
infirmières?
Le Devoir : Une infirmière au cœur de la pandémie
Le Devoir : L’expertise infirmière en CHSLD
Le Devoir : Prendre soin, l’expertise infirmière
Le Devoir : Profession, infirmière en soins palliatifs
Le Journal de Montréal : Comment les infirmières prennent soin de nos tout-petits
21 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENIV. La profession infirmière au sein
du système de santé
Notre système de santé en bref
Depuis la fusion en 2015 des agences régionales de santé et de services sociaux, la
gouvernance du système de santé et de services sociaux au Québec est centralisée et
repose sur deux paliers : le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les
centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou les centres intégrés
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).
Il existe 22 centres intégrés; neuf d’entre eux peuvent utiliser l'appellation « centre intégré
universitaire ». Sept établissements n’ont pas été fusionnés; il s’agit de quatre centres
hospitaliers universitaires (CHU), de deux instituts hospitaliers (IU) et d’un institut.
Les centres intégrés peuvent exploiter différentes installations, par exemple un centre local
de services communautaires (CLSC), un centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), un centre hospitalier (CH), un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ) et un centre de réadaptation (CR).
Un CLSC offre des services de santé et de services sociaux courants de première ligne à la
population du territoire auquel il est rattaché. Ces services peuvent être préventifs, curatifs,
en réadaptation ou en réinsertion.
Un CHSLD est un centre d’hébergement temporaire ou permanent pour les personnes qui
ne peuvent pas demeurer dans leur milieu de vie, notamment en raison d’une perte
d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale. Ces centres offrent une gamme de services
d’assistance, de surveillance et de soutien aux soins infirmiers, pharmaceutiques,
médicaux et de réadaptation.
Une première classe de CH fournit des services médicaux généraux et spécialisés. Une
deuxième classe de CH fournit des services psychiatriques.
Les CPEJ offrent quant à eux des services psychosociaux à certains jeunes et leur famille
qui, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents, ont une situation qui le demande.
Enfin, les CR fournissent des services d'adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale
aux personnes à diverses clientèles ainsi qu’à leur entourage. Différentes classes de CR
22 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENexistent en fonction des besoins des personnes, soit celles ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, celles ayant une déficience
physique, celles ayant une dépendance, ou encore les mères et les jeunes en difficulté
d’adaptation.
Répartition des établissements au Québec
Où les infirmières et infirmiers exercent-ils?
Les infirmières et infirmiers peuvent exercer leurs fonctions dans une multitude
d’établissements du réseau public ou privé. Selon le Rapport statistique sur l’effectif
infirmier 8, la majorité, soit 84,8 %, travaille dans le réseau public de santé et des services
sociaux. Parmi eux, 34,1 % travaillent pour un CIUSSS, 30,5 % pour un CISSS et 16,9 %
pour un CHU. Certains membres de la profession infirmière vont travailler dans le secteur
privé (8,7 %), d’autres dans le secteur de l’éducation (3,5 %) et dans le secteur
communautaire (1,6%).
8
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2020). Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2019-2020 :
le Québec et ses régions.
23 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENCollaboration interprofessionnelle
La diversité des lieux et des domaines de pratique dans lesquels les infirmières et infirmiers
exercent commandent un travail en étroite collaboration avec plusieurs intervenants et
autres professionnels. Dans leur pratique courante, ils peuvent être appelés à collaborer
avec plusieurs professionnels de la santé qui exercent en santé et en relations humaines 9.
Les infirmières et infirmiers collaborent aussi avec d’autres partenaires ou intervenants qui
contribuent à la dispensation de soins tels que des personnes exerçant des métiers
d’assistance 10, des policiers, des techniciens ambulanciers paramédics, des intervenants
du milieu communautaire, des enseignants et des intervenants en soins spirituels.
Par la posture unique conférée par leur champ d’exercice et leurs activités professionnelles,
les infirmières et infirmiers jouent un rôle décisif, parfois central au sein de l’équipe de soins
composée de différents professionnels et intervenants. Leur analyse globale de la santé
d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et leur capacité à coordonner et à
personnaliser les soins, font d’eux des professionnels hautement contributifs à la réflexion
interdisciplinaire.
De tous les professionnels mentionnés précédemment, les infirmières et infirmiers sont
particulièrement appelés à travailler en étroite collaboration avec certains professionnels,
notamment les infirmières et infirmiers auxiliaires, les médecins, les pharmaciens ainsi que
des personnes exerçant des métiers d’assistance tels que les préposés aux bénéficiaires.
Comme représenté dans l’illustration ci-bas, certains mythes persistent selon lesquels des
professionnels ou intervenants sont interchangeables. Au contraire, tous ont un champ
d’exercice propre à leur profession ou leur rôle et travaillent de façon complémentaire. Le
schéma suivant illustre la complémentarité des rôles des membres de l’équipe de soins.
9
Liste non exhaustive – Conseillers en orientation, criminologues, dentistes, denturologistes, diététistes-
nutritionnistes, ergothérapeutes, hygiénistes dentaires, infirmières et infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes,
médecins, opticiens d'ordonnances, optométristes, orthophonistes et audiologistes, pharmaciens,
physiothérapeutes, podiatres, psychoéducateurs, psychologues, sages-femmes, sexologues, technologues en
prothèses et appareils dentaires, technologistes médicaux, technologues en imagerie médicale, en radio-
oncologie et en électrophysiologie médicale, travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux.
10
Souvent regroupés sous l’appellation « préposés aux bénéficiaires »
24 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYENPour aller plus loin Ministère de la Santé et des Services sociaux : Système de santé et de services sociaux en bref Ministère de la Santé et des Services sociaux : Établissements de santé et de services sociaux OIIQ : Milieux de pratique de la profession infirmière Collaboration interprofessionnelle 25 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
V. La profession infirmière face aux enjeux actuels de santé L'amélioration de l'accès aux soins de santé passe par le fait de doter les infirmières et infirmiers de leviers leur permettant d'exercer leur profession. Faire un meilleur usage des compétences infirmières peut améliorer l'efficacité du système de santé et l’accès aux soins afin de répondre adéquatement aux besoins de santé grandissants de la population du Québec. Des soins de plus en plus spécialisés La demande de soins à domicile et dans la communauté est en constante augmentation, du fait du vieillissement de la population, mais aussi parce que le soutien à domicile demeure le premier choix de bon nombre de Québécois ayant besoin de soins et services, notamment les aînés. En les maintenant le plus longtemps possible à domicile, cela permet de désengorger les urgences et de leur assurer une meilleure qualité de vie Par ailleurs, plus de la moitié des Québécois âgés de 65 ans et plus déclarent au moins deux problèmes chroniques de santé. Les maladies chroniques apparaissent davantage avec l’avancée de l’âge et tendent à se cumuler, ce qui complexifie leur prise en charge. Les types de maladies chroniques les plus fréquents sont l’hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires, et surtout le cancer. Les problèmes en santé mentale sont également omniprésents. Près de 20 % de la population du Québec sera atteinte d’un trouble mental au cours de sa vie. En 2019, plus de 15 000 personnes étaient en attente d’un service en santé mentale. La demande en soins spécialisés ne cesse d’augmenter. Des acteurs-clés en matière d’accès aux soins de santé En raison de leur expertise, les infirmières et infirmiers sont en mesure de déterminer ce qui est prioritaire pour assurer des soins sécuritaires aux patients. Ces professionnels, que l’on consulte dans plusieurs contextes (problèmes de santé, suivi de grossesse et autres), interviennent auprès de l’ensemble de la population, notamment auprès des personnes les plus vulnérables : aînés, proches aidants, enfants de 0 à 5 ans, personnes vivant avec un problème de santé mentale, communautés autochtones et autres. Ils peuvent amorcer les 26 DOSSIER D’INFORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU JURY CITOYEN
Vous pouvez aussi lire