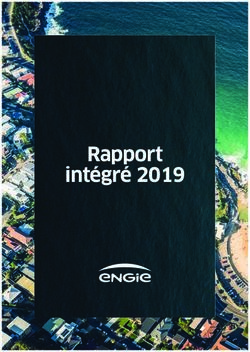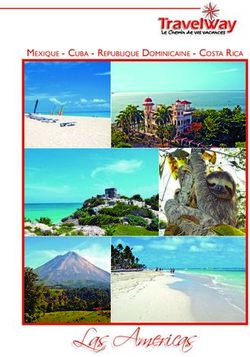29 JUILLET - 4 AOÛT 2019 - Musique en Charolais-Brionnais
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Martha ARGERICH piano
Itamar GOLAN piano
Juliana STEINBACH piano
Daniel ROWLAND violon
Sébastien SUREL violon
Ayako TANAKA violon
Lyda CHEN ARGERICH alto
Béatrice MUTHELET alto
Maja BOGDANOVIC violoncelle
Éric-Maria COUTURIER violoncelle
Guillaume MARTIGNÉ violoncelle
Emmanuel ROSSFELDER guitareSOMMAIRE
MOT DU PRÉSIDENT..........................................................P5
MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE....................................P7
SAMEDI 1ER AOÛT 2020
19H • RÉCITAL BEETHOVEN « JEUNESSE & TEMPÊTE »
21H • RÉCITAL BEETHOVEN « AURORE & CRÉPUSCULE »
DIMANCHE 2 AOÛT 2020
17H • RÉCITAL « CHACONNE POUR GUÉRINEL »
LUNDI 3 AOÛT 2020
10H30 • MOMENT MUSICAL « VAL DE JOUX »
19H • CONCERT « ESPRITS »
21H • CONCERT « VIENNE »
MARDI 4 AOÛT 2020
10H30 • ATELIER « SCÈNES D’ENFANTS »
12H • CONCERT « VARIATIONS GOLDBERG »
21H • CONCERT « ULTIME SCHUBERT »
MERCREDI 5 AOÛT 2020
10H30 • RÉCITAL BEETHOVEN « PRINTEMPS »
12H • RÉCITAL BEETHOVEN « KREUTZER »
21H • CONCERT « SOUVENIR DE FLORENCE »
JEUDI 6 AOÛT 2020
10H30 & 12H • CARTE BLANCHE À MAJA BOGDANOVIC
19H • CONCERT « ARCHIDUC »
21H • CARTE BLANCHE À MARTHA ARGERICH
VENDREDI 7 AOÛT 2020
10H30 & 12H • CARTE BLANCHE À EMMANUEL ROSSFELDER
19H • RÉCITAL BEETHOVEN « CELLISSIMO I »
21H • CARTE BLANCHE À MARTHA ARGERICH
SAMEDI 8 AOÛT 2020
10H30 & 12H • CARTE BLANCHE À GUILLAUME MARTIGNÉ
19H • RÉCITAL BEETHOVEN « CELLISSIMO II »
21H • CARTE BLANCHE À MARTHA ARGERICH
DIMANCHE 9 AOÛT 2020
10H30 & 12H • CARTE BLANCHE À ÉRIC-MARIA COUTURIER
17H • RÉCITAL « PIANOCELLO »
CYCLE BACH, PAR DANIELLE RIBOUILLAULT
CYCLE BEETHOVEN, PAR CLAUDE DUPERRET
BIOGRAPHIES DES ARTISTES..............................................P27
PARTENAIRES DU FESTIVAL................................................P42
INFORMATIONS PRATIQUES...............................................P46
P:3The show must go on...
Le premier semestre de l’année 2020 aura été le temps des bouleversements en tous genres.
Ces quelques mois auront suffi à ébranler nos sociétés et troubler jusqu’à nos façons de
vivre. Ils ont semé le désarroi dans les économies, versé le doute dans les esprits et installé
dans notre présent ce qui semblait réservé à la peste d’Athènes de - 430, à celles du Moyen-
Âge ou aux archives déjà séculaires de la grippe espagnole.
Parmi les activités touchées par les effets de la pandémie, le monde de l’art paie un lourd
tribut aux menaces de la contagion, à la distanciation sociale, à « l’être ensemble » qui fait
collectivement regarder, écouter, chanter, danser, jouer...
Est-il alors bien sérieux de ménager une place à ces « jeux » dans le chaos et la faillite an-
noncés ? C’est bien la question que se sont posée nombre de festivals. Beaucoup, pour di-
verses raisons, ont dû annuler ou différer leurs représentations. Nous avons pu proposer un
autre choix, aidés en cela par la confiance et le soutien que nous apportent les élus et les
autorités du territoire charolais-brionnais (le Conseil Départemental de Saône et Loire, la
si fidèle Communauté de Communes Le Grand Charolais, la Communauté de Communes La
Clayette Chauffailles en Brionnais, la commune de Saint-Bonnet de Joux et tous les autres
maires).
Au plan sanitaire d’abord, l’équipe du festival s’est ralliée au protocole rigoureux de protec-
tion, distanciation et hygiène prescrit par les autorités de santé, limitant même l’accès aux
concerts, par-delà les précautions requises, à une fraction de leur jauge habituelle.
Et puis, comment faire comme si nous n’avions pas besoin de musique pour nous repérer,
nous élever et continuer à vivre, pas besoin de musiciens, nos compagnons de route restés
ces derniers mois si nombreux sur le bord des chemins qu’ils ont pour vocation et métier de
parcourir pour nous et avec nous... ?
Il fallait bien tout l’art de Juliana pour concilier et interpréter dans cette édition si spéciale
de Musique en Charolais-Brionnais des impératifs sanitaires, artistiques et humains si di-
vers.
L’art en ces temps de Covid se fait plus que jamais vigie quand il nous livre l’observation et
la métamorphose de notre contingence dans l’intemporel... Ou quand Bach et Beethoven
qui nous observent depuis l’affiche de cette seizième édition du festival transcendent et
éclairent de leur point de vue pérenne nos craintes et nos espoirs d’aujourd’hui.
Alors pour cela...
... le spectacle peut et doit continuer.
Didier VOÏTA
Président, Musique et Patrimoines en Charolais-Brionnais
P:5TEMPS RETROUVÉS
- Ô temps, suspends ton vol !
De la note au soupir
L’éternité vibrante
(…)
Le temps de vivre
Le temps d’aimer
Le temps de croire
Le temps de douter
Le temps d’apprendre
Le temps de jouer
Le temps d’entendre
Le temps de semer
Le temps d’attendre
...
Le temps d’éclore
(…(…)…)
Un point d’orgue sur la voie
De nos Temps Retrouvés
Juliana Steinbach
P:7SAYAKA SHOJI
JULIANA STEINBACH
EINAV YARDEN DORA KOKÁS
MAJA BOGDANOVIC
VIRGIL BOUTELLIS-TAFT
ITAMAR GOLAN
NEMANJA RADULOVIC
SATÉNIK KHOURDOIAN
BÉATRICE MUTHELET
SILVIA SIMIONESCU IDDO BARSHAÏ
GUILLAUME MARTIGNÉ
SÉBASTIEN WALNIER
SÉBASTIEN SUREL
QUATUOR PSOPHOS TIBI CZIGER
BÉATRICE REIBEL
FANY MASELLI
PRIYA MITCHELL
JONAS VITAUD
LYDA CHEN ARGERICH
VIRGINIE REIBEL VLADIMIR PERSÉVIC
ÉRIC-MARIA COUTURIER ROY AMOTZ
NORIKO INOUE KATHARINA WINGENAMAURY COEYTAUX
MANUEL VIOQUE-JUDDE JAEWON KIM
MARTHA ARGERICH
YANN DUBOST
DANIEL ROWLAND
HÉLÈNE COLLERETTE
CLARA GERVAIS
ÉLISE THIBAUT
AYAKO TANAKA
TOMOKO AKASAKA
PÉTER BARSONY
ANTOINE DREYFUSS
GERGELY MADARAS
LUIZ GUSTAVO CARVALHO
UXÍA MARTÍNEZ BOTANA
EMMANUEL ROSSFELDER
NOEMI GYÖRI
THÉOTIME VOISIN
MICHAL KORMAN
SIVAN MAGEN
FUKI FUJIE CHRISTIAN-PIERRE LAMARCA
TRIO TALWEG
GUILHEM FABRE NELSON FREIRE
P:9SAMEDI 1ER AOÛT 2020
19H • RÉCITAL BEETHOVEN
« JEUNESSE & TEMPÊTE »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour piano n°1 en fa mineur, op.2 n.1
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto - Allegretto
IV. Prestissimo
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour piano n°17 en ré mineur, op.31 n.2
La Tempête
I. Largo-Allegro
II. Adagio
III. Allegretto
21H • RÉCITAL BEETHOVEN
« AURORE & CRÉPUSCULE »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour piano n°21 en ut majeur, op.53
Waldstein (l’Aurore)
I. Allegro con brio
II. Introduzione - Adagio molto
III. Rondo : Allegretto moderato - Prestissimo
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour piano n°32 en ut mineur, op.111
I. Maestoso - Allegro con brio ed appassionato
II. Arietta - Adagio molto, semplice e cantabile
JULIANA STEINBACH, PIANO
P : 11DIMANCHE 2 AOÛT 2020
17H • RÉCITAL DE VIOLONCELLE
« CHACONNE POUR GUÉRINEL »
SAINT-BONNET DE JOUX, église
Lucien GUÉRINEL (1930)
Ce Chant de Brume, pour violoncelle (1979)
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chaconne de la Partita pour violon n°2
en ré mineur BWV 1004, arrangement pour violoncelle
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
P : 13LUNDI 3 AOÛT 2020
10H30 • MOMENT MUSICAL « VAL DE JOUX »
SAINT-BONNET DE JOUX, petite unité de vie
Les musiciens du festival jouent pour les résidents et
visiteurs de la Petite Unité de Vie. Un précieux moment
d’échange entre les générations. Cette année ce
moment musical sera donné dans le jardin, en plein air.
19H • CONCERT « ESPRITS »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Variations pour violoncelle et piano en sol majeur
WoO.45 Judas Maccabaeus
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Trio pour piano et cordes n°5 en ré majeur,op.70 n.1
Geister (Esprits)
I. Allegro vivace e con brio
II. Largo assai ed espressivo
III. Presto
SÉBASTIEN SUREL, VIOLON
MAJA BOGDANOVIC, VIOLONCELLE
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
ITAMAR GOLAN, PIANO
JULIANA STEINBACH, PIANO
21H • CONCERT « VIENNE »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Partita pour clavier n°2 en si bémol majeur, BWV 825
I. Praeludium
II. Allemande
III. Corrente
IV. Sarabande
V. Menuet I & II
VI. Gigue
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Trio pour piano et cordes n°4 en si bémol majeur, op.11 Gas-
senhauer
I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Thème et Variations (sur le thème de Pria ch’io l’impegno)
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Quatuor pour piano et cordes n°2 en mi bémol majeur, K.493
I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegretto
DANIEL ROWLAND, VIOLON
BÉATRICE MUTHELET, ALTO
MAJA BOGDANOVIC, VIOLONCELLE
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
ITAMAR GOLAN, PIANO
JULIANA STEINBACH, PIANO
P : 15MARDI 4 AOÛT 2020
10H30 • ATELIER « SCÈNES D’ENFANTS »
CHAROLLES, salle du baillage
Les musiciens du festival jouent pour les enfants !
12H • CONCERT « VARIATIONS GOLDBERG »
CHAROLLES, église
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Variations Goldberg BWV 988,
version pour trio à cordes de Dmitri Sitkovetsky
SÉBASTIEN SUREL, VIOLON
BÉATRICE MUTHELET, ALTO
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
21H • CONCERT « ULTIME SCHUBERT »
VARENNE L’ARCONCE, église
Franz SCHUBERT (1797-1828)
Quintette à cordes en ut majeur, D.956
I. Allegro ma non troppo
II. Adagio
III. Scherzo. Presto - Trio. Andante sostenuto
IV. Allegretto
DANIEL ROWLAND, VIOLON
SÉBASTIEN SUREL, VIOLON
BÉATRICE MUTHELET, ALTO
MAJA BOGDANOVIC, VIOLONCELLE
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
P : 17MERCREDI 5 AOÛT 2020
10H30 • RÉCITAL BEETHOVEN « PRINTEMPS »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur, op.24
Frühlings (Le Printemps)
I. Allegro
II. Adagio molto espressivo
III. Scherzo. Allegro molto
IV. Rondo. Allegro ma non troppo
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour violoncelle et piano n°3 en la majeur, op.69
I. Allegro ma non tanto
II. Scherzo. Allegro molto
III. Adagio cantabile
IV. Allegro vivace
SÉBASTIEN SUREL, VIOLON
MAJA BOGDANOVIC, VIOLONCELLE
ITAMAR GOLAN, PIANO
JULIANA STEINBACH, PIANO
12H • RÉCITAL BEETHOVEN « KREUTZER »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Variations pour violoncelle et piano en fa majeur op.66
Ein Mädchen oder Weibchen
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour violon et piano n°9 en la majeur, op.47
Kreutzer
I. Adagio sostenuto
II. Andante con Variazioni
III. Presto
DANIEL ROWLAND, VIOLON
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
ITAMAR GOLAN, PIANO
JULIANA STEINBACH, PIANO
21H • CONCERT
« SOUVENIR DE FLORENCE »
SUIN, église
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Sérénade pour cordes n°13 en sol majeur K.525
Eine kleine Nachtmusik (Une Petite Musique de Nuit)
I. Allegro
II. Romance : Andante
III. Menuet & Trio : Allegretto
IV. Rondo : Allegro
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Sextuor à cordes en ré mineur, op.70
Souvenir de Florence
I. Allegro con spirito
II. Adagio cantabile e con moto
III. Allegretto moderato
IV. Allegro vivace
DANIEL ROWLAND, VIOLON
SÉBASTIEN SUREL, VIOLON
BÉATRICE MUTHELET, ALTO
LYDA CHEN ARGERICH, ALTO
MAJA BOGDANOVIC, VIOLONCELLE
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
P : 19JEUDI 6 AOÛT 2020
10H30 • CARTE BLANCHE À MAJA BOGDANOVIC
BRIANT, église
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Suite pour violoncelle n°3 en ut majeur, BWV 1009
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Bourrée I & II
VI. Gigue
Béla BARTÓK (1881-1945)
Melodia, extrait de la Sonate pour violon seul Sz.117
Zoltan KODÁLY (1882-1967)
Duo pour violon et violoncelle op.7 (1er mouvement)
DANIEL ROWLAND, VIOLON
MAJA BOGDANOVIC, VIOLONCELLE
12H • CARTE BLANCHE À MAJA BOGDANOVIC
BRIANT, église
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Suite pour violoncelle n°5 en ut mineur, BWV 1011
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Gavotte I & II
VI. Gigue
Jörg WIDMANN (1973)
Trois duos : Pas de Deux, Valse Bavaroise,
Toccattina all’Inglese
DANIEL ROWLAND, VIOLON
MAJA BOGDANOVIC, VIOLONCELLE
19H • CONCERT « ARCHIDUC »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Variations pour violoncelle et piano WoO 46
Bei Männern, welche Liebe fühlen
Trio pour piano et cordes n°7 en si bémol majeur, op.97
Erzherzog (Archiduc)
I. Allegro moderato
II. Scherzo Allegro
III. Andante cantabile
IV. Allegro moderato
DANIEL ROWLAND, VIOLON
MAJA BOGDANOVIC, VIOLONCELLE
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
ITAMAR GOLAN, PIANO
JULIANA STEINBACH, PIANO
21H • CONCERT
« CARTE BLANCHE À MARTHA ARGERICH »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Programme surprise !
P : 21VENDREDI 7 AOÛT 2020
10H30 • CARTE BLANCHE
À EMMANUEL ROSSFELDER
La Guitare Lyrique
Fernando SOR (1778-1839)
Introduction, Thème & Variations
sur La Flûte Enchantée de Mozart
Francisco TÁRREGA (1852-1909)
Introduction, Thème & Variations
sur le carnaval de Venise
Mauro GIULIANI (1781-1829)
Fantaisie sur des thèmes de Rossini
Johan Kaspar MERTZ (1806-1856)
Élégie
Julián ARCAS (1832-1882)
Fantaisie sur des thèmes de la Traviata de Verdi
EMMANUEL ROSSFELDER, GUITARE
12H • CARTE BLANCHE
À EMMANUEL ROSSFELDER
SEMUR EN BRIONNAIS, collégiale Saint-Hilaire
Cordes Virtuoses
Mauro GIULIANI (1781-1829)
Sonate
Antonio VIVALDI (1678-1741)
Concerto en ré majeur
Niccolò PAGANINI (1782-1840)
Sonate Centone n°1
Niccolò PAGANINI (1782-1840)
Cantabile
Fritz KREISLER (1875-1962)
Prélude & Allegro
19H • RÉCITAL BEETHOVEN « CELLISSIMO I »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour violoncelle et piano n°1 en fa majeur, op.5 n°1
I. Adagio sostenuto - Allegro
II. Rondo : Allegro vivace
Sonate pour violoncelle et piano n°2 en sol mineur, op.5 n°2
I. Adagio sostenuto ed espressivo. Allegro molto piutosto presto
II. Rondo. Allegro
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
JULIANA STEINBACH, PIANO
21H • CONCERT
« CARTE BLANCHE À MARTHA ARGERICH »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Programme surprise !
P : 23SAMEDI 8 AOÛT 2020
10H30 • CARTE BLANCHE
À GUILLAUME MARTIGNÉ
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Suite pour violoncelle n°1 en sol majeur, BWV 1007
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Menuet I & II
VI. Gigue
Suite pour violoncelle n°2 en ré mineur, BWV 1008
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Menuet I & II
VI. Gigue
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
12H • CARTE BLANCHE
À GUILLAUME MARTIGNÉ
Silvia COLASANTI (1975-)
Lamento pour violoncelle
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Suite pour violoncelle n°6 en ré majeur, BWV 1012
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Gavotte I & II
VI. Gigue
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Duo pour alto et violoncelle en mi bémol majeur, WoO32
Mit zwei obligaten Augenglasern (Avec lunettes obligées)
I. Allegro
II. Minuet
LYDA CHEN ARGERICH,ALTO
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
19H • RÉCITAL BEETHOVEN « CELLISSIMO II »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour violoncelle et piano n°4 en ut majeur, op.102 n°1
I. Andante - Allegro vivace
II. Adagio - Tempo d’Andante - Allegro vivace
Sonate pour violoncelle et piano n°5 en ré majeur, op.102 n°2
I. Allegro con brio
II. Adagio con molto sentimento d’affetto
III. Allegro – Allegro fugato
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
JULIANA STEINBACH, PIANO
21H • CONCERT
« CARTE BLANCHE À MARTHA ARGERICH »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Programme surprise !
P : 25DIMANCHE 9 AOÛT 2020
10H30 • CARTE BLANCHE
À ÉRIC-MARIA COUTURIER
SUIN, église
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Suite pour violoncelle n°4 en mi bémol majeur, BWV 1010
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Bourrée I & II
VI. Gigue
Suite pour violoncelle n°6 en ré majeur, BWV 1012
I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Gavotte I & II
VI. Gigue
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
12H • CARTE BLANCHE
À ÉRIC-MARIA COUTURIER
SUIN, église
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Divertimento pour trio à cordes en mi bémol majeur, K.563
I. Allegro
II. Adagio
III. Menuetto : Allegretto - Trio
IV. Andante
V. Menuetto : Allegretto
VI. Allegro
AYAKO TANAKA, VIOLON
LYDA CHEN ARGERICH, ALTO
ÉRIC-MARIA COUTURIER, VIOLONCELLE
17H • RÉCITAL « PIANOCELLO »
BOIS SAINTE-MARIE, église
Johannes BRAHMS (1833-1897)
Sonate pour violoncelle et piano n.1 en mi mineur, op.38
I. Allegro non troppo
II. Allegretto quasi minuetto
III. Allegro
Rober SCHUMANN (1810-1856)
Fantaisiestücke pour violoncelle et piano op.73
I. Zart und mit Ausdruck
II. Lebhaft, leicht
III. Rasch und mit Feuer
Claude DEBUSSY (1862-1918)
Sonate pour violoncelle et piano
I. Prologue
II. Sérénade
III. Finale
GUILLAUME MARTIGNÉ, VIOLONCELLE
JULIANA STEINBACH, PIANO
P : 27CYCLE BACH Présentation, par Danielle Ribouillault
La Chaconne Exception faite des Variations Goldberg, toutes les œuvres de Bach présentées au programme de ce festival ont probablement été écrites entre 1717 et 1723 à la cour de Koethen. Bach s’y rendit pour être le maître de chapelle de Léopold d’Anhalt-Koethen, un mélomane, musicien lui-même. Bach a alors la trentaine. La cour étant calviniste, il laisse un peu l’orgue et la musique d’église. Et c’est ainsi qu’il va écrire parmi ses plus grands chefs-d’œuvre de musique instrumentale: le livre I du Clavier Bien Tempéré, les Suites Anglaises, les Suites Françaises, les Inventions et les Sinfonie pour le clavier ; les Concertos Brandebourgeois pour petit orchestre ; ainsi que les Suites et Partitas pour instruments solistes dont celles pour violon seul et en particulier la deuxième où figure en cinquième mouvement, la fameuse Chaconne. Cette période semble être une synthèse des acquis des périodes précédentes de la vie de Bach, passées à Mulhausen et Weimar où avaient éclos ses somptueuses grandes pièces pour orgue et ses très nombreuses Cantates. Autant dire que ses œuvres instrumentales héritant de tout ce bagage, sont des chefs-d’œuvre absolus. Elles concentrent tout l’art de Bach en pleine maturité. La Chaconne écrite initialement pour le violon est jouée ici au violoncelle. Sa transposition comme à l’alto reste très proche de l’original, ce qui est aussi le cas pour les versions pour guitare ou luth, alors que d’autres transpositions comme celles pour instruments à vent, flûte, clarinette, saxophone ...s’en éloignent davantage. On a voulu aussi jouer la Chaconne au piano, avec par exemple au XIXème siècle celle de Brahms pour la main gauche, très proche de la version initiale pour violon - comme celles pour clavecin ou harpe. Mais même les organistes s’en emparèrent, montrant combien cette œuvre écrite pour un simple violon à quatre cordes pouvait sonner en toute plénitude sur le plus vaste des instruments polyphoniques. Et on ira jusqu’à la transcrire pour orchestre symphonique… C’est qu’il s’agit d’une œuvre extraordinaire. Elle témoigne d’abord d’une connaissance approfondie du violon dont Bach jouait fort bien dit-on. Mais aussi d’une tradition italienne puis allemande du violon soliste, cette dernière illustrée par exemple par Biber ou Westhopff qui pratiquaient déjà la polyphonie et les doubles cordes. Mais ici Bach, fort de cet acquis et de son formidable génie, arrive à faire entrer dans cet instrument à priori monodique, l’écriture d’un quasi petit orchestre. Miracle d’écriture, l’harmonie est là sans aucun support extérieur (de clavecin ou de viole) et les lignes se mêlent en un habile et délicieux contrepoint. D’une redoutable difficulté pour l’interprète, l’écriture elle, avance limpide et évidente, drapée dans des accords vivement arpégés donnant l’idée de la verticalité, ou plus loin d’un discours concertant accompagné d’une basse solide… L’illusion est parfaite au violon - comme au violoncelle dans la version transcrite - même si elle demeure extrêmement difficile à rendre : car il s’agit bien, entre les mains d’un seul instrumentiste, de restituer tout le discours musical. La Partita s’apparente à une suite de danses (Allemande, Courante, Sarabande, Gigue…) qui se termine ici par cette immense Chaconne où l’on ne peut s’empêcher de penser à l’écriture d’orgue, majestueuse en ses accords, ses gammes en fusées, ses arpèges volubiles, ses doubles ou triples croches, ou intimement recueillie dans son humble choral religieux… Mais au-delà des techniques extraordinaires de composition ou de jeu instrumental, il faut bien reconnaître qu’on parvient avec cette œuvre à un sommet spirituel inouï où les mots doivent s’effacer, où l’on touche à l’intemporel de la pure Beauté… Les Suites pour violoncelle Contempler les pages autographes de Bach est déjà une invite à entrer dans son monde, leurs graphismes sinueux et vigoureux à la fois, traduisent en silence les formidables mouvements intérieurs qui habitaient celui qui les traçait. À l’écoute sonore s’anime littéralement cette écriture de courbes volubiles encadrées d’un rythme puissant. Les Suites pour instruments seuls de Bach sont l’épure de ce geste compositionnel. Elles concentrent dans leur forme même, la solide vigueur des danses anciennes et l’inspiration mélodique ondulante du grand Jean Sébastien. Ses plus célèbres Suites pour instrument seul, hormis bien sur tout le corpus de clavier, sont celles pour violon (Suites et Partitas), pour luth notées en tablature (BWV 995 à 1000) souvent transcrites pour la guitare, pour flûte (Partita BWV 1013) et bien sûr celles pour violoncelle données au festival de cette année dans leur intégralité (les six Suites BWV 1007 à 1012). Ces Suites pour violoncelle de Bach sont toutes introduites par un Prélude, suivi d’une Allemande à quatre temps, d’une Courante à trois temps, d’une Sarabande à trois temps, des Menuets I et II à trois temps et d’une Gigue finale ternaire. Se substituent aux Menuets des Bourrées dans les troisième et quatrième suites, des Gavottes dans les cinquième et sixième suites - Menuets, Bourrées et Gavottes (aussi appelées Galanteries) allant toujours par paire, de natures souvent opposées (grave/joyeux, mineur/majeur). Le ternaire domine l’ensemble de la partition comme un élan vital, celui physique des danses vives…même si celles-ci ne sont plus guère pratiquées alors - élan vital qui se suspend soudain au plein cœur de la Suite, dans le contraste saisissant des lentes et profondes Sarabandes. Ici comme au violon, Bach réussit à créer l’illusion épurée d’une magnifique polyphonie au long de mouvements de danses tous le plus souvent bipartites avec reprises. Le festival présente cette année un Cycle Bach dédié essentiellement ici au violoncelle soliste. Et cela d’une façon peu commune puisque, présent dans les œuvres originales, le violoncelle l’est aussi ici par des transcriptions moins connues et à (re)découvrir (Chaconne, Variations Goldberg…). Le violoncelle au cours de l’histoire ne s’est que peu à peu fait une place comme soliste - plus tardivement que le violon et d’abord en Italie. Ailleurs, il restera longtemps le rival de la viole de gambe. Hubert le Blanc par exemple écrira une Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle (!) (Amsterdam 1711). Et d’ailleurs, Bach lui-même écrivit d’abord trois sonates pour violeP de : 29
gambe avant de se tourner vers le violoncelle en écrivant ses six Suites (dont la sixième fut écrite pour un autre instrument encore, plus petit (violoncelle piccolo à cinq cordes, accordé do sol ré la mi que certains assimilent à la viola pomposa). Dans toute son œuvre, Bach se montre l’héritier de la tradition musicale occidentale qui cultiva l’horizontal des lignes contrepointiques plusieurs siècles durant, puis au temps du premier baroque, favorisa une conception plus verticale, dite harmonique, sans renier pour autant l’esprit de la polyphonie...Durant cette période du XVIIème siècle, chaque pays développa son propre style. Au début du XVIIIème siècle, Bach, en les copiant et recopiant inlassablement pour les faire siens, va réunir ces différents styles, faire fusionner influences française, italienne, allemande, les assimiler et les transcender dans un seul moule, le sien. LA PREMIÈRE SUITE EN SOL MAJEUR est solaire et lumineuse, avec un Prélude fameux en arpèges construit sur une basse obsessive de tonique, puis une Allemande majestueuse et méditative, une Courante joyeusement bondissante, une Sarabande recueillie, deux Menuets contrastés - l’un affirmé et l’autre soudain grave passant en mineur pour revenir à l’assurance du premier - le tout terminé par une Gigue entraînante à souhait. LA DEUXIÈME SUITE EN RÉ MINEUR est d’un caractère tout opposé, très intérieure voire sombre dès le Prélude, à peine éclairé à un moment d’un bref fa majeur, l’Allemande gardant cette couleur, non atténuée par la rapide et jaillissante Courante elle-même tourmentée, et plus marquée encore dans la sublime Sarabande toute en questionnements douloureux - moment comme suspendu dans l’espace… avant les deux Menuets pourtant vifs, évoquant le jeu de la viole de gambe française, dont le premier incisif et tragique dans ses accords péremptoires est tempéré par le second en ré majeur, avant la Gigue finale qui quoiqu’enlevée et volubile, reste avec ses sombres accords diminués, dans la teinte générale. LA TROISIÈME SUITE EN UT MAJEUR est en parfait contraste avec la précédente : respirant généreusement dès le vaste Prélude, elle est solide, humaine et comme enracinée dans la terre, dans ces temps forts marqués par des pieds qui en dansant, repoussent vigoureusement le sol. Y règne une sorte d’élan, de liberté joyeuse qui, hormis la Sarabande qui plane hors sol, conduisent à la Gigue finale d’une vigoureuse gaieté. Les trois premières suites sont les plus simples que les trois suivantes qui sont plus difficiles à tous point de vue. LA QUATRIÈME SUITE EN MI BÉMOL MAJEUR est grandiose. Elle débute par un Prélude qui évoque une pédale d’orgue surmontée d’harmonies arpégées qui seront suivies, après un point d’orgue, d’un déferlement de doubles croches culminant sur une magnifique neuvième de dominante en mineur…. avant le retour à la sérénité initiale que l’Allemande respirante prolonge. La séduisante Courante alterne continûment le binaire et le ternaire. A noter la Sarabande habitée et méditative puis les Bourrées I et II, la première développée sur cinq notes, la seconde très courte par opposition, enfin la Gigue, mouvement perpétuel complexe à quatre temps ternaires qui rappelle le Finale du sixième Concerto Brandebourgeois. LA CINQUIÈME SUITE EN UT MINEUR est basée sur un accord différent, ce que l’on appelle une scordatura où la quatrième corde est baissée d’un ton au-dessous de l’accord normal (sol au lieu de la). Dans cette vaste suite en do mineur, la plus sombre de toute, s’exprime parfois un tragique sans âge… Elle débute par un Prélude en Ouverture à la Française, avec un Grave lent en accords solennels et un discours rhétorique appuyé sur la réponse des basses profondes, auquel s’enchaîne une remarquable Fugue à trois temps avec sujet et contre-sujet sur quatre entrées en imitation. Le développement est impressionnant dans ses modulations et pédales de dominante ou tonique aboutissant à de magistrales cadences aux allures de Toccata…un vrai violoncelle polyphonique ! Musique dans le style français à nouveau avec l’Allemande qui poursuit encore la méditation du Prélude, et la Courante qui semble réveiller l’art de la viole française en ses complexités rythmiques, avant la plus poignante de toutes les Sarabandes, si fervente, comme perdue, si désolée en ses valeurs longues qui toujours nous questionnent. Les Gavottes I et II nous ramènent sur terre jouant là encore sur les rythmes binaires de la première et ternaires de la seconde, avant la Gigue dont les courbes subtilement irrégulières s’envolent avec passion. LA SIXIÈME ET DERNIÈRE SUITE EN RÉ MAJEUR de ce corpus, redoutablement difficile car écrite pour un instrument à cinq cordes mais jouée sur le violoncelle à quatre cordes, se présente comme une sorte d’aboutissement grandiose et lumineux, libre, virtuose et d’une inspiration hautement spirituelle. Son Prélude est magistral. Bach y a noté des nuances piano et forte dans une structure en Rondo (couplet/refrain) avec des réponses en échos s’amplifiant en un déferlement en doubles croches d’arpèges et de gammes fusantes dans le style d’orgue. Son Allemande rappelle les improvisations ineffables du Maître au clavier comme la Courante enchaînée vivement avec ses belles envolées rythmées. C’est l’apaisement et la sérénité absolue de la Sarabande qui conduisent à la joie des Gavottes, avec leurs effets de bourdons et de musique populaire, et à la Gigue finale superbement complexe dans sa forme et ses rythmes variés qui pour conclure nous transportent dans un monde de jubilation. Sans le dire explicitement, on peut imaginer qu’il y a dans ce groupe des six Suites un cheminement intérieur de la première à cette dernière qui conduit à une transcendance, traversant par étapes toute une gamme de sentiments humains, sereins ou tout à fait joyeux, tristes voire tragiques, exaltés ou débouchant sur des visions mystiques… C’est à chacun, dans son écoute intime et son imaginaire, de faire la lecture en creux de ces Suites et d’en percevoir la logique
et l’unité globale. Pour ce faire, on peut choisir de se tourner vers la vie de Bach à Koethen, une vie qui fut traversée par
tout cela et où l’on trouve pêle-mêle : les agréments d’une cour accueillante, une bonne rémunération, de la réputation;
le deuil dont Bach est très douloureusement frappé par la mort de sa femme bien-aimée Maria Barbara survenue alors
qu’il est au loin ; les soucis, avec quatre jeunes orphelins à consoler, élever et éduquer musicalement (les deux aînés
seront des génies formés par leur père) ; la découverte enrichissante d’un orchestre mis à sa disposition par son prince
et qui dynamise sa créativité instrumentale ; le retour de l’affection et du bonheur avec la rencontre de la jeune Anna
Magdalena, chanteuse et musicienne à la Cour de Koethen, qu’il va épouser en secondes noces et qui lui donnera encore
beaucoup d’enfants, tout en l’aidant à copier ses partitions et en écrivant un fameux petit livre bien connu des pianistes
en herbe… ; une foi grandissante enfin, qu’il aspire à exprimer dans le répertoire sacré, genre qui commence de plus
en plus à lui manquer à Koethen et qui expliquera pour une part, son départ bientôt pour Leipzig où il composera les
fameuses Variations Goldberg...
Les Variations Goldberg
Publiées en 1742, elles figurent dans le quatrième recueil du Klavierübung et furent commandées au moment où Bach
résidait à Leipzig (depuis 1723) dans la dernière période de sa vie. Le commanditaire en était le conte Von Keizerling,
insomniaque notable qui ne trouvait d’apaisement que dans la musique de clavecin. Cet ex-ambassadeur de Russie
auprès de la cour de Saxe avait demandé à Bach d’écrire quelques pièces pour son claveciniste attitré, un certain
Goldberg, qui était par ailleurs l’élève de Bach. Ces variations ont reçu de leur auteur ce titre : Aria avec variations pour
clavecin à deux claviers. En fait, plus qu’un thème varié, Bach se coule plutôt ici dans la tradition de la Chaconne avec
basse obstinée (c’est-à-dire dans la forme Passacaille où inlassablement revient la même basse structurant ainsi toute
la pièce). Les pianistes ont voulu transposer ce magnifique corpus pour leur instrument, même au prix de remarquables
difficultés...Comment oublier la version de Glenn Gould? Voilà qui justifie amplement la transcription pour trio à cordes
réalisée par le violoniste Sitkovetsky et présenté dans ce festival.
À travers cette forme du Ground anglais, Bach réalise à nouveau une synthèse de tous les acquis des périodes antérieures
de sa vie y compris cette fois celle de Koethen, variant sans cesse rythmes, écriture verticale et contrepointique, à deux,
trois ou quatre voix... dans une intarissable exubérance d’idées.La version pour trio à cordes (violon, alto, violoncelle)
de Sitkovetsky ne reprend pas la structure traditionnelle de la musique de chambre baroque, celle des Sonates en Trio
avec répartition hiérarchique des rôles : basse continue et deux dessus au medium et à l’aigu. Tout au contraire, elle
donne un rôle égal à chacun des instruments, répartis au sein de trois registres à part entière : grave, médium, dessus
pour violoncelle, alto, violon. Cette version est enrichissante par rapport à l’original pour clavecin, en ce qu’elle est
colorée de timbres inédits comme sur un écran qui du noir et blanc serait passé à la couleur. Elle est en outre habillée
d’inflexions propres aux cordes, avec une main gauche vibrante, un archet varié dans ses attaques, à chaque instrument,
simultanément ou non. On peut parler ici d’une sorte de subtile registration, un peu comme à l’orgue. Voilà qui éclaire
cette partition bien connue d’un jour tout à fait nouveau et captivant. Après la lecture des présentations précédentes
de tous les concerts de ce Cycle Bach, il est sans doute superflu de décrire tous les détails d’écriture des trente Variations
Goldberg, chacun étant à même de tendre son écoute aux mille raffinements de cette partition plurielle et de se régaler
de tous ces mouvements fugués, canons, chorals ornés, etc….
Le Cycle Bach pour cette année se termine ici et nous laisse pénétrés par cette pensée musicale olympienne du grand
Jean Sébastien Bach, nourrie de force vitale et d’inspiration spirituelle!
Si Bach se situe entre la tradition baroque du XVIIème siècle et le classicisme à venir de Haydn et Mozart puis du jeune
Beethoven, ce dernier assure dans sa maturité une autre transition qui débouche sur le romantisme - Beethoven dont
l’admiration sans borne qu’il vouait à Bach se retrouve dans la citation qu’il fait des Variations Goldberg dans son op 111…
P : 31CYCLE BEETHOVEN Carnet de Présentation, par Claude Duperret
Jeunesse & Tempête Il faut commencer. L’opus 1 - trois trios - était avec partenaires mais l’opus 2 - trois sonates - dédié à « Papa Haydn » affronte la solitude de l’interprète face à son clavier. Op.2 n°1 : Le bras s’élance en un arpège ascendant et staccato. La proposition est excellente et sera reprise maintes fois mais variée, non sans lui répondre en arpège descendant et legato. Des oppositions de nuances, des modes de jeu pianistique variés, des ruptures rythmiques : la loi des contrastes est là, inventive jusqu’au moindre détail mis en avant le temps d’« un petit tour de piste » sur la scène de l’imaginaire. Le mouvement lent découvre que l’on peut, que l’on doit chanter sur cet instrument nouveau à percussion, dont le nom piano-forte porte le contraste en lui et lance à l’interprète le défi du legato. Le Menuet est obligatoire mais on va le désarticuler quelque peu et on lui conteste son rôle de Finale, que Haydn souvent lui attribuait car le Prestissimo est impatient de commencer sa course folle de triolets dans le rythme obsédant de trois valeurs égales. Le chiffre trois est à la fête et pour reprendre haleine en son milieu, le mouvement passe au chiffre deux avant que la rage de jouer aussi vite reprenne le dessus. Joie de l’interprète! Avec cette première Sonate, le ton est donné : le voyage sera passionnant jusqu’au bout. Pas de place au doute ! On sait que chaque sonate ne devra rien à la précédente, ou si peu, et sera objet unique dans le corpus des trente-deux. Op 31 n° 2 : Encore un groupe de trois par opus. On découvre avec bonheur que le pianoforte a des possibilités de résonnance infinies qui favorisent les ruptures de tempo, de texture et ajoute une dramatisation au discours, ce qui permet parfois à ce premier mouvement, sous forme de récitatif, de nous « parler ». Le nouvel instrument ose également la lenteur Adagio du deuxième mouvement avant que le Finale impose en un tempo retenu Allegretto un motif tournoyant qui ne doit pas étourdir pour profiter du voyage harmonique extraordinaire du développement. Le mouvement ayant gravé définitivement dans la mémoire de l’auditeur son très court motif, il peut s’éclipser « sur la pointe des pieds. » Aurore & Crépuscule Op.53 : Cette fois, cette « Grande Sonate pour pianoforte » est publiée seule et dédiée au premier mécène de Beethoven à Bonn, le Comte Waldstein, compositeur et pianiste qui fait le lien avec cette ville si ouverte aux idées de la Révolution Française. Beethoven, retenant la leçon de liberté l’appliquera avant tout dans sa création et cette Sonate est en elle-même toute une révolution. Elle est grande parce son écriture est étonnante d’invention et que sa forme en supprimant le mouvement lent qui devient introduction à un long final déplace le centre de gravité vers celui-ci. L’instrument a encore fait des progrès dans sa facture et permet cette fois une exploration des timbres par l’écriture même, en répétition d’accords et de tremoli à usage orchestral. La virtuosité devient acte compositionnel de grande ampleur dans le premier mouvement. L’introduction au Finale semble improvisée sur un intervalle scandé en rythme pointé en attente du thème se levant comme l’aurore sur un chant de batelier du Rhin. Le matériau est simple et donnera dans sa fulgurance d’inventivité une explosion de timbres où trilles, éléments superposés, gammes « fusées », glissandi mettent la matière musicale en fusion. On part à la conquête du temps et de l’espace. Révolution ! Op 111 : La Sonate « Waldstein » vient de montrer le chemin. Tout devient possible. Dans l’ultime sonate : deux mouvements. Le premier tragique et opératique dans ses changements de tempi et ses suspensions, mais aussi savant dans son écriture fuguée où le contrepoint n’est pas que savoir-faire, mais savoir-dire, dire les tensions, le drame. La fin apaisée en do majeur appelle l’Aria du second mouvement qui saluera au passage Dieu le Père, Jean Sébastien Bach, et son Aria des Variations Goldberg. Variations ? Justement il y en aura cinq et dans lesquelles la méthode des temps anciens du contrepoint par diminution des durées de notes provoque une accélération de la musique sans changer de tempo. Miracle ! Dans la dernière variation, le temps suspendu irradie de lumière une matière sonore qui se raréfie. Le crépuscule monte au ciel. Concert Beethoven « Esprits » Vienne, capitale du piano-forte, Vienne capitale de la musique de chambre qui se fait dans les salons aristocratiques mais aussi de plus en plus dans les salons privés des amateurs, nombreux à pratiquer la musique à la maison : c’est le règne de la Hausmusik. Le jeune Beethoven de vingt-deux ans lorsqu’il arrive à Vienne, n’a de cesse de vouloir briller comme pianiste et compositeur et la moindre rencontre avec un musicien habile et connaisseur suscite des œuvres comme par exemple toutes ces séries de Variations, sur un thème d’opéra très souvent et destinées au violon ou au violoncelle. Beethoven admire l’œuvre de Haendel dont l’Oratorio Judas Maccabeus vient d’être redonné à Vienne en 1793. Un de ses chœurs célèbre la liberté britannique qui s’émancipe des Stuart et son thème sera repris avec enthousiasme par les prorévolutionnaires viennois, dont Beethoven était proche. Œuvre mineure ? Quand on la joue : non ! Quand on l’écoute attentivement dans ses combinaisons de métriques différentes, de modes variés, d’écriture instrumentale mettant en valeur chaque protagoniste : non ! Deux fois non ! De petites miniatures reliées habilement par un thème récurrent. Et puis le plaisir de jouer ! P : 33
Le Trio Les Esprits - qui doit son nom, après la mort de Beethoven, à son deuxième mouvement - énigmatique et convoquant dans une esthétique très romantique des fantômes peut-être shakespeariens, aborde le genre du trio avec une volonté d’en découdre dans le maniement des idées, des contrastes et des jeux instrumentaux. Ecoutons ! L’imagination est au pouvoir. Récital « Printemps » Sonate op 24 pour violon et piano. Si le titre n’est pas de Beethoven, sa tonalité bucolique de fa majeur - ton de la Symphonie Pastorale - ses tournures mélodiques, ses harmonies simples mais parfois surprenantes dans le mouvement lent, comme chez Schubert, son Scherzo humoristique et son Finale en « thème promenade » lui donnent une fraîcheur rendant possible le sous-titre. Le dialogue entre les deux instruments est aimable, souriant, comme un appel à une rencontre dans cette Nature si chère à l’auteur. Sonate op 69 pour violoncelle et piano. Cette fois le registre change, d’une part le grave du violoncelle et d’autre part le propos est d’une tout autre nature. On peut la considérer, dans toute l’histoire de la musique comme la première sonate pour piano et violoncelle dans laquelle les parties instrumentales sont à égalité d’expression, de virtuosité et d’équilibre sonore. Le premier mouvement joue sur les couleurs instrumentales, tour à tour mystérieuses, brillantes sans oublier le lyrisme du violoncelle, particulièrement sollicité. Le second mouvement est un Scherzo battu à la mesure où le jeu des rythmes syncopés donne une énergie communicative et souligne l’exubérance de la danse, non sans avoir fait une pause en la majeur dans le trio, où le mouvement ne perd cependant pas son allant sous-jacent. Un Adagio méditatif et court introduit un Finale brillant et lumineux, comme une conquête joyeuse des interprètes sur les difficultés du texte. Récital « Kreutzer » Quand Beethoven arrive à Vienne en 1792, Mozart est mort depuis un an et sa Flûte Enchantée en est à sa centième représentation. Là encore, un thème célèbre de cet opéra sera prétexte à variations pour violoncelle et piano. La rencontre à Berlin chez le Roi Frédéric Guillaume II, du virtuose du violoncelle, Jean Pierre Duport, va permettre à Beethoven de composer cette série de variations sur l’Air de Papageno, Ein Mädchen oder Weibchen, en hommage à son illustre prédécesseur, mais aussi à l’œuvre elle-même puisque si le personnage de Papageno est présent à travers l’imitation du glockenspiel, certains accents et modulations harmoniques évoquent le caractère sérieux et initiatique de l’opéra. Restons dans la virtuosité expressive avec la célèbre Sonate à Kreutzer dont l’histoire n’est pas banale. Elle est née d’une rencontre entre Beethoven et le violoniste virtuose anglais, d’origine polonaise, George Bridgetower, pour lequel il va écrire très vite cette sonate pour la donner en concert. Au dernier moment la partition de piano n’étant pas complètement écrite Beethoven dut improviser. Se greffe alors l’idée d’un projet d’aller à Paris, pour solliciter un poste auprès du Premier Consul qui n’est autre que Bonaparte que Beethoven s’apprête à célébrer dans sa Symphonie Héroïque. Ayant rencontré auparavant à Vienne le violoniste Kreutzer, très proche de Bonaparte, Beethoven lui dédia sa sonate dans l’espoir d’un appui sérieux. Malheureusement le violoniste français la jugea injouable et la tentative de Beethoven échoua piteusement. L’aura du Paris révolutionnaire est totalement sous-jacente dans cette sonate dans la mesure où l’exubérance dans le propos sous couvert d’une forme classique en trois mouvements éclate avec brio. La virtuosité qui joue la rivalité entre les deux instruments, des effets de timbres et différents types de jeu dans les variations, des masses sonores en opposition, tout concourt à une expression véritablement révolutionnaire qui a dérouté le public et… Kreutzer. Le génie déchaîné tente tout. C oncert Beethoven « Archiduc » La Flûte Enchantée sera encore inspirante avec les Variations sur le Duo Pamina et Papageno Bei Männern, welche Liebe fülhen lors de sa reprise à Vienne en 1801, car Beethoven avec le sens de l’à-propos qu’on lui connaît ne pouvait laisser passer l’occasion. Sept variations qui forment un tout. Beethoven est toujours là où on ne l’attend pas. Le thème est tellement approprié par le processus compositionnel qu’il devient vecteur d’une forme sonate cachée, avec introduction, mouvement rapide, Scherzo, mouvement lent et Finale plus rapide. Tour de passe-passe pour dépasser le modèle mozartien. Trio Archiduc op 97. Si le Trio Les Esprits en son premier mouvement garde une fièvre agitée, dans une mesure à trois temps qui frôle le déséquilibre pendant le développement, par contraste, le Trio Archiduc dédié à l’Archiduc Rodolphe, très bon pianiste et compositeur, aura une ampleur lyrique, plus sereine, exposée dans le calme d’un tempo moderato à quatre temps dès le premier mouvement, suivi d’un Scherzo sagement dit sur une gamme ascendante du violoncelle auquel répond, avec le sourire, le violon descendant sur la dominante du ton principal. Le dialogue se poursuit avec le
piano, dans le même caractère dansant et aimable jusqu’à la partie - Trio, plus mystérieuse et dont le chromatisme
en écriture plus polyphonique hésite à troubler l’atmosphère générale. L’étrangeté romantique du mouvement lent
des Esprits est bien lointaine avec l’Andante cantabile suivi de variations dans lequel à partir d’un thème en ré majeur,
dolce, semplice, la texture va se densifier, s’épanouir en étirant à l’infini les lignes vocales, soutenues par les accords
pulsés du piano dans la plénitude de leur résonance. Le mouvement se poursuit jusqu’à une suspension en attente du
surgissement du thème dansant du Finale où la virtuosité instrumentale est de mise, avec un sort particulier réservé
au piano que de grands intervalles bondissants ne doivent pas effrayer ! Quasi symphonique parfois, dans une écriture
rayonnante par ses riches et amples idées, l’Archiduc est le chef-d’œuvre du genre.
Concert Beethoven « Cellissimo I »
Dans ce passionnant périple Beethoven, le violoncelle est à la fête. Et nous avons droit à l’intégrale de la musique
de chambre composée spécialement pour cet instrument, lequel, en formation trio notamment, était resté jusqu’ici
plutôt cantonné dans un rôle d’accompagnant de main gauche du piano. Beethoven le premier lui donnera une place
considérable et ses successives rencontres avec de grands violoncellistes vont l’influencer énormément, à commencer
par Jean Pierre Duport dont il fait la connaissance à Berlin chez le Roi de Prusse - lui-même élève de ce premier
surintendant de la musique - et dont la très belle sonorité était remarquée aussi bien dans les aigus que dans les
graves.
Les deux Sonates de l’opus 5 seront composées pour ce violoncelliste et dédicacées au Roi Frédéric-Guillaume II. Et
Beethoven de s’empresser de faire parvenir la partition à Jean Louis Duport, le frère célèbre de Paris, dans l’espoir de
les jouer avec lui dans la capitale. Les deux sonates sont sur le même modèle, en deux mouvements avec introduction
lente. Dans ces lieux de tradition baroque, Bach s’y est fait entendre auprès de l’oncle, Frédéric le Grand, le clin
d’œil à la forme suite-sonate sans changement de tonalité dans les différents mouvements de danses n’est pas
anodin. Virtuosité aux deux instruments, combinaisons de timbres dans les successions de tempi différents, modes
de jeu variés, rythmes souples autant qu’endiablés témoignent de cette jeunesse conquérante que Beethoven vivait
ardemment, à l’étonnement de tous. L’effet est toujours là !
Concert Beethoven « Cellissimo II »
Le temps a fait son œuvre dans la pensée de Beethoven et de nouvelles expériences dans son écriture voient le
jour notamment sous l’influence du style ancien contrapuntique qu’il veut renouveler en lui insufflant « un esprit
nouveau » selon ses termes. Son amitié avec la Comtesse Erdödy, pianiste admirative de son œuvre et en particulier
de ses audaces, le violoncelliste Linke auquel il demande sans cesse des précisions sur le jeu instrumental, vont inciter
Beethoven à aller encore plus loin en multipliant les expériences de « laboratoire » musical. Les deux sonates de l’opus
102 en témoignent comme jamais.
Pour l’op.102 n° 1, le compositeur prévient qu’il s’agit d’une interprétation libre de la forme sonate. Deux mouvements
avec pour chacun une introduction lente proche de l’improvisation mais dont les éléments se retrouvent dans les
mouvements rapides. L’unité joue avec la diversité la plus extrême. Le compositeur défie l’analyste sclérosé et le
public routinier. Hymne à l’inventivité sans cesse renouvelée. Musique insaisissable et présente intensément dans son
déroulement imprévisible. Les générations futures en gardent un étonnement à jamais revivifié.
Avec l’op.102 n°2, la forme en trois mouvements semble plus attendue mais l’intérieur de l’édifice réserve bien des
surprises. Dans le premier mouvement le trait instrumental diffracté domine et les épisodes lyriques relient les
brusqueries éparses en un ensemble dynamique, dont l’effet acoustique de la coda ajoute encore à la surprise pour
finir en un grand éclat de rire. Nous sommes au cœur de l’humain en son travail compositionnel d’exception. Le
deuxième mouvement en ré mineur ose la lenteur la plus extrême à laquelle il faut absolument céder pour accéder aux
affects les plus abandonnés. Le mouvement va jusqu’à l’errance absolue de l’incertitude harmonique et retrouve pas à
pas le chemin de la volonté constructive avec cette fugue finale aussi nécessaire qu’inattendue. L’œuvre est à l’œuvre.
Les combinaisons polyphoniques les plus serrées, les plans sonores superposés, les accents rythmiques déplacés,
chaque voix suivant son chemin en provoquant des rencontres harmoniques surprenantes, tout est rassemblé pour
provoquer l’étonnement. Et puis, le temps d’un choral reposant et épuré, voilà les trilles dans le grave du piano,
annonçant quelques bruitages contemporains, les gammes en sixtes impatientes d’atteindre l’apothéose et tout à
coup pour mettre fin à ce délire d’écriture horizontale, une homophonie décalée en canon et une homorythmie
verticale surgissent, renvoyant l’auditeur à son exaltation stupéfaite. Le grand homme est ici !
P : 35Vous pouvez aussi lire