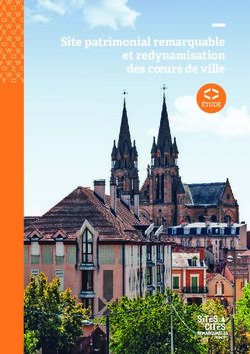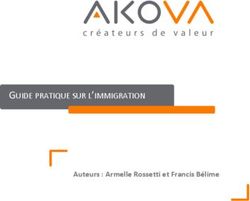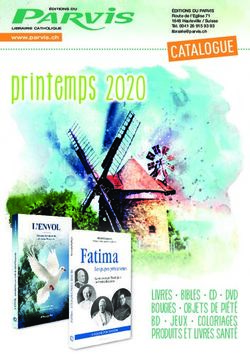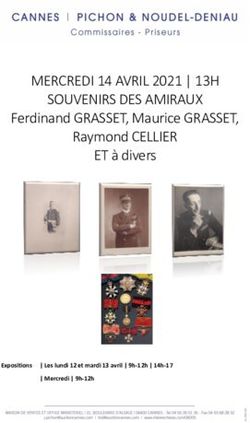Cahier Clinique du CFPT - L'ART, PORTE OUVERTE VERS LA TRANSPERSONNALITE ? - Camilo Villanueva
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Cahier Clinique du CFPT
L’ART, PORTE OUVERTE VERS LA TRANSPERSONNALITE ?
Collège Francophone de Psychothérapie Transpersonnelle | Journée d’étude | 23 Juin 2018TABLE DES MATIERES
p.2 : Editorial – Muriel Rojas Zamudio
Exposés de la journée d’étude du 24 Mars 2018
p.3 : L’acte créateur spontané est-il transpersonnel ? -Laetitia Veyron
p.7 : Explorer et valoriser l’identité Féminine, entre Création artistique et méthode
d’Accompagnement - Fanny Dangelser
p. 9 : A la rencontre du guérisseur intérieur blessé -Raphaël Lolli
p. 17 : Entre Art et Thérapie, une odyssée transpersonnelle - Muriel Rojas Zamudio
p.23 : Du spectateur inspiré au créateur conscient - Sabine Dewulf
Complément de la journée d’étude du 23 Juin 2018
p. 44 : L’art, porte ouverte vers la transpersonnalité ? – Camilo Villanueva
p.48 : Pour aller plus loin… et nous rejoindre
Relecture et mise en page :
Muriel Rojas Zamudio, Johann Henry et Bernard Onillon
Illustration couverture : El Maestro - Camilo Villanueva
PAGE 1EDITORIAL
En proposant pour notre deuxième journée d’étude le thème de L’Art : porte ouverte vers la
transpersonnalité ?, nous n’entendions pas redéfinir le champ de l’art, ni même celui de l’art-
thérapie, mais ouvrir une réflexion sur les liens que peuvent – ou pourraient – nouer
l’expression artistique et le transpersonnel.
Ne pas préciser les domaines ou réalités recouverts par ces deux termes fut un parti pris visant
à laisser aux intervenants l’espace d’y inscrire leur subjectivité. Les propositions qui nous sont
parvenues illustrent cette pluralité interprétative qui fait le sel des relations interpersonnelles.
Chacun connote les mots au fil de son expérience, entend ce qu’il peut (ou veut), et dit plus,
moins, ou autrement que ce qu’il croit énoncer, c’est pourquoi vous découvrirez dans les
articles de ce cahier des visions contrastées de l’histoire qui se raconte depuis les débuts de
l’humanité entre art et psyché. Une lecture attentive vous permettra peut-être de repérer au
détour d’une image ou d’une expression le même masqué par le différent, faisant l’expérience
de ce que le transpersonnel défend : quelque chose en nous transcende le singulier pour nous
inviter au choral, qu’il s’agisse de participation mystique ou d’engagement social. L’art à sa
manière y participe, que ce soit à travers la louange, la représentation du sacré, ou l’ouverture
via nos sens à une autre dimension de la réalité.
Tandis que nous organisions notre journée, l’artiste argentin Camilo Villanueva s’est présenté
à nous par l’une de ces synchronicités dont la vie sait si bien nous faire l’offrande. Dans son
témoignage, nous retrouvons la posture exprimée par certains intervenants du 23 Juin, avec
cette fois le regard inversé du peintre initié à la psychologie transpersonnelle.
Nous espérons que ce cahier déverrouillera les portes qui vous séparent de votre être, et que
les questions qu’il pourrait susciter se transformeront en mots, concepts, ou collaborations
susceptibles de fortifier les fondations de notre discipline artistique : la psychothérapie
transpersonnelle.
Muriel Rojas Zamudio
Coordinatrice de la journée d’étude
PAGE 2L’ACTE CREATEUR SPONTANE EST-IL TRANSPERSONNEL ?
Laetitia veyron est psychologue cognitive et instructrice de méditation pleine conscience (ADM). Elle a
suivi une première psychanalyse auprès de Marc Alain Descamps, suivi d’une seconde tranche auprès
de Marie Balmary. Elle complète sa formation clinique par l’école du GIREP de 2008 à 2012. Veyron-
psy28.com
François cheng : » toute œuvre d’art en son état le plus élevé est résonnance avec les
autres êtres et avec l’ Etre ».
C’est l’exercice personnel du mouvement dansé, « la danse contact improvisation », initié
par le gymnaste et danseur Steve Paxon, ainsi que la pratique de la méditation pleine
conscience, qui ont été à l’origine de mon intérêt pour la notion de spontanéité dans le
champ de la psychologie transpersonnelle. Je remercie ici les organisateurs de la journée et
du Collège Francophone de Psychothérapie Transpersonnelle (CFPT), de me donner
l’occasion de m’exprimer sur ce thème.
En me basant sur les auteurs qui ont influencé ma pensée , et les artistes dont j’ai pu
rencontrer les œuvres je présenterai rapidement comment le mouvement de l’histoire de
l’art accueille dès le début du XXème siècle des productions de non initiés dans ce que
j’appellerais un acte spontané de création, puis comment la psychologie à travers un cadre
mêlant l’improvisation et la pleine conscience peut accompagner la désidentification d’un
moi conditionné, et pour terminer cet article, quelques références scientifiques qui
élargissent notre conception de la conscience.
Notons avec M. de Raymond, professeur de philosophie et écrivain que « c’est dans l’art
contemporain que l’improvisation a été réhabilitée. Au théâtre d’abord, avec Stanislawski et
Jacques Copeau, dont les méthodes ont été souvent reprises depuis, que ce soit par
Grotowski, l’Actor’s Studio ou le Living Theatre. Dans le domaine musical, ensuite, grâce au
jazz, bien sûr, mais aussi à l’utilisation de plus en plus fréquente de procédures aléatoires
par des compositeurs comme Boulez, Stockhausen, John Cage ou les techniciens de la
musique électro acoustique. Dans le domaine pictural, enfin, avec l’Action painting chère à
Jackson Pollock et à tout le mouvement expressionniste abstrait. » 1
L’improvisation vécue comme pleinement libre par le sujet qui l’expérimente, conduit à
l’acte spontané. Il faut donc s’y exercer. À la répétition d’une pièce préalablement écrite
correspond ici l’entraînement à une posture créative.
1
L'improvisation. Contribution à une philosophie de l'action
PAGE 3Le concept de spontanéité sera mis en avant et étudié dans l’œuvre du Dr Moreno et le
théâtre de la spontanéité en 1947. C'est à partir de l'idée d'une nature primordiale à retrouver
au-delà de « la croûte institutionnalisée » 2, qu'il eut ses intuitions sur la spontanéité. D’une
étonnante actualité, Moreno diagnostique le mal dont souffre la culture du XXème siècle :
la répétition de conserves culturelles, il accuse comme responsable de l'immobilisme « la
déficience de la spontanéité à se servir de l'intelligence disponible et à mobiliser les émotions
éclairées ». Dans le théâtre de la spontanéité, l'imagination créatrice devient libre parce que
libérée des obstacles personnels et sociaux : il s'agit d'exprimer ce que l'on porte en soi.
Moreno fait jouer ses personnages pour dépasser les préjugés sur soi-même.
Cette libération créative et spontanée s’exprime également en peinture avec le mouvement
de l’art brut prôné par l’artiste Jean Dubuffet dès 1948, notamment à travers l’expression
picturale d’Augustin Lesage, minier de profession et n’ayant jamais appris à peindre, qui se
mit à l’œuvre après avoir entendu une voix qui le missionnait de devenir peintre.
Dans les années 1950 au Brésil, la psychiatre Nise da Silveira, s’interroge sur les productions
de patients psychotiques graves. Elle entretiendra une correspondance avec Jung et sera une
pionnière de la thérapie par l'expression plastique spontanée. Elle fonde le Museu de
Imagens do Inconsciente à Rio de Janeiro : un centre de recherches pour conserver les œuvres
des patients, en tant que documents rendant compte de ces forces de cohésion de la psyché
qui s’expriment de façon inconscientes et spontanées.
Pourquoi s’intéresser au spontané ?
L’artiste contemporaine Fabienne Verdier s’exprime dans ce sens « c’est ce grand principe
qui anime toutes choses, la chaleur qui sort de la terre et pousse le minéral, les montées de
sève ou dans l’air les formations nuageuses ou l’eau et les songes, qui anime tout, par ce
souffle, le peintre transcrit ce qui anime l’âme, l’être que je suis, mon esprit. »3
Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à l’acte créateur. Si l’enfant est par essence
spontané, nous perdons cette faculté, nous dit Ken Robinson, expert de l’éducation de
renommée internationale.
« L’école doit changer pour s’adapter aux enfants d’aujourd’hui, afin de lui donner toutes les
chances d’être créatif, et non reproduire inlassablement. L’école doit donner cette
compétence aux enfants car ils vont arriver dans un monde où beaucoup sera à réinventer. »
( voir la video)
La perte de la spontanéité est proportionnelle à la formation de schémas de pensées et
conditionnements, autrement dit aux limitations du moi et de l’égo.
Sans la spontanéité, il ne peut y avoir connaissance de soi. Sans la connaissance de soi, écrit
également le sage Krishnamurti, l'esprit est façonné par les influences passagères. L’égo est
un assemblage. La spontanéité est la seule clé qui ouvre la porte de ce qui EST.
2
Raymond Jean-François. Le théâtre de la spontanéité (Moreno). In: L'Homme et la société, N. 29-
30, 1973. Analyse institutionelle et socioanalyse
3
Peindre l’instant - Collection documentaire Empreintes. Réalisation : Mark Kidel (France, 2012).
Diffusion le 1er février 2013 à 21h30 sur France 5.
PAGE 4Chercher en psychologie comment accompagner à désassembler le « moi », à toucher plus
en profondeur les arcanes de la personnalité et les conditionnements, furent des questions
qui m’amenèrent à créer les ateliers Mindful-Art.
Il s’agit de sortir de sa zone de confort, de ses croyances et de ses peurs en mettant l’accent
sur le geste spontané et une attitude de pleine conscience dans l’acte de création.
Autrement dit avec le philosophe C. Béthune, renouer avec l’enfance des temps où le geste
et l’intention cohabitent de manière inséparable : agir c’est s’exprimer, et réciproquement
toute expression est aussi une action
L’improvisation se fait « éloge de la fausse note » pour paraphraser Marc Vella, où
l’entrainement à la pleine conscience réaffirme les valeurs de bienveillance envers soi-même,
de non jugements, d’enthousiasme, de présence à soi et aux autres.
Ainsi, le défi de sortir des chemins connus, allié au cadre exigeant et sécurisant de la pleine
conscience, favorisent l’expérience du flow décrit par le psychologue Mihály
Csíkszentmihályi. Un état mental (de conscience modifiée) de grande concentration qui
privilégie la perte du sentiment de conscience du moi.
La spontanéité permettrait d’élargir les frontières du moi avec la disparition de l’ego.
Ce sont les chercheurs tels que Jean-Jacques Charbonnier qui apportent un éclairage
conceptuel scientifique en supposant l’existence d’une conscience intuitive extraneuronale
(CIE) qui ne s’active que lorsque notre conscience analytique cérébrale (CAE) diminue son
influence, comme c’est le cas dans la pratique des arts et de l’improvisation. Cette thèse a
été approuvée dans un travail de doctorat sur les EMI en 2014 du Dr Lallier qui a reçu la
mention très honorable avec félicitations du jury.
L’expérience des ateliers me permet de constater que l’entrainement à l’acte spontané, et
l’improvisation en pleine conscience, stimulent chez les participants un sentiment de
gratitude qui selon la psychologue Rebecca Shankland est une habileté exceptionnelle pour
promouvoir l’état de bien-être.
L’improvisation en groupe peut alors être vécue collectivement comme une célébration au
flux de la vie qui s’écoule et stimuler alors un sentiment de respect et de gratitude vis-à-vis
de Cela qui nous dépasse, de Cela qui nous meut, qui nous anime.
PAGE 5Et si avec Mario Beauregard nous nous engageons dans un saut quantique de la conscience4,
Il est tentant de croire, qu’aborder l’acte créatif avec une intention bienveillante et rendre
grâce à ce qui est donné (la nature, les valeurs de beauté, d’amour, d’harmonie etc…) ainsi
qu’au collectif qui partage l’expérience, pourraient bien dans le paradigme de l’effet non-
local de cette intention en action5, avoir des répercussions tangibles sur autrui et la nature.
Aussi nous posons la question : l’acte créateur spontané en conscience contribuerait-il à
vivre dans un monde de paix ?
Laetitia Veyron – Chartres, Novembre 2018
4
2017, Dr mario beauregard
5
la psychologue transpersonnelle Jeanne Achteberg, pionnière de l’utilisation de la visualisation dans
le processus de guérison, a conduit une étude d’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle
(IRMf) afin de mesurer ce qui se passe dans le cerveau de récepteurs lorsque des guérisseurs émettent
des intentions bénéfiques à leur endroit. Onze guérisseurs habitant à Hawai furent couplés à 11
récepteurs. Ces guérisseurs se réclamaient de diverses approches thérapeutiques et se trouvaient à
distance lorsque la scanographie fut réalisée. Les guérisseurs devaient émettre une intention de
connexion seulement lors de certaines périodes. Durant l'envoi de l'intention, une augmentation
significative du niveau d'oxygénation du sang reliée à l'activité neuronale a été notée dans différentes
régions du cerveau des récepteurs. Cela suggère qu'il est effectivement possible pour les guérisseurs
de se connecter avec des personnes éloignées, et d'influencer leur activité cérébrale. Extrait du livre
« Un saut quantique de la conscience. Pour se libérer enfin de l’idéologie matérialiste », par Mario
Beauregard, préfacé par Jean Staune, aux éditions Guy Trédaniel.
PAGE 6EXPLORER ET VALORISER L’IDENTITE FEMININE, ENTRE
CREATION ARTISTIQUE ET METHODE D’ACCOMPAGNEMENT
Fanny Dangelser est Artiste et coach thérapeute par les Arts. Elle a suivi – entre autres - une formation
à la thérapie transpersonnelle et propose aujourd’hui des stages intégrant la dimension du Féminin, des
Arts et de la Nature. Lors de la table-ronde du colloque, elle a partagé son cheminement personnel et
artistique sur le thème de l’identité féminine.
Au sujet de l’identité féminine
La question suivante est toujours fondamentale pour de nombreuses femmes : comment la
Femme, dans nos sociétés, peut être assujettie dans un rôle d’objet et comment elle peut se
réapproprier un rôle de sujet en devenant elle-même créatrice ?
Dans mon cheminement, la réponse à ce questionnement s’est opérée de deux manières.
D’une part en redonnant il y a quelques années (après une dizaine d’années en tant que
salariée sur un poste exigeant) une place importante à la création artistique et en exposant
mes travaux avec une dimension d’« art messager » portant les valeurs du Féminin (je précise
que je parle des valeurs du Féminin et non du féminin opposé au masculin, autrement dit
les valeurs féminines potentiellement vivantes en tout homme et toute femme).
D’autre part en créant des espaces d’accompagnement avec la photographie dans la Nature
lors desquels la personne (la femme généralement) va pouvoir revivre un lien fort à elle-
même et à son univers intérieur. Ce « travail » initialement démarré sur le plan artistique,
m’a amenée à créer et développer une méthode d’accompagnement de reconnexion à soi en
utilisant la photographie et les éléments de la nature. L’impact de l’image sur la confiance
en soi est assez impressionnant et a déjà été exploré avec les recherches autour de la
photothérapie, discipline pratiquée depuis les années 60.
En accompagnant des femmes avec cette méthode, je réalise combien travailler avec l’image
répare en profondeur l’estime de soi et la confiance en soi surtout pour les femmes blessées
dans leur féminin qui ont eu des mémoires d’abus, de violences. Ainsi, le travail avec la
photographie permet de se réparer en profondeur dans la confiance en soi et dans sa capacité
à se reconnecter à sa source créatrice. Cela permet aussi avec les personnes ayant déjà fait
un certain parcours intérieur d’aller explorer des zones encore plus enfouies et parfois même
en se connectant avec les végétaux de développer une prise de conscience accrue (comme
un voyage en état de conscience modifiée, pour guérir et réparer ce qui demandait à être
soigné dans le passé).
Très concrètement, la méthode consiste en un temps d’accompagnement verbal de coeur à
coeur prolongé par une expérience multi-sensorielle et plus silencieuse avec une fragrance
choisie spécifiquement pour la personne accompagnée. L’eau de plante parfumée que je
sélectionne en me « branchant » sur la personne agit au niveau émotionnel et vibratoire.
Elle va permettre aussi à celle-ci de s’ouvrir à tous ses sens et de vivre un bain sensoriel en
lien avec les éléments naturels. La personne va vivre ainsi un processus avec les éléments en
prenant appui sur eux, à l’écoute d’elle-même et va pouvoir reconnecter sa spontanéité ou
beauté naturelle. Tout en se sentant accompagnée, sécurisée par notre lien - dans la
PAGE 7distance qui sera la plus juste dans l’instant, en fonction des partages qui auront été faits
auparavant.
La photographie n’est en réalité qu’un outil utilisé pour fixer ces moments clés vécus par la
personne. Quelques jours après la séance, les photos sont envoyées et la personne va devenir
comme « témoin » de cette expérience vécue. Elle voit sa « beauté dans son naturel » ce qui
va nourrir quelque chose dans son intériorité et peut aussi débloquer des choses en elle. Ces
photos peuvent devenir par la suite une source d’inspiration et de méditation et agir comme
un temps précieux de reconnexion à soi lorsque le quotidien devient trop pesant.
Ma posture entre artiste et accompagnante
Durant l’accompagnement, je me situe ainsi entre la thérapeute, l’accompagnante et l’artiste.
En effet, en tant qu’« artiste », je saisis les images à des moments clés de la personne et
parfois même j’écris une poésie inspirée par ce qu’elle a vécu. Finalement, je pourrais dire
qu’il s’agit d’une sorte de co-création entre la personne accompagnée, la nature et les arts
qui va permettre de vivre ensemble une ambiance d’abord initiée dans les liens du coeur et
puis un temps de liberté exploratoire cristallisée ensuite dans la prise d’images. Il ne s’agit
pas de poses au sens classique de la photographie mais bien d’un accompagnement vivant
avec un juste dosage de présence et de discrétion. Ceci pour apporter d’une part sécurité,
soutien et confiance mais aussi suffisamment d’espace pour permettre le déploiement
nécessaire de ce qui aura besoin d’être vécu et transformé. Ainsi, à différents endroits, je suis
l’artiste qui va capter la beauté de ce qui se déroule sous mes yeux : d’abord dans le live de
la séance et ensuite dans la sélection des photos. Et je voyage dans la séance entre ces deux
postures qui me permettent d’offrir une proposition originale et unique et de témoigner par
la création de ce moment de reliance.
Cette méthode comme un processus arts et nature a émergé après avoir vécu une expérience
forte dans ma vie personnelle en lien avec la photographie. Ce processus m’a permis de me
réapproprier ma propre dimension créatrice. En faisant ce cheminement, j’ai également
travaillé sur l’identité de la femme qui depuis un statut figé se réapproprie une identité
vivante, créatrice et sort d’une forme d’emprise qui la conditionnerait dans un statut de
femme objet. Ce travail sur l’identité féminine s’est effectué aussi bien dans mon travail
artistique (avec différentes expositions liées au thème du Féminin et de la Nature) que dans
mon travail d’accompagnement développé ces dernières années. Après plusieurs années en
tant que salariée et une période d’épuisement importante, le lien à la Nature et le besoin
vital de m’y relier m’a amenée à développer une méthode d’accompagnement intégrant
notre lien à la nature et aux différentes saisons comme des résonances à l’intérieur de nous.
Ainsi prendre soin de soi et de sa Nature Féminine semble un des chemins possibles pour
prendre soin de la Nature et de notre chère Planète Terre.
Fanny Dangelser – Strasbourg, Novembre 2018
PAGE 8A LA RENCONTRE DU GUERISSEUR INTERIEUR BLESSE
A l’heure où nous publions ce cahier, Raphaël Lolli est reparti vers ce qu’il qualifiait de « plus grand que
[lui]». Nous retiendrons de son partage d’expérience que, dans une perspective écologique et
transpersonnelle, en faisant notamment confiance à cette transcendance, son accompagnement visait
à cultiver avec son interlocuteur, le lien mystérieux qu’il nous est proposé d’explorer. Cela, afin d’aider
la personne à trouver (ou retrouver) sa capacité d’agir dans son environnement qu’il soit humain, social
ou matériel. Mettre en œuvre une action aussi petite soit-elle qui favorisera son mieux être et son
intégration optimale au sein de cet environnement. Aider le développement de son « savoir-devenir ».
Psychopraticien certifié par la FF2P, Raphaël Lolli exerçait en cabinet et dans un foyer de vie auprès
d’adultes en situation de handicap mental.
Durant cette table ronde, partagée avec d’autres art thérapeutes, je me suis exprimé sur
« l’influence de mon chemin personnel sur mes pratiques via l’expression artistique, et
réciproquement ».
LE FIL CONDUCTEUR DE MON INTERVENTION : « A LA RENCONTRE DU GUERISSEUR
BLESSE INTERIEUR »
IL M’A ETE INSPIRE PAR UN DE MES PATIENTS, QUI ALORS QUE JE LUI POSAIS LA
QUESTION : « QUI JE SUIS POUR TOI ? », M’A REPONDU TOUT NATURELLEMENT... «
UN GUERISSEUR ! BIEN SUR ! »6
Argument : C’est en partant de la blessure héritée de ma petite enfance et repérée au fur
et à mesure de mon chemin thérapeutique, que j’ai pu faire lien avec mon intérêt immense
pour l’art en général et la musique en particulier, et l’utilisation que je pouvais en faire dans
l’accompagnement thérapeutique des personnes dont j’ai eu la charge dans diverses
situations (Institutionnelle et Libéral). Je pourrais qualifier cette blessure d’Exil ou de
Déracinement.
Ainsi, l’objet de mon intervention est : « Comment ma pratique artistique m’a permis de
guérir mes blessures » et « comment je m’en sers pour accompagner en tant que
psychopraticien »
Je pratique la psychothérapie intégrative. A ce titre, les visions « personnelle » et
transpersonnelle » de l’existence ne sont bien sûr pas incompatibles, mais apportent deux
éclairages complémentaires, voire dans beaucoup de cas, similaires, mais simplement
explicités avec des mots différents…
6
Cette réponse d’un de mes patients fait écho à ces 2 notions jungiennes que sont :
- « Le guérisseur blessé » d’une part
- « Le guérisseur intérieur » d’autre part
Deux notions qui me sont précieuses dans ma posture d’accompagnant thérapeute. On trouvera en
annexe une synthèse glanée sur le Web qui m’apparait très explicite de la notion de « guérisseur
blessé ».
PAGE 9Le texte ci-dessous s’articule en quatre temps plus ou moins entre-mêlés.
- Dans un premier temps, il se compose de quelques éléments autobiographiques
- Dans un second temps, il décrit notre condition d’humain face au phénomène sonore,
en empruntant quelques éléments de l’approche psychologique « personnelle »
- Dans un troisième temps, il se poursuit d’une part, en pointant deux points de vue
sur le processus développé en Art thérapie illustré par un atelier animé auprès de
personnes SDF et apporte quelques éléments d’une vision plus
« transpersonnelle »
- Il se termine par une mini conclusion d’étape de là-où-j’en-suis-actuellement aussi
bien dans ma perception des phénomènes sensibles (sonores et musicaux, mais pas
que…) et dans ma posture thérapeutique.
1- Quelques éléments d’autobiographie
L’immigration familiale (père, mère et moi) d’Italie en France, au début des années 60, alors
que j’avais à peine 3 ans … à une époque où la famille élargie (parents, mais surtout grands-
parents, une multitude d’oncles, de tantes et de voisins) était mon environnement de base,
a provoqué chez moi comme une sorte d’exil, doublé d’un déracinement. Un mini
tremblement de terre…
J’étais alors « assez grand » pour être conscient de ce qui se déroulait et pourtant « trop
petit » pour pouvoir assimiler le changement de situation… ainsi, ce grand chambardement
« non accompagné » (ou plus exactement accompagné du mieux que mes parents le
pouvaient), m’a plongé dans une sorte de stress qu’il m’était très difficile de gérer (maîtriser-
contrôler) …
Ainsi, à notre arrivée en France, j’ai été longtemps perçu et me suis moi-même ressenti
comme le vilain petit canard… qui « faisait-des-caprices ». Ma mère d’ailleurs complètement
dépassée, s’en plaignant à qui voulait bien l’entendre… mais, à ma connaissance, personne
ne nous a jamais proposé d’aller voir un accompagnant parent-enfant pour mettre un peu
d’huile dans les rouages…
Bref, ces troubles du comportement (quelques fois assez explosifs) étaient sans doute les
effets du déracinement… mais que personne ne m’a aidé à « digérer » à ce moment-là.
Longtemps plus tard, j’ai compris que ce déracinement avait plongé « le petit être » que
j’étais dans un univers inconnu source d’angoisse, mais aussi, et c’est ce qui m’a sauvé car
étant d’un tempérament explorateur, source d’exploration…
Et pour le propos qui nous occupe aujourd’hui, cet univers, qui était mon nouvel
environnement social était un bain sonore somme toute assez différent de celui que j’avais
connu durant les premières années de mon existence.
En effet, même si les langues italienne et française sont des langues latines toutes deux ;
l’ambiance sonore de la banlieue parisienne et celle d’une petite ville de province d’Italie
Centrale restent intrinsèquement différentes. Ni meilleure ni moins bonne, mais
simplement différente… D’autant plus qu’en Italie, nous ne parlions pas la langue «
nationale », mais un dialecte. C’est ce bain « dialectal » qui formait ma tribu sonore
d’origine.
PAGE 102- La vision « personnelle » en psychologie universitaire
Au premier abord, en psychologie classique, on parlerait volontiers d’enveloppe sonore,
pour évaluer la maturation psychique de l’enfant au regard de son environnement sonore.
Mais les choses sont bien plus complexes que cette simple enveloppe sonore.
En effet, le petit enfant pour se construire et se différencier par rapport à son
environnement en général, et sonore en particulier, passera par diverses étapes décrites
plus avant.
Durant mes études de psychologie à l’Université, les divers évènements cités ci-dessus
m’ont rendu très rapidement sympathique Françoise Dolto. Même si je me suis orienté
ensuite vers la Psychologie Sociale qui traite, comme son nom l’indique, des interactions
entre l’individu et son environnement. J’étais à la recherche de comprendre ce qui n’avait
pas bien fonctionné à l’époque…
Mais tout d’abord, je souhaite remettre en perspective la maturation du moi du petit enfant
au regard de son environnement sonore.
Notre condition d’humain fait que nous sommes, chacun d’entre nous, d’emblée plongés
dans un bain sonore (les sons arrivant de toute part). Et cela, que ce soit dans la matrice 7,
ou une fois que nous en sommes sortis… Aussi, dès la naissance, nous allons
progressivement élaborer une enveloppe psychique pour notamment reconnaitre et nous
protéger de trop de stimulations sonores.
La nature de cette enveloppe est double. C’est une enveloppe « musico-verbale ».8
- D’une part elle est « musicale » au sens très large du terme, elle englobe ainsi, les
musiques « socialement » reconnues par notre environnement d’origine, mais aussi
et plus largement tous les sons produits par ce même environnement et plus
subtilement la musique même des sons utilisés par notre langue maternelle. La
musique des mots.
- D’autre part elle est « verbale ». Car au fur et à mesure de l’évolution de l’enfant,
chaque son émis par ses congénères va être associé peu ou prou à une signification
particulière. Au début de la vie, l’enfant va émettre toute sorte de sons (babillages…)
qui pour certains d’entre eux seront valorisés, car faisant partie de la gamme de ceux
utilisés dans sa langue dite « maternelle » et pour d’autres seront pour le moins
relégués au second plan voir même dévalorisés… c’est ce processus de base qui va
initier chez l’enfant l’entrée ultérieure dans le langage9.
7
Suzanne Maiello, À l'aube de la vie psychique : réflexions autour de l'objet sonore et de la
dimension spatio-temporelle de la vie prénatale. In Réminiscences : entre mémoire et oubli… 2010.
Suzanne Maiello. L'objet sonore. Hypothèse d'une mémoire auditive prénatale. In Journal de la
Psychanalyse de l'Enfant, n° 20 - 1997
8
Edith Lecourt, l’enveloppe musicale. In « les enveloppes psychiques ». Dunod 2013.
9
Alain Delbe, Le stade vocal. L’Harmattan 1995.
PAGE 11Mon enveloppe Musico-verbale comme on peut s’en douter, vu les quelques éléments
biographiques cités ci-dessus, a été mise à rude épreuve dans un premier temps. Et qui par
la suite… bon an, mal an par la force des choses et des évènements, s’en est trouvée
assouplie…
Je passe sur les évènements de mon enfance, de mon adolescence, de jeune adulte et un peu
moins jeune… jusque vers la quarantaine où j’étudie l’art thérapie et plus spécialement la
musicothérapie.
3- Mon approche et ma pratique de l’art thérapie
L’art est de mon point de vue d’essence transpersonnelle. Mais il peut être pratiqué en
tant qu’artiste et en tant qu’art thérapeute, dans une vision « personnelle » et/ou
« transpersonnelle ».
Je souhaite décrire ici ma pratique de l’art thérapie comme métaphores :
- D’un espace de rencontre de deux esthétiques 10 (celle du client-patient et celle du
thérapeute). Ces rencontres peuvent donner naissance à des moments de grâce, pourvu
que l'art thérapeute accueille l'autre dans son unicité et au plus proche de sa totalité du
moment.
- D’un processus de recyclage (peu ou prou assimilable au processus alchimique) de
l’existant « psychique » des personnes auprès de qui j’interviens.
L'objectif, durant mes interventions est de créer un espace de jeu et d'échange11. Espace
virtuel symbolisant à la fois ma volonté de rejoindre avec tout mon être la personne là où
elle est tout en me laissant rejoindre et toucher par elle.
Pour illustrer ces métaphores je vous vous parlerai de l’animation d’un atelier de « collage
musical » auprès de personnes SDF et/ou isolées et en rupture de projet de vie.
A/ L'art thérapie comme espace de rencontre de 2 esthétiques
La pratique de l’art thérapie donne naissance à des formes dans le monde concret, même si
ces formes, notamment dans le cas du sonore restent très « subtiles ». On peut dire par
exemple qu’un son prononcé et par extension une musique, sculpte l’air ambiant... Laissant
une trace subtile mais néanmoins tangible qui peut perdurer sous la forme d'enregistrement
plus spécifiquement.
10
Cette perspective m’a été confiée par Pascal Comeau. Un des mes référents de stage pratique de
Musico-thérapie à Montréal durant l’été 2001. J’ai réalisé ce stage dans le cadre du DU d’Art
Thérapie de l’Université Paris V en 2000-2001.
11
On retrouve ici la notion d’espace transitionnel winnicottien
PAGE 12La notion de forme fait écho à celle d’esthétique... la forme pourra ainsi être « belle » ou
non, plaire ou non à l’un et à l’autre des intervenants (thérapeute & client/patient) en
fonction de leur perception, histoire de vie, etc... En dernière analyse, une séance d’art
thérapie consistera en la rencontre d’au moins deux esthétiques, celle du thérapeute et celle
du (des) client/patient(s).
A priori, le thérapeute (en tant que « recycleur » de l’existant), se doit de trouver toujours
« belle » « valable", "valide » et "pleine de sens" l’œuvre réalisée par son accompagné.
Ici, les choses étaient différentes, puisque c’est moi-même qui avait élaboré le collage
musical, il est vrai, à partir de musiques « choisies-imposées » par les participants. Voir ci-
dessous le processus détaillé d’élaboration du collage musical 12.
Je pense avoir adopté ici une position du Shaman qui réalise avec l’autre, pour l’autre et en
présence de l'autre, un outil de guérison personnel et spécifique à chacun.
On peut assimiler ces Rencontres "Esthétiques" à des « Moments de Grâce »
- Des moments de grâce que j’ai moi-même vécus lors du processus d’élaboration des
collages musicaux, seul devant ma table de mixage... afin d'élaborer l'objet le plus
abouti... comme le cuisinier devant ses fourneaux qui élabore le plat « le meilleur » ...
- Des moments de grâce vécus lors des rencontres avec les personnes elles-mêmes
notamment lors de la présentation "personnelle" de leur collage musical à chaque
personne en atelier collectif. Je dois dire que chaque participant était heureux de
recevoir ce miroir musical et fier ensuite de l'exposer au sein de l'Institution.
Le collage sonore comme "talisman"… véritable caillou "magique" 13…
B/ L'art thérapie comme processus de
recyclage de l’existant
J’ai donc pu animer il y quelques années
un atelier de « collage musical » dans un
Centre d’Accueil de Jour pour personnes
SDF.
12
Un exemple de collage musical et de la maison correspondante accompagne le présent texte.
13
NDLR : Clin d’oeil à une scène de Prendimi l’Anima, de Roberto Faenza, durant laquelle Carl G.
Jung donne à sa patiente Sabina Spielrein un caillou, qui renfermerait son âme, pour qu’elle en soit
la gardienne
PAGE 13L’objectif de cet atelier était de proposer à des participant d'un atelier d’art plastique en
cours au sein du Centre d’Accueil une collaboration pour créer ensemble (à deux, chaque
participant et moi) un « collage sonore » illustrant au plus près l’objet qu’ils étaient en train
de créer. Cet objet était « une maison » dont vous trouverez une photo ci-jointe.
Ces diverses maisons, réalisées avec du matériel neuf, mais aussi recyclé, devaient à terme
constituer un village qui serait présenté lors d'une exposition temporaire dans les locaux du
Centre.
Le processus d’élaboration d’un collage musical suit les 7 étapes ci-dessous :
a- Echanges d’idées avec le(s) participant(s) lors d'un atelier collectif
b- Sélection par mes soins de musiques dans mon « laboratoire »
c- Proposition de ces musiques (environ une quinzaine) à chaque participant lors d'un
atelier collectif.
d- Recueil des choix de musiques (environ 6 ou 7) durant le même atelier
e- Elaboration des collages dans mon « laboratoire ».
f- Présentation personnelle et en groupe des collages et modification si besoin (il n'y
en eu pratiquement aucune).
g- Révélation à la communauté (Institution) – l’Individu se retrouve dans le Collectif.
Présentation sous la forme d'un Village. Chaque Maison était illustrée avec sa
musique respective.
Le processus mis en œuvre dans cet atelier, pourrait être vu comme une illustration de la
notion de 1er & 2ème « miracles » développée par Richard Moss14
1- Les participants sont invités à choisir quelques musiques illustrant les idées et
valeurs concernant leur maison ou comment ils se la représentent. Invitation à
explorer leur position de sujet. Invitation à extraire quelques musiques d'un
amas... ce qui leur permet d'explorer leur enveloppe musico-verbale. Repérer
ce qu'ils estiment être eux et ce qu'ils ne sont pas et qui ne fait pas sens...
2- Ils se reconnaissent comme en écho (lors d’une unité spatio-temporelle «
momentanée") dans le collage sonore que j'ai soigneusement élaboré en contact
étroit avec chacun d'eux... Soutien et renforcement de leur position de sujet.
3- Et se retrouve enfin connectés aux autres membres de la Collectivité, à l'image de
chacune de leur maison au sein du Village). Sujet dans un groupe de Sujets,
chacun ayant trouvé sa place unique. Unis dans la diversité et non plus dans
la fusion.
Ce processus, peut aussi être lu comme un recyclage de l’existant assimilable au processus
alchimique15. La matière première étant les musiques proposées et la pierre philosophale
le collage sonore résultant, véritable mandala sonore. Celui-ci fixé à un instant-t, mais
restant toujours en devenir et propre à chaque participant de l’atelier...
14
Voir entre autres Richard Moss. Le deuxième miracle. Le Souffle d’Or. 1997
15
Je laisse à la sagacité du lecteur ou de la lectrice qui le souhaite, le soin de continuer plus avant le
repérage des correspondances… mais je serais néanmoins enchanté de partager avec elle ou lui le
fruit de ses réflexions. Pour cela, on peut me joindre à l’adresse mail suivante : lolli.psy@gmail.com
PAGE 144- Conclusion provisoire
En conclusion, je dirais que mes pratiques artistiques (écoute musicale, chant spontanés,
collage musical, danse libre, danse primitive, kinésiophonie, etc...) conscientes, m’ont
permis de passer progressivement d’une vie réactive à une vie plus créative.
J’ai pu ainsi au fil du temps sublimer cette blessure et grâce à elle vivre quelques beaux
moments de grâce. Vécus aussi bien lors de ma pratique artistique que lors
d’accompagnements thérapeutiques en collectifs et en individuel (écoute musicale, chant
spontané, improvisation instrumentale avec des diverses percussions telles que tambour
amérindien, djembé, etc…).
Ma pratique d’art thérapeute m’a encouragé, soutenu et autorisé à bien des égards (et
notamment à l’encontre de mes propres idées reçues qu’écouter de la musique et son
environnement sonore n’était pas un art16) à développer ma pratique artistique...
… et une Vie plus créative, dans laquelle je tente du mieux que je peux :
• D'une part, de m'accueillir au mieux, m'acceptant comme je suis dans ma forme (et
mes formes) du moment
• D'autre part, d'être pour moi même dans le présent, le recycleur inlassable des
scories du passé afin qu'elles soient le terreau dans lequel "Je" en lien avec les autres
renait à chaque instant.
Je ne me ressens plus maintenant un Exilé, car j’ai pu grâce à l’art et à un solide
accompagnement psychothérapeutique (en grande partie art thérapie ou/et à médiations),
prendre racines… je me vis actuellement comme un Artisan des sons, des formes, des
couleurs, des odeurs etc....
L’Artisan est la forme qui incarne mon « Guérisseur Intérieur » … J’invite ceux de mes
patients qui le souhaitent à se laisser guider pour en faire autant…
Pour clore cette présentation, je vous confie un extrait du texte de la chanson de Michel
Berger : « Je veux chanter pour ceux... » (cf. ci-dessous) qui illustre au plus près, à mon goût
le parcours que j’ai effectué grâce à ma blessure et qui explique en partie la posture de
thérapeute transpersonnel à laquelle je me suis identifié et qui reste le modèle d’intervenant
en thérapie...
Raphaël Lolli – Art thérapeute , en ce jour de la fête des morts, le 2 novembre 2018.
16
J’ai pu développer, comme tout un chacun qui s’intéresse à un domaine particulier, un art de
l’écoute musicale. Art qui m’accompagne dans d’autres sphères de ma vie qu’elles soient
personnelles ou professionnelles.
PAGE 15Annexe :
Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux (Michel Berger )
« Celui-là passe toute la nuit
À regarder les étoiles
En pensant qu'au bout du monde
Y a quelqu'un qui pense à lui
Et cette petite fille qui joue
Qui ne veut plus jamais sourire
Et qui voit son père partout
Qui s'est construit un empire
Où qu'ils aillent
Ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent
Ils sont seuls dans leur tête
Je veux chanter pour ceux
Qui sont loin de chez eux
Et qui ont dans leurs yeux
Quelque chose qui fait mal, qui fait mal
Je veux chanter pour ceux
Qu'on oublie peu à peu
Et qui gardent au fond d'eux
Quelque chose qui fait mal, qui fait mal »
PAGE 16ENTRE ART ET THERAPIE, UNE ODYSSEE TRANSPERSONNELLE
Muriel Rojas-Zamudio est psychanalyste, praticienne en médiations artistiques et art-thérapeute. Après
des études universitaires en Arts du spectacle puis une année préparatoire aux Beaux-Arts, elle s’est
orientée vers la psychanalyse ; une référence en appelant une autre, elle a cheminé jusqu’au
transpersonnel. Coordinatrice des premières journées d’étude du CFPT, elle reprend et développe dans
l’article qui suit les thèmes abordés durant son intervention à la table ronde traitant du guérisseur blessé.
« Tout ce que je veux dire est dans les accords et les
mélodies. Les mots les accompagnent. Ça a toujours été
mon moyen d’exprimer ce qu’il m’est impossible d’exprimer
autrement » David Bowie
Comment mettre en relief l’ouverture vers le transpersonnel en
témoignant d’un parcours personnel sans pour autant
« raconter sa vie » ? Tel est le défi que je me propose de relever
ici, en exposant mon bricolage singulier fait d’art et de thérapie,
après avoir dressé un panorama du recours à l’art dans le cadre
thérapeutique général et transpersonnel.
Catharsis, médiation, espace d’émergence du sujet ou louange ?
D’une manière générale, les médiums artistiques peuvent devenir, dans le cadre d’un
accompagnement thérapeutique, le support de différentes démarches :
- la catharsis
- la médiation
- l’émergence du sujet
- la louange
La catharsis est un terme que l’on trouve aux origines du théâtre grec antique. Sa visée est
alors morale puisqu’il s’agit de représenter les conséquences des passions humaines ; parce
qu’elles seraient motivées par un orgueil démesuré 17 , les actions mises en scène
engendreraient le courroux des dieux et de redoutables sanctions. Repris par la psychanalyse,
le concept de catharsis deviendra au fil du temps une libération émotionnelle d’éléments
refoulés. Lorsqu’elle passe par une expression artistique (arts plastiques, corporels,
musicaux…etc), le but n’est pas d’exprimer une idée ou un désir mais de soulager la tension
qui en découle.
La médiation est la réalité que recouvre la plupart des pratiques actuelles dites d’art-thérapie,
tant celles d’inspiration jungienne que cognitivo-comportementale. Elle utilise les
productions artistiques (peintures, textes, modelage, chorégraphies…etc) comme des
matériaux, participant plus ou moins activement à un processus de transmutation du contenu
psychique identifié lors de l’interprétation des symboles/formes représenté(e)s.
17 Appelé Hubris chez les grecs
PAGE 17Dans le cas d’une approche de type jungienne, le thérapeute parlera d’un dialogue alchimique
avec l’âme, dans le cas d’une lecture cognitivo-comportementale, d’une correction de
distorsions cognitives. L’une des spécificités de la médiation, en particulier dans le contexte
d’activités groupales, est d’intégrer dans le travail – et dans son évaluation - les différents
plans intersubjectifs18 .
L’émergence du Sujet renvoie pour sa part à la capacité à exprimer sa parole – et non le
discours de l’Autre19– l’objectif étant de créer un espace d’émergence et/ou de vérité du « Sujet
de l’inconscient » (Lacan) ou du « témoin silencieux » (Wilber), c’est-à-dire ce qui est au-
delà/au-dessus/derrière le Moi. Le recours à des expressions non-verbales, de préférence
vouées à l’éphémère20, permettraient de replacer le sujet accompagné dans le présent et dans
sa créativité. Que la philosophie qui sous-tend cette posture soit de type existentialiste (ex.
Lacan) ou zen (ex. Wilber), nous notons qu’elles visent, chacune à leur manière, une forme
d’assouplissement – voire de dépassement ? - de l’identification au Moi.
La louange est le terme que nous proposons pour qualifier les pratiques – typiques, selon
nous, de nombreuses thérapies transpersonnelles - basées sur l’orientation d’expressions
artistiques vers la célébration ou l’invocation du sublime/du divin. Il peut s’agir de la création
d’œuvres prises comme symboles (ou images archétypales) ou offrandes (modèle de l’ascèse
spirituelle ou religieuse). Il ne s’agit plus ici de décharger une tension, ni de révéler puis
corriger une problématique ou s’affranchir de nos conditionnements, mais de rendre
hommage à la vie, telle qu’elle nous traverse et nous englobe.
Nous remarquons une progression dans ce panorama, des formes d’accompagnements les
plus archaïques aux plus spirituelles. Si les centres de formations en préconisent
généralement des formes pures, l’observation du terrain dessine une cartographie plus
métissée, à travers laquelle se racontent l’histoire et la mythologie personnelles de chaque
thérapeute 21 . Puisque la table ronde de cette deuxième journée d’étude met en avant ce
phénomène, le moment est venu de partager avec vous les références et pratiques que
j’emprunte pour donner sens à mon incarnation, dans ses multiples dimensions.
Comment je suis passée du bon côté du bureau en évitant la case HP22
D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu comprendre. Le plus beau jour de cette
vie restera celui où enfin j'ai appris à lire, accédant de mon point de vue de fillette au savoir
infini. Un espace vertigineux où je me sentais chez moi, à ma place, libérée de mon incapacité
à me sentir proche d'un autre être humain. Une bulle spatiotemporelle où je n'étais jamais
seule et où l'on ne me jugeait pas. Quand les autres élèves voulaient être pompier, institutrice
ou encore fonder une famille, je n'avais qu'une certitude : je voulais explorer ce qu'il y a dans
notre tête – je ne connaissais pas encore le concept de conscience – parce que rien ne me
semblait plus fascinant au monde que cet inconnu- là.
18 Thérapeute-groupe, thérapeute-individus, individu-groupe et individu-individu
19 Terme lacanien, en lien avec sa théorie du stade du miroir, qui postule que nos discours témoignent
plus d’un conditionnement à une norme extérieure (sociale, culturelle, familiale) que d’une
authentique subjectivité
20 En France cette approche est développée par Jean-Pierre Royol et son équipe au sein de l’institut
agréé PROFAC
21 Au-delà d’un choix technique ou méthodologique déterminé par le profil et la problématique à
accompagner
22 HP pour hôpital psychiatrique
PAGE 18Vous pouvez aussi lire