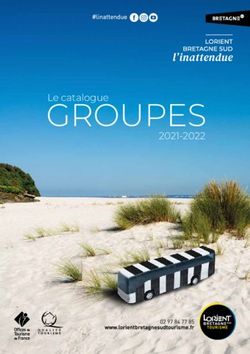COLLOQUE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME ET L'ILLECTRONISME : DU CONSTAT À L'ACTION - SYNTHÈSE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
COLLOQUE
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
ET L’ILLECTRONISME :
DU CONSTAT À L’ACTION
SYNTHÈSE
27 septembre 2018
Hôtel de lassay, assemblée nationaleSOMMAIRE
Allocution d’accueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
béatrice PiRon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
sylvie RoGeR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table ronde n°1 : acquérir les compétences clés en entreprise . . . . . . . . . . . . . . 11
laurence maRtin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Les publics en situation d’illettrisme dans la loi du 5 septembre 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Cécile RilHaC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
michel FeRReiRa-maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
david maRGUeRitte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Valérie soRt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
L’accompagnement des publics en situation d’illettrisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
laurence bReton-KUeny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Certificat de connaissances et de compétences professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Échanges avec la salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Séquence « Grands témoins » : #STopiLLeTTriSme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
samira dJoUadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
selma aKoVa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kartoum niaGate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
aïda belaRibi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table ronde n°2 : accéder aux savoirs de base dans les territoires . . . . . . . . . . . 23
Jeanne FontaGneRes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Témoignage d’une communauté d’agglomérations : Grand paris Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
marie-line PiCHeRy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Philippe Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Témoignage d’un département : le pas-de-Calais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
blandine dRain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
politique publique d’intégration des étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
agnès ReineR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Échanges avec la salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Une initiative associative informelle : B.A.BA TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
stéphane GaUltieR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Séquence « Grands témoins » : les Ateliers de pédagogie personnalisée. . . . . . 33
marie boUCon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fanta yeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kadidiatou tRaoRe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
asta diaby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Discours de clôture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
thierry lePaon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sigles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Album photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3ALLOCUTION D’ACCUEIL
Béatrice PIRON
Députée de la République de la 3e circonscription des Yvelines, et Présidente du
groupe d’études « illettrisme » de l’Assemblée nationale
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au colloque « lutte contre l’illettrisme
et l’illectronisme : du constat à l’action », que j’ai l’honneur d’organiser en cet Hôtel
de lassay, résidence du Président de l’assemblée nationale. Je remercie
chaleureusement m. Richard Ferrand de nous accueillir en ces lieux ; son haut
patronage désigne bien la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme comme une cause
intéressant l’ensemble de la représentation nationale. Je tiens également à remercier
m. thierry lepaon, délégué interministériel à la langue française pour la cohésion
sociale, dont je connais l’engagement dans la lutte contre l’illettrisme, engagement
qui découle de son parcours, d’ouvrier puis de syndicaliste. il est depuis plusieurs
mois l’un des fers de lance de cette lutte. Je remercie aussi tous les intervenants qui
aujourd’hui partageront leurs expertises et leurs témoignages, et qui tous sont des
référents dans leur domaine. enfin, je vous remercie tous d’être présents à ce
colloque : votre présence à chacun témoigne de l’intérêt de cette cause.
5ALLOCUTION D’ACCUEIL
nous allons donc ce matin échanger de bonnes pratiques, et débattre des conditions
nécessaires pour vaincre l’illettrisme et l’illectronisme. Je vous accueille aujourd’hui
en ma qualité de présidente du groupe d’études « illettrisme » de l’assemblée
nationale, groupe qui sera prochainement renommé « illettrisme et illectronisme » :
en effet, l’illectronisme, problématique plus récente, a été évoqué dans le cadre de
presque toutes nos auditions.
Je fais partie des députés nouvellement élus, issus de la société civile. J’étais
auparavant Cheffe d’entreprise dans le domaine du service à la personne, spécialisée
dans le maintien à domicile, vie professionnelle durant laquelle j’ai été confrontée,
comme beaucoup d’entre vous, à l’illettrisme. nous connaissons tous les mécanismes
d’évitement mis en œuvre par les personnes en situation d’illettrisme (oubli des
lunettes, manque de temps), qui souvent rendent difficile la détection du problème.
on peut aussi aisément sous-estimer l’impact sur les compétences de base d’une
absence de pratique régulière, le désapprentissage. il m’est arrivé en tant que
Cheffe d’entreprise de proposer à certains salariés de se former, et souvent ce projet
n’a pas abouti, soit par manque de financement, soit par absence d’offres de
formation, soit par refus du salarié. on peut invoquer le tabou, le déni, le refus
d’évoluer, et dorénavant aussi le refus d’utiliser les outils numériques. Pourtant, ces
difficultés ont des répercussions importantes dans la vie professionnelle des intéressés,
dans leur vie personnelle, voire dans la vie de leurs enfants. si je n’ai pas fermé les
yeux sur cette question, c’est sans doute pour avoir vécu une situation similaire : j’ai
résidé quatre ans au Japon, et je sais à quel point il peut être difficile d’apprendre à
lire et à écrire. J’ai réussi à acquérir quelques bases, au bout de plusieurs années
d’efforts ; mais je peux aussi témoigner du fait qu’après 20 ans sans pratique, je serais
aujourd’hui incapable d’écrire ne serait-ce que mon nom ou mon prénom en japonais.
nous savons tous que la lecture, l’écriture, et désormais l’usage du numérique,
sont des vecteurs d’intégration, de citoyenneté et de cohésion. la
dématérialisation administrative qui est en cours, et qui va en s’amplifiant, éloigne les
personnes en situation d’illettrisme ou d’illectronisme du monde du travail, mais aussi
des services publics, et ces personnes ont de plus en plus de mal à faire valoir leurs
droits. l’illettrisme et l’illectronisme sont des freins à l’émancipation des individus, et
il faut éviter que ces difficultés ne se transmettent de génération en génération. Ces
inégalités de naissance, et les vulnérabilités qui en découlent, affectent le rapport des
individus aux autres et à la société : une personne qui a des difficultés à lire ou à parler
français peut se sentir exclue, voire s’exclure elle-même de la société. or on estime
qu’il y a en France environ six millions de personnes éprouvant des difficultés à
déchiffrer et à comprendre des consignes écrites, dont 2,5 millions ayant été
scolarisées en France – ce critère étant celui aujourd’hui retenu pour définir l’illettrisme
stricto sensu. Cette situation est évidemment inadmissible à l’heure où nous
6portons la promesse d’une société des compétences émancipatrices, où chaque
individu doit avoir ses chances, quelles que soient son origine sociale et ses fragilités.
il y a donc plus de deux millions de Français qui ont été scolarisés en France, et qui
ne maîtrisent pas ou plus la lecture et l’écriture. mais il y a aussi de très nombreuses
personnes, parfaitement intégrées, vivant en France parfois depuis plus d’une dizaine
d’années, qui sont arrivées sur notre sol à l’âge adulte pour travailler après avoir été
scolarisées à l’étranger, notamment dans les pays européens voisins – et qui ne sont
donc pas analphabètes, savent très souvent parler le français, mais qui pourtant ne
maîtrisent pas la lecture ou l’écriture de notre langue. doit-on les considérer
différemment des premiers ?
les métiers évoluent et se numérisent, les entreprises ont changé. Quelle que soit
l’activité, la lecture est de plus en plus une compétence sine qua non de l’accès à
l’emploi. il existe bien actuellement dans les procédures d’immigration des processus
d’accompagnement des nouveaux arrivants dans l’apprentissage de la langue
française et des compétences de base. Cependant, ces processus ne portent que sur
le « flux » des arrivants : le « stock » n’est pas comptabilisé, et ces personnes, qui
souvent sont déjà en emploi, sont oubliées. en plus, les dispositifs destinés aux
étrangers extracommunautaires ne sont pas ouverts aux ressortissants européens. la
réalité est là : les difficultés rencontrées par ces personnes, surtout à l’écrit, les
enferment dans des métiers faiblement qualifiés, et parfois dans des situations de
grande précarité. enfin, il faut tenir compte de cette nouvelle problématique de
l’illectronisme. Pour revenir aux enjeux de la définition, très restrictive, je dirai qu’elle
est un frein à la bonne compréhension des difficultés que notre société va rencontrer.
elle ne permet pas non plus de mettre en œuvre la solution adaptée à l’ampleur du
problème. au sein de notre groupe d’études, nous avons donc réalisé diverses
auditions, afin d’évaluer les politiques actuellement mises en œuvre. notre objectif
est d’établir un diagnostic précis, et de dresser un état des lieux des dispositifs de
prévention et de lutte contre l’illettrisme. la première de nos auditions, consacrée à
l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (anlCi), nous a permis de mieux cerner
la problématique, et aussi d’en finir avec quelques idées reçues. aujourd’hui, les
parlementaires et le gouvernement tentent d’agir très concrètement contre
l’illettrisme. nous allons identifier les étapes clés dans le parcours des individus, de
sorte à pouvoir créer des sas de repérage et de remédiation. C’est d’ailleurs pourquoi
la scolarité a été rendue obligatoire dès l’âge de trois ans, et que les classes de CP et
de Ce1 ont été dédoublées en réseaux d’éducation prioritaire. dans un deuxième
temps, nous souhaitons améliorer la détection de l’illettrisme en instaurant un rendez-
vous incontournable permettant d’évaluer toute une tranche d’âge : c’est là l’un des
objectifs du service national universel (snU). enfin, nous avons voté cet été la loi
7ALLOCUTION D’ACCUEIL
pour la liberté de choisir son avenir professionnel1, qui a pour objectif de sécuriser
le parcours professionnel des adultes par l’accès à la formation tout au long de la
vie. dans cette loi, à l’article 15, nous avons réussi à mentionner explicitement les
personnes en situation d’illettrisme parmi les publics prioritaires. nous avions par
ailleurs tenté d’obtenir un rapport des Régions sur leurs actions en matière de lutte
contre l’illettrisme, laquelle est en effet une compétence régionale, afin de pouvoir
travailler à la réduction des inégalités territoriales. la part des personnes en situation
d’illettrisme est en effet très variable : elle est de 7 % au niveau national, mais elle
peut aller selon les départements de 4 % jusqu’à 75 % à mayotte. malheureusement,
le Conseil constitutionnel a invalidé cet amendement, qu’il a considéré comme étant
un « cavalier législatif »2. Cependant, les parlementaires poursuivront leurs efforts en
ce sens : il s’agit de rénover notre modèle de société, de créer la société des
compétences de demain, afin que tout individu soit enfin libre de mobiliser ses
compétences et d’en acquérir tout au long de son parcours.
la première table ronde, consacrée aux compétences clés et à la formation
professionnelle, évoquera les avancées acquises à travers la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel et le Plan d’investissement dans les compétences
(PiC). la première séquence dite « Grands témoins » sera dédiée au réseau
#stoPillettRisme. la seconde table ronde abordera la question de l’accès aux
savoirs fondamentaux dans les territoires, avec pour conclure la présentation d’un
projet d’apprentissage innovant, b.a.ba tV. la seconde séquence « Grands témoins
» sera une présentation du dispositif des ateliers de pédagogie personnalisée (aPP).
enfin, m. thierry lepaon conclura nos travaux.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne matinée à toutes
et tous.
1 - Cette loi a été publiée au Journal officiel le 5 septembre 2018 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A9848F3377DB27AB7ABB21ED469560E.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
367660&categorieLien=id.
2 - Un « cavalier législatif » est un article de loi qui introduit des dispositions n’ayant rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi – manière
parfois de faire passer des dispositions sans éveiller l’attention de ceux qui pourraient s’y opposer.
8Sylvie ROGER
Secrétaire générale de la Délégation interministérielle à la langue française pour la
cohésion sociale
la délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale apporte
son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques favorisant l’accès à
la lecture, à l’écriture et à la maîtrise de la langue française. elle a notamment pour
mission de faciliter les échanges et la coopération entre les différents acteurs
impliqués dans ces politiques. or plusieurs chantiers gouvernementaux comportent
des évolutions importantes en matière de lutte contre l’illettrisme et
l’illectronisme. Ces réformes seront donc au centre de nos travaux, dans la mesure
où leur application devra mobiliser les compétences de l’état, des collectivités
territoriales, de l’entreprise et de la formation professionnelle. C’est pourquoi il nous
semblait essentiel de réunir aujourd’hui tous ces acteurs, pour réfléchir ensemble aux
solutions qui permettront à ces réformes de bénéficier au mieux, très concrètement,
à ceux qui en ont besoin. Vous aurez la possibilité de suivre les débats sur twitter
(#Colloqillettrisme).
9TABLE RONDE N°1 : ACQUÉRIR LES
COMPÉTENCES CLÉS EN ENTREPRISE
Laurence MARTIN
Directrice de l’Association pour la promotion du label APP, animatrice de la première
table ronde
La loi du 5 septembre 2018 a pour objectif de permettre à chacun d’acquérir une
autonomie dans son parcours d’apprentissage, et de pouvoir aisément mobiliser,
en euros et non plus en heures, son Compte personnel de formation (CPF). Cela induit
pour les entreprises de nouvelles responsabilités, et pose la question de la manière
dont doivent être intégrées à ces politiques les personnes en situation d’illettrisme
ou d’illectronisme. Cela induit également, pour l’état et les Régions, une nouvelle
répartition des rôles et une nouvelle organisation et coordination des différents
acteurs œuvrant à l’accès de tous aux compétences de base.
LES PUBLICS EN SITUATION D’ILLETTRISME DANS LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2018
Cécile RILHAC
Députée de la 3e circonscription du Val-d’Oise, et membre de la commission des
Affaires culturelles et de l’Éducation
madame béatrice Piron a évoqué dans son allocution l’amendement rejeté par le
Conseil constitutionnel, qui aurait constitué une avancée significative en faveur des
publics en situation d’illettrisme. le rapport d’évaluation demandé par cet
amendement nous aurait donné les moyens d’évaluer les politiques publiques de lutte
11TABLE RONDE N°1 : ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES CLÉS EN ENTREPRISE
contre l’illettrisme : notre groupe parlementaire a donc bien la volonté que la question
soit prise avec tout le sérieux qu’elle requiert. le Conseil constitutionnel a estimé qu’il
s’agissait d’un « cavalier législatif », autrement dit que la question spécifique du public
en situation d’illettrisme n’avait pas sa place dans la loi. Pour autant, nous poursuivrons
nos travaux, même si nos moyens seront évidemment moindres. en revanche, la loi a
redéfini la typologie des actions de la formation professionnelle. dans l’ancienne loi,
ces actions étaient au nombre de 12, et l’illettrisme était l’un des items. il me faut
rassurer ceux qui s’inquiètent du fait que l’illettrisme aurait été retiré de la loi : en fait,
des items trop précis (envers le handicap, l’illettrisme, l’outre-mer etc.) ont pour effet
de restreindre le champ d’application de la loi, et donc le champ d’action des
professionnels. La nouvelle loi représente donc une ouverture pour les publics en
situation d’illettrisme ou d’illectronisme, lequel d’ailleurs n’était pas inscrit dans
l’ancienne loi. en outre, l’illettrisme est bien inscrit dans la loi, à l’article 34, comme
étant un champ d’action prioritaire.
Michel FERREIRA-MAIA
Chef de la mission des Politiques de formation et de qualification de la Délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
l’article 34 de la loi a fixé un cadre juridique permettant, pour certaines actions
prioritaires et partagées, le conventionnement de formations auprès des Régions :
l’état intervient donc de concert avec les Régions, du moins celles qui s’engagent (à
défaut, l’état peut avoir d’autres partenaires). Quant au Plan d’investissement dans
les compétences (PiC), il prend acte de divers constats plutôt négatifs sur ce qui a été
fait auparavant. les plans d’urgence jusqu’alors mis en œuvre étaient annuels : le piC
instaure la pluriannualité, et donne aux régions la possibilité d’enclencher une
réelle dynamique en s’engageant jusqu’en 2022. l’illettrisme est désormais une
priorité affichée par la loi, et les conventions d’amorçage prennent d’ores et déjà en
compte les publics peu ou pas qualifiés, la statistique est à prendre avec beaucoup
de précautions, mais 20 % des personnes déjà en formation sur 2018 suivraient des
formations relevant de l’acquisition des compétences de base et de la lutte contre
l’illettrisme.
12David MARGUERITTE
Vice-président du Conseil régional de Normandie en charge de la formation et du
développement des compétences, et Président de la commission Emploi, Formation
professionnelle et Apprentissage de l’Association des Régions de France (ARF)
la compétence de lutte contre l’illettrisme a été confiée aux Régions assez
récemment, par la loi du 5 mars 20143, entrée en vigueur en 2015, ce qui peut
expliquer une part des inégalités territoriales révélées par les chiffres à disposition. si
l’aRF a accueilli le texte de la loi du 5 septembre 2018 avec un enthousiasme très
modéré, sur le volet de la lutte contre l’illettrisme, mes propos seront positifs. le
binôme état/Régions s’articule très bien dans les territoires : la normandie que je
représente est d’ailleurs un exemple de bonne coopération état/Région. le PiC
présente trois grands avantages, par rapport au « plan 500 000 »4 par exemple. tout
d’abord, il est pluriannuel, ce qui répond au vœu des Régions. ensuite, conséquence
immédiate, il s’inscrit dans une logique qualitative et non plus quantitative. enfin, les
publics visés sont clairement les publics non qualifiés, pour lesquels une formation
immédiatement qualifiante serait insuffisante. or ce sont précisément les publics que
nous avons le plus de mal à intéresser à nos formations. le catalogue des formations
relatives aux socles de compétences ; y compris numériques (cela s’appelle en
normandie « Cap digital »), est très abouti – mais ces formations, qui répondent
pourtant à un réel besoin, affichent des taux de remplissage inférieurs à 50 %. la
quasi-totalité des Régions ont signé les conventions d’amorçage, et les deux qui ne
l’ont pas fait souscriront probablement au Pacte régional d’investissement dans les
compétences, déclinaison pluriannuelle du PiC. l’enjeu pour nous est de débarrasser
ces formations de toute connotation punitive ou contraignante : l’obligation porte sur
les Régions, qui doivent proposer une formation à ces publics. en ce sens, l’expression
« socle de compétences » pose d’ailleurs problème. pour capter ces publics
invisibles, il faut leur donner le goût de la formation. Celle-ci doit être
immédiatement opérationnelle, à travers un métier, un emploi qui arrivera en bout
de parcours. les Régions disposent de la capacité de lancer des actions innovantes
pour intéresser ces publics aux formations. on doit laisser les territoires expérimenter,
et un changement de terminologie serait pertinent.
3 - Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576.
4 - Le plan « 500 000 formations supplémentaires » avait été lancé par le président Hollande le 31 décembre 2015 :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/autres-publications/article/rapport-d-evaluation-du-plan-
500-000-formations-suplementaires.
13TABLE RONDE N°1 : ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES CLÉS EN ENTREPRISE
Valérie SORT
Directrice générale du Fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAF.TT)
le FaF.tt, comme tous les opérateurs de compétences (oPCo), devra demain
répondre à un nouveau cahier des charges, qui lui donnera pour missions de :
w promouvoir l’alternance, et la question de l’illettrisme nécessitera la mise en œuvre
de nouvelles ingénieries, en particulier auprès des Centres de formation d’apprentis
(CFa)
w êtrevéritablement l’oPCo d’une branche professionnelle, en l’occurrence celle du
travail temporaire, en réconciliant et en articulant formations « socles » et formations
« métiers »
w garantir
aux entreprises un service de proximité, à travers un maillage du territoire
extrêmement fin et expert
w répondre aux objectifs de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPeC), au niveau des entreprises, mais surtout des territoires.
La loi modifie nos missions, mais elle modifie aussi notre système de financements :
chacune de nos branches va devoir faire preuve de créativité pour trouver les supports
financiers qui permettront de construire cette nouvelle ingénierie et d’accompagner
les salariés et il faut faire vite.
L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN SITUATION D’ILLETTRISME
Laurence BRETON-KUENY
Vice-présidente de l’Agence nationale des Directeurs des ressources humaines
(ANDRH), et DRH du groupe AFNOR
Un employeur sur deux est tout à fait conscient d’être confronté à l’illettrisme, sans
toutefois être en mesure de repérer et d’évaluer le problème, et surtout
d’accompagner ses salariés vers la formation. or dans les prochaines années, 10 %
des métiers vont changer, c’est-à-dire disparaître ou être créés, et 50 % vont
devoir évoluer. les compétences cognitives de base sont la « littératie », la
« numératie » et la « résolution de problèmes » – auxquelles bien sûr on peut ajouter
les compétences numériques, relationnelles et situationnelles. l’andRH a engagé en
2018 un partenariat avec l’anlCi, et dans un guide publié conjointement par nos
deux organismes, nous ne parlons pas d’illettrisme, mais de développement des
14compétences de base5. il ne faut pas oublier que sur les 2,5 millions de personnes en
situation d’illettrisme, 50 % sont aujourd’hui en poste, et que 13 millions de personnes
sont en situation d’illectronisme. l’andRH est donc très concernée par ce problème,
et mène auprès de ses membres de multiples actions de sensibilisation. demain nous
organisons d’ailleurs un webinaire6 sur la question, qui sera ouvert à tous.
Cécile RILHAC
la loi ne pose aucune obligation à l’entreprise s’agissant de la lutte contre l’illettrisme :
l’accompagnement ne saurait être une contrainte. Pour autant, il faut aider les salariés
concernés à surmonter cette honte, que l’on connaît tous, et qui les fait échapper au
repérage au prix parfois de trésors d’habileté. il convient d’abord de les rassurer, de
leur faire comprendre qu’ils ne courent pas, en se signalant pour suivre une formation,
le risque de perdre leur emploi. ensuite, il faudrait que les entreprises proposent ces
formations très ouvertement, sans stigmatisation aucune de tel ou tel, et presque sans
même qu’il soit besoin pour un salarié de s’y inscrire : l’enjeu est vraiment de pouvoir
repérer, démasquer ces personnes, mais de manière positive. la loi du 5 septembre
2018 porte sur les personnes en emploi, mais des mesures existent qui s’attaquent
au problème de l’illettrisme à la racine, c’est-à-dire dès l’école primaire, sachant que
les enfants dont les parents sont illettrés sont des illettrés en puissance. il s’agit en
définitive de changer de paradigme, en cessant d’interpréter l’évaluation comme un
« examen », voire une sanction. nous nous emploierons tout au long de ce
quinquennat, dans chaque loi, à trouver des pistes pour accompagner ces publics,
depuis l’école jusqu’à l’entreprise.
Valérie SORT
en tant qu’oPCo, le FaF.tt met actuellement en place la politique définie par la
branche au printemps 2018. Notre premier axe d’intervention ne porte pas sur
l’accompagnement des publics, mais sur la mobilisation des dirigeants
d’entreprise. le sujet de l’illettrisme, qui dans le secteur du travail temporaire touche
9 % des salariés et impacte donc très directement la performance et le
développement des agences, fera prochainement l’objet d’une communication directe
des professionnels aux professionnels. d’autre part, dans le cadre de notre partenariat
avec l’anlCi, nous mobilisons d’ores et déjà, pour accompagner les agences, les
Centres de ressources illettrisme (CRi). la spécificité du secteur du travail temporaire
5 - Ce guide, paru en juin 2018 et intitulé précisément « Développer les compétences de base des salariés », est consultable en ligne à cette adresse :
https://www.andrh.fr/actualites/685/anlci-andrh-developper-les-competences-de-base-des-salaries.
6 - Séminaire d’information se déroulant en direct sur Internet.
15TABLE RONDE N°1 : ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES CLÉS EN ENTREPRISE
est que les formations sont dispensées dans la perspective d’une prise de fonction
pour une mission : elles sont donc en lien immédiat avec l’emploi. Ce sur quoi nous
attendent les agences aujourd’hui, c’est sur les solutions de formation. nous avons
encore devant nous un important travail d’ingénierie à réaliser.
David MARGUERITTE
sur le plan local, la plupart des régions sont engagées aujourd’hui dans une démarche
de contractualisation avec les départements : la normandie a signé en 2017 avec les
cinq départements normands des conventions de partenariat qui rendent accessibles
l’intégralité des formations dites « socles de compétences » aux bénéficiaires du
Revenu de solidarité active (Rsa). il s’agit là simplement de bon sens, de
décentralisation bien organisée : les départements sont en charge des publics, et
la région propose les dispositifs de formation. Quant à la question de savoir
comment capter ces publics, je suis d’accord avec vous, madame la députée.
l’essentiel est bien de trouver des moyens d’aider les personnes concernées à franchir
la barrière de la honte, et celle aussi d’un sentiment d’inutilité de la démarche. en
normandie, nous avons expérimenté la prescription « libre », c’est-à-dire que la
personne a la possibilité de contacter directement l’organisme de formation. et si les
canaux d’accès aux formations sont multiples (Pôle emploi, missions locales), il arrive
de plus en plus souvent que l’initiative émane des stagiaires eux-mêmes. il faut un
déclic, qu’il est bien difficile pour un intermédiaire d’obtenir. Je crois à la possibilité
libre de choisir sa formation, grâce à une communication accrue et non stigmatisante,
et je crois au changement de paradigme sur le contenu même de ces formations.
Michel FERREIRA-MAIA
il existe au sein de l’entreprise deux outils pour accompagner ces publics vers la
formation : l’entretien professionnel et le conseil en évolution professionnelle, qui
sont des temps où l’on peut amener les personnes à mettre des mots sur leurs
difficultés et le rapport Pisani-Ferry7 évoque des pistes pour réussir à toucher ces
publics dits invisibles. l’état s’adossera sur le PiC pour lancer des appels à projets
nationaux, lesquels sont en cours de rédaction, sachant qu’il faut prendre garde à ne
pas entrer en contradiction avec ce qui se passe sur les territoires. Ces appels à
projets nationaux seront donc vraisemblablement lancés après les pactes
régionaux.
7- Le rapport de Jean Pisani-Ferry, remis au Premier ministre en septembre 2017, est consultable en ligne à cette adresse :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000710/index.shtml#book_presentation.
16CléA, CERTIFICAT DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Valérie SORT
le certificat Cléa a pour vocation de valider un premier niveau de compétences afin
de permettre à la personne de se projeter dans un parcours de formation et dans le
marché de l’emploi. dans notre secteur du travail temporaire, nous avons ces
dernières années financé 1 600 certificats Cléa, ce qui représente plus de 12 % des
certificats délivrés au niveau national. si le secteur s’est tant investi sur Cléa, c’est
parce que CléA fonctionne : le retour sur investissement est indiscutable. Ce n’est
pas la certification en soi qui fait débat aujourd’hui, mais plutôt son articulation avec
les formations métiers, ce qui est d’autant plus sensible dans notre secteur qu’il nous
faut former des personnes dans la perspective d’une mission précise. il s’agit donc
avant tout pour nous d’accompagner les organismes délivrant les certificats Cléa pour
qu’ils travaillent davantage en collaboration avec les autres opérateurs préparant aux
formations socles, afin qu’ensemble ils puissent construire de véritables parcours de
formation. en parallèle, nous menons actuellement auprès des chefs d’entreprise une
enquête d’évaluation de leur connaissance et appréhension de Cléa.
Michel FERREIRA-MAIA
le certificat Cléa, qui a été conçu et mis en œuvre par les partenaires sociaux, est en
effet un outil efficace, et plutôt bien assis dans la société. la seule question qui peut
éventuellement se poser est de savoir si le socle de connaissances Cléa n’est pas trop
élevé pour les publics en situation d’illettrisme il faut donc davantage se poser la
question du repérage et de l’accompagnement des personnes vers le socle des
connaissances et des compétences professionnelles.
David MARGUERITTE
la Région normandie a édité, en partenariat avec l’anlCi, un kit pratique intitulé
« Faciliter l’accès à la certification Cléa pour les personnes en situation d’illettrisme »8
Par ailleurs, je suis plutôt favorable à ce que les Régions mettent en place des modules
complémentaires à Cléa, à condition qu’il ne s’agisse pas « d’infra-Cléa ». en
revanche, je suis très favorable à la certification des modules numériques, étant
entendu que parmi les formations socles, les digitales sont précisément celles dont
les taux de remplissage en normandie ne dépassent pas 20 %. Pourtant, les publics
8 - Ce kit pratique est téléchargeable en ligne à cette adresse : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-
illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Kit-pratique-Faciliter-l-acces-a-la-certification-CleA-pour-les-personnes-en-situation-d-illettrisme.
17TABLE RONDE N°1 : ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES CLÉS EN ENTREPRISE
suivant ces formations sont transformés bien plus en profondeur qu’à l’issue d’autres
formations. la normandie est en outre la première Région à s’être lancée dans une
démarche de labellisation digitale des CFa. Plus généralement, les Régions sont très
engagées dans cette dynamique de certification.
Laurence BRETON-KUENY
l’andRH ne peut que soutenir la démarche consistant à lier illettrisme et
illectronisme, et bien sûr celle de la certification Cléa : apprendre à apprendre est
fondamental, et il n’y a pas de progrès sans mesure.
Cécile RILHAC
la loi du 5 septembre 2018 n’aborde pas directement la certification Cléa, mais
instaure en revanche les validations par blocs de compétences. Un certificat est un
ensemble, ce qui a été identifié comme un frein pour les personnes en situation de
handicap, d’illettrisme ou d’exclusion : la plupart de ces personnes possèdent déjà
des connaissances, il leur manque juste quelque chose, un bloc. la reconnaissance
des blocs de compétences permet de valider le fait qu’une personne ayant suivi une
formation, même si elle n’en a pas acquis toutes les compétences, a tout de même
validé tel ou tel bloc de compétences – et qu’elle peut donc ensuite ne se former que
sur tel ou tel autre bloc de compétences. dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme,
il faudrait imaginer dans les certifications des petits modules sur l’illettrisme et
l’illectronisme.
ÉCHANGES AVEC LA SALLE
De la salle, Pascale GÉRARD, directrice de l’Insertion sociale à l’Agence nationale
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
Pour information, un décret publié le 10 septembre dernier a créé un Cléa numérique,
qui sera prochainement inscrit au Répertoire national des certifications
professionnelles.
18De la salle, Véronique LAURENT, sous-préfète des Hauts-de-Seine chargée de la
Politique de la ville et de la Cohésion sociale
dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), nous avons créé des
ateliers de formation portant sur l’apprentissage de la langue et le numérique. le
problème qui se pose pour nos publics, notamment les femmes, est celui de la garde
d’enfants, mais aussi celui de la « porte d’entrée ». se rendre dans une mission locale
ou à Pôle emploi quand on ne sait ni lire ni écrire reste compliqué.
Michel FERREIRA-MAIA
l’approche de ces publics est de fait un des principaux points d’amélioration du
projet : il s’agit d’accompagner ces personnes avant, pendant et après la formation.
évidemment, cela coûte de l’argent, mais dans la négociation en cours état/Régions,
nous tenons compte du fait qu’il faut financer aussi les frais de transport,
d’hébergement ou de garde d’enfants.
David MARGUERITTE
Je confirme que la prise en charge des frais de transport, hébergement, restauration
(tHR) est à l’étude, et pourrait être retenue dans la rédaction du Pacte régional.
De la salle, Kadidiatou TRAORE
Je suis une ancienne stagiaire aPP, et après avoir échoué au concours d’aide-
soignante, un centre de formation m’a fait passer le certificat Cléa. Cela m’a permis
de comprendre ce dont j’avais besoin, et ce dont je n’avais pas besoin : le Cléa est
vraiment une bonne chose.
19SÉQUENCE « GRANDS TÉMOINS » :
#STOPILLETTRISME
Samira DJOUADI
Présidente, réseau #STOPILLETTRISME
l’association #stoPillettRisme, créée en 2013, est un réseau d’entreprises ayant
décidé de se mobiliser dans la lutte contre l’illettrisme. Certains salariés des
entreprises membres, sur la base du volontariat, consacrent une fois par semaine un
peu de leur temps de travail à aider d’autres salariés, en leur délivrant des cours de
français ou des consignes pratiques adaptées à leur métier. le projet, né au sein de
l’entreprise l’oréal, a d’emblée suscité un fort engouement, et tF1, entreprise pour
laquelle je travaille, a ensuite beaucoup œuvré à la structuration du projet. les
personnes chargées du ménage sont la plupart du temps des prestataires, et tF1 a
choisi d’inscrire le programme dans son appel d’offres. l’entreprise prestataire
s’engage à sensibiliser ses collaborateurs à la problématique de l’illettrisme, et
#stoPillettRisme accompagne d’abord l’entreprise dans cette démarche de
mobilisation des bénéficiaires, puis les bénéficiaires dans leur apprentissage, en
mettant bien en avant qu’il s’agît pour eux de pouvoir évoluer professionnellement.
Nous leur délivrons un diplôme, parce qu’il est important qu’ils en retirent de la
fierté, pour eux-mêmes et aussi vis-à-vis de leur famille. on parle souvent de
parents démissionnaires, mais parfois, s’ils ne participent pas à la vie scolaire de leurs
enfants, c’est tout simplement parce qu’ils ne parlent pas le français, ou qu’ils ne
savent pas lire ou écrire. Quant aux salariés des entreprises membres qui
accomplissent un tutorat, ils éprouvent eux aussi un sentiment de fierté, parce qu’ils
sont en capacité de transmettre, et qu’ils travaillent pour une entreprise qui s’engage.
21SÉQUENCE « GRANDS TÉMOINS » : #STOPILLETTRISME
Selma AKOVA
Tutrice, réseau #STOPILLETTRISME
Je travaille pour tF1, et cela fait déjà trois ans que je suis tutrice pour
#stoPillettRisme. Cet engagement était pour moi naturel, parce que je suis l’aînée
d’une famille immigrée en France, et que j’ai toute mon enfance servi de traductrice
à mes parents. Je suis donc très heureuse d’aider mes tutorés à devenir plus
autonomes. Cette année, ma tutorée est Kartoum, et j’éprouve une grande fierté pour
elle, parce qu’elle a fait beaucoup de progrès.
Kartoum NIAGATE
Tutorée, réseau #STOPILLETTRISME
Je suis arrivée en France il y a bientôt 30 ans, j’ai des enfants, je travaille depuis 2004,
et je n’avais jamais fait aucune formation. C’est tF1 qui m’a proposé cette formation,
j’ai accepté, et au bout de quatre ou cinq mois, je parviens maintenant à faire des
choses dont j’étais incapable auparavant.
Aïda BELARIBI
Tutorée, réseau #STOPILLETTRISME
C’est très dur d’avoir des difficultés avec le français quand on a des enfants, et c’est
vrai que je le cachais à tout le monde : j’avais l’impression d’être handicapée. Grâce
à #stoPillettRisme, je suis beaucoup plus à l’aise aujourd’hui dans mon poste de
travail, et j’espère que beaucoup d’entreprises s’engageront comme tF1. C’est
important pour nous, et nous sommes nombreux. Je vous remercie tous pour ce que
vous faites pour nous.
22TABLE RONDE N°2 : ACCÉDER AUX SAVOIRS
DE BASE DANS LES TERRITOIRES
Jeanne FONTAGNERES
Directrice, CRI de Nouvelle Aquitaine, animatrice de la deuxième table ronde
le CRi de nouvelle aquitaine existe depuis 25 ans, et intervient quotidiennement en
appui des structures de lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme. les politiques
publiques qui se mettent aujourd’hui en place ont pour point commun de se décliner
aux échelons régional, départemental, communal, voire infracommunal au sein des
quartiers. la question se pose donc de savoir comment articuler ces politiques
avec les besoins des territoires, en fonction de leurs spécificités. C’est l’objet de
cette table ronde.
TÉMOIGNAGE D’UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION : GRAND PARIS SUD
Marie-Line PICHERY
Maire de Savigny-le-Temple, Vice-présidente de Grand Paris Sud chargée de la
Politique de la ville
la séquence « Grands témoins » montre très clairement que pour nous, élus, la
question centrale est bien de colmater ces fractures invisibles, ou que l’on ne veut
pas voir. Grand Paris sud est une nouvelle intercommunalité de 24 communes et
350 000 habitants, qui compte aussi 19 QPV, qui à eux seuls abritent un quart de la
population de l’agglomération. environ 20 000 personnes de l’agglomération ont des
problèmes d’accès à la langue, ce qui est deux fois plus que la moyenne nationale.
nous sommes perpétuellement amenés à nous poser cette question : comment
23TABLE RONDE N°2 : ACCÉDER AUX SAVOIRS DE BASE DANS LES TERRITOIRES
intégrer au plus vite des enfants qui vivent dans une même journée dans deux mondes
où l’on ne parle pas la même langue, l’école et leur famille ? l’enfant quand il rentre à
la maison le soir est complètement coupé de son apprentissage, mais pour autant, le
lendemain, on lui demande : « as-tu fait tes devoirs ? » ; et les parents sont coupés de
la société. on compare souvent nos collectivités en fonction de leur nombre d’habitants,
mais nos problématiques ne sont absolument pas les mêmes. À savigny-le-temple, il
nous arrive d’être épinglés par la Chambre régionale des comptes pour n’être pas dans
les ratios attendus. C’est vrai, mais en vérité, on ne peut pas l’être. Cependant, il existe
dans les QPV un véritable potentiel de développement économique, que l’on ne pourra
révéler qu’en franchissant la barrière de la langue. dans notre agglomération, une
vingtaine de structures proposent des ateliers sociolinguistiques à plus de 1 000
bénéficiaires : c’est pourquoi nous avons réfléchi, avec la Délégation interministérielle
à la langue française pour la cohésion sociale, à la création d’un « service public
d’accès à la langue française contre l’illettrisme et l’illectronisme » », ce qui est une
réponse au Pacte de dijon9. on pourrait dire : « encore une création de service public »,
mais en fait, nous n’avons pas le choix. Ce service sera créé en partenariat avec l’état,
la communauté d’agglomération de Grand Paris sud, et les villes de Grigny et savigny-
le-temple. l’argent est nécessaire, mais ne suffit pas : il faut une véritable volonté
politique. dans les semaines à venir, ce service public se déclinera en fiches actions, un
prestataire sera sélectionné, et les structures pouvant servir de relais entre le service et
les personnes éloignées de la pratique de la langue française et des nouvelles
technologies seront labellisées. il est essentiel, on l’a dit, que les parents puissent faire
les devoirs avec leurs enfants et les accompagner dans leur vie scolaire, pour instaurer
avec eux un vrai lien de parentalité et éviter l’échec scolaire.
Philippe RIO
Maire de Grigny, Vice-président de Grand Paris Sud chargé du Développement durable
Je me félicite que notre nation se soit saisie de cette question, et je tiens à dire que
la honte ne devrait pas être du côté des personnes, mais du côté de la nation
précisément – celle de Voltaire, de Victor Hugo et de simone de beauvoir – où l’on a
laissé s’enkyster l’illettrisme et toutes ses conséquences. le coût humain en est
terrible, tout comme le coût économique. le 17 octobre 2017 a été lancé l’appel de
Grigny10, qui serait suivi du rapport dit « Rapport borloo »11, lequel ciblait bien cette
9 - Sur le Pacte de Dijon, voir https://www.gouvernement.fr/partage/10408-signature-du-pacte-de-dijon.
10 - Sur l’appel de Grigny, voir http://www.leparisien.fr/essonne-91/etats-generaux-de-la-politique-de-la-ville-les-elus-lancent-l-appel-de-grigny-
16-10-2017-7336149.php (sur la photo, l’homme au micro est Philippe Rio).
11 - Ce rapport, intitulé “Vivre ensemble, vivre en grand, pour une réconciliation nationale”, est consultable en ligne à cette adresse :
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/sra4_complet.pdf.
24question de l’illettrisme. la lumière a donc été faite sur ce que nous nous cachions
tous, à savoir que l’illettrisme touche à Grigny, par exemple, 5 000 personnes. Comme
on dit, « il y a du boulot » : il nous faut changer l’écosystème. bien évidemment l’école
est au cœur du sujet et les collectivités locales, les communes, dans leur compétence
« école », ont travail remarquable à faire dans l’accompagnement de l’acte éducatif.
mais la question du temps périscolaire voire extrascolaire est également
déterminante. le travail des associations est de ce point de vue crucial. Je suis aussi
président d’un centre de formation que nous avons créé à Grigny, grâce à la politique
de la ville. Parce que nous y avions constaté l’absence de nos publics dans les
formations de remise à niveau des compétences, ou dans les parcours de certification
professionnelle. nous avons pour l’occasion réalisé un diagnostic territorial sur la
maîtrise de la langue française, et défini ensuite deux orientations, l’une sur le français
comme lien social, et l’autre sur le français à visée professionnelle. dans le moment
historique que nous vivons actuellement, je formulerais la demande suivante : que
les collectivités locales, échelon de proximité, soient associées à la réflexion du
groupe parlementaire travaillant sur cette question. deuxième chose, je
souhaiterais que nos collectivités locales, tout autant que les entreprises, se
préoccupent de leurs personnels. Certains agents de catégorie C sont en effet
concernés par le problème de l’illettrisme. enfin, nous sommes confrontés à « une
ingénierie administrativo-financière mortifère » qui freine considérablement nos
actions, et à ce rythme, nous n’arriverons jamais à régler le problème. C’est la raison
pour laquelle, dans le cadre du service public que nous sommes en train de mettre
en place, il va falloir nous réinterroger sur la logique des appels à projets.
TÉMOIGNAGE D’UN DÉPARTEMENT : LE PAS-DE-CALAIS
Blandine DRAIN
Vice-présidente du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chargée des Collèges,
de la Politique éducative et de l’Enseignement supérieur
le Pas-de-Calais est un département magnifique, qui compte 1,5 million d’habitants,
mais dont le taux de chômage avoisine les 11 %, et le taux de pauvreté les 20 % ;
dans certaines villes, le taux de chômage atteint même 30 %, voire 50 % pour les 15-
24 ans, sachant que l’illettrisme et l’illectronisme sont en lien direct avec ces taux
de chômage et de pauvreté. 35 % de la population des plus de 15 ans sont dans le
Pas-de-Calais sans diplôme. la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme est donc pour
nous un enjeu économique, social voire sociétal, et démocratique. la Région des
Hauts-de-France est l’une des plus touchées par le problème, avec 11 % de la
population, soit 405 000 personnes en situation d’illettrisme, mais nous ne disposons
pas de statistiques au niveau départemental. nous allons réaliser un diagnostic sur
25Vous pouvez aussi lire