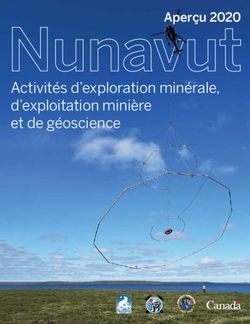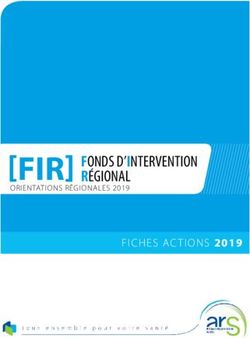DIAGNOSTIC CULTUREL TERRITORIAL À L'ÉCHELLE DU PAYS VENDOMOIS MARS 2021 - Territoires Vendômois
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
DIAGNOSTIC CULTUREL TERRITORIAL À
L’ÉCHELLE DU PAYS VENDOMOIS
MARS 2021
PS : tout au long de la démarche, ce diagnostic sera complété en fonction des
informations : liées aux rencontres avec les institutionnels et aux réunions avec les
acteurs culturels.
Projet culturel territorial 1/82
Diagnostic – version 03/2021Sommaire Sommaire .............................................................................................................................. 2 Objet de l’étude : présentation du projet et de la démarche ............................................ 4 Principe méthodologique ................................................................................................... 7 Contexte général : les dynamiques territoriales du Pays vendômois ............................. 9 L’accessibilité au Pays vendômois ...................................................................................10 Données démographiques : croissance modérée et généralisée sur le territoire .........11 1. La Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (CATV) .....................11 2. La Communauté de communes Perche et Haut Vendômois (CPHV) .................12 3. La Communauté de communes des Collines du Perche (CCCP) ......................13 Données socioéconomiques .............................................................................................15 1. Caractéristiques économiques des Territoires Vendômois.................................15 2. Caractéristiques économiques du Perche et Haut Vendômois ...........................16 3. Caractéristiques économiques des Collines du Perche .....................................17 Partie I : portrait du territoire : état des lieux de l’offre culturelle du Pays .........18 I. Les politiques culturelles : de l’Etat aux collectivités territoriales ..............18 1. L’Etat et le ministère de la Culture : historique et compétences depuis 1959 .....20 2. La région : chef de file économique, touristique et promoteur de la diversité culturelle ..........................................................................................................................22 3. Le département : moteur de cohésion sociale et culturelle.................................23 4. L’intercommunalité et la commune : maillons essentiels de l’investissement culturel ..........................................................................................................................24 II. Une vie culturelle riche et contrastée.............................................................27 1. La grande diversité de l’offre culturelle .........................................................27 a) La culture, pilier indissociable des autres politiques publiques ...........................28 b) Multiplicité des disciplines sur le territoire ..........................................................29 2. Un bon maillage en matière de lecture publique ...........................................32 3. Le patrimoine culturel et naturel : une force pour l’identité du Pays vendômois ..........................................................................................................................36 a) Le patrimoine bâti : reflet d’une histoire riche .....................................................37 b) Le patrimoine non-bâti : témoignage d’une culture locale singulière ..................38 c) Le patrimoine naturel : un héritage à protéger et un atout précieux ...................39 d) Les outils de protection ......................................................................................40 e) Les outils de valorisation ...................................................................................40 4. Une vitalité et un dynamisme, des acteurs associatifs peu structurés .......42 III. Une intervention culturelle fortement variée et dense : entre diffusion, création, éducation, enseignement et pratiques amateurs .............................................43 1. Diffusion et programmation ............................................................................43 Projet culturel territorial 2/82 Diagnostic – version 03/2021
a) Les opérateurs de diffusion................................................................................43 b) Les moyens de diffusion ....................................................................................46 c) Les lieux de diffusion .........................................................................................47 2. Création artistique ...........................................................................................52 a) Les structures de création ou soutenant la création ...........................................52 b) Les artistes locaux .............................................................................................54 c) Les lieux de création ..........................................................................................55 3. La transmission ...............................................................................................56 a) Les actions à visée « tout public » .....................................................................57 b) Les enfants et adolescents (scolaire et périscolaire) ..........................................59 c) Les personnes empêchées et les publics handicapés .......................................63 4. L’enseignement artistique et culturel.............................................................64 a) L’offre et la fréquentation des écoles d’enseignement musical en Pays vendômois ..........................................................................................................................65 b) L’enseignement de la danse ..............................................................................67 c) L’enseignement du théâtre ................................................................................68 d) L’enseignement des arts plastiques ...................................................................68 5. Les pratiques amateurs artistiques ................................................................69 1) En musique .......................................................................................................70 2) En danse ...........................................................................................................71 3) En théâtre ..........................................................................................................72 4) En arts plastiques ..............................................................................................73 Partie II : portrait culturel du Pays vendômois : des attentes et des besoins identifiés sur le territoire ................................................................................................74 1. Le rôle de l’intercommunalité : La nécessité d’une mise en réseau et d’un travail institutionnel commun ...........................................................................................................75 2. Diffusion et programmation ................................................................................76 3. Création artistique .............................................................................................77 4. Transmission .....................................................................................................78 5. Enseignement artistique et culturel ....................................................................79 6. Pratiques amateurs artistiques ..........................................................................81 CONCLUSION .....................................................................................................................82 Projet culturel territorial 3/82 Diagnostic – version 03/2021
Objet de l’étude : présentation du projet et de la démarche
Dans le cadre de sa stratégie territoriale, la communauté d’agglomération Territoires
vendômois s’est engagée en faveur de la culture. A ce titre, il souhaite élaborer un projet
culturel territorial, dans le but de renforcer et fédérer les établissements artistiques et
culturels et les démarches des acteurs culturels au sein du territoire. Et ainsi, répondre à ses
grandes orientations transversales : l’attractivité et le bien vivre sur le territoire, et la
valorisation des ressources locales.
Le choix a été fait de mener le diagnostic culturel territorial à l’échelle du Pays, les
acteurs culturels ne s’arrêtent pas aux limites administratives. En effet, ce diagnostic
constitue la première étape de mobilisation des acteurs locaux en vue de l’élaboration du
projet culturel territorial. Il a pour objectif de poser un regard qualitatif et analytique sur les
dynamiques du paysage culturel du Pays vendômois. Il vise également à définir les
orientations stratégiques et les priorités sur le territoire en matière de développement
culturel.
Bien qu’il existe déjà des recensements, notamment l’étude « Accessibilité des
services au public en Loir-et-Cher » de décembre 2016, réalisée par l’Observatoire de
l'Economie et des Territoires ou le projet « Réussite éducative » réalisé par la DEJ, ceux-ci
ne sont pas suffisants. Ils portent souvent sur l'offre publique et plus particulièrement les
infrastructures, ce qui met en évidence l’absence relative d’un état des lieux de l’offre privée
et, a fortiori, l’offre privée dans les espaces privatifs, ou l’offre émergente, pourtant
essentielle et complémentaire en situation de carence de l’offre publique. De ce fait, nous
avons souhaité élargir le champ de l’étude sur une réflexion centrée sur l’offre culturelle et
sur l’équipement du territoire. Un travail sur l’offre permet en effet d’appréhender en plus des
équipements, les structures d’animation, les activités et les événements, ainsi que d’identifier
l’état de surutilisation ou de sous-utilisation des infrastructures.
Ce diagnostic a donc pour but d’établir une connaissance fine et territorialisée des
dynamiques culturelles sur le territoire (acteurs et partenariats, lieux, évènements, réseaux,
voire projets). Autrement dit, il répond à un enjeu de production de connaissances du
territoire, d'études et d'aide à la décision, à travers la livraison d’un corpus de données relatif
à l’offre culturelle à l'échelle du Pays. Il doit permettre d’identifier des enjeux et de dégager
des pistes d’action ancrées sur les réalités locales. C’est une démarche stratégique,
permettant d’ores et déjà de saisir les forces du territoire en matière culturelle, ainsi que ses
fragilités. Néanmoins, le diagnostic culturel n’a pas vocation à entrer dans le détail de toutes
les thématiques. Ainsi, chaque structure ou acteur culturel travaillent à développer les
politiques mises en œuvre dans le cadre de leurs démarches respectives (projet
d’association, projet d’établissement, projet artistique …).
En préambule de cette étude et dans le but d’assurer une bonne compréhension des
notions régulièrement évoquées dans ce diagnostic, il est important de rappeler ce que l’on
entend par culture, et de rappeler quelques définitions des politiques culturelles, des
différentes familles artistiques (disciplines) et des différentes formes que peuvent prendre
l’art et la culture. La culture est un terme polysémique qui présente une hétérogénéité de
sens, car elle est évoquée dans différents domaines, tels que la philosophie, la politique, la
sociologie et les arts. Elle est aussi considérée en tant que facteur de création de richesses
et de développement économique et touristique.
Projet culturel territorial 4/82
Diagnostic – version 03/2021La définition de la culture développée par l’UNESCO semble la plus consensuelle,
mais semble aussi ouverte à une diversité d’acceptions : « La culture, dans son sens large,
est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les
lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs,
les traditions et les croyances »1. En effet, la culture constitue un facteur du développement
durable du territoire, car elle agit sur les plans humain, économique, social, éducatif mais
aussi environnemental et urbanistique. Elle joue également un rôle civique en aidant à
l’émancipation des personnes et au développement de la citoyenneté. Les différentes
politiques publiques culturelles (PPC) françaises ont longtemps considéré la culture à travers
une simple approche artistique. Elles ont donc mené à la création de famille
artistique (disciplines) :
Champs disciplinaires Discipline
Arts de Danse Danse classique, danse expressive, danse
représentation/ folklorique, danse urbaine, danse sociale,
Spectacle vivant Musiques Chant, chansons, musique d’ensemble,
musique instrumentale, théorie musicale,
musiques amplifiées,
Création littéraire Ecriture,
Arts de la piste Cirque,
Théâtre Marionnette et théâtre d’objet, théâtre,
Patrimoine Patrimoine matériel Patrimoine immobilier, patrimoine mobilier,
culturel patrimoine industriel,
Patrimoine immatériel Tradition, rite, folklore, savoir-faire,
Patrimoine Manuscrit, livre, archives,
documentaire
Patrimoine naturel Monuments naturels, formations géologiques
et physiographiques, sites naturels,
Lecture publique Réseau de lecture publique, animations,
Arts graphiques Peinture, dessin, gravure et estompe
Arts visuels Arts plastiques, aménagement, décoration et
design, sculpture, art médiatique, cinéma,
Les métiers d’art Art textile, céramique, joaillerie.
Tableau n°1 : les différentes disciplines de la culture.
1
UNESCO. (1982). Conférence mondiale sur les politiques culturelles. Mexico.
Projet culturel territorial 5/82
Diagnostic – version 03/2021L’ensemble de ces disciplines peut prendre différentes formes. Ces disciplines sont
des indicateurs d’un bon dynamisme culturel de territoire :
- les équipements, souvent structurants et symboliques pour un territoire (musée, salle
de spectacle...) ;
- les lieux non-dédiés ou « lieux-tiers » comme les écoles ou salles des fêtes ;
- l’événementiel, aux travers des différentes festivités ;
- le patrimoine, qui résulte d’une construction sociale autour d’une valeur commune,
matérielle ou immatérielle ;
- les pratiques culturelles.
Enfin, il est important de proposer une définition des pratiques culturelles. Nous
avons retenu la définition suivante : « l’ensemble des activités de consommation ou de
participation liées à la vie intellectuelle et artistique, qui engagent des dispositions
esthétiques et participent à la définition des styles de vie »2 .
2
Coulangeon, P. (2010). Sociologie des pratiques culturelles. Paris. La Découverte
Projet culturel territorial 6/82
Diagnostic – version 03/2021Principe méthodologique
Le travail de diagnostic présenté ici constitue la première étape du projet culturel
territorial et permet une première mobilisation des acteurs au sein du territoire. Il consiste en
une campagne de collecte des données, qui s’opère à l’échelle du Pays vendômois. Cet état
des lieux permet de :
- connaître le territoire, ses forces et ses faiblesses ;
- connaître son public, ses attentes et ses besoins ;
- instaurer un dialogue entre les acteurs.
Afin de réaliser le diagnostic culturel du territoire, trois grandes phases ont été
nécessaire.
Phase 1 : Appropriation des réalités territoriales
Cette phase a été établie à partir de plusieurs éléments qui ont permis d’identifier les
enjeux du territoire en matière de politique culturelle :
- visites sur le terrain ;
- analyse de travaux théoriques, d’expériences sur la question de la culture, du
développement culturel et la compréhension des enjeux et méthodes d’un diagnostic
culturel stratégique (liste des ouvrages en annexe) ;
- analyse des différents documents de planification ;
- questionnaire auprès des communes, afin de statuer sur l’état du territoire en matière
culturelle.
Phase 2 : Enquêtes de terrain et analyse des données
Cette phase est centrée sur la réalisation d’entretiens qualitatifs auprès acteurs du
territoire qu’il s’agisse de porteurs de projets ou d’actions dans le champ culturel ou
d’acteurs institutionnels accompagnant ces projets. La phase d’entretien a pour objet de
repérer les acteurs ressources, leurs réseaux, leurs actions, leurs projets. Ce travail a été
décomposé en plusieurs étapes :
- préparation de la phase de terrain avec la réalisation d’une grille d’entretien
commune à tous les acteurs et la prise de contact avec ces derniers ;
- repérage des acteurs à rencontrer ;
- traitement et analyse des données et des entretiens.
Phase 3 : Synthèse des résultats et identification des enjeux et orientations pour
l’action
La phase d’analyse a conduit à la rédaction du rapport organisé autour de grands
constats alimentés par les témoignages d’acteurs, la mobilisation d’expériences vues
ailleurs, l’identification d’enjeux et propositions de pistes d’actions. Ce diagnostic repose
donc sur l’analyse des différentes études menées sur le territoire du Pays vendômois, des
données quantitatives issues des questionnaires menés auprès des maires des communes
et des associations et des données qualitatives récoltées lors des entretiens.
Projet culturel territorial 7/82
Diagnostic – version 03/2021De fait, il ne se veut pas exhaustif mais révélateur des réalités culturelles identifiées
et vécues par tous les acteurs présents sur le territoire.
1ere phase
Appropriation des réalités territoriales
(septembre –
et définition d’une méthodologie de projet
octobre 2019)
Recensement des actions, des acteurs
et des lieux culturels du territoire
+ 2eme phase
Analyse des données : définition des (novembre -
attentes/besoins sur l’offre culturelle mai)
3eme phase
Diagnostic culturel
(juin-
novembre)
Restitution écrite du diagnostic
culturel, identification des enjeux à l’échelle
du pays.
Fig. n°1 : les trois grandes phases du diagnostic culturel territorial.
Projet culturel territorial 8/82
Diagnostic – version 03/2021Contexte général : les dynamiques territoriales du Pays vendômois
Pour commencer notre travail, il est utile de situer, dans les grandes lignes, les
caractéristiques du territoire. C’est bien à partir de sa réalité et de ses perspectives qu’il va
convenir d’engager la réflexion concernant le développement culturel.
Fig. n°2 : carte de présentation du Pays vendômois (Source : Observatoire de
l’Economie et des Territoires).
Situé au nord-ouest du département du Loir-et-Cher, en région Centre - Val de Loire,
le Pays vendômois a été créé en 1996 pour porter la politique régionale de contrat de Pays.
Il regroupe cent une communes organisées en trois communautés :
- Communauté d’agglomération Territoires vendômois (CATV)
- Communauté de communes du Perche et Haut Vendômois (CPHV)
- Communauté de communes des Collines du Perche (CCCP)
Projet culturel territorial 9/82
Diagnostic – version 03/2021L’accessibilité au Pays vendômois
Fig. n°3 : carte de l’accessibilité au Pays vendômois (Source : SCoT3, 2019).
Le Pays vendômois est desservi par la route nationale RN 10 reliant Paris à
Bordeaux, qui traverse le territoire entre Châteaudun et Château-Renault. Il est également
desservi par deux autres routes structurantes : la RD957 permettant de relier Épuisay à Blois
et la RD357, qui lie Le Mans à Orléans via Fréteval. Le réseau secondaire est composé
principalement de la RD9 reliant Savigny-sur-Braye à Château-Renault et de la RD106
reliant Cloyes-les-Trois-Rivières à Mondoubleau.
Le territoire est par ailleurs bordé par plusieurs autoroutes : les autoroutes A10 (axe
Orléans Tours), A11 (Chartres Le Mans) et A28 (Le Mans Tours). Cependant,
aucune de ces autoroutes ne le traverse ni le dessert.
Les accès autoroutiers les plus proches se situent à :
- Blois sur l’A10 (sortie 17 Blois, Vendôme) à 35 km de Vendôme ;
- Chartres sud/La Ferté Bernard sur l’A11 (sortie 3 Thivars) à 76 km ;
- Châteaudun/Nogent-le-Rotrou sur l’A11 (sortie 4 Brou) à 30 km ;
- Neuillé-Pont-Pierre sur l’A28 (sortie 27) à 52 km.
En termes d’accessibilité ferroviaire, le Pays vendômois est desservi par deux lignes
de train : une ligne TER reliant Paris-Austerlitz et Chartres à Tours et desservant le territoire
3
Schéma de cohérence territoriale
Projet culturel territorial 10/82
Diagnostic – version 03/2021à travers les gares de Saint-Amand-Longpré, Vendôme, Pezou et Fréteval-Morée, ainsi
qu’une gare TGV sur la ligne à grande vitesse Atlantique (jusqu’à Bordeaux), sur les
communes de Vendôme /Villiers-sur-Loir.
Un réseau de cars interurbains départementaux polarisé autour de Vendôme : sur
l’ensemble du territoire, six lignes interurbaines circulent, dont deux reliant Montoire et
Vendôme à Blois et quatre reliant Artins, St-Hilaire-la-Gravelle, Droué et Mondoubleau à
Vendôme. Quant à l’offre en transports en commun, celle-ci est globalement faible (hormis à
Vendôme). La voiture apparaît donc un mode de transport nécessaire pour se déplacer sur
le territoire.
Données démographiques : croissance modérée et généralisée sur le territoire
Le Pays vendômois est un territoire majoritairement rural qui compte en 2017, près
de 54 097 habitants selon l’INSEE. Nous avons retenu quatre profils types de communes,
identifiés par le SCoT, et établis sur l’importance de la commune suivant la densité
d’habitant :
- un réseau de villages, moins de 1 000 habitants, qui concentrent 42,7% de la
population (soit plus de 30 000 habitants) ;
- des bourgs entre 1 000 et 2 500 habitants (Naveil, La Ville-aux-Clercs, Lunay) ;
- des pôles ruraux compris entre 1000 et 2500 habitants (Mondoubleau, Droué,
Savigny-sur-Braye, Couëtron-au-Perche, Sargé-sur-Braye) ;
- les villes de Saint-Ouen et de Montoire-sur-le-Loir, qui regroupent au total 7 150
habitants et la ville de Vendôme qui, avec ses 16 879 habitants, rassemble 24% de
la population du territoire du SCoT.
Le Vendômois se révèle très contrasté. D’un côté, des territoires urbains et péri
urbains ne cessent de croître, et de l’autre, des espaces plus naturels, peu artificialisés,
composés de gros bourgs et de communes rurales.
Sur le plan démographique, à l’exception de la période 1968-1975, l’évolution fait
apparaitre une croissance modérée et généralisée sur le territoire, davantage portée par un
solde migratoire positif (+0,5 sur la période 1999-2009). Cependant, la situation change sur
la période 2011-2016, où le Pays vendômois enregistre un léger recul et ce dû
principalement au solde naturel qui est négatif dès le milieu des années 1970 et devient de
plus en plus négatif au fil du temps, traduisant un vieillissement de la population et une
difficulté à attirer de jeunes ménages.
Ainsi, toutes les communautés du Pays vendômois sont marquées par ce
retournement de tendance :
1. La Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (CATV)
La CATV se compose de soixante-cinq communes et compte une population
municipale de 54 450 habitants en 2016 selon l’Insee. C’est un territoire à dominante rurale4
:
4
Extrait du PLUi Territoire Vendômois, 2019.
Projet culturel territorial 11/82
Diagnostic – version 03/2021- Vendôme, qui comprend 16 688 habitants en 2016 selon l’INSEE, soit 31% de
l’ensemble du territoire, constitue la ville centre ;
- parmi les communes pôles, quatre comptent entre 2 000 et 4 000 habitants, dont
deux sont en périphérie immédiate de Vendôme ;
- cinq communes totalisent entre 1 000 à 1 300 habitants ;
- alors que les autres communes (soit 85% de l’ensemble) comptent moins de 1 000
habitants, dont vingt-sept de moins de trois cents habitants.
Le territoire de la CATV enregistre un léger recul sur la période 2011-2016, après
avoir enregistré un développement continu depuis plusieurs décennies. Le taux d’évolution
passe ainsi de 0.24% par an (entre 2006 et 2011), correspondant à un gain de 663 habitants
sur la période, à -0.26% par an (entre 2011 et 2016), soit une perte de 704 habitants sur les
cinq ans. Pour la CATV, cette situation varie selon les communes :
- une stabilisation de la situation à Vendôme, qui connait toujours une légère baisse.
- un creusement à Savigny-sur-Braye et à Montoire-sur-le-Loir ;
- un léger recul de la croissance démographique dans l’ensemble des communes hors
pôles, ainsi qu’à Saint-Ouen où il est très marqué, alors que la ville s’est très
fortement développée par le passé ;
- un maintien de la forte croissance à Naveil.
Il observe également un
déséquilibre en termes
de taux d’évolution de la
population :
l’augmentation de la
population se concentre
principalement en
couronne de Vendôme et
dans le sud du territoire,
mais les autres espaces
enregistrent plutôt une
diminution principalement
à l’ouest du territoire.
Fig. n°4 : carte de
population des
communes de la CATV
(Source : Insee 2016).
2. La Communauté de communes Perche et Haut Vendômois (CPHV)
La CPHV se compose de vingt-trois communes, qui regroupent 9 213 habitants en
2016 selon l’Insee, Concentrés principalement autour de quatre communes : Fréteval,
Projet culturel territorial 12/82
Diagnostic – version 03/2021Morée, Pezou et Droué. La commune de Pezou est la plus peuplée du territoire avec 1 138
habitants. Les quatre communes les plus peuplées totalisent à elles seules, 47% de la
population du territoire5.
Globalement le territoire de la communauté de communes du Perche et Haut
Vendômois, possède une dynamique démographique positive, qui reste néanmoins
contrastée. Cette dynamique positive est territorialisée, l’ensemble des communes ne
semblant pas en profiter. Elle apparaît également ralentie depuis 2008, et est due
principalement au solde migratoire, ce qui contraste la vitalité démographique du territoire
(PLUi Perche et Haut Vendômois, 2016).
De ce fait, la CPHV observe une certaine dichotomie voire un déséquilibre entre la
partie nord et la partie sud. En effet, le vieillissement et les évolutions démographiques ne
sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire : le sud qui se structure autour d’un pôle de
proximité (Morée) et deux pôles relais (Fréteval et Pézou) semble profiter des évolutions
démographiques les plus positifs grâce à l’attractivité de la Vallée du Loir et l’aire d’influence
de Vendôme, contrairement au nord qui se structure uniquement autour d’un seul pôle de
proximité (Droué) et concentre les évolutions démographiques les plus négatives.
Fig. n°5 : carte de
population des
communes de la CPHV
(Source : Insee 2016).
3. La Communauté de communes des Collines du Perche (CCCP)
La CCCP se compose de douze communes (qualifiées de communes isolées selon
l’Insee), qui regroupent 6 156 habitants (population est très peu dense : vingt-et-un habitants
par km²) en 2016 selon l’Insee. Elle est cependant plus importante dans la partie sud de la
5
Extrait du PLUi Perche et Haut Vendômois, 2019.
Projet culturel territorial 13/82
Diagnostic – version 03/2021communauté où sont situées les trois communes les plus peuplées, dont trois seulement
comptent plus de mille habitants. : Mondoubleau (près du quart de la population
communautaire), Couëtron-au-Perche et Sargé-sur-Braye6.
La CCCP a connu un important et long déclin démographique. Elle voit sa population
diminuer depuis la fin des années 1960. Néanmoins, le rythme de baisse ralentit depuis les
années 1990 et, sur la période récente (2011-2016), la population se stabilise. Cependant, la
population de la CCCP connait, d’une part, un phénomène de vieillissement progressif qui
soulève de nombreux enjeux et d’autre part, par une tendance au desserrement continu des
ménages à l’origine de décohabitations (divorce, départ des étudiants…).
L’enjeu donc est de conforter cette attractivité démographique retrouvée, et ce de
manière équilibrée et partagée par l’ensemble des communes. Afin de garantir une
répartition cohérente et équitable entre les communes, la CCCP a défini une armature
urbaine :
- les pôles de centralité de Cormenon – Mondoubleau : représentent un tiers de la
population des Collines du Perche ;
- les pôles d’équilibre de Sargé-Sur-Braye et du Couëtron-du Perche : représentent
également un tiers de la population des Collines du Perche ;
- les pôles de proximité
de Choue et du Gault-
du-Perche :
représentent environ
15% de la population ;
- les bourgs et villages
ruraux : Boursay, Le
Plessis-Dorin, Baillou,
Saint-Marc-du-Cor,
Beauchêne, Le
Temple, regroupant
près de 20% de la
population.
Fig. n°6 : carte de population
des communes de la CCCP
(Source : Insee 2016).
Le Pays vendômois connait ainsi une baisse démographique en raison d’un déficit
naturel qui s’accentue, sous l’effet combiné du vieillissement de la population et d’une
réduction du nombre de naissances ainsi que la perte de vitalité démographique en
particulier les jeunes (études, vie professionnelle). Ceci a eu pour conséquence une difficulté
6
Extrait du SCoT TGV, 2017.
Projet culturel territorial 14/82
Diagnostic – version 03/2021à attirer de nouveaux habitants sur son territoire qui pâtit d’une population qui vieillit plus
rapidement qu’ailleurs.
Ces phénomènes induisent donc des enjeux en termes de réponse aux besoins de la
population, notamment en ce qui concerne le vieillissement de la population et l’accueil de
jeunes ménages, mais également en termes de structuration de l’offre de services et de sa
géolocalisation.
Données socioéconomiques
1. Caractéristiques économiques des Territoires vendômois
Sur le plan économique, la communauté
d’agglomération a connu une légère
augmentation du nombre d’emplois entre 2012 et
2017, après avoir connu une forte chute avec la
crise de 2008.
Ce redressement constitue un atout indéniable pour fixer de nouveaux actifs sur le
territoire et alimenter l’attractivité résidentielle.
La CATV compte un total de 20 544 d’emplois en 2017 selon l’INSEE, dont Vendôme
occupe 11 210 soit 54.6% des emplois. Elle est principalement tournée vers le secteur
tertiaire avec 63% de l’emploi salarié. Elle est également caractérisée par une présence des
emplois industriels qui représente 25 % des emplois.
8000
2012
6000
2017
4000
2000
0
Agriculture Industrie Construction Commerce, transports, adm publique,
services divers enseignement, santé,
act sociale
Répartition des emplois par secteur d’activité en 2012/2017
Les actifs sur Territoires vendômois sont principalement des employés, des ouvriers
et ont des emplois qui relève des professions intermédiaires. Toutefois, ce sont les deux
catégories à connaître une diminution de leurs effectifs.
Projet culturel territorial 15/82
Diagnostic – version 03/20218000
6000 2012
2017
4000
2000
0
Agriculteurs exploitants Artisans, comm.,Chefs Cadres, Prof. Intel. Sup. Prof. Intermediaires Employés Ouvriers
entr.
Répartition des actifs de 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2012/2017
2. Caractéristiques économiques du Perche et Haut Vendômois
La communauté de communes Perche et Haut vendômois assiste depuis 2008, à une
reprise de la dynamique de création d’emploi. Cette tendance constitue une opportunité pour
l’attractivité du territoire.
Elle compte un total de 2157 emplois en 2017 selon l’INSEE, et est principalement
tournée vers le secteur tertiaire avec 53 % des emplois. Elle est également caractérisée par
une présence des emplois industriels et agricoles avec, respectivement 21% et 15% des
emplois.
1000
2012
800
600 2017
400
200
0
Agriculture Industrie Construction Commerce, transports, Adm publique,
services divers enseignement, santé, act
sociale
Répartition des emplois par secteur d’activité en 2012/2017
La structure de l’emploi selon la catégorie socio-professionnelle est en évolution. La
catégorie socio-professionnelle des professions intermédiaires connait la plus grande
augmentation contrairement à la catégorie « artisans, commerçant et chefs d’entreprise » qui
est la seule à connaitre une diminution légère de leurs effectifs.
1400
1200 2012
1000 2017
800
600
400
200
0
Agriculteurs Artisans, comm.,Chefs Cadres, Prof. Intel. Prof. Intermediaires Employés Ouvriers
exploitants entr. Sup.
Répartition des actifs de 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2012/2017
Projet culturel territorial 16/82
Diagnostic – version 03/20213. Caractéristiques économiques des Collines du Perche
La communauté de communes Collines du Perche, contrairement aux deux
communautés voisines, a connu également une légère diminution du nombre d’emplois entre
2012 et 2017.
Le nombre d’emplois présents dans le secteur est plus faible que dans les
communautés voisines dû à la faible densité de population sur le territoire. Elle compte un
total de 2086 d’emplois en 2017. Dans le secteur culturel, elle compte notamment quarante
équivalents temps plein.
800
600
400 2012
200 2017
0
Agriculture Industrie Construction Commerce, transports, Adm publique,
services divers enseignement, santé,
act sociale
Répartition des emplois par secteur d’activité en 2012/2017
Une situation très disparate en termes de compositions socioprofessionnelles des
actifs. On note une forte présence des ouvriers et employés sur l’ensemble du territoire mais
une baisse du nombre d’emplois dans le secteur agricole, soit cinquante-six emplois
d’agriculteur en moins. Un constat inquiétant d’autant que la communauté Collines du
Perche est une intercommunalité rurale, même si, ramené à la population, le nombre
d’emplois dans le secteur culturel est important.
1000
800
600
2012
400
2017
200
0
Agriculteurs Artisans, comm.,Chefs Cadres, Prof. Intel. Prof. Intermediaires Employés Ouvriers
exploitants entr. Sup.
Répartition des actifs de 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2012/2017
Concernant les déplacements domicile-travail, plus d’un quart des actifs occupés
résidant dans le Pays vendômois travaille à l’extérieur du périmètre du pays, soit 6245
personnes selon les données de l’INSEE de 2015. A l’inverse, 4310 résidants d’autres
territoires y entrent quotidiennement pour leur travail. Ceci permet de constater la relative
attractivité du territoire.
Toutes ces caractéristiques sociodémographiques et économiques permettent de
décrire le Pays vendômois de manière généraliste définissant les bassins de vie du territoire
permettant qu’ils se distinguent les uns des autres. Elles peuvent avoir une influence sur
l’offre culturelle et les initiatives culturelles présentes sur le territoire.
Projet culturel territorial 17/82
Diagnostic – version 03/2021Partie I : portrait du territoire : état des lieux de l’offre culturelle du
Pays
Le Pays vendômois, espace à dominante rurale, est un territoire où se déroule un
nombre important de manifestations culturelles et artistiques reposant sur la musique, la
danse, le théâtre ou autour de la lecture publique par exemple. Ces thématiques sont
illustrées par un maillage d’équipements culturels mais également de lieux patrimoniaux
culturels et naturels.
Avant de développer le portrait de ce territoire très actif culturellement bien que des
disparités demeurent entre les différents espaces, il est nécessaire de se pencher sur la
répartition des compétences culturelles. Il semble pertinent de faire le panorama des
institutions qui mènent les politiques culturelles de notre pays depuis la mise en place du
ministère des Affaires culturelles, personnalisé par André Malraux, lors de la naissance de
la Ve République, pour comprendre l’articulation des initiatives portant sur la culture.
I. Les politiques culturelles : de l’Etat aux collectivités territoriales
Le paysage culturel français est composé d’entités territoriales fortement investies
dans la conduite d’actions culturelles. En effet, les compétences culturelles des collectivités
territoriales sont inscrites dans les diverses politiques de décentralisation depuis 1982. Le
développement culturel a relevé pendant longtemps de la clause générale de compétence,
supprimée en 2015, sauf pour les communes. Par ailleurs, les élus à la culture se sont
mobilisés lors de la rédaction de la Loi NOTRe, en 2015, pour que la compétence culturelle
devienne une compétence partagée entre les différents échelons territoriaux français, suivie
d’une démarche de coopération. En effet, les lois récentes ont permis d’affiner et d’affirmer
les compétences attribuées aux divers échelons territoriaux. La culture relève donc de
compétences coercitives mais aussi de nombreux engagements volontaires.
En effet, le champ culturel est ouvert à plusieurs collectivités à savoir les communes,
les établissements de coopération intercommunale, les départements et les régions, en
coopération plus ou moins proche avec l’Etat. Ces relations de coopération sont souvent
bâties autour de partenaires institutionnels comme les directions régionales des affaires
culturelles. De plus, les intercommunalités et les petites villes sont épaulées dans leurs
orientations culturelles par les régions ou encore les départements. Dans un contexte de
décentralisation renforcée, nous notons l’affirmation des collectivités qui jouent un rôle fort
avec des responsabilités et des compétences définies notamment dans le domaine culturel.
Le but est une réappropriation des thématiques nationales « par le bas », au plus proche des
citoyens. Ainsi, cette coopération entre échelons territoriaux permet de mieux prendre en
compte les enjeux culturels locaux et de prendre des décisions tant sur le plan de la
cohésion territoriale que sur le plan de la lutte contre les inégalités spatiales.
L’idée est ici de prendre en compte quelles ressources sont mobilisables dans le
cadre des politiques culturelles mais aussi de mieux connaître les partenariats possibles
d’ordre financier. La politique culturelle possède une structure « polycentrique » (Guy Saez,
Gouvernance culturelle territoriale : les acteurs ; institutions et vie culturelles, les notices de
la documentation française, 2004) avec des financements émanant de l’Etat et des
Projet culturel territorial 18/82
Diagnostic – version 03/2021collectivités. Ces dernières sont des moteurs dans la valorisation de leur patrimoine à travers
des contrats de développement culturel. Les financements croisés entrainent donc une
effervescence de la vie culturelle au niveau local.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger le financement privé qui est assez notable en
France, explicité par le tableau ci-dessous, extrait de l’ouvrage Projets culturels de territoire,
d’Emmanuel Négrier et Philippe Teillet publié en 2019.
Néanmoins, nous allons focaliser sur les financements de l’Etat et des collectivités
qui financent les projets culturels mis en place par les structures territoriales.
Ces financements résultent donc le plus souvent de moyens croisés des partenariats
institutionnels avec l’Etat, les régions, les départements, les communes ou les
intercommunalités, agissant au niveau des co-financements des études ou des
équipements.
La majorité des dépenses sont aujourd’hui supportées par les communes et les
intercommunalités (leur implication représentait environ les trois-quarts des dépenses
culturelles des collectivités en 2010) suivies par les régions, puis les départements. Les
politiques et les investissements intercommunaux ont tendance à se renforcer même si les
dotations de l’Etat reflètent des baisses de budget.
Il s’agit ici de décrire les interventions de chaque entité, en débutant par l’Etat et le
ministère de la Culture.
Projet culturel territorial 19/82
Diagnostic – version 03/20211. L’Etat et le ministère de la Culture : historique et compétences depuis
1959
La décentralisation culturelle est aujourd’hui profondément ancrée au sein des
politiques mises en place par les gouvernements de ces trente dernières années. Pour
autant, l’Etat demeure l’un des acteurs de l’impulsion culturelle en France à travers le
ministère de la Culture, même s’il ne possède plus le monopole historique qu’était le sien en
matière culturelle. L’Etat assure sur le plan patrimonial la gestion, l’ouverture et l’entretien
des monuments lui appartenant (divers châteaux, jardins, parcs ou les cathédrales par
exemple). Il garde la main sur la protection des patrimoines et sur l’autorisation des fouilles.
Il est aussi chargé de l’application de la législation sur les monuments historiques.
Ce sont les lois de décentralisation et de déconcentration qui ont permis un transfert
de compétences envers les collectivités territoriales ou encore vers les services
déconcentrés des directions régionales des affaires culturelles. Cette collaboration entre
l’Etat et les collectivités entraine l’usage de fonctions partagées comme la sauvegarde, la
valorisation des patrimoines ou encore l’animation de la politique patrimoniale.
D’une part, c’est à travers le ministère de la Culture que l’Etat impulse, régule et
coordonne les grandes lignes des politiques culturelles. Le ministère des Affaires culturelles,
première véritable institution dédiée à la culture voit le jour en 1959 et va concrétiser le
lancement de « la politique culturelle » avec un fort interventionnisme étatique à travers les
Maisons de la Culture, voulues par Malraux telles des « cathédrales du XXe siècles ». Ces
lieux de foisonnement culturel sont cogérés avec les collectivités locales et le financement
est partagé. De plus, dès 1960, nous assistons à la création de la Fédération Nationale des
Collectivités pour la Culture (FNCC) à l’initiative de d’un groupe de maires et présidée par le
maire de Saint-Etienne, Michel Durafour.
Cette politique illustre une revendication démocratique forte dans un souci d’assurer
à tous les citoyens l’accès à tous les types de culture. La visée du ministère est
l’appropriation par tous de la culture et du patrimoine. De plus, la culture va s’insérer dans
l’utilisation du plan dans le but d’établir une cohérence sur le long terme. Les ambitions
assumées d’André Malraux s’illustrent également à travers une politique patrimoniale, un
soutien à l’avant-garde ou encore une décentralisation théâtrale. Concernant le patrimoine,
l’administration Malraux met en place l’inventaire général des monuments en 1964 pour
rendre plus visible aux yeux des Français le patrimoine du pays, transféré aux régions en
2004.
Néanmoins, malgré le volontarisme déployé à partir de 1959, c’est un bilan qui
demeure en demi-teinte. La culture ne représentait à cette époque que 0.4% du budget de
l’Etat et qualitativement, les études ont démontré les limites de la démocratisation culturelle
et la difficulté de toucher tous les publics malgré un engouement certain.
D’autre part, le ministère va aussi jouer un rôle moteur au début des années 1980
avec la mise des lois de décentralisation sous le ministère de Jack Lang. Cette
modernisation engendre des actions culturelles de plus en plus territorialisées
accompagnées d’une politique d’élargissement culturel entrainant une expansion des
domaines d’intervention. Cette politique volontariste couplée avec une coopération avec les
Projet culturel territorial 20/82
Diagnostic – version 03/2021acteurs locaux a permis de réaliser des projets perçus comme un atout économique et
attractif par les collectivités.
La loi de déconcentration de 1992 puis l’acte deux de la décentralisation de 2003 ont
également entrainé une application culturelle plus territorialisée des directives politiques et
une clarification des rôles, accentuée par les lois de 2014 et 2015.
En effet, organes déconcentrés de l’Etat, les directions régionales des affaires
culturelles existent depuis les années 1970 et illustrent une première « régionalisation des
politiques culturelles ». Elles sont chargées de piloter et de mettre en œuvre sous l’autorité
du préfet de région et des préfets de département, les politiques culturelles définies par
l’Etat, en articulation ou en soutien de celles des collectivités territoriales ou EPCI.
La DRAC agit sur deux pôles :
- le patrimoine et l’architecture (restauration, classement, musée...) avec les unités
départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP) ;
- la création et l’industrie culturelle (spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, livre et
lecture et lecture et arts plastiques).
Elles proposent des missions de conseils, d’expertise et d’accompagnement et sont
organisées autour de champs sectoriels, accompagnés de « conseillers », responsable d’un
secteur précis. Ses actions se diversifient et les agents sont de plus en plus en contact avec
les élus et professionnels des départements et des intercommunalités.
Enfin, ce sont ces conseillers qui instruisent les demandes de subventions réalisées
par les collectivités territoriales ou les professionnels. Les crédits alloués par le ministère de
la Culture sont gérés par les DRAC.
En illustration de ces propos, voici quelques exemples d’actions de la DRAC Centre –
Val de Loire au sein du Pays vendômois :
- signature du label « Ville d’Art et d’Histoire » avec la ville de Vendôme depuis 1986 ;
- le pacte culturel d’une durée de trois ans, signé en 2015 entre l’Etat et la CC des
Collines du Perche, afin de garantir l’accès à la culture en milieu rural ;
- l’accompagnement d’opérateurs et d’équipes artistiques de spectacle vivant :
- soutien à l’Hectare dans le cadre du dispositif "service éducatif"7
- soutien de STEREOPTIK pour le théâtre d’objet (Compagnie conventionnée
pour la création et le fonctionnement)
- soutien des musiques actuelles via Figures Libres ;
- soutien de Cheptel Aleikoum pour le cirque, compagnie conventionnée pour
la création et le fonctionnement ;
- soutien à la création avec l’Echalier, agence rurale d’action culturelle dans le
cadre d’une convention de développement culturel multipartite avec L’État, la
7
S’ajoute à cela un conventionnement pour les arts de la Marionnette en 2013 et en voie de labellisation « Centre
National de la Marionnette » en 2020 (programme 131 « création » et 224 « Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture »)
Projet culturel territorial 21/82
Diagnostic – version 03/2021Vous pouvez aussi lire