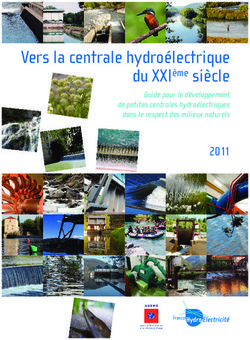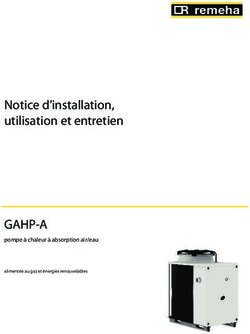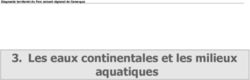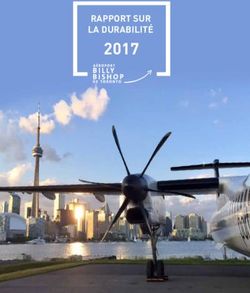(DIG) Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Syndicat des Bassins versants
des Corbières Maritimes
Travaux de gestion de la ripisylve, des
atterrissements et restauration de
berges par génie végétal
Dossier de demande de
Déclaration d’Intérêt Général
(DIG)
➢ Au titre des articles L 211-7 et L 215-15 du Code de
l’Environnement
➢ Dossier de Déclaration au titre des articles L 214-1
à L 214-6 du Code de l’Environnement
-1-TABLES DES MATIERES
1 PRESENTATION DE LA DEMANDE ................................................... - 3 -
1.1 Nom et adresse du demandeur ................................................................................ - 3 -
1.2 Présentation du secteur de la DIG ........................................................................... - 4 -
1.3 Intégration des travaux dans une réflexion à l’échelle du bassin versant Aude ...... - 6 -
1.4 Nature et consistance des travaux ou de l’activité envisagée ................................. - 11 -
2 CADRE REGLEMENTAIRE................................................................ - 14 -
3 DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL ..................... - 17 -
3.1 Mémoire justifiant de l’intérêt général de l’opération ............................................- 17 -
3.2 Principes d’intervention et descriptif des travaux ................................................. - 20 -
3.3 Plan de financement prévisionnel ......................................................................... - 50 -
3.4 Modalité de contrôle et de suivi des milieux restaurés .......................................... - 51 -
3.5 Calendrier prévisionnel des travaux ...................................................................... - 51 -
4 DECLARATION POUR L’EXECUTION DU PLAN DE GESTION..........- 52 -
4.1 Cohérence hydrographique .................................................................................... - 52 -
4.2 Principes d’intervention......................................................................................... - 52 -
4.3 Coûts des opérations .............................................................................................. - 53 -
5 DOCUMENT D’INCIDENCE ...............................................................- 55 -
5.1 Rubrique de la nomenclature concernée ............................................................... - 55 -
5.2 Impacts liés aux travaux de restauration de milieux ............................................. - 55 -
5.3 Evaluation d’incidences Natura 2000 ................................................................... - 57 -
6 DROITS DE PECHE .......................................................................... - 65 -
6.1 Identification des cours d’eau ou section de cours d’eau concernés par la
rétrocession gratuite du droit de pêche, pour une durée de 5 ans. ...................................... - 65 -
6.2 Cadre réglementaire............................................................................................... - 67 -
-2-1 PRESENTATION DE LA DEMANDE
1.1 Nom et adresse du demandeur
La demande de Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux
de ripisylve, de berges par génie végétal et de gestion des
atterrissements est formulée par :
MONSIEUR JEAN-PAUL FAURAN,
PRESIDENT DU SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS DES CORBIERES
MARITIMES
SIEGE : MAIRIE DE CAVES, 4 RUE DE LA MAIRIE, 11510 CAVES
TEL. 04 68 45 71 71
FAX. 04 68 45 65 47
COURRIEL : MAIRIEDECAVES@WANADOO.FR
-3-1.2 Présentation du secteur de la DIG
1.2.1 Situation
Le Syndicat des Bassins Versants des Corbières-Maritimes a été créé en 1991. Il exerce ses
compétences sur un territoire situé exclusivement à l’intérieur d’un périmètre
hydrographique constitué par les limites des bassins versants des ruisseaux des Corbières-
Maritimes dont les principaux cours d’eau sont le Rieu, l’Arena et le Pla.
En application du volet GEMAPI de la loi MAPTAM du 27 février 2014, les statuts du
syndicat sont amenés à être modifiés. Il est devenu un syndicat mixte fermé, composé de
deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP), le
Grand Narbonne et la Communauté de Communes Salanque-Méditerranée, par
représentation-substitution des six communes incluses dans le périmètre syndical (La Palme,
Treilles, Feuilla, Leucate, Caves et Fitou).
1.2.2 Caractéristiques physiques et hydrologiques
1.2.2.1 Géographie des bassins versants
Le secteur des Corbières-Maritimes situé au sud-est du département de l’Aude le long du
littoral méditerranée, dispose d’un réseau hydrographique complexe tributaire des étangs de
Salses Leucate et de La Palme. Il est constitué d’un chevelu de petits ruisseaux et talwegs
orientés ouest-est dont les écoulements sont temporaires. Ces cours d’eau prennent leur
source dans les contreforts orientaux du massif des Corbières à une altitude comprise entre
200 et 250 mètres. La surface du territoire syndical est de 127 km², représentant un linéaire
de 63 km de cours d’eau principaux.
-4-Bassins versants Surfaces (km²) Longueur (km) Pente générale (m/m)
Pla 2,12 4 0,045
Palisse 6,3 4,7 0,040
Canaveire 6,2 5,3 0,032
Estagnols 1,7 3,2 0,012
Aréna 12 11,9 0,045
Fénals 6,4 6,3 0,032
Rieu 23,1 15 0,043
Montoriol 19,3 6,8 0,068
Combe Roussel 7 5,3 0,029
1.2.2.2 Hydrographie et contexte hydraulique
La morphologie des bassins versants (topographie avec fortes pentes sur l’amont, remblai de
l’A9 en piémont « concentrant » les écoulements sous des ouvrages de franchissement
surdimensionnés, plaine d’inondation et de divagation à l’aval), les intensités
pluviométriques, la géologie spécifique (présence de karsts et résurgences) et l’occupation des
sols participent au processus de formation des crues parfois d’une extrême violence, avec un
temps de réponse très rapide.
Les niveaux des étangs influencent également le fonctionnement hydraulique du secteur et la
capacité d’évacuation des eaux.
Ces ruisseaux sont qualifiés de cours d’eau de type oued méditerranéen ou talwegs secs. De
plus, ils sont sujets à un important transport solide qui peut générer des dépôts terrigènes
localisés entraînant des rehausses de la ligne d’eau au droit de certains enjeux.
Ainsi, les débits de références, définis par l’étude d’un schéma d’aménagement réalisée en
2004 par GAEA, sont rappelés dans le tableau suivant :
Surfaces Débit max. instantané Débit max. instantané
Bassins versants
(km²) décennal (m³/s) centennal (m³/s)
Ruisseau du Pla 2,12 28 67
Ruisseau de l’Arène 12 47 150
Le Rieu à Feuilla 23,1 42 145
Le Rieu à l’A9 19,3 62 210
Embouchure
7 110 360
Montoriol
1.2.2.3 Climatologie
Le climat de la région des Corbières-Maritime est de type méditerranée, caractérisé par la
chaleur et la sécheresse de l’été et la douceur de l’hiver. La hauteur moyenne des
précipitations annuelle est comprise entre 500 et 600 mm sur l’ensemble des bassins
versants.
Les précipitations sont d’une grande irrégularité selon les années, des averses nombreuses et
violentes, provoquent parfois des crues subites des cours d’eau pouvant entraîner des
inondations dramatiques (1999).
-5-1.2.2.4 Géologie et hydrogéologie
La géologie des bassins versants des Corbières Maritimes est composée de deux entités
distinctes dont la limite est approximativement l’autoroute A9 :
▪ A l’Est, la nappe des Corbières-Orientales, constituée en partie des massifs charriés
jurassico-crétacé du Pied-du-Poul et de Pérills, se présentant comme une grande dalle
de calcaire, décollée au niveau du Trias et du Lias marneux et charriée à l’Eocène
supérieur, sur près de 20km vers le nord-ouest, sur un socle autochtone ;
▪ A l’Ouest des colluvions (matériaux de pente) et alluvions anciennes à sub-récentes
accumulées au bord des ruisseaux drainant les massifs en direction des étangs et sur
les pentes faibles du piémont en bordure des reliefs calcaires. Ils sont constitués d’un
mélange de cailloutis et de limons empruntés au affleurements proches.
Les calcaires plus ou moins karstifiés du Jurassique et du Crétacé inférieur représentent le
principal aquifère du secteur. En outre les alluvions quaternaires de la plaine de Caves-La
Palme et les formations miocènes et oligocènes sous-jacentes dans la plaine contiennent des
ressources non négligeables, mais avec une forte contamination marine.
1.3 Intégration des travaux dans une réflexion à l’échelle du
bassin versant Aude
1.3.1 Le Syndicat des Bassins Versants des Corbières-Maritimes
Les structures gestionnaires de bassin versant se sont adaptées à l’évolution du contexte
législatif, réglementaire et financier. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), le
Grenelle de l’Environnement, le classement des cours d’eau et le SDAGE conditionnent les
maîtres d’ouvrages dans leur programmation. En parallèle, les outils financiers disponibles
corroborent l’évolution réglementaire et orientent ces maîtres d’ouvrages. Par conséquent, les
élus conscients du risque lié aux inondations, des atouts écologiques de leur territoire et
motivés pour faire évoluer leur structure vers des actions plus durables pour les milieux
aquatiques, ont modifié régulièrement les statuts du syndicat.
En 2010, le conseil syndical avait délibéré pour attribuer de nouveaux statuts qui sécurisaient
juridiquement son action et diversifiaient son intervention. Le Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique des Bassins Versants des Corbières Maritimes avait pour objet
sur l’ensemble de son périmètre, de participer à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion
des cours d’eau et des milieux aquatiques associés dans le but de :
▪ Faciliter la prévention des inondations des lieux habités ;
▪ Contribuer à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Avec le transfert automatique de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) des communes aux EPCI à FP depuis le 1er janvier 2018, le
syndicat en exercera la compétence pour ses membres (GEMAPI, alinéa 1,2,5 et 8 de l’article
L211-7 du Code de l’Environnement).
Il est également membre de l’EPTB de l’Aude SMMAR qui assure la coordination et
l’assistance de ses syndicats adhérents dans l’exercice de leur compétence GEMAPI ainsi
qu’une cohérence d’intervention à l’échelle du bassin versant.
Dans le cadre de la prise en compte de la loi MAPAM et notamment de la GEMAPI, une
mutualisation des maîtres d’ouvrages a été menée en 2016, pour la mise en place d’une
démarche de labellisation des structures EPAGE. La demande de DIG porte sur le territoire
du syndicat mixte fermé couvrant les bassins versants des ruisseaux des Corbières-
Maritimes.
-6-1.3.2 Travaux réalisés et retours d’expériences
Avant 1999, le syndicat fonctionnait par interventions ponctuelles suite à la demande de
chaque adhérent. Entre 1991 et 1998, il a essentiellement fait exécuter des travaux de
recalibrage, de réfection de seuil, de curage et de débroussaillement.
Au lendemain de la crue dévastatrice de 1999, la prise de conscience d’une nécessaire gestion
intégrée des bassins versants, a conduit le syndicat a lancé en 2002 un schéma général
d’aménagement. Un programme de gestion globale des bassins est ainsi défini et un premier
plan pluriannuel d’entretien et de restauration de cours d’eau validé en 2004.
Le syndicat a d’abord réalisé en 2004 une tranche pilote de restauration et de gestion
régulière des berges des cours d’eau. Ces travaux, financés à hauteur de 40 000 € HT, ont
permis de traiter 4,5 km de cours.
Le syndicat a engagé ensuite en dix ans (2005-2015), 6 tranches de restauration et
d’entretien de cours d’eau qui ont permis de traiter un linéaire de 50 km pour un
montant d’investissement d’environ 450 000 € HT. L’ensemble des ruisseaux principaux
des bassins versants des Corbières Maritimes ont été traités dans le cadre de ce premier plan
de gestion qui avait fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général (DIG) valable dix ans.
La dynamique végétale nécessite de renouveler périodiquement l’intervention jusqu’à ce
qu’un équilibre du boisement rivulaire s’établisse, à travers des interventions ciblées sur
différents ruisseaux. La poursuite des travaux déjà réalisés lors des tranches précédentes est
indispensable pour ne pas perdre le bénéfice des efforts consentis.
-7-Illustrations des travaux de gestion de la ripisylve réalisés sur les bassins versants des Corbières Maritimes
Feuilla, septembre 2012 (5ème tranche) L’Arena après travaux, Fitou mars 2011 (4ème tranche)
Avant Travaux Après Travaux
Le Pla après travaux, Fitou février 2011 (4ème tranche)
-9-Entretien du ruisseau du Caneveire, février 2011 (4ème tranche)
Le Rieu à Feuilla, janvier 2010 (3ème tranche)
Ruisseaux des Fenals, Palisse, Pla et Rieu de Feuilla, décembre 2007 (2ème tranche)
- 10 -Sur ce secteur des Corbières Maritimes, force est de constater que l’entretien des berges et du
lit des différents cours d’eau n’est plus assuré et ce depuis de nombreuses années. Malgré un
travail régulier et de l’information, les propriétaires riverains sont rarement engagés à
respecter leurs devoirs réglementaires précisés dans l’article L215-14 du Code de
l’environnement : « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. »
1.4 Nature et consistance des travaux ou de l’activité
envisagée
1.4.1 Etats des lieux et diagnostic de la ripisylve
La ripisylve des cours d’eau des Corbières Maritimes n’est pas très développée du fait
notamment des conditions climatiques et des sols. La végétation rivulaire se répartit
graduellement en différents secteurs distincts :
▪ Sur les secteurs amont des bassins versants localisés sur le piémont oriental du massif
des Corbières, la végétation en place est de type garrigue, avec le lit des cours d’eau
localisé au fond des combes. Il n’y a pas à proprement parler de végétation rivulaire
mais plutôt des espèces de versants ;
▪ En plaine, la ripisylve est constituée de massifs de cannes de Provence, de joncs voire
de roseaux dans le lit des ruisseaux. Pour la strate arborescente, les saules, les frênes,
les peupliers et les tamaris sont présents mais sous une forme discontinue. Des
oliviers et des amandiers sont également présents en bordure des lits ;
▪ Dans la traversée du vignoble, le lit des ruisseaux est bordé de formations
buissonnantes denses composées de chênes verts, de chênes kermès, de genêts et de
ronces ;
▪ A l’embouchure au niveau des étangs, la végétation est caractéristique avec la
présence de roselières ou de prairies de Salicorne.
Dans le secteur amont des bassins, la ripisylve des cours d’eau est naturelle et sa composition
directement liée à la végétation environnante. En aval, les pratiques agricoles et l’entretien
des espaces, ainsi que les aménagements hydrauliques ont engendrés une dégradation
progressive de la végétation rivulaire. De plus, l’abandon relatif des rivières et de l’entretien
des ripisylves attenantes a eu pour principales conséquences une perturbation des
écoulements, des dégradations causées aux berges et un appauvrissement du milieu naturel.
Les tranches de travaux réalisées entre 2005 et 2015 par le syndicat ont eu pour vocation de
restaurer un fonctionnement équilibré des cours d’eau puis d’entretenir régulièrement la
végétation rivulaire en vu de limiter les impacts des crues.
1.4.2 Objectifs de travaux
Les interventions prévues dans le présent plan pluriannuel de gestion des ruisseaux des
Corbières Maritimes visent à poursuivre les actions engagées en limitant notamment
l’évolution des boisements spontanés rivulaires dans le lit ou en périphérie des cours d’eau.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
▪ Restaurer et/ou préserver les milieux aquatiques et la diversité de la végétation
rivulaire ;
▪ Limiter l’impact de la végétation sur la fermeture des zones humides (assèchement,
perte de biodiversité, perte de zone de pâturage…) ;
- 11 -▪ Restaurer et/ou améliorer le compartiment physique d’un cours d’eau dans l’objectif
d’en améliorer sa qualité biologique (biodiversité) ;
▪ Améliorer la qualité de l’eau ;
▪ Réduire les problèmes d’érosion des berges et assurer la pérennité de certains
ouvrages (ponts, route) ;
▪ Améliorer l’aspect paysager des cours d’eau aux abords des agglomérations et de
certains ouvrages de franchissements ;
▪ Concilier et respecter les différents usages du cours d’eau.
Les principes d’interventions essentiels sont les suivants :
▪ Concilier les enjeux sécuritaires, environnementaux, économiques et sociaux ;
▪ Favoriser le rôle régulateur, stabilisateur et paysager de la ripisylve ;
▪ Intervenir différemment suivant les enjeux riverains ;
▪ Informer au mieux la population de la nature des opérations envisagées.
Au regard de l’ensemble des objectifs présentés ci-dessus, le Syndicat des Bassins
Versant des Corbières Maritimes souhaite disposer d’une DIG qui couvre
l’ensemble du territoire syndical (2 EPCI en représentation-substitution de 6
communes depuis le 1er janvier 2018) pour pouvoir exercer pleinement sa
compétence. En effet, le maitre d’ouvrage des futurs travaux se laisse le droit d’intervenir
sur l’ensemble du réseau hydrographique (base cartographique des cours d’eau disponible
auprès de la DDTM) et non pas uniquement sur les travaux ciblés pour assumer son rôle lors
d’évènements naturels qui impliquent la réalisation de travaux imprévus avec un caractère
d’urgence. Le plan pluriannuel approuvé par les élus, localise les opérations au travers des
fiches actions détaillées par la suite. Une première priorisation est ainsi faite. Par ailleurs, un
calendrier global retrace les actions et leur durée.
1.4.3 Nature des travaux
1.4.3.1 La restauration de la ripisylve
Les principes d’interventions qui seront respectés au cours de cette phase seront les suivants :
→ Favoriser les interventions semi-annuelles
Les interventions préconisées relèvent dans la plupart du temps des techniques forestières :
élagage, coupe sélective d’arbres, rééquilibrage, débroussaillage, abattage sélectif, recépage.
Elles font généralement appel à des moyens légers et semi-manuels. Ces opérations
permettent d’affecter le moins possible la stabilité des berges.
Si toutefois il était nécessaire d’utiliser des engins mécaniques lourds depuis les berges
(tracteur agricole, forestier…) une attention particulière sera portée à la surveillance des
interventions.
Toutes ces interventions devront être réalisées en tenant compte de la diversité du milieu
biologique et physique de la rivière, mais également sa dynamique avec son environnement.
C’est pourquoi les chantiers devront être menés avec une grande délicatesse.
Ces interventions devront favoriser un couvert haut pluristratifié, dense, sain, divers et
continu sur les rives afin de faciliter le maintien des berges en limitant le processus érosif des
cours d’eau. Elles devront également prendre en compte l’existence d’une faune riche.
Les démantèlements d’embâcles se feront en fonction de leur positionnement et dans les
endroits où ils perturbent dangereusement l’écoulement.
- 12 -→ Gérer le bois valorisable
Les bois provenant des travaux seront enstérés en 1 m de long et mis en dépôt hors d’atteinte
de l’emprise de la crue décennale. On prendra soin d’informer le riverain de la présence de
ces bois pour qu’il puisse émettre le souhait de le récupérer.
Les bois non brûlés, non récupérés par les riverains seront à évacuer par l’entreprise.
→ Gérer les rémanents de coupe : broyage et débrisage
La faveur sera donnée au broyage sur place et à l’enlèvement. Le débrisage simple ne sera
toléré que sur les interventions sur arbres isolés et difficiles d’accès.
1.4.3.2 Confortement des berges
Certaines encoches d’érosions actives au droit d’enjeux peuvent faire l’objet d’études et de
travaux au cours de cette déclaration d’intérêt général. Une utilisation des techniques
végétales douces sera préférée. Elles comprennent le terrassement en pied de berge et une
stabilisation par réalisation d’un tressage et/ou fascinage. Un profilage de la berge en pente
douce, une stabilisation par pose de géotextile, bouturage et plantation en haut de berge
seront retenus dans la mesure du possible. D’autres techniques peuvent être envisagées telles
qu’un caisson végétalisé, lit de plants et plaçons…
1.4.3.3 Traitement des atterrissements
Les dépôts obstruant les écoulements seront préférentiellement si besoin dévégétalisés puis
scarifiés. Cette opération consiste à couper les végétaux qui stabilisent les dépôts et à « griffer
en surface » ces derniers à l’aide d’engins mécaniques pour permettre de les rendre mobiles.
Cette solution permet de préserver au maximum la dynamique naturelle des cours d’eau.
Dans certain cas, un déplacement des matériaux, en intrados de méandre par exemple afin
d’être remobilisés par le cours d’eau, pourra être envisagée en fonction des caractéristiques
hydrauliques particulières de chaque site.
Ce traitement local et partiel des dépôts (arasement à une côte altitudinale sans
surcreusement du lit mineur) qui contribuera à améliorer la dynamique sédimentaire, pourra
également être réalisé en raison d’une perturbation importante et préjudiciable au niveau du
cours d’eau (accumulation de matériaux et obstruction au niveau d’un pont ou d’un vannage
augmentant anormalement le risque de débordement…).
- 13 -2 CADRE REGLEMENTAIRE
Intervention des Collectivités Territoriales dans la gestion de l’eau
▪ Loi 92.3 sur l’Eau du 3 janvier 92, notamment son article 31, codifié sous l’article
L211-7 du Code de l’Environnement, qui habilite les collectivités territoriales, leurs
groupements, les syndicats mixtes et les communautés locales de l’eau à réaliser et
exploiter des travaux, ouvrages ou installations reconnus d’intérêt général ou
d’urgence dans les conditions prévues par les articles L.151-36 à L.151-40 du Code
Rural ;
▪ Loi MAPAM : l’évolution des compétences dans le cadre de la loi MAPAM, votée en
janvier 2014, nécessite un ajustement à la fois sur la prise de compétence des
collectivités territoriales mais également un besoin de mutualisation des structures
maitre d’ouvrage. Dans ce sens, la « GEMAPI » est une compétence transférée au bloc
intercommunal à fiscalité propre qui lui-même peut le transférer ou déléguer à un
EPAGE ;
▪ Le Code de l’Environnement et ses articles R214-88 à R214-104
Cette Déclaration d’Intérêt Général (DIG) correspond bien à la demande du « Syndicat des
Bassins Versants des Corbières Maritimes » qui opère désormais sur un périmètre
d’intervention constitué par les 2 EPCI à FP du périmètre syndical.
Droit de pêche
▪ L’article L.435-5 du Code de l’Environnement.
Servitude de passage sur les berges
▪ Le Code de l’Environnement et son article L215-18 :
« Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs
terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des
travaux ».
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
▪ SDAGE « Rhône Méditerranée » adopté par le comité de bassin et approuvé par
arrêté du Préfet Coordonnateur de bassin en date du 3 décembre 2015.
→ Compatibilité avec le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée
est institué par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Il a pour objet de définir ce que doit être la
gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin.
Le SDAGE 2016-2021 comporte 9 orientations fondamentales. Il reprend les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et y inclue l’orientation
fondamentale Of0 « s’adapter aux effets du changement climatique »
Les 9 orientations fondamentales du SDAGE sont :
▪ OF0 - S’adapter aux effets du changement climatique ;
▪ OF1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
▪ OF2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;
▪ OF3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
- 14 -▪ OF4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
▪ OF5 - Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé ;
▪ OF6 - Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones
humides ;
▪ OF7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l’avenir ;
▪ OF8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel du cours d’eau.
A ce titre, les travaux d’entretien et de restauration prévus respectent les engagements du
SDAGE et plus particulièrement les orientations fondamentales 2, 4, 6 et 8 en :
▪ Maintenant le fonctionnement des champs d’expansion de crue et en privilégiant des
techniques de restauration dites douces ;
▪ Limitant les travaux à fort impact sur le lit mineur et en préservant les différentes
strates de la ripisylve ;
▪ Réduisant les dommages et les déséquilibres causés aux boisements rivulaires ;
▪ Réduisant les possibilités d’inondation des zones d’habitation ou d’activité et en
anticipant la dégradation de certains ouvrages.
Les règles essentielles de gestion physique des rivières édictées par le SDAGE seront
respectées pendant les travaux.
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
▪ SAGE « Etang de Salses-Leucate » lancé en 2004 et dont la révision a été approuvée le
25 septembre 2015.
→ Compatibilité avec le SAGE
Le périmètre du SAGE recoupe la partie sud du territoire syndical du SBVCM, de la limite
méridionale du bassin versant du Rieu de Feuilla à la limite départementale entre l’Aude et
les Pyrénées Orientales.
Les orientations stratégiques du SAGE sont les suivantes :
▪ Garantir une qualité de l’étang à la hauteur des exigences des activités traditionnelles
et des objectifs de bon état de la DCE ;
▪ Protéger la qualité des eaux souterraines et définir les conditions de leur exploitation ;
▪ Préserver la valeur patrimoniale des zones humides et des espaces naturels
remarquables ;
▪ Poursuivre la gestion concertée locale et assurer un partage de l’espace équilibré entre
tous les usagers ;
▪ Intégrer la fonctionnalité des milieux dans la préservation des risques littoraux.
Le SAGE vise notamment les objectifs suivants :
▪ III.2 : Préserver et gérer les milieux remarquables présents sur le périmètre du
SAGE ;
▪ V.2 : Veiller à la préservation de la fonctionnalité des milieux dans la prévention
des risques.
Ce programme de travaux est conforme dans son principe et son exécution aux objectifs du
SAGE.
- 15 -Secteurs Natura 2000
Le territoire syndical des Corbières Maritimes présente un fort intérêt écologique. Il est situé
dans le périmètre de 7 zones identifiées dans le réseau Natura 2000 et classées au titre des
Directives « Habitats » et « Oiseaux » (cf. carte § 5.3 p.59) :
▪ 4 zones de protections spéciales (ZPC) : « Basses Corbières », « Complexe lagunaire
de Salses-Leucate », « Plateau de Leucate » et « Etang de La Palme » ;
▪ 3 zones spéciales de conservation (ZSC) : « Complexe lagunaire de La Palme »,
« Complexe lagunaire de Salses » et « Plateau de Leucate ».
Au regard des espèces animales et végétales pouvant être concernées, l’animateur du site
Natura 2000 est systématiquement associé aux comités de pilotages pour chaque projet.
Ainsi, dans la suite de ce document, on retrouve globalement définis dans des tableaux, les
milieux et espèce susceptibles d’être concernées par les travaux (cf. 5.3 "Evaluation
d’incidences Natura 2000", p. 58).
- 16 -3 DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET
GENERAL
3.1 Mémoire justifiant de l’intérêt général de l’opération
3.1.1 Une opération d’intérêt public
a) L’intérêt général
Sur le territoire, il a été constaté un défaut généralisé d’entretien régulier des cours d’eau et
des lacunes de la part des riverains devant les obligations auxquelles ils doivent répondre en
tant que propriétaire :
▪ Au travers de l’article L215-14 du Code de l’Environnement relatif à l’entretien des
rivières qui précise que les riverains sont tenus à « l’entretien de la rive par élagage
et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement d’embâcles et de débris
flottants ou non afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne
tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques » ;
▪ Au travers de l’article L432-1 du Code de l’Environnement qui précise que « tout
propriétaire d’un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas
leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d’entretien, sur les
berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique ».
Face au manque d’entretien avéré des ruisseaux des Corbières Maritimes, le
syndicat œuvre par la mise en place d’un programme de restauration et
d’entretien des cours d’eau. Il demande à ce titre la Déclaration d’Intérêt
Général sur une durée de 5 ans entre 2019 et 2023 pour pouvoir assurer la
réalisation des futurs travaux.
Le syndicat des bassins versants des Corbières Maritimes a entrepris depuis 2004 de
nombreux travaux sur la ripisylve (50 km de cours d’eau restaurés et entretenus). Les
résultats démontrent que l’action est bénéfique à la fois au droit de l’intervention en
réajustant l’équilibre des boisements rivulaires majoritairement sénescents mais également
sur l’aval où la formation d’embâcle est limitée.
Il s’agit bien là d’une mission d’intérêt public que le maître d’ouvrage souhaite développer sur
d’autres types d’interventions dans différents compartiments du bassin versant.
En effet, les bénéfices sont nombreux lorsque l’on intervient sur le milieu avec comme
objectif de restaurer ses fonctionnalités naturelles. Quelques raccourcis peuvent permettre de
comprendre les avantages et les notions de service public des interventions programmées :
▪ Restauration de la ripisylve : extraction du bois mort sur pied ou flottant
(inondation), intervention sélective sur les individus (qualité, inondation,
biodiversité) ;
▪ Confortement de berges aux droits d’enjeux majeurs ou présentant une réelle menace.
Ces notions sont portées par le syndicat depuis une dizaine d’année et il souhaite bien
poursuivre dans ce sens durant de nombreuses années. Le travail et les investissements
réalisés jusqu’à aujourd’hui pourraient très rapidement disparaitre si jamais les opérations
ne pouvaient être reconduites. L’évolution du milieu naturel est telle qu’une gestion
permanente permet de conserver des enjeux auprès de cours d’eau.
b) Le Plan Pluriannuel de Gestion de Bassin Versant (PPGBV)
Il s’agit d’un outil contractuel technique et financier entre le maitre d’ouvrage, les financeurs
et l’ensemble des services instructeurs des dossiers réglementaires pour la réalisation de
- 17 -travaux. Ce plan détermine sur une durée de 5 ans (2015-2019) les études et travaux à
réaliser sur le territoire correspondant à la masse d’eau SDAGE « FRDR202 ».
Les tranches annuelles de travaux sont basées sur la capacité financière du maitre d’ouvrage
à investir sur des opérations de restauration parfois conséquentes. En dehors de l’aspect
pédagogique que les travaux peuvent avoir sur les riverains et élus locaux, la réalité de
restaurer certains sites devient une priorité d’enjeux publics majeurs (routes, ponts, digues,
barrages…).
3.1.1.1 Objectifs des travaux sur le bassin versant
Différents cadres réglementaires fixent les objectifs à viser et donc les types d’actions à
réaliser par bassin versant pour répondre aux attentes de l’Europe et de l’atteinte du bon état
écologique des masses d’eau. Au-delà des attentes réglementaires, la qualité du milieu
aquatique est un atout pour le territoire du syndicat que les élus locaux souhaitent préserver
et valoriser.
En effet, le syndicat répond en cela, par souci de gestion cohérente et intégrée aux
prérogatives du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée qui préconise la gestion équilibrée de
la ripisylve, composante majeure de l’écosystème et élément essentiel du fonctionnement
physique du cours d’eau.
Ces travaux de restauration et de gestion régulière auront pour objectifs de rendre aux cours
d’eau d’une part, leur fonctionnalité naturelle et leur état d’équilibre, et d’autre part, de
conserver un aspect physique qui correspond d’avantage au rôle écologique, paysager, voir
sociologique que l’on peut attendre d’un cours d’eau « naturel ».
- 18 -3.1.1.1.1 Limitation des risques liés aux inondations
Une zone humide dont le fonctionnement hydraulique est bon, une ripisylve
équilibrée et un cours d’eau dont les faciès sont variés et de qualité
garantissent :
- Une amélioration de la fonction épuratrice du réseau racinaire
- Une limitation de l’apport de bois morts dans le lit de la rivière
- Un piégeage des bois flottants et des embâcles en zone appropriée
- Une limitation du ruissellement des eaux de pluies
- Un débordement préférentiel dans les zones sans enjeux
Il s’agira donc pour limiter les risques dans les zones à enjeux de procéder à l’enlèvement des
obstacles aux écoulements sur les secteurs sensibles aux inondations (embâcles, arbres
couchés etc…), de traiter préventivement les arbres morts sur berges, fortement gîtés ou
sénescents (vieillissant) afin de limiter l’apport de bois morts dans le cours d’eau, et de
restaurer un bon état sanitaire des boisements sur les secteurs dégradés.
Sur les secteurs naturels sans enjeux majeurs, l’action se portera vers une densification et une
diversification des boisements de berges, en conservant certains obstacles aux écoulements,
ceci afin de ralentir les vitesses d’écoulement avant la traversée des agglomérations.
Ces interventions sectorisées et différenciées en fonction des enjeux, des secteurs, et du degré
d’encombrement, auront pour objectifs :
- De limiter le risque et le niveau de submersion des zones où les enjeux sont forts
(zones habitées, infrastructures etc.) ;
- D’éviter l’obstruction des ouvrages d’art (ponts) par les matériaux ligneux dérivants ;
- D’éviter le phénomène de rupture d’embâcles, dangereux pour les secteurs situés en
aval.
3.1.1.1.2 Limitation des dégradations causées aux berges en zone
urbanisée
Grâce au système racinaire des différentes strates de végétation (herbacée,
arbustive et arborée), la ripisylve assure un excellent maintien des berges.
Les interventions devront ainsi permettre de :
▪ Encourager une diversité des essences et des strates, favoriser les essences
adaptées afin de conserver un bon maintien des berges et de limiter le
ruissellement ;
▪ Supprimer les arbres déstabilisés ou couchés pouvant générer des turbulences à
l’origine de phénomènes d’érosion des berges ;
▪ Conserver la végétation arbustive et herbacée qui, en se couchant sous l’action du
courant, limite l’érosion des berges.
- 19 -3.1.1.1.3 Amélioration de la qualité de l’eau
La végétation et les interactions avec le sol jouent un rôle prépondérant dans
l’autoépuration des eaux de surface. En effet, en éliminant les nitrates, en fixant
les phosphates et en favorisant les connexions avec le sous-sol, les travaux de
restauration à la fois des zones humides, de la morphologie et de la ripisylve
participent à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Les interventions sur la ripisylve devront intégrer la nécessité de conserver un couvert végétal
suffisamment dense pour éviter un éclaircissement trop important du cours d’eau pouvant
occasionner un réchauffement des eaux, et donc un développement de phénomènes
d’eutrophisation (développement de la végétation aquatiques et asphyxie du milieu). Les
travaux sur les zones humides prendront en compte la fragilité et les particularités de ces
sites pour ne pas apporter de dommages profonds. Les travaux de restauration physique
prendront en compte les zones à enjeux où la mobilité du lit n’est pas souhaitée.
3.1.1.1.4 Valorisation du patrimoine naturel
Les milieux aquatiques sont source de biodiversité. Ils constituent également un
élément structurant et valorisant du territoire, en étant pratiqués et fréquentés
pour diverses activités (pêche, chasse, randonnée etc…)
Les travaux préconisés devront aller dans le sens de :
▪ La conservation des essences végétales et des espèces animales rares ;
▪ L’amélioration de la richesse biologique par la limitation des espèces indésirables
ou envahissantes ;
▪ La valorisation paysagère des rivières dans la traversée des villages et aux abords
des ponts ;
▪ La conservation des différents usages ;
▪ La création de sentiers d’interprétations ou de sensibilisation afin de
communiquer pour le tourisme vert ou la population sur la richesse naturelle
présente sur le territoire.
3.2 Principes d’intervention et descriptif des travaux
3.2.1 Les principes d’intervention essentiels
✓ Améliorer le fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques ;
✓ Concilier les enjeux sécuritaires, environnementaux, économiques et sociaux ;
✓ Favoriser le rôle régulateur, stabilisateur et paysager des milieux aquatiques ;
✓ Intervenir différemment suivant les secteurs et enjeux riverains
✓ Informer au mieux la population de la nature des opérations envisagées.
- 20 -Les interventions ne seront pas systématiques et ont au préalable fait l’objet d’une réflexion
secteur par secteur quant aux conséquences qu’elles pourront induire sur les écoulements et
le milieu naturel.
Les travaux pourront comprendre :
→ Travaux sur la ripisylve :
✓ Des abattages sélectifs d’arbres morts, malades ou instables dans les formations
végétales riveraines, en prenant soin de ne pas arracher les souches de manière à ne
pas déstabiliser la berge ;
✓ Le recépage des cépées trop denses (l’élimination de certaines tiges permettant de
revitaliser les tiges préservées) ou des arbres vieillissants (une coupe propre
permettant de générer des rejets qui assureront la repousse d’un arbre nouveau) ;
✓ L’élagage des branches basses susceptibles de freiner l’écoulement ou de piéger des
débris flottants ;
✓ Des éliminations d’embâcles et de bois morts (suivant leur position dans le lit
mineur et leur risque de dérive vers l’aval) ;
✓ Les travaux nécessaires pour accéder aux sites concernés (dépose puis remise en
place de clôtures…), l’élimination des rémanents produits par le chantier
(incinération ou broyage selon la période et la réglementation en vigueur) ;
✓ La dévégétalisation et la scarification d’atterrissement et le régalage des matériaux,
susceptibles de gêner l’écoulement ou de provoquer ou d’accentuer des érosions.
→ Travaux de génie végétal :
✓ Un retalutage des berges en pente douce ;
✓ Une pose de pieux avec tressage en pied de berge ;
✓ Une protection de berge alliant pierre, bois et végétaux vivants ;
✓ Une plantation d’arbres, arbustes, plantes hélophytes ou graminées.
→ Travaux sur les atterrissements :
✓ Traitement de la végétation (coupes, dessouchage débroussaillage, évacuation
d’embâcles) ;
✓ Scarification de la croûte consolidée en surface ou labourage (retournement de la
partie supérieure du banc) ;
✓ Ouverture de bras (modelage d’un bras vif à travers le banc) ;
✓ Déplacement de matériaux dans le lit mineur du cours d’eau pour y être
remobilisés par le courant lors de crues dites morphogènes.
3.2.2 Localisation des secteurs
La Déclaration d’Intérêt Général est demandée pour une période de 5 ans sur l’ensemble
du réseau hydrographique appartenant au territoire du Syndicat des Bassins
Versants des Corbières Maritimes. Sont concernées les 2 EPCI à fiscalité propre
représentées sur le territoire syndical et les 6 communes qu’elles regroupent.
En matière d’entretien de la ripisylve, le plan pluriannuel de gestion définit par le syndicat,
précise les tronçons sur lesquels vont être réalisés les travaux objets de la présente DIG, en
fonction des travaux déjà réalisés par le syndicat.
Les préconisations de travaux sont regroupées par tronçons homogènes de rivière
d’après un découpage basé sur la géographie et le fonctionnement du bassin. Cependant les
interventions sont différentiées au sein de chaque secteur selon les types d’enjeux et de
peuplements identifiés lors de la phase de terrain et les besoins en matière de restauration.
- 21 -Les années de réalisation des actions de restauration et d’entretien de la ripisylve sont
données à titre indicatif. En effet, il faut avant tout retenir la hiérarchisation des
actions à effectuer. Ce plan de gestion peut être réactualisé en fonction des financements
et des travaux d’urgence à réaliser après des évènements climatiques important et
déstabilisant nécessitant la mise en œuvre d’opérations de restauration de berge en génie
végétal ou de traitement des atterrissements.
La programmation des travaux définie sur l’ensemble des bassins versants des ruisseaux des
Corbières Maritimes est présentée dans les fiches actions suivantes, comprenant : une
description générale du secteur, une cartographie par tronçons homogènes, les objectifs de
gestions identifiés ainsi que les travaux préconisés (coût estimatif au mètre linéaire et nature
de l’intervention : DEB=débroussaillage / ABA=abattage / EMB=embâcles / ELA=élagage /
SCA-ATT=scarification d’atterrissement).
- 22 -- 23 -
Rieu – Masse d’eau FRDR210
RIEU
PK PK
Embouchure Etang La Palme Pont A9
0 3.2Km
RI1
Altitudes en m NGF 0 33
Pente moyenne : 1%
Linéaire : 3.2 km Communes riveraines : La Palme / Caves / Leucate
Description générale du secteur et objectifs
Ce tronçon correspond à la partie aval du Rieu qui s’écoule en sortie de combes vers l’étang de La
Palme, traversant une zone d’activité agricole. Dans les secteurs d’à sec, la végétation rivulaire se
transforme en lande arbustive et arborée, abritant le chêne vert, l’olivier, le buis, le chêne
kermès, l’aubépine ou encore le genêt d’Espagne. La partie médiane est également caractérisée
par la présence de peupliers, de saules et de joncs. A l’aval de la RD6009, le lit se rétrécit avec un
développement du tamaris et des massifs de canne de Provence. En amont de son débouché dans
l’étang de La Palme, le Rieu est bordé de Tamaris et de roseaux.
Objectifs :
- Réduire les risques d’inondation en participant au ralentissement dynamique des crues
(régulation des écoulements, rétention d’eau, frein hydraulique…),
- Améliorer la qualité des eaux en participant au rôle auto-épurateur du milieu (zone tampon
entre les cultures et les cours d’eau, piégeage des polluants, ombrage du cours des cours
d’eau…),
- Structurer et valoriser les paysages, en offrant un corridor arboré différent des paysages
alentours.
Travaux à réaliser
Année 2 (secteur : passage à gué Clots de la Devèse - Aval Pont RD 6009) : DEB / ABA /ELA / SCA-
ATT
Débroussaillage sélectif de la végétation arbustive et buissonnante.
Travaux d’abattages sélectifs et d’élagage des zones les plus denses pour permettre notamment la
pousse des jeunes individus.
Surveillance des atterrissements sur l’ensemble du tronçon, en particulier au droit des ouvrages
de franchissement.
Coût estimatif : 9 000 € pour 1500 mètres linaires (ml) de cours d’eau traité.
- 24 -- 25 -
RIEU
RI3 Conflu. Feuilletayre
PK PK
Amont RD227
5.1 9.0
Altitudes en m NGF 117 225
Pente moyenne 2.8%
Linéaire : 3.9 km Commune riveraine : Feuilla
Description générale du secteur et objectifs
Traversée du village de Feuilla où le lit du Rieu est rectiligne avec des berges plutôt abruptes.
Depuis l’amont du tronçon, la ripisylve est étroite et clairsemée avec l’implantation de la strate
buissonnante et arbustive, quelques arbres épars, frênes, peupliers et saules.
Objectifs :
- Réduire les risques d’inondation en favorisant les écoulements au droit d’une zone à enjeux,
- Structurer et valoriser les paysages, en offrant un corridor arboré différent des paysages
alentours.
Travaux à réaliser
Année 1 (Amont franchissement D27 – Aval traversée village) : DEB / ABA /ELA
Débroussaillage de la végétation arbustive et buissonnante se développant dans le lit mineur du
cours d’eau,
Travaux d’abattages sélectifs et d’élagage des zones les plus denses pour permettre notamment
la pousse des jeunes individus.
Coût estimatif : 5 000 € pour 1000 mètres linaires (ml) de cours d’eau traité.
- 26 -Vous pouvez aussi lire