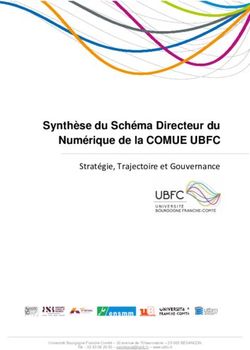Etude d'impact socio-économique de la Fondation du patrimoine - ETUDE DE CAS : LE MOULIN A VENT DE GIGNAC
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
JUILLET 2020 / MONOGRAPHIE
Etude d’impact socio-
économique de la Fondation
du patrimoine
ETUDE DE CAS : LE MOULIN A VENT DE GIGNACStatut du document Ce document formalise les résultats et enseignements de l’étude de cas portant sur le moulin à vent de Gignac, dans le Lot. Il a le statut de monographie finale à la suite de la relecture et la validation par le commanditaire. Nous tenons particulièrement à remercier l’ensemble des acteurs rencontrés dans le cadre de ces travaux d’études et en particulier Monsieur Rémi Paulin, chargé de mission de la Fondation du patrimoine pour la délégation régionale Occitanie-Pyrénées et l’association Lo Patrimoni, porteur du projet, qui se sont montrés disponibles et ont partagé avec l’ensemble de l’équipe leur connaissance fine du territoire et de son patrimoine. Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 1 / 40
TABLE DES MATIERES
1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODE D’ETUDE D’IMPACT...............................................................4
1.1. Objectifs et enjeux de la mission .............................................................................................................. 4
1.1.1. Les enjeux de la mesure d’impact et des études de cas ............................................................................... 4
1.1.2. Pourquoi ce projet ? ..................................................................................................................................... 5
1.1.3. Problématique évaluative ............................................................................................................................. 5
1.2. La méthode déployée pour l’étude de cas ............................................................................................... 6
1.2.1. Vue d’ensemble de la méthode déployée .................................................................................................... 6
1.2.2. Liste des interlocuteurs rencontrés .............................................................................................................. 7
2. LE CONTEXTE INITIAL D’INTERVENTION ...................................................................................................9
2.1. Un moulin à vent du XIXe siècle qui joue avec le découpage administratif des territoires ...................... 9
2.1.1. Bref historique du moulin à vent de Gignac ................................................................................................. 9
2.1.2. Un territoire d’implantation particulier, au croisement de trois départements .......................................... 9
2.2. La genèse du projet ................................................................................................................................. 10
2.2.1. Un projet porté par un petit collectif qui a su très progressivement convaincre les Gignacois ................. 10
2.2.2. La Fondation du patrimoine : un acteur reconnu sur le territoire, sollicité pour un appui opérationnel .. 11
2.2.3. L’écosystème des acteurs autour du projet ................................................................................................ 13
3. LA RESTAURATION DU SITE................................................................................................................... 15
3.1. Le financement des travaux .................................................................................................................... 15
3.1.1. Vue d’ensemble du plan de financement définitif ..................................................................................... 15
3.1.2. Les outils financiers « activés » via la Fondation du patrimoine et l’impact sur le financement global du
projet 16
3.1.3. Les autres appuis valorisables économiquement : le mécénat de compétences ....................................... 17
3.2. La réalisation des travaux ....................................................................................................................... 18
4. L’IMPACT MULTIDIMENSIONNEL DE LA RESTAURATION DU MOULIN A VENT DE GIGNAC, UN PROJET
SOUTENU ET ACCOMPAGNE PAR LA FONDATION ......................................................................................... 20
4.1. La pertinence du projet étudié en matière d’impact .............................................................................. 20
4.2. La plus-value de l’intervention de la Fondation du patrimoine sur le projet du moulin à vent de Gignac
21
4.3. L’impact économique du projet de restauration .................................................................................... 23
4.3.1. Rappel méthodologique concernant l’impact économique : ..................................................................... 23
4.3.2. L’impact économique de la restauration du moulin à vent de Gignac-en-Quercy : ................................... 24
4.3.3. L’exploitation économique du site :............................................................................................................ 26
4.4. L’offre touristique développée autour du moulin de Gignac ................................................................. 28
4.4.1. L’offre touristique socle construite autour du moulin ................................................................................ 28
4.4.2. Un projet touristique territorialisé : de l’importance de l’écosystème local .............................................. 29
4.5. La fonction sociale du site : un lieu actif de vie locale (ré)intégré dans l’identité de la commune ........ 31
4.5.1. Un lieu réapproprié par les habitants et réinséré dans la vie locale… ........................................................ 31
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 2 / 404.5.2. … marqueur de l’identité de la commune .................................................................................................. 32
4.6. Dynamiser l’offre culturelle locale et s’appuyant sur le moulin à vent et en incitant l’interprétation
artistique de son histoire ..................................................................................................................................... 33
4.6.1. L’activité de meunier : une tradition artisanale et culturelle attractive ..................................................... 33
4.6.2. Quand l’histoire du moulin inspire la production culturelle locale ............................................................ 33
4.6.3. Une interconnexion territoriale forte entre les structures associatives socio-culturelles du territoire qui
ouvre de nombreuses opportunités pour relier le moulin à l’offre culturelle existante ......................................... 35
4.7. Les effets d’entraînement perceptibles pour la Fondation depuis la restauration du moulin à vent .... 37
5. LES ENSEIGNEMENTS POUR LA FONDATION SUR LES EFFETS DE L’ENGAGEMENT AUTOUR DU
PATRIMOINE ............................................................................................................................................... 39
5.1. Les enseignements clefs pour la Fondation ............................................................................................ 39
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 3 / 401. Rappel des objectifs et de la méthode
d’étude d’impact
1.1. Objectifs et enjeux de la mission
1.1.1. Les enjeux de la mesure d’impact et des études de cas
Depuis 1996, la Fondation du patrimoine œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine français. Au
travers du label, des collectes de dons et du mécénat d’entreprise, elle accompagne les particuliers, les collectivités
et les associations dans leurs projets de restauration. Avec la conviction que le patrimoine s’inscrit dans des
problématiques territoriales plus larges. La Fondation s’interroge aujourd’hui sur l’empreinte territoriale de son
activité et sur la plus-value qu’elle apporte en faveur du lien social, de l’attractivité locale et de l’économie sociale
et solidaire.
A l’aune de ses 25 ans et considéré désormais comme un objectif majeur, il lui importe de valoriser son impact à
travers ses différentes actions menées sur les territoires. Dans cette perspective, la Fondation du patrimoine a
confié à notre cabinet Pluricité une mission d’étude portant sur l’impact économique, social et sociétal de son
action.
Il s’agit dès lors de mesurer l’impact multidimensionnel et réel des projets soutenus par la Fondation. Une
ambition qui se traduit à travers deux grandes questions évaluatives et transversales autour desquelles notre
équipe a construit son intervention :
Q1 – Quels sont les effets directs et entrainés des travaux de rénovation du patrimoine ?
Q2 – Dans quelle mesure l’intervention de la Fondation du patrimoine sur ces projets apporte-t-elle une
plus-value et répond-elle à un enjeu d’intérêt général ?
Opérationnellement, cette mission d’étude s’est déployée dans un contexte très particulier dû à l’épidémie de
COVID-19 et au confinement national décrété le 16 avril 2020, quand les travaux étaient déjà engagés. Le travail
de terrain a, de fait, été réalisé à distance grâce à des outils de visioconférence, d’enquête mail et de nombreux
échanges mails/téléphoniques.
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 4 / 401.1.2. Pourquoi ce projet ?
Dans le cadre d’intervention présenté ci-dessus, 7 études de cas ont été menées sur un panel de 7 projets
présentant des caractéristiques différentes et donnant ainsi un aperçu de la diversité des projets accompagnés
par la Fondation du patrimoine.
Le moulin à vent de Gignac a été sélectionné pour plusieurs raisons. Il présente des caractéristiques qui en font
un projet à la fois typique et exemplaire :
• Son implantation territoriale particulière sur la commune de Gignac dans le Lot (6 000 hab.), au
croisement de trois départements : la Dordogne, la Corrèze et le Lot, qui en fait un projet intercommunal.
Au-delà de la municipalité de Gignac, les communes avoisinantes se sont en effet associées sous
différentes formes pour soutenir la démarche (relais de la collecte de dons, appui opérationnel, etc.) et
faire de ce moulin un projet de territoire, marqueur de l’identité et du paysage local.
• Ce projet a par ailleurs été l’occasion de sensibiliser et mobiliser les habitants du territoire autour de
l’enjeu de préservation du patrimoine. En lien avec la délégation régionale Occitanie-Pyrénées de la
Fondation du patrimoine, l’équipe projet a su réunir le montant escompté de la collecte de dons en moins
d’un an et bénéficié de dons associatifs notables, un résultat interprété comme le fruit d’une dynamique
et d’un engagement important de la part des membres de cette équipe. L’étude de la provenance des
dons témoigne de ce succès.
• En lien avec le point précédent, ce projet a également permis de revaloriser le patrimoine historique et
artisanal à travers l’activité meunière, caractéristique du territoire, autour de laquelle des évènements
culturels sont organisés depuis la restauration (visites régulières, manifestations autour du pain et de sa
fabrication, etc.).
• Enfin, compte-tenu de l’attractivité touristique du territoire et de l’emplacement du moulin (en hauteur,
sur un circuit vélo), ce projet de restauration a indéniablement permis de renforcer la visibilité de l’action
de la Fondation et de l’engagement des territoires ruraux en faveur de la sauvegarde de leur patrimoine.
Eu égard à ces caractéristiques connues dès la phase de « sélection » des projets, notre équipe a travaillé sur une
problématisation plus spécifique de l’étude de cas en identifiant les points précis qui mériteraient d’être
analysés/approfondis dans le cadre de la mesure d’impact socio-économique.
1.1.3. Problématique évaluative
Nous avons décidé d’axer notre approche sur trois grandes questions évaluatives présentées ci-dessous. Chaque
question a été déclinée en hypothèses de travail et en indicateurs que nous avons mesurés afin de répondre à la
question générale posée. La présente monographie donne ainsi une réponse à cette problématique évaluative.
Question évaluative n°1 : En quoi la restauration du moulin de Gignac a-t-elle permis de réinscrire le bâtiment
dans le paysage et l’identité locale ?
Hypothèses de travail Indicateurs
• Les habitants de Gignac et des environs connaissent ‒ Données de fréquentation des visites organisées ;
l’histoire de ce moulin et l’associent à l’identité de la ‒ Nombre de manifestations locales autour de
commune ; l’activité artisanale meunière et nombre de
• Les associations locales se sont réappropriées le participants ;
moulin pour des évènements / manifestations ; ‒ Fréquence des arrêts des cyclistes / randonneurs
• Le moulin est devenu un lieu de passage touristique ; ‒ Couverture médiatique de la restauration du
• Le moulin est valorisé médiatiquement et dans les moulin et de son inauguration ;
supports de présentation du territoire ; ‒ Niveau de sensibilisation des habitants au projet
• Les établissements scolaires organisent des activités ‒ Visibilité du projet dans le paysage.
pédagogiques en lien avec le moulin restauré.
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 5 / 40Question évaluative n°2 : Dans quelles mesures le projet du moulin de Gignac est-il un projet de territoire ?
Hypothèses de travail Indicateurs
‒ Profil des donateurs (origine géographique, sexe,
• Les communes des alentours se sont mobilisées tout
âge) ;
au long du projet et continuent de l’être sous
‒ Profil des autres partenaires financiers et
différentes formes (participation ou organisation de
opérationnels du projet ;
manifestations, visites) ;
‒ Valorisation du projet à l’échelle des autres
• Le projet a bénéficié d’un soutien local financier et
communes du territoire ;
opérationnel important ;
‒ Nombre d’initiatives touristiques ayant intégré la
• Le moulin de Gignac est relié à d’autres initiatives
visite du moulin à vent de Gignac ;
territoriales valorisant le patrimoine historique
‒ Nombre de participants à l’inauguration et
(écomusée de Causse par exemple) ;
provenance géographique.
• Le moulin de Gignac est inscrit dans des parcours
touristiques inter-communaux.
Question évaluative n°3 : Dans quelles mesures le projet de rénovation a-t-il eu un impact sur les actions de
sauvegarde du patrimoine de la région ?
Hypothèses de travail Indicateurs
• Le projet a bénéficié d’une bonne visibilité et a permis ‒ Nombre et type de projets soumis à la délégation
à la Fondation du patrimoine de se faire (mieux) Occitanie-Pyrénées dans le Lot sur les années
connaître des collectivités locales et propriétaires 2018/2019 et montants ;
privés du Lot mais également de la Corrèze et de la ‒ Niveau de connaissance des activités de la
Dordogne ; Fondation des habitants, associations, élus locaux ;
• Le projet a entrainé une prise de conscience locale ‒ Degrés de sensibilité concernant le patrimoine
autour de la nécessité de préserver le patrimoine, local (habitants, acteurs locaux, touristes).
naturel ou bâti ;
• Les délégations départementales du Lot et régionale
d’Occitanie-Pyrénées constatent une hausse/diversité
des projets de rénovation ou restauration du
patrimoine local qui lui sont présentés.
1.2. La méthode déployée pour l’étude de cas
1.2.1. Vue d’ensemble de la méthode déployée
Comme précisé plus haut, la méthode de travail qui était initialement prévue a été fortement impactée par la
situation sanitaire ayant entrainé le confinement national et la limitation stricte des déplacements à des besoins
de première nécessité. Le travail d’étude sur le moulin à vent de Gignac s’est en conséquence réorganisé comme
suit.
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 6 / 401.2.2. Liste des interlocuteurs rencontrés
Ci-dessous la liste des interlocuteurs rencontrés dans le cadre d’un entretien qualitatif formel. Nous tenons à
remercier ici chacun des interlocuteurs qui ont accepté le cadre de l’entretien formel et qui se sont montré
disponibles pour répondre à l’ensemble de nos interrogations.1
Nom Fonction / Institution
Chargé de mission au sein de la délégation régionale
M. PAULIN R.
Occitanie-Pyrénées de la Fondation du patrimoine
Mme LECLERE J. Présidente de l’association Lo Patrimoni
M. VAISSIE R. Vice-Président de l’association Lo Patrimoni
Délégué départemental du Tarn et conseiller en affaires
M. CEBE O. culturelles pour la délégation régionale Occitanie-
Pyrénées de la Fondation du patrimoine
Délégué départemental du Lot au sein de la délégation
M. DE MONPEZAT J. régionale Occitanie-Pyrénées de la Fondation du
patrimoine
Service Patrimoine
Environnement Agriculture Sport Département du Lot
Tourisme
1Malgré nos multiples relances, il n’a pas été possible d’organiser un entretien avec la Mairie de Gignac contrainte par le contexte
électoral et sanitaire.
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 7 / 40M. DELPECH G. Meunier du moulin à vent et guide
M. LAFON A. et M. GARDIN J. Co-présidents de l’association culturelle Ecaussystème
M. CHASTANET J. Responsable des affaires culturelles d’Ecaussystème
LA TOURNEE DU COQ (Prestataire) Charpentier-Couvreur
M. LARRIBE Directeur CAUE du Lot
Etablissement X Restaurateur local
Monsieur Y Habitant de la commune de Gignac en Querçy
Madame Z Habitant de la commune de Gignac en Querçy
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 8 / 402. Le contexte initial d’intervention
2.1. Un moulin à vent du XIXe siècle qui joue avec le découpage
administratif des territoires
2.1.1. Bref historique du moulin à vent de Gignac
Construit en 1840 au sommet du Pech des Eoules sur les hauteurs de Gignac,
le moulin à vent était un bâtiment emblématique de la ville, construit à
partir de matériaux caractéristiques du pays tels que la pierre calcaire pour
son appareillage et son escalier intérieur ou encore l’ardoise traditionnelle
pour sa couverture. Bâti à la terre, sans chaux vive, il était de fait plus
sensible au froid et à la pluie ce qui explique sa fragilité, contrairement à
d’autres moulins de la région, plus résistants grâce à la chaux vive qui
solidifie avec l’humidité et le froid.
Ce moulin à grains s’appuyait sur le vent pour mettre en mouvement sa
machinerie grâce aux ailes chargées de faire tourner l’arbre entrainant le
rouet et ses 40 dents, lui-même entrainant la meule tournante. Un système
qui impose une exposition particulière puisque la vitesse du vent doit à
minima atteindre les 40km/h.
Le moulin à vent de Gignac à la fin du XIXe siècle
Durant tout le XIXe siècle, le moulin était utilisé pour des activités
artisanales : il servait principalement à moudre des céréales et autres grains afin de les transformer en farine,
quand d’autres moulins de la région étaient plutôt orientés vers la production d’huile. Mais cet établissement
avait une autre fonction sous-jacente, sociale cette fois, en étant un lieu de vie incontournable pour le village.
Les moulins ont toujours été un lieu de vie pour les habitants, c’est cette fonction qui nous intéressait au
départ […] lui redonner sa dimension sociale et conviviale. Sur des territoires ruraux comme le nôtre,
c’est vraiment important. (Extrait d’entretien, représentant de l’association Lo Patrimoni)
A partir de 1880, un conflit autour d’une succession va rapidement
mettre fin à son usage. Le droit de propriété du moulin est disputé
entre plusieurs habitants et cet imbroglio juridique va aboutir à une
altercation mortelle en 1920 qui signera l’arrêt définitif de son
fonctionnement après des décennies d’activité artisanale.
Délaissé, il tombe progressivement en ruine, perdant d’abord ses
ailes puis son toit jusqu’à ce qu’un collectif d’habitants, en lien avec la
municipalité (devenue propriétaire du moulin en 2008), s’empare du
sujet au début des années 2010 et élabore un projet de restauration
Le moulin à vent juste avant sa restauration visant à exclure l’autre alternative qui était la destruction pure et
simple du bâtiment.
2.1.2. Un territoire d’implantation particulier, au croisement de trois départements
Commune rurale de 6 000 habitants répartis sur 4 066 hectares, Gignac en Quercy forme l’une des plus vastes
communes du département du Lot et doit sa richesse architecturale à la truffe, abondante au XIXe siècle. Son
économie repose principalement sur deux secteurs qui sont aujourd’hui de plus en plus concomitants : 1/ un petit
réseau d’entreprises locales liées en grande partie à l’exploitation agricole (noix, canard, maraichage) ainsi qu’à
l’artisanat et 2/ le tourisme (gîtes, aires de camping, restaurants, patrimoine). Le Lot est en effet reconnu pour ses
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 9 / 40nombreux produits de qualité (vente en circuit-court, AOC, AOP, IGP, etc.) et son territoire naturel riche qui attire
chaque année de nombreux amateurs allant jusqu’à offrir 3 300 emplois directs dans le secteur touristique.
Les gens viennent dans le coin pour être dans la nature, au vert, descendre la vallée de la Dordogne en
canoé, profiter de la gastronomie locale et concilier ces activités avec des visites culturelles
patrimoniales. (Extrait d’entretien, représentant de l’association Ecaussystème)
Implanté au cœur de la communauté de communes Causses et Vallée
de la Dordogne, Gignac connait une situation géographique particulière
qui donne à son moulin à vent, implanté sur les hauteurs, une dimension
territoriale intéressante. Elle est en effet située aux confins de trois
départements : le Lot, la Dordogne et la Corrèze et de deux régions : la
Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie (cf. carte ci-contre), ce qui en fait un
territoire où les interconnexions sont nombreuses entre les habitants.
« Gignac est finalement plus proche du bassin économique de Brive que
de la Préfecture qui est Cahors ou de la sous-préfecture, Figeac ! »
Son logo témoigne de sa situation géographique originale au point de
jonction entre le Limousin (le vert), le Périgord noir (marron) et le
Quercy (jaune). Autre témoin historique, la « pierre des 3 évêques » également appelée « pierre des 3 régions »
en référence à l’ancien découpage territorial. Ce dernier serait, selon la légende, le lieu où les trois évêques des
trois sénéchaussées auraient, en 1317, déjeuné ensemble tout en restant chacun dans leur diocèse, puisqu’un
mégalithe se dressait à cet endroit, lieu de convergence de trois villages dépendant de trois départements et de
deux régions.
En matière de patrimoine, la commune de Gignac et ses environs possèdent de nombreux petits bâtiments
artisanaux liés à la vie quotidienne : fours à pain, cabanes en pierre sèche, grangettes dans les champs, etc. Elle
offre à ses visiteurs deux églises romanes, une chapelle du XIXe siècle, une architecture rurale de qualité et un
« désert vert », autrement dit une nature riche et abondante de plus en plus attractive ces dernières années.
2.2. La genèse du projet
2.2.1. Un projet porté par un petit collectif qui a su très progressivement convaincre les
Gignacois
Le projet de restauration du moulin à vent a vu le jour au sein de l’association locale reconnue d’intérêt général
« Lo Patrimoni » qui existe depuis 16 ans et qui mobilise une quarantaine de personnes autour d’un même
objectif : préserver et restaurer le patrimoine local, notamment le petit patrimoine rural (fours, fontaines,
cabanes) et faire connaître le patrimoine immatériel, l’histoire et les cultures locaux.
Depuis sa création, l’association a participé à de nombreux projets de restauration du patrimoine artisanal et
diversifie ses activités en proposant également des visites, des ateliers ou des interventions autour de la langue,
des traditions culinaires et de l’histoire du territoire. Elle s’est ainsi progressivement inscrite dans le paysage local
en tant qu’acteur associatif reconnu des collectivités, des établissements scolaires et du reste du réseau associatif
avec lequel elle entretient des liens étroits. C’est ce qui explique en partie le succès du projet étudié comme nous
l’illustrerons par la suite.
Concernant plus particulièrement le moulin à vent, ce dernier était, à la fin des années 2000, dans un état de
délabrement avancé et l’idée de sa restauration est venue assez naturellement, portée par des membres de
l’association habitant à proximité et sensibles à son histoire.
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 10 / 40J’habite à 300m du moulin, mes grands-parents ont fait moudre leur grain là-bas. Je trouvais dommage
qu’un tel patrimoine soit abandonné. C’était pour moi un devoir de mémoire que de le restaurer. Un
héritage historique. (Extrait d’entretien, représentant de l’association Lo Patrimoni)
En tant que résidente de longue date de Gignac je connais ce moulin depuis des années et en le voyant
comme ça tout moche, sans toit, avec juste de la tôle pour protéger les pierres, je me suis dit qu’il fallait
faire quelque chose. (Extrait d’entretien, représentant de l’association Lo Patrimoni)
En 2011, l’association Lo Patrimoni se lance et se rapproche de la Mairie de Gignac, propriétaire du moulin depuis
2008, et de ses habitants pour soumettre son projet. La réunion publique organisée ne porte malheureusement
pas ses fruits et le projet est mis de côté, faute d’adhésion. Les motifs invoqués montrent que les Gignacois ne
perçoivent pas encore « l’intérêt général » de la restauration du patrimoine et préfèrent que la Mairie
s’investisse sur d’autres priorités communales. Une attitude qui explique par la suite le portage associatif plus
fort du projet. Une chose étonne cependant les protagonistes : les plus enclins sont les « nouveaux » habitants,
ceux qui se sont installés plus récemment dans la commune et qui, instinctivement, pourraient être moins
sensibles à l’histoire patrimoniale du village.
Les gens n’ont pas compris l’intérêt de ces travaux. Pour eux, si l’agent public devait être dépensé c’était
dans les routes ou les infrastructures de la commune. Pas dans un vieux moulin en ruine. (Extrait
d’entretien, représentant de l’association Lo Patrimoni)
Le projet du moulin ça faisait longtemps qu’on en entendait parler, je crois qu’au début le village n’avait
pas vraiment conscience de ce que ça pouvait représenter ces travaux. On ne voyait pas l’utilité, sachant
que le moulin était abandonné depuis très longtemps. (Extrait d’entretien, habitant.e)
L’association n’avait pas à l’époque les moyens de porter des travaux de restauration d’un tel montant (le premier
chiffrage s’élevait à plus de 100 000 €) ; il lui fallait de fait le soutien opérationnel et financier de la Mairie. Suite
aux élections municipales de 2014 et à la nouvelle équipe qui s’installe, le projet refait surface. Entre temps
l’association a mis de côté près de 40 000 € grâce à des dons et promesses de dons d’autres associations locales.
On a retenté le coup en 2016 et cette fois ça a marché. On est allé voir le Maire qu’on a senti sensible sur
la question, intéressé. On a demandé si l’association pouvait commencer la restauration du moulin sans
l’appui financier de la commune. Entre ce jour où il nous a donné son accord et l’inauguration il s’est
passé 12 mois. C’est très peu. (Extrait d’entretien, représentant de l’association Lo Patrimoni)
Cette fois le pari qui est fait est celui d’une adhésion progressive des habitants et de la mobilisation du réseau
associatif local, y compris en dehors de Gignac, pour favoriser l’ancrage local du projet. Le moulin est en effet à la
frontière de plusieurs communes et il peut intéresser de nombreux acteurs locaux. Un fonds de dotation
spécifique est créé, « Les amis du Moulin de Gignac », afin que la démarche de restauration soit transparente et
bien distincte des autres activités de l’association. Une seconde réunion publique est ensuite organisée en 2016,
lors de laquelle un nouvel acteur fait son apparition : la Fondation du patrimoine.
2.2.2. La Fondation du patrimoine : un acteur reconnu sur le territoire, sollicité pour un appui
opérationnel
Lorsque le projet de restauration du moulin à vent de Gignac (re)voit le jour en 2016, la préservation et la
valorisation du patrimoine sont des enjeux qui sont, dans un même temps, réaffirmés par le Département du Lot
à travers la signature d’une convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine. C’est donc un moment
propice pour faire émerger des projets qui peinaient jusqu’alors à convaincre de leur intérêt général pour le
territoire. Une époque « propice » pour le patrimoine local qui va profiter au moulin.
» Le patrimoine local, un engagement commun de la Fondation et du Département du Lot
Le département du Lot possède une richesse patrimoniale - naturelle comme construite, protégée ou non au titre
des monuments historiques - valorisée à travers de nombreuses initiatives qui tentent de faire vivre l’histoire et
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 11 / 40l’identifié du territoire. On relève ainsi la présence de nombreuses églises, mais également de corps de ferme en
pierre sèche, de vallées et d’espaces naturels protégés, de bâtiments artisanaux ou encore de sites
archéologiques. Un important travail d’inventaire réalisé à partir de 2016 a permis de formaliser un « atlas local
du patrimoine »2 et de relier cette diversité à l’offre culturelle et touristique afin de mieux valoriser et préserver
cet héritage historique.
Cette dynamique autour du patrimoine a été soulignée à plusieurs reprises au cours de nos investigations et s’est
vue renforcée depuis quelques années notamment grâce à la convention de partenariat passée en 2016 entre le
Département et la délégation régionale Occitanie-Pyrénées de la Fondation du patrimoine qui a eu un impact
majeur sur l’activité de la Fondation à l’échelle du territoire et sur son intervention en faveur du patrimoine
local. Par la communication massive autour du sujet et les différentes aides départementales accordées pour
encourager la restauration du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, l’activité de la
Fondation a connu « un coup d’accélérateur » ayant entrainé la hausse et la diversification des projets
accompagnés sur le territoire. En parallèle, le Département souligne la qualité du partenariat avec la Fondation
sur le plan technique.
Le Lot est un des départements les plus performants, pertinents et efficaces en activité pour la Fondation
[…] A partir de 2016 on est passé de 5 dossiers par an à 25 : 10 portés par des collectivités, 15 pour le
label. […] Cette situation s’explique par un partenariat solide avec le Département, qui n’est pas
uniquement financier mais qui s’appuie sur un réel échange, une réciprocité. Le Département fait le lien
et rend visible l’action de la Fondation auprès des habitants et des autres collectivités, c’est un acteur
central. (Extrait d’entretien, Délégation régionale Occitanie-Pyrénées de la Fondation du patrimoine)
Sur le terrain on sait que les délégués de la Fondation jouent un rôle important mais ce qui nous intéresse
nous, en tant que collectivité, c’est d’avoir un interlocuteur technique. On a des relations différentes avec
les délégués et les chargés de mission, ce n’est pas la même façon de travailler. Le dialogue est facilité
quand on a en face un technicien qui va savoir parler avec nos équipes de techniciens. […] Pour nous la
Fondation peut être un partenaire des collectivités dès lors qu’on arrive à avoir des échanges techniques,
qu’on parle le même langage, par exemple sur la qualité des travaux. (Extrait d’entretien avec le service
coordination patrimoine du conseil départemental du Lot)
A l’instar d’autres régions, il reste toutefois un travail de pédagogie à avoir auprès des non-initiés pour faire
prendre conscience que la richesse patrimoniale dépasse le bâti, les « vieilles pierres » et les monuments
reconnus comme étant historiques par les services de l’Etat. C’est notamment la mission que se fixe certains
délégués territoriaux de la Fondation en Occitanie-Pyrénées pour qui ce travail continu de sensibilisation est
essentiel et doit permettre d’enrichir l’activité locale de la Fondation.
Les gens n’ont pas encore vraiment conscience de ce qu’est le patrimoine et de ce qu’il signifie, ce qu’il
nous apprend sur nous-même. Il y a encore du travail pour déconstruire les préjugés. […] Dans le Lot, on
a des églises, des magnifiques pierres mais ça n’est pas tout ! Progressivement on commence à voir plus
d’attention pour le patrimoine naturel. Mais c’est du travail, du terrain. (Extrait d’entretien, Délégation
régionale Occitanie-Pyrénées de la Fondation du patrimoine)
Dans ce contexte, le moulin à vent de Gignac apparaissait comme une opportunité indéniable pour appuyer la
dynamique locale et tout le travail de sensibilisation mené par la Fondation. Son caractère artisanal et le projet
d’ensemble qui était porté autour de son exploitation en faisait un projet idéal qui a rapidement convaincu la
délégation régionale.
» Une sollicitation « par bouche-à-oreille » avec des attentes réciproques
Tirant des conclusions de l’expérience de 2011, les porteurs du projet sont conscients qu’il leur faut encore
« convaincre » et mobiliser les habitants/acteurs locaux en 2016 afin de rassembler les fonds nécessaires pour
2 Atlas disponible ici : http://www.patrimoine-lot.com/fiche.asp
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 12 / 40l’entièreté des travaux. Le nom de la Fondation du patrimoine ne leur est pas étranger mais ils n’ont, jusqu’à
présent, jamais fait appel à elle.
L’occasion ne s’est pas présentée. Non pas que nous étions réticents ou quoi que ce soit mais pour nous
la Fondation intervenait sur des patrimoines plus importants, pour des budgets qui dépassaient
largement les nôtres. (Extrait d’entretien, représentant de l’association Lo Patrimoni)
L’accompagnement du projet de restauration du moulin à vent de Gignac s’est fait suite à l’orientation des
porteurs du projet vers la Fondation, via le « bouche-à-oreille » local et non pour donner suite à une logique de
« démarchage » opérée par les délégués comme cela est souvent le cas. En l’occurrence ce dossier démontre
l’importance du maillage territorial de la Fondation et sa notoriété à l’échelle locale.
Avant d’être chargé de mission sur l’Occitanie-Pyrénées, j’étais en Dordogne […] Certains maires voisins
que j’avais eu l’occasion de rencontrer ont orienté la commune de Gignac et l’association Lo Patrimoni
vers moi. Si le dossier de Gignac nous est arrivé c’est par un concours de circonstances mais pas par du
hasard ! (Extrait d’entretien, délégation régionale Occitanie-Pyrénées de la Fondation du patrimoine)
L’offre de la Fondation était peu connue des porteurs du projet. Leurs attentes initiales portaient avant tout sur
un soutien opérationnel dans la conduite du projet qui peut se traduire plus concrètement par un appui dans la
mise en place d’une collecte de dons. Le mécénat populaire était en effet identifié comme un levier financier
essentiel pour la réalisation des travaux. L’expertise de la Fondation sur le sujet était donc très recherchée. Si les
conditions d’intervention (« les 6% de frais de gestion ») ont pu interroger au départ l’association Lo Patrimoni,
l’approche présentée par M. Paulin chargé de mission au sein de la délégation régionale a su « rassurer » et
convaincre le porteur de s’engager dans une démarche partenariale avec la Fondation qui devait aller au-delà
même de l’ouverture d’une collecte de dons.
L’état d’esprit nous a plu dès le premier contact : ils sont venus chercher un appui pour travailler
ensemble. Le plus souvent c’est le culte de la « subvention » alors que nous sommes là pour être un
intermédiaire. L’aide directe de la Fondation c’est la cerise sur le gâteau. On fait les projets ensemble. […]
Pour le moulin de Gignac on était en totale confiance dès le début (Délégation régionale Occitanie-
Pyrénées de la Fondation du patrimoine)
La Fondation a ainsi été conviée à la réunion publique de 2016, temps fort durant lequel elle a présenté son
action aux participants et s’est prêtée à un jeu de questions/réponses sur la transparence des dons. La collecte
de dons a pu être ouverte très peu de temps après et force est de constater que l’adhésion populaire au projet
s’est révélée relativement forte puisque les attentes de dons ont été dépassées en à peine quelques mois.
2.2.3. L’écosystème des acteurs autour du projet
Le projet du moulin à vent de Gignac a impliqué de nombreuses parties prenantes, directes ou indirectes. Le
panorama qui suit a pu être construit avec un regard rétrospectif de 3 ans.
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 13 / 40Précisions de lecture du sociogramme
Au-delà des trois entités centrales à savoir l’association Lo Patrimoni (porteur), la Fondation du patrimoine
(partenaire) et la commune de Gignac (propriétaire), de nombreux acteurs ont été directement ou indirectement
impliqués dans ce projet.
− Du côté des pouvoirs publics, le ministère de l’Intérieur, le Département du Lot et la Région Occitanie ont
contribué financièrement au projet grâce à des subventions (cf. le point 3.1.1 du présent rapport) ;
− Les habitants ont non seulement été des partenaires financiers via la collecte de dons mais ils sont
également les principaux bénéficiaires comme nous le détaillerons plus loin ;
− Les communes voisines de Gignac-en-Quercy ont été des partenaires opérationnels en relayant par
exemple la collecte de dons. Ce sont également des bénéficiaires indirects puisque le site restauré
accueille des initiatives portées par d’autres associations du territoire. C’est également une étape d’un
circuit touristique qui peut profiter directement aux restaurants, gîtes et commerces des alentours (cf. le
point 4.4.2 du rapport).
− Les établissements scolaires ont été associés dans la restauration (via le lycée professionnel de Sarlat) ; ils
sont aujourd’hui à la fois partenaires en coorganisant des visites ou des ateliers pour les élèves et peuvent
être considérés comme des bénéficiaires dans le sens où le site leur permet d’accueillir des manifestations
scolaires qui n’ont pas directement de lien avec le moulin (cf. le point 4.6.3) ;
− Idem pour les associations culturelles et touristiques qui s’appuient sur le moulin pour enrichir leur offre
et développer de nouvelles initiatives locales. A noter que certaines ont également fait des dons au projet,
c’est pourquoi elles sont également désignées comme partenaires financiers ;
− L’entreprise La Tour du Coq a bénéficié du marché de restauration (cf. le point 3.2 du rapport) ;
− Enfin les artisans locaux sont des partenaires opérationnels car ils ont fait don de la main d’œuvre
(mécénat de compétences) et ont contribué à la réalisation des travaux (cf. le point 3.1.3)
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 14 / 403. La restauration du site
Première étape cruciale dans le déploiement d’un projet visant à préserver et valoriser le patrimoine, sa
restauration demande la mobilisation importante de l’équipe projet pour définir un plan de financement équilibré.
Dans le cadre du moulin à vent de Gignac, force est de constater que l’intervention de la Fondation du patrimoine
a permis de diversifier les sources de financement grâce à son rôle de « catalyseur » (3.1) rendant possible le
lancement des travaux et la restauration selon des savoir-faire spécifiques et locaux (3.2).
3.1. Le financement des travaux
3.1.1. Vue d’ensemble du plan de financement définitif
Récapitulatif du plan de financement global du projet :
Dépenses HT Recettes HT
Ministère de l’intérieur 4 000 €
Conseil régional 9 671 €
Conseil départemental - FAPEC 13 264 €
Fondation du patrimoine* 5 000 €
La Tournée du Coq 88 425,18 € AG2R La Mondiale* 15 000 €
Collectes de dons* 15 843,70 €
Autofinancement (commune de Gignac) 10 572 €
Autofinancement (association Lo
15 074,48 €
Patrimoni)
Total 88 425,18 € Total 88 425,18 €
* Sources de financement induites par l’activité de la Fondation du patrimoine
Caractéristiques des recettes du projet :
Autour du projet de réhabilitation du moulin à vent, plusieurs acteurs se sont mis en ordre de marche afin de
contribuer aux travaux. Si l’association des différents financeurs a permis d’atteindre les montants nécessaires à
une efficace rénovation du patrimoine communal, l’analyse de son découpage atteste de plusieurs effets
d’entrainement :
› Les financements publics (42%) :
La commune de Gignac, cheffe de file et co-porteuse du projet, a financé en autonomie près de 12% des travaux
(10 572 €). Cette part résiduelle auto-financée est liée - en partie - à la capacité de la ville à intégrer au projet ses
partenaires institutionnels historiques. En ce sens, le conseil départemental au travers d’un fonds d’aide dédié, a
contribué à hauteur de 15% du coût de la rénovation (13 264 €). Par effet d’entrainement, et en cohérence avec
la compétence touristique et d’attractivité touristique qui lui incombe, la Région a participé quant-à-elle à 11% du
plan de financement (9 671 €). L’Etat, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, a également apporté sa pierre
à l’édifice à hauteur de 4,5% du projet territorial de Gignac (4 000 €).
› Les financements privés (58%) :
Le projet a réussi à mobiliser un large panel d’acteurs privés dont la contribution globale au financement du
projet est mesurable dans d’importantes proportions.
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 15 / 40– En premier lieu, la Fondation du patrimoine, par ses successions en déshérence, mais également
par le biais de ses partenaires (AG2R La Mondiale) au travers du mécénat financier, se situe
comme un contributeur majoritaire et indispensable (23%) du financement total des travaux
(20 000 €).
– Ensuite, l’association Lo Patrimoni, co-porteuse du projet, a rassemblé 18% des fonds
nécessaires à la rénovation du moulin à vent (15 074,48 €). Plus que cela, l’association a été un
levier de la récolte de dons, puisqu’en lien avec le tissu associatif communal, elle a permis la
participation sous forme de dons d’autres associations municipales.
– Enfin, les collectes de dons qui indiquent le degré d’adhésion locale au projet mené, se sont
situées à un niveau significatif du financement global des travaux (18%). En effet, 15 843,70 €
ont été récoltés au travers de 171 dons au cours d’une unique année civile (2016).
Caractéristiques des dépenses du projet :
Les dépenses, calibrées aux besoins identifiés lors d’un diagnostic municipal, se sont concentrées sur trois tâches
principales. Si plusieurs factures associées à ces trois différentes spécificités des travaux ont été émises, un seul
prestataire a été retenu par la ville de Gignac : « La Tournée du Coq ».
On constate que le coût de la rénovation du moulin se ventile selon trois postes de dépenses :
› La charpente : poutres, planchers, relevages et trempure, capelade, civière, gouvernail, support de
couverture, corps d’escalier (etc.)
› Le fonctionnement et les mécanismes des ailes : grand arbre, rouet, frein, ailes, lanterne et drapeau,
gros fer et relevages, motorisation (etc.)
› Le système de meunerie : plancher des meules, accessoires de meunerie.
Par ailleurs, et additionnellement à ces postes de dépenses qui sont associés à des compétences spécifiques sur
lesquelles nous reviendrons (partie 3.2), il faut notifier des dépenses d’approvisionnement en bois ainsi qu’en
essais et réglages du matériel installé.
3.1.2. Les outils financiers « activés » via la Fondation du patrimoine et l’impact sur le
financement global du projet
Au travers du projet de Gignac, la Fondation du patrimoine a pu mettre en place, et à profit des porteurs de projet,
un ensemble d’outils qu’elle a pour habitude de mobiliser lors de ses différentes interventions :
La collecte de dons
Au travers d’une campagne de don annuelle engagée en 2016, les porteurs du projet de la restauration du moulin
à vent de Gignac ont pu bénéficier de 171 dons. Ce nombre représente 15 843 € dont près de 65% du montant
provient de territoires extra-communautaires (hors commune de Gignac). Cet indicateur atteste d’une part de la
capacité de la Fondation du patrimoine à rayonner au-delà des frontières territoriales des porteurs de projet,
et d’autre part de sa faculté à mobiliser les parties prenantes de la rénovation du moulin afin qu’elles puissent
jouer un rôle dans la collecte de dons (auprès de particuliers ou d’associations locales).
Complémentairement à l’intervention autonome de la Fondation, nous avons impliqué les acteurs du
projet. On les a incités à travailler en réseau et ils ont réussi à mettre leur investissement à profit du
projet et de son financement. (Extrait d’entretien, Délégué territorial de la délégation régionale
Occitanie-Pyrénées)
Outre la réussite financière de cette campagne de collecte de dons, cette dernière atteste d’un réel ancrage du
projet sur son territoire. En effet, la portée et la pertinence du projet se sont illustrées au travers des dons
provenant des habitants, des associations et des entreprises situés dans le périmètre du bassin de vie de Gignac
(dans le Lot, la Corrèze et la Dordogne).
Pluricité – Monographie portant sur l’étude de cas du moulin à vent de Gignac | Juillet 2020 16 / 40Vous pouvez aussi lire