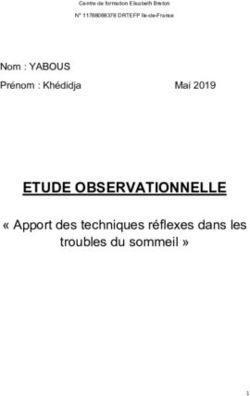How democracies lose small wars
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Fiche de lecture
« How democracies lose small wars »
« How democracies lose small wars »
Ouvrage de Gil MEROM,
Cambridge : Cambridge University Press, 2003; 300 p.
L’ouvrage de Gil Merom débute par la mise en évidence d’une anormalité : depuis 1945, plusieurs
démocraties occidentales ont perdu des guerres contre des adversaires qui leur étaient pourtant très
largement inférieurs. La Grande-Bretagne en Palestine, la France en Algérie, les Etats-Unis au Vietnam,
tous ont échoué alors même qu’ils disposaient d’une supériorité militaire incontestée. Pour Merom, ces
échecs « sont d’autant plus spectaculaires et étonnants que les protagonistes démocratiques étaient
parmi les Etats les plus expérimentés, les plus couronnés de succès (sauf pour la France), et les plus
résilients à avoir mené des guerres conventionnelles dans la période récente 1 ». D’où cette question :
comment expliquer que des démocraties occidentales aient pu perdre ces autres guerres, ces « petites
guerres », celles qui les opposent à des acteurs insurgés ?
D’emblée, l’auteur écarte deux thèses généralement avancées pour répondre à cette question :
- L’argument « réaliste », qui consiste à expliquer les défaites occidentales par la mise en place d’une
stratégie militaire inadaptée voire par des erreurs de commandements (le problème venant donc
d’un mauvais usage de l’outil militaire), ne permettrait pas, selon Merom, d’expliquer les cas où
l’un des belligérants disposent d’une supériorité militaire écrasante : quand une des parties au
conflit dispose d’un énorme avantage en termes de ressources, celui-ci ne peut pas être
complètement remis en cause par des erreurs organisationnelles et opérationnelles.
- La seconde thèse critiquée s’intéresse aux intérêts et aux motivations des acteurs. Elle stipule que,
dans le cas d’une petite guerre, le faible a beaucoup à perdre (il risque l’extermination) et
beaucoup à gagner (il peut obtenir l’indépendance de sa nation) alors que pour le fort les enjeux
sont biens moins importants et une défaite n’aura en aucun cas de conséquences existentielles. De
cette comparaison des intérêts, il ressort que le faible sera probablement plus motivé que son
1
Page 5. (“seem all the more spectacular and puzzling as the democratic protagonists were among the most experienced, successful
(except for France), and resilient states to have fought conventional wars in modern times”)adversaire. Cet avantage en termes de motivation compenserait un désavantage en termes de
ressources et aboutirait donc à un rééquilibrage du conflit. Gil Merom balaie cette hypothèse :
« Est-il raisonnable d’affirmer que les Algériens, les Palestiniens, les Libanais chiites, et d’autres
peuples qui ont gagné leur indépendance – et qui ont chassé des puissances étrangères de leur
territoire – ont fait preuve d’une plus grande motivation que les Tibétains ou les Kurdes ? 2 ».
Ayant écarté ces deux explications initiales, l’auteur présente ensuite sa propre réponse : pour expliquer
l’échec des démocraties occidentales à remporter les petites guerres dans lesquelles elles se trouvent
impliquer, il faut s’intéresser aux processus sociétaux au sein de ces démocraties. Simplifiée, la thèse de
Merom stipule que les élites intellectuelles, défendant une certaine conception morale de la vie
humaine et des droits de l’homme, s’opposent par principe à la mise en pratique du niveau de violence
nécessaire pour gagner le conflit.
De façon plus complexe, l’auteur établit un schéma développant la suite logique des événements au sein
d’une démocratie occidentale confrontée à une petite guerre :
- L’apparition ou le renforcement d’une insurrection force l’Etat à mobiliser davantage de soldats
pour mener des opérations de contre-insurrection.
- La conséquence directe de la mobilisation est une augmentation du nombre des victimes au sein de
l’armée de l’Etat démocratique.
- La détérioration de la situation conjuguée à un accroissement du nombre de morts renforce
l’opposition interne à la guerre.
- Confronté à des critiques, l’Etat démocratique tente de trouver une solution stratégique qui serait à
la fois efficace pour lutter contre l’insurrection et relativement peu coûteuse en vies humaines.
Cette solution est la brutalité : un usage souvent indiscriminé de la force, non seulement contre les
insurgés, mais également, voire surtout, contre les populations civiles qui les soutiennent.
- L’adoption de cette stratégie de la brutalité engendre des critiques à la fois au sein des forces
armées mais également au sein des élites intellectuelles, révoltées par le recours à des méthodes
« immorales ».
- L’Etat démocratique ne modifie pas pour autant sa stratégie. Il va même tenter de mobiliser
l’opinion publique en sa faveur et, si les critiques persistent, agir en trompant ses citoyens
(désinformation…), voire même en adoptant des mesures coercitives (pressions sur les leaders
d’opinion, les journalistes, arrestation d’opposants, torture, etc.)
- L’Etat devenant de plus en plus coercitif à l’encontre de sa propre population, la guerre présente
dès lors une menace pour la démocratie elle-même. Pour sauver la démocratie, il est donc
nécessaire de mettre un terme au conflit, en concédant une défaite.
Selon Merom, les Etats autoritaires, contrairement aux démocraties, sont libres d’employer la stratégie
militaire de leur choix, y compris une stratégie brutale, sans avoir à faire face à des critiques internes. En
cela, il apparaît que la « capacité des grandes puissances à gagner des petites guerres dépend par
définition de leur structure domestique 3 ».
C’est ici qu’émerge une première faiblesse dans l’analyse présentée: des Etats autoritaires ont perdu
des petites guerres. Par exemple, l’Union Soviétique a combattu neuf ans en Afghanistan contre les
moudjahidines sans parvenir à l’emporter. Il n’est pas possible d’attribuer cette défaite à des pressions
internes contre les méthodes de l’armée rouge.
2
Page 14. (“Is it reasonable to claim that the Algerians, Palestinians, Lebanese Shiites, and other communities that won independence –
and drove foreign powers off their territory – displayed greater motivation than the Tibetans or the Kurds?”)
3
Page 48. (“The capacity of strong powers to win small wars is almost by definition a function of their domestic structure”)La thèse de l’auteur repose sur trois grandes hypothèses qu’il convient d’étudier plus en profondeur :
- La brutalité constitue la solution la plus efficace et la plus économe pour battre une insurrection.
- Les élites intellectuelles au sein des démocraties se mobilisent contre le recours à un niveau de
violence jugé immoral.
- L’Etat démocratique persiste dans sa brutalité vis-à-vis des insurgés et importe certaines méthodes
coercitives pour faire face à l’opposition domestique.
De la brutalité comme approche contre-insurrectionnelle.
Gil Merom développe deux idées complémentaires qui soutiennent l’ensemble de sa thèse : le recours à
la brutalité est le moyen le plus efficace pour éliminer une insurrection ; c’est aussi le moyen le plus
économe pour l’acteur étatique.
Pour démontrer la première de ces deux idées, l’auteur relève qu’à travers l’histoire, différents Etats ont
été confrontés à des guérillas et qu’ils sont bien souvent parvenus à remporter la victoire grâce à
différentes méthodes dont notamment :
- « L’annihilation nationale » pour détruire la base populaire de l’insurrection (génocide, massacre de
masse…). Par le passé, les Etats n’hésitaient pas à s’attaquer et à tuer de façon quasi systématique
les populations civiles dans les zones où s’établissait une rébellion. Les exemples ne manquent pas,
de la révolte irlandaise matée par les Anglais et notamment Cromwell (environ un tiers de la
population irlandaise fut décimée au cours des dix années de répression) au massacre des Kurdes
par Saddam Hussein.
- « L’isolation », pour s’attaquer à la base politique de l’insurrection. Concrètement, cela recouvre,
entre autres, les déplacements de population, l’usage de la torture, etc. L’idée consiste à séparer
les insurgés des populations civiles pour mettre un terme au soutien que celles-ci peuvent fournir à
ceux-ci, mais également pour forcer les insurgés à accepter la confrontation.
- « La décapitation » qui vise les cadres politiques et militaires de l’insurrection (arrestation,
déportation, emprisonnement, exécution…)
Selon l’auteur, toutes ces méthodes ont fait leur preuve : « En réalité, l’idée de combattre une
insurrection grâce à l’éradication était apparemment si attrayante que les Etats totalitaires l’ont mise en
œuvre jusqu’à des extrêmes monstrueux, en tant que doctrine préventive et non pas réactive, conçue
pour garantir une soumission rapide à la suite d’une invasion 4 ». Et de conclure : « la conclusion la plus
dérangeante par rapport à notre position morale actuelle est que la brutalité paye 5 ».
Cette conclusion est doublement problématique. Tout d’abord, alors que Merom évoque un certain
nombre de cas où, en effet, la brutalité a payé, il passe complètement sous silence toute une série
d’autres exemples historiques où, malgré un degré de violence extrême, l’Etat n’est pas parvenu à se
défaire de l’insurrection. L’Union Soviétique en Afghanistan n’a pas lésiné sur la brutalité mais a
finalement été contrainte de se retirer. Idem pour les Etats-Unis au Vietnam : les Américains y ont
pratiqué les déplacements de population (le programme « strategic hamlet »), l’assassinat ciblé (le
projet Phoenix), et des bombardements (notamment au napalm) rarement discriminants. Pour autant,
ils ont perdu la guerre. Ces exemples démontrent que la brutalité ne paye pas nécessairement.
4
Page 42. (“In fact, the idea of fighting insurgency by eradication was apparently so attractive, that totalitarian states carried it to
monstrous extremes, as a preventive rather than reactive doctrine, which was designed to assume quick submission following a conquest”)
5
Page 47. (“the most disturbing conclusion from our current moral vantage point is that brutality pays”)Deuxièmement, l’auteur ignore toutes les méthodes moins violentes de lutte contre une insurrection.
Certes, la redécouverte en 2006 par l’armée américaine d’une théorie de la contre-insurrection insistant
sur la « bataille pour les cœurs et les esprits » n’a pas porté ses fruits en Irak et en Afghanistan.
Toutefois, plusieurs exemples historiques démontrent qu’une approche non exclusivement militaire de
la guerre, ciblant la reconstruction, le développement économique, etc., peut être couronné de succès.
Il est ainsi possible d’isoler les insurgés de la population sans recourir à la brutalité, mais en gagnant
progressivement le soutien de celle-ci.
Gil Merom ne se contente pas d’affirmer que la brutalité est la posture stratégique la plus efficace pour
lutter contre une insurrection ; il défend également l’idée – bien plus convaincante – que ces méthodes
permettent de gagner les guerres à moindre coût, en limitant les pertes humaines et les dépenses
matérielles pour l’armée qui conduit les opérations de contre-insurrection.
Pour justifier cette deuxième idée, l’auteur compare la gestion allemande et la gestion britannique de
deux guérillas africaines du début du 20ème siècle : de 1899 à 1902, le Royaume-Uni livra la seconde
guerre des Boers ; de 1904 à 1907, l’Allemagne fut confrontée à plusieurs rébellions au sein de ses
possessions africaines (l’actuelle Namibie principalement). Les Allemands décidèrent de procéder à des
exterminations de masse quand les Britanniques optèrent pour une approche plus discriminante et
chercha à isoler les insurgés. Alors que les premiers ne déployèrent que 18 000 militaires, les seconds
mobilisèrent environ 450 000 soldats dont 50 000 participèrent aux opérations offensives. Le coût
financier de ces deux guerres fut dix fois plus élevé pour le Royaume-Uni que pour l’Allemagne.
Concernant le coût humain, 7 900 militaires britanniques furent tués au combat et 14 000 moururent de
maladie, soit 22 000 au total, plus que le nombre de militaires déployés par l’Allemagne. Enfin, alors que
le Royaume-Uni fut responsable de la mort d’environ 25 000 civils, les Allemands inaugurèrent les
premiers camps de concentration, déplacèrent des populations entières dans des déserts et
déclenchèrent un véritable génocide : plusieurs dizaines de milliers, sinon une centaine, de personnes
furent massacrer. Ainsi, malgré les horreurs commises, Merom souligne l’efficacité et le coût réduit des
opérations allemandes comparées à l’intervention britannique.
L’idée qu’un certain degré de violence peut être la solution pour limiter les pertes humaines de l’acteur
contre-insurrectionnel conserve aujourd’hui encore une validité indéniable. Notamment, certaines
méthodes contribuant à la protection des troupes causent (pas nécessairement de façon volontaire,
mais en tout cas de façon régulière et inévitable) des victimes civiles : le soutien aérien en est l’exemple
le plus probant.
Le fait que la brutalité constitue une méthode économe est un point très important de l’analyse
présentée. En effet, selon celle-ci, au début de l’insurrection, l’Etat démocratique se trouve critiqué par
sa propre population qui conteste le coût humain et financier de cette guerre lointaine et non-vitale.
Dès lors, la brutalité apparaît comme un moyen de satisfaire l’opinion public en limitant le nombre de
pertes : « Parce que les pertes, notamment dans les guerres non-existentielles, menacent d’affaiblir le
soutien à la guerre, l’Etat est tenté de recourir davantage à la puissance de feu et à des niveaux plus
élevés de brutalité 6 ». Le recours à la brutalité est en cela une forme de nécessité : l’Etat ne pourrait pas
continuer la guerre sans rassurer l’opinion publique concernant les coûts du conflit et donc sans mettre
en place cette méthode économe. Toutefois, apparaît ici un dilemme : la brutalité est elle aussi critiquée
par certaines franges de l’opinion qui la jugent immorale.
6
Page 24. (“Because casualties, particularly in non-existential wars, threaten to undercut support for the war, the state is tempted to rely
more on firepower and higher levels of brutality”)L’émergence de critiques contre les méthodes brutales de l’armée.
L’auteur remarque que pendant bien longtemps, les opinions publiques ne s’intéressaient pas aux
actions de leur armée dans les guerres lointaines qu’elles menaient. Le traitement des populations
locales ne constituaient alors pas un sujet de débats. Cette situation a évolué. L’apparition puis le
renforcement d’une élite intellectuelle, voire même d’une classe moyenne éduquée, ont été à l’origine
d’un changement visible à partir du milieu du 19ème siècle. En 1845, pour la première fois, le
comportement de l’armée française en Algérie fait réagir en France : cinq cent hommes, femmes et
enfants sont asphyxiés dans une grotte où ils s’étaient réfugiés. Les parlementaires seront
particulièrement critiques vis-à-vis de cet événement. Gil Merom détaille un certain nombre d’autres
cas où le comportement des forces coloniales engendre des réactions outrées parmi les élites
bourgeoises (dont : la guerre des Boers, la pacification des Philippines, ou encore la répression de
l’insurrection syrienne à Damas en 1926). Il en conclut à l’apparition d’un « fossé normatif » entre l’Etat
(prêt à recourir à des méthodes brutales) et des citoyens éclairés (rejetant ces méthodes, immorales).Ce
fossé normatif n’a guère de conséquence initialement. Les critiques des élites intellectuelles demeurent
restreintes à certains cercles et sont largement ignorées par la majorité de l’opinion. Cela change avec
l’arrivée des médias de masse, ce que Merom appelle le « marché libre des idées 7 ».
La critique des méthodes brutales de l’armée place l’Etat devant un dilemme quasi-insoluble. D’un côté,
le recourt à la brutalité est nécessaire puisque sans lui, l’opinion publique se révolterait contre les coûts
trop importants du conflit ; de l’autre côté, la brutalité est rejetée par les citoyens éduqués au nom de
critères moraux. D’une certaine manière, l’Etat est confronté à un choix entre deux solutions (mettre en
place ou non des méthodes brutales) qui conduisent toutes deux, même si chacune pour un motif
différent, à un rejet du public.
Gil Merom esquisse ici une idée potentiellement très intéressante : l’idée qu’il existe une tension entre
efficacité stratégique et acceptabilité populaire. En mettant en avant les aspects efficace, économe et
impopulaire de la brutalité, il parvient à concevoir que la solution stratégique la plus adaptée (selon lui,
la brutalité) puisse avoir pour principal inconvénient d’être impopulaire. Si l’on reprend son
raisonnement, en modifiant simplement l’un des trois postulats initiaux (la brutalité comme stratégie
efficace), il est possible de parvenir à une meilleure conclusion. Merom explique, nous l’avons vu, que
l’émergence d’une insurrection amène l’Etat démocratique à déployer davantage de forces ; cela a pour
conséquence une augmentation du nombre de morts au sein de l’armée. Or, comme il le relève
parfaitement, l’opinion publique, au sein des démocraties, ne tolère que peu les pertes humaines dans
des guerres lointaines et non-existentielles. Ainsi, l’Etat doit développer une stratégie qui soit non
seulement efficace (pour gagner la guerre) mais également économe (pour limiter le coût humain et
financier du conflit). L’on peut s’interroger sur la capacité de la contre-insurrection (dans le sens donné
par le général Petraeus à cette doctrine) à remplir ce second critère. Il nous apparaît que certains des
préceptes développés par le général Petraeus contreviennent à première vue à ce critère : alors que le
succès d’une telle stratégie contre-insurrectionnelle repose sur une large présence au sol, à proximité de
la population, pour « tenir le terrain », marquer sa présence et rassurer les civils locaux, nul doute que
les forces démocratiques, patrouillant à pieds, sont plus vulnérables. En cela, la contre-insurrection
apparaît certes comme une doctrine militaire efficace pour faire face à une guérilla, mais s’affirme
également comme particulièrement couteuse (sur le plan humain comme financier). D’où cette
question : les opinions publiques occidentales sont-elles prêtes à tolérer les dépenses nécessaires à la
mise en place d’une stratégie contre-insurrectionnelle ? Si l’on répond non à cette question, l’on
retombe sur la conclusion de Gil Merom : il existe une tension entre efficacité militaire et acceptabilité
7
« The free marketplace of ideas »populaire ; plus encore, la structure domestique des démocraties occidentales constitue un frein à la
mise en œuvre de la stratégie militaire décidée.
La ténacité de l’Etat contesté : la France en Algérie.
La troisième grande hypothèse de Gil Merom est que l’Etat, une fois l’apparition d’une contestation
populaire du recours à la brutalité, ne va pas changer de stratégie. L’auteur affirme que les institutions
démocratiques ne vont pas modifier leur comportement : elles vont demander à l’armée de persévérer
dans la violence indiscriminée. Qui plus est, elles vont tenter d’influencer leur opinion publique. Pour ce
faire, elles ne vont pas hésiter à recourir à des moyens anti-démocratiques, dont notamment la
désinformation.
Selon Gil Merom, si la contestation se poursuit, l’Etat démocratique va progressivement importer
certaines méthodes que l’armée utilise contre les insurgés. Ainsi, les services secrets vont commencer à
faire pression sur les journalistes et sur les leaders d’opinion. Certains opposants vont faire l’objet de
poursuite, d’arrestation, voire d’enlèvement et même de torture. Petit à petit, l’Etat démocratique,
convaincu par sa cause, va devenir de plus en plus coercitif au point de renoncer à certains principes
parmi les plus fondamentaux de la démocratie.
La description que fait l’auteur de ce processus d’entêtement antidémocratique de l’Etat semble trouver
une illustration idéale avec le cas algérien. L’auteur consacre ainsi l’intégralité de la deuxième partie de
son ouvrage à l’étude de la guerre française en Algérie.
Les méthodes de l’armée française, notamment à partir de la bataille d’Alger en 1957, ont été très
critiquées : torture, exécutions sommaires, déplacement de population, etc. Le recours à la brutalité a
choqué en France, conduisant de nombreux intellectuels à dénoncer les dérives de l’armée et à appeler
à l’indépendance. Refusant de céder, l’Etat a alors adopté des mesures qualifiées de despotiques par
l’auteur. La DST arrêta et tortura non seulement des Algériens mais également quelques Français.
L’intimidation des critiques fut monnaie courante. A ce moment là, ce fut la survie de la démocratie elle-
même qui fut en jeu en France.
L’analyse faite par Merom du conflit algérien est particulièrement pertinente. Nul doute que la théorie
globale qu’il propose trouve à s’appliquer dans ce cas particulier. Toutefois, l’on peut douter de la
transposition de cette thèse à d’autres cas. Plusieurs pays démocratiques ont conduit des petites
guerres ; certains ont même adopté des stratégies plus brutales encore que la France en Algérie ;
pourtant, nulle part l’Etat démocratique a développé des mesures de rétorsion aussi drastique qu’en
France contre ses opposants internes. Il n’y a pas d’autre exemple convaincant d’Etat démocratique
s’étant transformé en Etat despotique pour prolonger une petite guerre. La réaction de l’Etat français
pendant la guerre d’Algérie n’est pas représentative. En effet, contrairement à la majorité des petites
guerres, l’Etat français percevait un enjeu extraordinairement important en Algérie : la préservation de
l’intégrité territoriale de la France (à l’époque, l’Algérie était un département français). L’existence d’un
enjeu aussi important explique sans doute la dérive autoritaire d’un Etat qui se considérait en proie à
une guerre civile.
La thèse de Gil Merom soulève certains points intéressants (notamment l’idée d’une tension entre
efficacité stratégique et acceptabilité populaire). Elle trouve dans le cas algérien une application
indéniable. Mais c’est là qu’apparaît également sa principale limite : si la thèse de Gil Merom offre une
interprétation très pertinente de la guerre d’Algérie, l’on peut douter de sa généralisation et de son
application à d’autres petites guerres. En cela, l’ouvrage de Gil Merom ne contient pas tant une Théorie,
d’application universelle, que la description – très convaincante – d’un cas particulier.
Adrien SCHU
Doctorant rattaché à l’IRSEMVous pouvez aussi lire