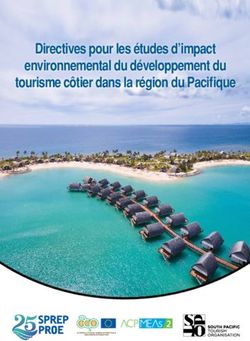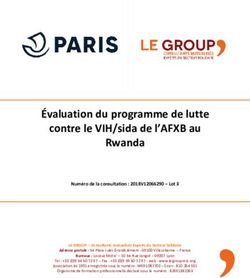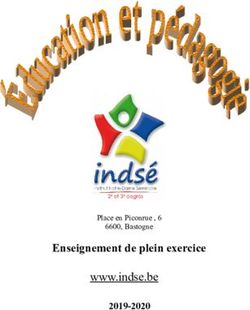Implémenter les Chemins Cliniques dans le Dossier Patient Informatisé
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Implémenter les Chemins Cliniques dans le Dossier Patient
Informatisé
1. Préambule
Sommaire
En juin 2016 l'ANAP publie Informatiser le Chemin Clinique: un gage de performance pour les établissements de
santé, texte qui à la fois sous-tend, mais aussi introduit par sa conclusion la production de ce deuxième document
consacré aux Chemins Cliniques dans le cadre du Programme Hôpital Numérique: "Comment implémenter les
Chemins Cliniques (CC) dans les logiciels de Dossier Patient Informatisé (DPI)".
"Nous constatons que de nombreuses équipes ont formalisé...des chemins cliniques et que l'informatisation est
souvent impossible ou n'est que partiellement réalisée" "Informatiser le chemin clinique : un gage de
performance..." ANAP juin 2016
Rappels
Le chemin clinique décrit, pour une pathologie donnée, tous les éléments du processus de prise en charge en
suivant le parcours patient (Forest M, Psiuk T, Richomme X, « Informatiser le chemin clinique : un gage de
performance pour les établissements de santé », Document Chapeau ANAP, Juin 2016, p 11.).
Centrés autour du patient et faisant appel à l’analyse des processus, les Chemins Cliniques sont au cœur du métier
des établissements de santé. Les liens entre l'informatisation des Chemins Cliniques et les domaines fonctionnels
du plan Hôpital Numérique sont nombreux: "agenda patient, alimentation du DPI et du DMP, pilotage médico-
économique, prescription, plan de soin".
L’informatisation des chemins cliniques place le DPI au sein de la gestion des soins et du parcours des patients, et
la richesse fonctionnelle attendue nécessite une évaluation de la maturité du DPI.
La culture de l’interdisciplinarité entre tous les professionnels de santé accompagne la construction des chemins
cliniques et également le paramétrage informatique.
2. Synthèse pour le décideur
Les Chemins Cliniques
Un premier document de l’ANAP Informatiser le Chemin Clinique: un gage de performance pour les établissements
de santé a permis de montrer en quoi la démarche des chemins cliniques permettait d’améliorer la qualité des soins
et la performance des établissements. Il s’agit, dès qu’un patient présente une configuration clinique correspondant
à un cas d’espèce régulièrement pris en charge par l’établissement, d’organiser sa prise en charge en adaptant les
bonnes pratiques préconisées par les standards scientifiques aux ressources disponibles dans l’établissement. Les
vertus des chemins cliniques s’expriment au mieux quand :
une organisation pluriprofessionnelle assure la maintenance des connaissances scientifiques, le consensus
entre les acteurs et l’insertion dans l’organisation de l’établissement
quand les écarts au chemin défini sont dépistés et analysés, car ils peuvent résulter d’une particularité
évolutive du patient à reconnaitre au plus tôt pour les traiter au mieux, ou d’une nécessité d’améliorer les
protocoles de prise en charge.
Ce document concluait en avançant que l’informatisation des chemins clinique au sein des outils métiers était la
meilleure méthode pour s’assurer de leur usage effectif.
Principes d’une informatisation idéale
Dans le présent document, nous examinons comment réaliser en pratique cette informatisation, alors que les
Dossiers Patient Informatisés ne sont généralement pas conçus pour cette tache.
Idéalement, la présence d’un certain nombre d’éléments décisionnels dans le système d'information (diagnostics,
actes, état clinique, résultats biologiques...) permet de proposer à l’équipe l’inclusion du patient dans un Chemin
Clinique, ou l’orientation dans une branche de celui-ci (un chemin clinique peut comporter plusieurs protocoles
optionnels en fonction de situations spécifiques). Les éléments de prise en charge sont alors mobilisés dansl’agenda du patient et le plan de soin, et l’équipe peut ajuster finement le séquencement des opérations, en particulier la réservation des ressources (blocs, imagerie, etc. intervenants spécialisés. ). Ce fonctionnement nécessite l’utilisation d’un langage de gestion de processus qui puisse tirer parti d’une parfaite interopérabilité entre les différentes composantes du SIH. Sauf développements locaux, cette situation ne semble pas fréquente en France. Adaptation aux SIH existants Les établissements qui ont développé l'informatisation de leurs chemins cliniques se sont donc appuyés sur des paramétrages locaux, souvent avec l ’aide de l’éditeur de leur DPI. Ils ont généralement utilisé des questionnaires, avec au mieux des liens dynamiques vers les différents composants de leurs SI (plan de soin, outil de rendez- vous). Bien souvent, il persiste des défauts de synchronisation qui nécessitent des interventions manuelles, sources d’erreurs et d’oubli, générant prolongation du séjour et perte de « créneaux » dans l’utilisation des ressources. Que l’on parte de Chemins Cliniques pré existants ou qu’on décide de profiter de l’implantation d’un DPI pour le faire, et, quelle que soit la qualité des outils informatiques, l’informatisation des chemins clinique dépend en premier d’une bonne organisation de ce qui est un programme à part entière. Il peut être judicieux d’articuler la mise en place de chemins cliniques avec des évolutions stratégiques majeures de l’établissement nécessitant la mise en place de parcours de soin, comme le lancement d’un projet de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC). On comprend qu’un des objectifs de la modélisation des Chemins Cliniques est de les intégrer dans des parcours de soin englobant des acteurs externes à l’établissement. Les logiciels qui ne permettent pas de mettre en place des prescriptions en avance de phase du séjour du patient seront très limités dans leurs fonctionnalités. Facteurs de réussite Il est important que le corps médical soit mobilisé par les enjeux de qualité des soins et de gains de temps apporté par la systématisation des parcours, pour qu’il s'implique dans la contraignante phase de définition initiale des chemins cliniques. Une démarche progressive, commençant par les cas les plus fréquents et/ou ceux qui comportent un risque dument identifié de dérive des pratiques est plus facile à mettre en oeuvre. La direction doit allouer les moyens suffisants aussi bien en formation (sur les chemins cliniques et leur implémentation) qu’en ressources informatiques, soignantes, médicales et pharmaceutiques. Il ne faut surtout pas oublier que la maintenance des chemins cliniques sur le long terme continuera à mobiliser des moyens. La communication doit être particulièrement soignée, car l’utilisation des Chemins Cliniques en routine représente un véritable bouleversement des pratiques, comportant souvent une certaine délégation de tâches. La situation peut devenir complexe quand l’informatisation des Chemins Clinique se trouve en décalage vis-à-vis du déploiement du DPI. Il est alors nécessaire de bien comprendre que l’informatisation des Chemins Cliniques représente un des principaux aboutissements du DPI, par lequel celui-ci fait le mieux la preuve de son intérêt opérationnel et entraine l’appropriation par les métiers. Sur le plan technique, on choisira de préférence des méthodes de développement agiles, plutôt qu’une méthode classique figeant en une seule tranche l’ensemble du programme. L’inscription du projet dans une stratégie globale de qualité des soins, la compétence et la légitimité de l’équipe projet sont des facteurs clés de succès. L’évaluation régulière et la réactivité de l’équipe de maintenance sont indispensables au maintien de l'adhésion des professionnels. Nous avons identifié 4 niveaux d’intégration par le moyen de questionnaire, du plus basique au plus sophistiqué, avec de nombreuses variantes. Bien entendu, le bénéfice retiré de l'informatisation allait croissant. Les relations avec les éditeurs du SIH sont cruciales, et la capacité d’agir des équipes dépendra notablement de la rédaction des appels d’offres.La bonne utilisation des clubs utilisateurs et de communautés de pratique permettant de partager constats, besoins et pratiques devrait permettre de faciliter l’informatisation des Chemins Cliniques. Conclusion et perspectives L’informatisation de Chemin Clinique, quand elle est aboutie, permet de bénéficier au mieux de la mise en place d’un système d’information hospitalier intégré, pour en tirer une franche amélioration de la qualité des soins et de la performance des établissements. On doit envisager de pouvoir l’intégrer dans des parcours de soins avec d'autres acteurs dans une logique de territoire.
À terme, on peut imaginer que des fonctionnements utilisant un formalisme tel que le BPMN (Business Process
Modeling Notation) pourraient largement faciliter le travail de paramétrage, en le réduisant à l’adaptation aux
ressources locales. Cela implique cependant que les producteurs de connaissances (Sociétés savantes, HAS,
INCA...) publient leurs recommandations selon ce formalisme, et que les éditeurs sachent les implémenter.
3. À retenir
BIEN CHOISIR SON DPI
Grâce à ces visites de sites représentatifs, les auteurs peuvent affirmer que l'informatisation partielle des chemins
cliniques est possible avec plusieurs des dossiers patients informatisés (DPI) présents sur le marché français.
ÊTRE RÉALISTE
Aucun des sites visités n'a pu montrer d'informatisation complète des chemins cliniques, même en excluant le suivi
des parcours des patients sous forme d’un arbre décisionnel. Tous sont néanmoins en capacité de faire converger
les champs d'application pour arriver à une couverture fonctionnelle presque complète. Nous avons logiquement
observé aussi que tous les Établissements de Santé ayant déployé un DPI avec un Logiciel d’Aide à la Prescription
alimentant un plan de soin sont en capacité, sauf problème ergonomique majeur, de mettre en production des
chemins cliniques diagrammes de Gantt.
PRODUCTION DE VALEUR
Gérer en parallèle l'informatisation du DPI y compris dans sa composante « logiciel d’aide à la prescription » et la
construction des chemins cliniques est probablement un avantage opérationnel dans la gestion de ce projet,
permettant d'aboutir à une industrialisation de la démarche, couvrant de façon homogène toutes les UF avec les
mêmes fonctionnalités. Il est possible qu'ainsi la production de valeur soit plus importante. L’optimisation du projet
peut ensuite continuer avec l’informatisation des outils associés (cibles prévalentes en fonction du GHP et Plans de
soins types alimentant les transmissions ciblées).
Les liens avec l'agenda patient, la gestion des ressources et la possibilité de requêtes sont très dépendants de la
cartographie des systèmes d’information de l’établissement ou du groupement d’établissements.
MOTIVATIONS INITIALES MESSAGE AUX ÉDITEURS
L’harmonisation des pratiques et leur
adaptation rapide aux évolutions des données
de la science, de l’organisation des ES et des L'ergonomie des DPI est assez unanimement critiquée dans
séjours (RAAC…) ou aux contraintes légales l'utilisation au quotidien des chemins cliniques informatisés
est une motivation constante. (lenteurs, manque de reports de données, multiplication des clics,
difficulté pour gérer les écarts) et ces demandes d'évolution
Une meilleure coordination autour du patient s'ajoutent au besoin d'avoir un outil d'élaboration et de suivi des
découle de l’écriture de chemins cliniques, parcours des patients (PERT), un module transmissions ciblées
leur informatisation est choisie pour les rendre permettant d’argumenter les écarts et sorties de chemins cliniques,
opérationnels. et la possibilité de requêter.
L’informatisation du DPI et de la Prescription L’implémentation de langages formalisés type BPMN est à
médicale peut être couplée à celle des envisager pour faciliter la mutualisation des Chemins Cliniques.
Chemins Cliniques, avec une importante
synergie.
Tableau 3.1: Motivations des projets d'informatisation des chemins cliniques
PILOTAGE DE PROJET : CONSTITUER ET MAINTENIR UNE BONNE ÉQUIPE
PROJET
Les éditeurs sont peu dynamiques dans ce domaine, et il faut une équipe projet pluri-professionnelle de qualité
poussée par un sponsoring très présent de la direction de l'établissement pour enclencher la démarche
d'informatisation des chemins cliniques, et la maintenir. Il faut que cette équipe, en lien avec la CME et la Direction
des Soins, mais aussi tous les acteurs transversaux de l'établissement, survive à la phase de déploiement du DPI
et perdure dans le mode routine, tout en étant intégrée dans l'écriture des chemins cliniques. L'informatisation des
chemins cliniques doit faire partie des offres de service que cette équipe propose aux professionnels de santé.EFFETS SUR…
les patients les pratiques médicales les professionnels le système
Diminution de la
différence de prise en Médecins : occasion d’écrire et de faire Le système et l’ES
Harmonisation
charge en fonction évoluer les chemins cliniques peuvent attendre une
des équipes Évolutivité Infirmières et autres PS non médicaux : analyse des écarts et
soignantes appropriation plus facile des prises en des évolutions par GHP
Adéquation des
Les « petits écarts » prescriptions aux charge de chaque GHP par la et par évènement
au chemin prévu sont bonnes pratiques pour présentation d’un plan de soin complet intercurrent
plus facilement et (rôle prescrit et rôle propre, mais aussi
le bon patient et au bon Bon support au pilotage
rapidement détectés moment. autonomie infirmière encadrée).
médico- économique
et pris en charge.
Tableau 3.2: Illustration des effets de l'informatisation des chemins cliniques
REGARD DES ACTEURS
Illustration 1: Perception par les acteurs de l'informatisation des chemins cliniques
4. Objectifs du document, méthode
Objectifs du document
Ce document présente différentes méthodes d’informatisation des chemins cliniques. Il s’appuie sur le retour
d’expérience d’établissements de santé représentatifs en taille et diversité du paysage français, dont la
méthodologie de recueil est détaillée ci-après.
Méthode
La méthodologie de recueil des retours d'expérience sur la démarche d'informatisation des chemins cliniques
permettra de capitaliser pour l’ensemble des établissements qui souhaiteraient se lancer dans un projet similaire.
"La réussite de la démarche d'informatisation des chemins cliniques implique alors :
Une démarche en mode projet...
Un outil d'organisation et de planification qui prévoira un lien d'interopérabilité avec l'agenda et la gestion
des ressources...
Un outil de traçabilité (en lien avec le Dossier Patient Informatisé)
Un outil d'identification et de gestion des cas..."
"Informatiser le chemin clinique : un gage de performance..." ANAP juin 2016
Ce document s’appuie sur l’expérience des experts Anap HNUM et de quatre établissements représentatifs du
paysage français (en statut, taille, activité …).Dans un premier temps un questionnaire de qualification a été adressé aux établissements de santé français pour
effectuer une présélection des établissements à rencontrer :
Méthode :
1. Avez-vous informatisé des Chemins Cliniques au sein de votre Etablissement ?
o Si OUI aller à la Question 2
o Si NON nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Ce questionnaire est
terminé.
2. Quel est le périmètre d'informatisation défini dans votre projet d'informatisation des CC ? Préciser votre
degré d'avancement dans chaque domaine : projet débutant, projet écrit, tests faits, informatisation en
cours, informatisation faite et testée, mode routine.
3. Quels outils en lien avec le Chemin Clinique avez-vous informatisés ?
1. Parcours de soins (logigramme de Pert)
2. Plans de Soins Types
3. Chemin Clinique en Diagramme de Gantt
4. Guide(s) de Séjour(s)
5. Transmissions Ciblées
6. Autres (préciser)
Après analyse des réponses obtenues, l’équipe ANAP a rédigé un guide d’entretien pour réaliser les visites dans
quatre établissements retenus :
Centre Hospitalier de Moulins Yzeure, CH
Centre Oscar Lambret à Lille, CLCC
Clinique des Cèdres à Cornebarrieu, Clinique Privée (groupe Capio)
Centre Hospitalier de Niort, CH
Ces retours d’expérience ont été complétés par des échanges moins structurés, mais riches d’enseignements avec
des établissements de santé qui ont commencé un travail pour l’informatisation des chemins cliniques encore
incomplètement déployés.
Groupe Hospitalier Catholique de Lille
CHRU d’Amiens
APHP
Exemples de chemins cliniques informatisés dans les établissements visités
CH Moulins : Patient présentant une Insuffisance cardiaque sur écart de régime alimentaire
Centre Oscar Lambret Lille : Patient hospitalisé pour une transfusion globulaire
Clinique Les Cèdres Toulouse : Patients atteints de Pancréatite aiguë dans le service des urgences.
CH Niort : AVC ischémique
Groupe Hospitalier Catholique Lille : patient hospitalisé pour une gastrectomie longitudinale de la veille
de l’intervention à la sortie
CHRU Amiens : Patient Parkinsonien devant bénéficier d’une chirurgie des mouvements anormaux, de son
entrée à son transfert en neurologie
APHP : début de paramétrage des outils de chemins cliniques dans le DPI choisi pour un déploiement
prévu à compter de 2018
5- Informatisation des chemins cliniques : le projet
L’écriture des processus de prise en charge (par groupe homogène de patient –GHP) par les équipes reste un
préalable, que l’informatisation soit réalisée en parallèle ou a posteriori.
« l’objectif de la démarche est donc bien d’identifier les différentes actions des professionnels qui interviennent tout
au long de la prise en charge du patient afin que chaque intervention de soins soit définie, optimisée, séquencée et
surtout coordonnée entre les différents professionnels. Le chemin clinique modélise un processus pour une
pathologie donnée et lors de ce processus le niveau de granularité utile est défini et détermine un choix pour la
décomposition de l’activité » (Cf. définition dans le document chapeau, annexes p11)Sous-chapitres :
5.1. Outils utilisés
5.2. État des lieux/ phase de cadrage
5.3. Gouvernance et sponsoring
5.4. Équipe projet
5.5. Gestion de projet : Particularités
5.6. Communication projet : vers une culture du chemin clinique
5.7. Mise en œuvre, analyse des risques et suivi, choix de pilote (fonctionnalité et usage), déploiement
5.8. Leviers de motivation
5.9. Facteurs clés de succès
5.10. Mise en place : paramétrage ou fonctionnalité ?
5.11. Dialogue avec l’éditeur
5.12. Clubs utilisateurs et communautés de pratique
5.13. Extension : vers la notion de parcours de soins
5.1. Outils utilisés
Le document Informatiser le Chemin Clinique: un gage de performance pour les établissements de santé montre
que la représentation globale d’un parcours de soins peut être une combinatoire de plusieurs types de chemins
cliniques présentés : le logigramme de Pert, la Check-List/questionnaire et le diagramme de Gantt. La performance
d’un logiciel de dossier patient informatisé (DPI) est de permettre le paramétrage de cet ensemble afin d’avoir une
gestion prévisionnelle des soins pour un parcours de soins complet. Cette performance est sans aucun doute un
objectif que les éditeurs doivent être en mesure d’atteindre dans une perspective d’évolution des logiciels DPI ; en
effet, lors des retours d’expérience, nous avons observé que le paramétrage des chemins cliniques restait
séquentiel avec une préférence pour les chemins cliniques diagramme de Gantt.
La construction d’un Plan de Soin Type (PST) (Cf.définition dans le document chapeau, annexes p23) à partir d’un
modèle clinique regroupant les cibles en lien avec la symptomatologie, les risques liés à la pathologie, les effets
secondaires de traitement, et les réactions humaines physiques et psychologiques, oriente la formalisation d’un
chemin clinique avec les cinq dimensions du soin : curative, préventive, éducative, de maintenance et de
réadaptation.
Les Retours d’expérience montrent que l’informatisation des Chemins Cliniques s’effectue le plus souvent à l’aide
de protocoles intégrés sous forme de Diagramme de Gantt et/ou de questionnaires spécifiques.
Sont présentées ci-dessous, les différentes modalités d’informatisation rencontrées avec leurs avantages et leurs
inconvénients :
Type Avantages Inconvénients
Les activités ne sont souvent pas
présentées dans l’ordre logique du
chemin clinique => risque de ne pas
Type 1 : Protocole respecter le chemin clinique
d’activités générées dans Adapté à une majorité d’outils
un Plan de soins informatiques existants
(Diagramme de Gantt) Le plan de soins démarre le plus
souvent à l’admission du patient dans
le service, dès lors, il n’intègre pas les
éléments préparatoires au séjour et
au suivi après la sortie.
Type 2 : Questionnaire sans Informations difficiles à visualiser pour
lien ergonomique de les chemins cliniques complexes et/ou
Saisie facilitée dans un Questionnaire
basculement vers Plan de sur plusieurs jours, risque de rupture
soins (Diagramme de Gantt) dans le circuit d’informations.
Saisie facilitée avec un Questionnaire,
À l’usage, l’ergonomie limitée du fait
Type 3 : Questionnaire avec avec lien qui permet l’accès à la totalité
de la nécessité de basculer en
lien ergonomique de des informations à charge des patients et
permanence du Questionnaire chemin
basculement vers Plan de par conséquent de limiter les risques de
clinique au Plan de soins (Diagramme
soins (Diagramme de Gantt) rupture dans la prise en charge des
de Gantt)
patients.Type Avantages Inconvénients
Type 4 : Questionnaire avec Saisie rapide des données et visualisation
liens dynamiques vers classique des données dans le Plan de Aucun
chaque « activité » du Plan soins
de soins (Diagramme de
Gantt)
5.2. État des lieux/ phase de cadrage
Sommaire
L’établissement de santé en phase préalable à l’informatisation ou en phase de renouvellement du dossier patient
informatisé (DPI) devra intégrer d’emblée l’informatisation des Chemins Cliniques dans le cahier des charges de
sélection du DPI.
Lorsque l’informatisation est envisagée à partir des chemins cliniques existants, la logique de traçabilité de
la prise en charge des patients axée sur leur parcours sert de guide pour l’informatisation du dossier. L’ensemble
des acteurs partage ainsi d’emblée un outil commun tant pour la planification que pour la traçabilité des actes.
Lorsque l’informatisation d’un chemin clinique et d’un plan de soin type associé intervient après le
déploiement du DPI, une analyse critique préalable est indispensable pour décider de l’abandon des outils
redondants (listing d’actes standards par exemple) ou des outils inadaptés à un processus de soins
pluridisciplinaire (par exemple menus déroulants de cibles 14 besoins fondamentaux ou diagnostics infirmiers). La
prévision des liens doit également être envisagée dès le début (par exemple lien fonctionnel sans clics entre le plan
de soins et la pancarte). Le chemin clinique peut alors être géré comme un outil de coordination et d’amélioration
de la performance.
La mise en œuvre d’un projet d’informatisation des Chemins Cliniques s’effectue en tenant compte de la situation
de l’établissement au regard :
de la maturité de son Dossier Patient Informatisé (DPI),
de l’antériorité ou non de l’écriture sur support papier des Chemins Cliniques,
de son actualité, de ses projets et de leur priorisation.
Évaluation de la maturité du dossier patient informatisé (DPI) en vue de réaliser des Chemins
Cliniques
Les DPI ne disposent pas tous de la même richesse fonctionnelle. Les premières générations étaient souvent de
simples transpositions du dossier patient sur support papier (recueil de données). Pour informatiser les chemins
cliniques, le DPI doit non seulement permettre de tracer, restituer et analyser l’information, mais aussi de planifier et
organiser la production de soins. Les fonctionnalités clés attendues sont les suivantes :
un plan de soin (diagramme de Gantt) alimenté par les prescriptions, unique ou communicant,
la possibilité de constituer un protocole (combinaison de plusieurs prescriptions) de médicaments, de
soins...
des transmissions ciblées avec liens vers d’autres outils du dossier patient informatisé,
des fonctionnalités d’analyse (indicateurs, requêtes. )
idéalement un logigramme décisionnel.
L’accessibilité de l’outil informatique en consultation externe est également un critère à prendre en compte.
On remarque dans certains établissements, l’intérêt de prescrire le chemin clinique applicable directement dans
l’outil informatique avant l’admission du patient. Les soins et les prescriptions médicamenteuses sont alors
applicables dès le début du séjour, après évaluation clinique du patient par l’infirmière qui l’accueille.
Clinique des Cèdres
"Les protocoles en hospitalisation programmée sont majoritairement prescrits par les anesthésistes au moment de
la consultation préanesthésique."
Bien qu’elles ne soient pas réellement des fonctionnalités, il est important d’évaluer le degré de communication
entre les modules du DPI, et l’ergonomie des fonctionnalités. Par exemple, une constante saisie dans un formulaire
alimente-t-elle la pancarte ?, une action de soin associée à un risque et initiée dans une transmission ciblée est-elle
également lisible dans le plan de soins avec le risque associé ?Exemple CH Niort : AVC ischémique Illustration 2: Utilitaire de recherche des cibles par mot clé, pour un chemin clinique
Illustration 3: Les actions de soins attachées aux cibles sélectionnées du chemin clinique sont planifiées Illustration 4: Illustration du résultat de la planification des actions Force est de constater que les différents éditeurs n’ont pas évolué au même rythme. Après analyse des retours d’expérience, il apparaît toutefois que les Dossiers Patients Informatisés observés possèdent l’essentiel des fonctionnalités nécessaires au paramétrage des chemins cliniques. En effet nous constatons que la plupart des DPI hospitaliers disposent d’un plan de soins (Diagramme de Gantt) avec des fonctionnalités de paramétrage de protocoles et de gestion des transmissions ciblées, ce qui s’avère le plus souvent suffisant pour lancer la démarche. On relève néanmoins sur la plupart de ces mêmes DPI l’absence d’un module de requête, nécessaire à l’évaluation des outils et au suivi d’indicateurs. Il ressort des retours d’expérience que cette maturité du dossier patient informatisé a influencé les objectifs eux- mêmes. Dans les établissements rencontrés en plus des REX, les équipes n’ont pas toujours pu valider la faisabilité de l’informatisation des chemins cliniques, en raison de problèmes de communication entre les modules ou d’ergonomie insuffisante du DPI. Dans ces cas, des demandes d’évolution auprès de l’éditeur peuvent s’avérer nécessaires. Antériorité de l’écriture des Chemins Cliniques Dès lors que l’établissement a élaboré des Chemins Cliniques sur support papier, le premier travail de l’équipe projet consiste à paramétrer le DPI sur la base des protocoles de prise en charge existants. Dans le cas où les Chemins Cliniques n’ont pas été définis au préalable, leur élaboration peut s’effectuer avant ou même concomitamment au paramétrage dans le DPI, selon le choix de l’équipe projet. Clinique des Cèdres : Les chemins cliniques ont été élaborés directement dans le contexte de leur informatisation, ils n'ont pas fait l'objet d'une démarche de formalisation préalable. Les chemins cliniques sont donc décrits en fonction des besoins des praticiens, puis paramétrés après quelques échanges entre l'équipe projet, l'équipe médicale et paramédicale. Ils couvrent la prise en charge des patients de l'entrée à la sortie de l'établissement. L'informatisation des chemins cliniques a suivi le déploiement du DPI, avec une première phase de personnalisation de la prise en charge (le nom interne du chemin clinique) par pathologie par praticien. Puis est venue une phase d'homogénéisation, tous les praticiens utilisent alors le même chemin clinique pour la même pathologie. Exemple de la prise en charge des patients atteints de Pancréatite aiguë dans le service des urgences :
Le chemin clinique est paramétré sous forme des protocoles de prise en charge médicale et soignant. Le protocole
est prescrit par l'urgentisre. Ils sont paramétrés avec des lignes pré-saisies pouvant être cochées ou décochées
selon les besoins d'ajustement. Les protocoles sont générés dans le plan de soins sous forme de diagramme de
Gantt. Ils intègrent des prescriptions des médicaments, des examens complémentaires, ainsi que des soins et
surveillances à appliquer.
Les écarts les plus fréquents sont prévus, paramétrés sous forme conditionnelle, et ainsi intégrés dans chaque
chemin clinique.
Actualité et projets de l’établissement (opportunités)
L’actualité et les projets de l’établissement peuvent constituer des situations favorables à la mise en œuvre de
projets d’élaboration de Chemins Cliniques et leur implémentation dans le DPI.
Pour exemple, le lancement d’un projet de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC), pour lequel l’écriture
des chemins cliniques est systématisée.
L’étude de faisabilité réalisée dans les établissements met en évidence deux points importants (on présuppose
l’existence d’un réseau informatique performant et d’un financement des postes de travail déjà acquis) :
La constitution d’une équipe pluriprofessionnelle
Le financement de cette équipe pour en assurer la pérennité.
L’informatisation des chemins cliniques combinant deux projets au cœur du métier d’un établissement de santé, les
bénéfices attendus une fois l’objectif atteint doivent être importants, à confronter avec la gravité d’un évènement
indésirable ou l’impact d’un dysfonctionnement, le tout au prix d’un effort de changement patent pour les
utilisateurs. Une Analyse des Risques Projet, très formalisée ou non, accompagne dans les établissements de
santé visités les choix proposés par l’équipe projet et portés par le management.
5.3. Gouvernance et sponsoring
Sommaire
Comme tous les projets impactant les organisations, l’informatisation des Chemins Cliniques nécessite :
D’être porté par la Direction et le Président de CME, permettant d’induire une vraie culture du chemin
clinique
D’être présenté aux différentes Instances (CME, bureaux de pôles… )
De faire l’objet d’un plan de plan de communication institutionnel
"La DSAP a souhaité promouvoir une démarche institutionnelle sur le management par la clinique au service du
parcours patient. L'amélioration de la prise en charge du patient par une démarche mieux coordonnée entre
médecins et soignants, qui garantit qualité et sécurité des soins, est un enjeu majeur pour nos organisations
hospitalières...le raisonnement clinique partagé s'inscrit dans les 10 orientations du projet de soins 2015-2019 et
plus spécifiquement à travers 4 axes :
développer la coordination médecins-soignants pour une prise en charge efficiente
s'inscrire dans une démarche continue d'amélioration de la qualité des soins et de prévention des risques
évitables liés aux soins
développer et formaliser les parcours de soins
accompagner l'informatisation du dossier de soins
La DSAP a saisi l'opportunité de l'informatisation du dossier patient et de la V2014, pour ancrer la collaboration
médico-soignante dans une évolution de la culture de l'AP-HP et apporter une vision du changement des pratiques
professionnelles"
Françoise ZANTMAN, Directrice de la direction des soins et des activités paramédicales (DSAP) Magazine
Transmissions dossier le raisonnement clinique partagé N°54 septembre 2016
Nous pouvons donc constater que nous n’en sommes qu’aux prémices de l’informatisation des chemins cliniques :
la majorité des établissements visités a informatisé des chemins cliniques partiels qui ne suivent pas le parcours de
soins complet des groupes homogènes de patients. Cette performance ne sera atteinte qu’avec une volonté
institutionnelle de la direction et de la commission médicale d’établissement.Le chemin clinique touche au cœur de métier des praticiens et paramédicaux; c’est le fondement d’une
gouvernance clinique qui se doit d’apparaître dans un projet d’établissement afin de motiver l’ensemble des
professionnels.
CH Niort
L'établissement a fait le choix d'un budget fort de formation continue sur le chemin clinique (priorisé également sur
le plan de formation pluri-annuel), qui évolue vers une formation au plus près des services. Aujourd'hui, 1/3 des
services de l'établissement sont dans la démarche avec des chemins cliniques papier construits. L'organisation du
projet d'écriture des chemins cliniques est particulièrement structurée, et animée par deux cadres de santé.
Clinique des Cèdres Toulouse
L'un des déclencheurs de l'adhésion dans l'établissement de l'émergence d'une culture du chemin clinqiue semble
avoir été la RAAC : elle a entraîné la recherche d'un consensus médical par spécialité et par prise en charge.
Centre Oscar Lambret Lille
Une partie de l'équipe actuelle était déjà présente lors des travaux réalisés en 2000 sur les chemins cliniques. Leur
ténacité est à l'origine du projet d'informatisation qui a évolué sans cesse jusqu'à la gestion de requêtes pour
identifier les écarts et les sorties du chemin clinique. L'ancienneté des cadres de soins dans l'établissement est un
élément très favorable à la mise en oeuvre et à l'évolution des chemins cliniques et des outils associés. Les cadres
de soins dans ce centre sont des cadres cliniciens qui, suite à une formation ont continué à accompagner la
construction des plans de soins types et des chemins cliniques dans leur unité de soins, ce qui explique le nombre
actuel d'outils construits. La volonté de la directrice des soins d'informatiser ces outils et la réussite dans les 2
services pilotes est un levier de motivation pour l'ensemble des équipes ; les témoignages des IDE que nous avons
rencontrés sont très positifs.
5.4. Équipe projet
Sommaire
Indépendamment des fonctionnalités des logiciels de DPI, c’est la constitution de l’équipe et le cadencement du
projet qui pourra faire la différence sur le périmètre et la maturité obtenus.
Le projet d’informatisation des chemins cliniques est un projet pluriprofessionnel par essence. Il convient de ne pas
confondre l’équipe dédiée à l’informatisation des chemins cliniques avec les équipes dédiées à la construction des
chemins cliniques dans les différents services de spécialité.
La composition de l’équipe projet « Informatisation des chemins cliniques » est similaire dans les différents
établissements visités : elle est pluriprofessionnelle, et intègre des ressources dédiées au paramétrage des
chemins cliniques dans le DPI, qui sont nécessairement des professionnels de santé.
Le financement de cette équipe pour en assurer la pérennité. Lors du paramétrage du chemin clinique
et des outils associés tels que le Plan de Soin Type (PST), il faut d’emblée prévoir leur ajustement régulier,
issu soit d’une veille documentaire ou de l’évolution des recommandations des sociétés savantes, soit de
l’analyse des écarts positifs ou négatifs réalisée à partir de requêtes. C’est une condition essentielle pour
permettre aux équipes soignantes d’entrer dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité et
toujours conserver un niveau de sécurité dans les pratiques professionnelles. C’est l’un des motifs du
maintien d’une équipe en phase d’exploitation.
Composition de l’équipe projet : ressources permanentes
Un chef de projet cadre de soin : pour les établissements ce choix favorise la cohérence entre les besoins
d’usage pour les soignants et les contraintes informatiques. Les cadres de soin sont en plus à même de
participer à la communication autour du projet dans l’ensemble de l’établissement. Cette ressource
indispensable n’a été pourtant mobilisée à temps complet que le temps du déploiement et dans un seul
établissement, et est donc sur le projet à temps partiel (50 à 80%) dans les autres expériences.
Une équipe de paramétrage composée de professionnels de santé, le plus souvent plusieurs IDE, à temps
partiel. L’implication directe et continue d’un praticien n’est rencontrée qu’une seule fois, à temps partiel.
Le temps partiel affecté aux ressources permanentes n’est pas décrit comme un manque. En effet le lien
avec les utilisateurs est renforcé et les établissements sont bien dans un projet en lien fort avec les usages
et leur cœur de métier.
Et bien sûr des responsables Système d’InformationComposition de l’équipe projet : ressources ponctuelles
la Direction de l’établissement et la CME doivent mettre des ressources supplémentaires à disposition, de façon
ponctuelle et ciblée selon les besoins du projet. On trouve :
Un praticien (au moins un par UF)
Des soignants non médecins des UF et des Unités Techniques (bloc, soins critiques, urgences…)
Un pharmacien
Des soignants non médecins et non IDE : AS, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues…
Des membres des fonctions supports et administratives
Responsables Qualité et Risque
Point d’attention (rappel)
Trois des établissements visités sont restés en mode projet depuis plusieurs années, un seul est passé en mode
routine. L’impact financier et organisationnel d’un tel projet est donc important et durable :
Impact financier : le financement des personnes ressources, permanentes et ponctuelles, doit faire réfléchir
à l’opportunité de regrouper en une seule équipe projet les ressources pour écrire les chemins cliniques et
celles pour les informatiser. Ce d’autant que le mode routine ne pourra s’accompagner automatiquement
d’une diminution importante du coût de l’équipe. Un seul établissement a fait ce choix, mais c’est aussi celui
qui a informatisé le plus de chemins cliniques (plusieurs centaines) et peut en attendre le plus de production
de valeur (aide au passage à la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie –RAAC- et à l’Ambulatoire par
exemple).
La présence d’un praticien dans l’équipe permanente a un coût organisationnel (ressource rare) et financier
important. Ce choix est appuyé sur les objectifs fixés du projet d’informatisation de l’établissement,
notamment la volonté ou non d’intégrer les prescriptions médicamenteuses au PST et la recherche
d’harmonisation rapide ou non des pratiques.
L'équipe projet, par la participation à l'évolution de l'écriture et du paramétrage des chemins cliniques, doit être à
même d'accompagner les modifications organisationnelles de l'ES et de son environnement, les modifications de
bonnes pratiques.
Quand des requêtes sont possibles pour connaître et analyser les sorties de chemin clinique (un seul établissement
visité), l’équipe doit être aussi en capacité de proposer la révision des chemins cliniques et d'en assurer le
paramétrage.
Des liens réguliers avec la CME et l’équipe de Direction sont nécessaires (groupe de travail CME, participation au
CODIR par exemple).
5.5. Gestion de projet : Particularités
Sommaire
Implémenter les chemins cliniques dans le dossier patient informatisé (DPI) implique une démarche
programmatique atypique, car il s’agit souvent de la jonction de deux programmes :
o Choisir, concevoir, déployer et utiliser les chemins cliniques en routine dans l’établissement
o Informatiser le dossier patient
La phase d’informatisation des chemins cliniques, suivie de leur déploiement est cadencée à un rythme
propre à chaque établissement. Elle impose néanmoins d’enchaîner rapidement du mode déploiement au
mode routine, voire dans les structures visitées d’avoir certaines UF ou certains chemins cliniques en mode
déploiement, et d’autres en mode routine de façon simultanée.
C’est un programme à part entière : les chemins cliniques sont la description et ensuite le support du cœur
de métier d’un établissement (prendre soin d’un patient quel que soit son parcours). Leur évolutivité découle
de la réévaluation des bonnes pratiques, des évolutions organisationnelles, de la boucle d’amélioration
après étude des sorties de chemin clinique, et rend le mode routine particulièrement dynamique.
Cette démarche peut s’appréhender soit en cycle court (démarche Agile), soit en cycle long (dit cycle en V,
démarche classique des projets informatiques). En l’occurrence, comme il ne s’agit pas de développer des
nouvelles fonctionnalités, mais de les paramétrer et les utiliser, les cycles courts semblent plus pertinents. La
distinction entre une démarche Agile et une démarche classique dans le contexte de l’informatisation des chemins
clinique se place dans l’enchaînement séquentiel entre la conception et la réalisation, c’est-à-dire de l’écriture des
chemins cliniques à leur traduction dans les outils du DPI. En effet, aucun des établissements rencontrés n’a
attendu de concevoir tous les chemins cliniques pour tous les informatiser, et tous les déployer. Pour tous, acontrario, chaque chemin clinique est vu comme un mini-projet, avec une étape de conception (écriture), une étape
d’informatisation, puis de validation avant déploiement et le début de la phase d’exploitation. Dans son principe, la
démarche Agile s’appuie sur une grande proximité paramétreur-utilisateur et une boucle rétroactive courte qui
permet d’adapter très rapidement les outils au contexte d’utilisation. Nous utiliserons donc le terme Agile pour
distinguer ceux des projets pour lesquels conception et paramétrage des chemins cliniques sont quasi-simultanés
et le terme de séquentiel pour les autres.
Clinique des Cèdres
La méthode de déploiement utilisée est de type Agile, avec des cycles évolutifs, très adaptée à l'initialisation, car
elle favorise par la réactivité qu'elle apporte, l'adhésion des utilisateurs aux outils proposés. Pour le futur, avec le
nombre de chemins cliniques réalisés et en cours d'utilisation, le groupe projet envisage une démarche plus
construite, tout en conservant de la réactivité pour intégrer des évolutions externes, comme une recommandation
de société savante, par exemple.
Cycle long Cycle court
CH Moulins Izeure
Établissements CLCC Oscar Lambret Clinique des Cèdres
(Capio)
CH Niort
Tous types (chemins cliniques diagramme de Gantt Tous types, mais
avec regroupement des prescriptions médicales et utilisation faible des
paramédicales dans le plan de soins, liens avec les transmissions ciblées
Types de chemins cliniques transmissions ciblées si écarts du chemin clinique),
Pas d'outils de parcours
Pas d'outils de Parcours (PERT) (PERT)
Oui, avec formalisation d'un Plan de soin type et
Travail sur les chemins cliniques
ensuite du chemin clinique (liens risques et actions)
déjà lancé avant le dossier Non
construit par une équipe pluridisciplinaire et validé par
patient informatisé (DPI)
le corps médical
Étape dans le projet lors de la Mode routine sur
Déploiement en cours, voire pilotes
visite l'ensemble des UF
PST infirmiers et aides-soignants
Utiliser les transmissions ciblées pour argumenter les
écarts et sorties de chemins cliniques et planifier PST toutes
Objectifs principaux
l'ajustement des actions administrations et soins
Requête et qualité à Oscar Lambret
Implication de médecin dans le
Non, cependant la participation des médecins existe
paramétrage et le déploiement Oui
toujours dans le travail réalisé avant le paramétrage
du DPI et des chemins cliniques
Implication de cadre de soin
dans le paramétrage et le
Oui Oui
déploiement du DPI et des
chemins cliniques
Implication d’IDE ou d’ASQ dans
le paramétrage et le
Oui Oui
déploiement du DPI et des
chemins cliniques5.6. Communication projet : vers une culture du chemin clinique
Sommaire
La formalisation des chemins cliniques est récente en France malgré les recommandations de la haute autorité de
santé publiées en 2004. Pour les équipes soignantes comme médicales, la culture du chemin clinique est donc
nouvelle, et son acquisition nécessite une formation adaptée. Cette première étape de communication, qui touche
d’abord les équipes en charge de la conception « papier » des chemins cliniques, sera progressivement étendue.
En effet, l’informatisation des chemins cliniques est un levier majeur de diffusion de cette culture émergente, ce qui
en fait un projet dont la communication sera particulièrement soutenue.
L’enjeu est fort d’une communication structurée, à l’échelle de l’établissement, notamment auprès de la DSIO avec
qui l’équipe « métier » va partager les enjeux de l’informatisation. On distingue trois étapes majeures :
La conception, où la communication peut se faire notamment via les formations « métier », et touchera
principalement les équipes soignantes, les médecins étant sollicités a minima pour validation,
L’informatisation, qui concrétise la démarche et l’implante dans le mode de fonctionnement de
l’établissement, où la communication vise essentiellement la DSIO et les utilisateurs du DPI nouvellement
paramétré,
L’évaluation des résultats en vie courante, qui instaure un cycle régulier de réévaluation, et permet d’étudier
et mesurer la valeur apportée par les chemins cliniques informatisés, où la communication touchera plus
largement les acteurs de l’établissement.
Les cibles, dont la sollicitation pourra varier selon les étapes et l’ampleur du projet, sont : la direction de
l’établissement, la direction administrative et financière, les ressources humaines, la direction des systèmes
d’information, les médecins et les soignants.
Les équipes médicales et paramédicales qui ont concrétisé les chemins cliniques ont été le plus souvent
accompagnées par une formation. Dans les 7 établissements visités, 6 ont effectivement suivi ces étapes :
formations avec production de plans de soins types, chemins cliniques et parfois guides de séjours en outils papier
puis démarche de communication auprès du service informatique pour informatiser ces outils.
Un second enjeu de communication concerne le corps médical, dont la contribution est essentielle à la validation
des chemins cliniques conçus par les équipes métier, et incontournable au moment de la mise en œuvre des
chemins cliniques informatisés.
Dans les expériences recueillies, les médecins ont participé à la validation définitive des chemins cliniques et des
plans de soins types, mais le constat est que ces médecins ne prescrivent pas le chemin clinique complet lorsqu’il
est informatisé dans le DPI. La prescription partielle est réalisée par l’IDE (soins du rôle propre) et les
thérapeutiques protocolisées ou individuelles sont prescrites par le médecin. Dans un des établissements, les
chemins cliniques ont été directement paramétrés suite aux consensus médicaux, sans la formalisation d’un Plan
de Soin Type au préalable. Dans cet établissement la prescription des chemins cliniques est faite par les médecins.
Centre Oscar Lambret Lille
La prescription médicale n'est pas encore mise en oeuvre dans les chemins cliniques au moment de la visite. Les
praticiens sont toutefois étroitement liés au processus de construction des chemins cliniques et des plans de soins
types. La Directrice des soins doit évoquer ce point avec le président de la CME.
CH Niort
Les Chemins Cliniques sont une priorité institutionnelle dans le projet de soins 2013-2017. Pour ce projet d'abord
axé sur les soins, l'adhésion des équipes médicales est anticipée sur l'intérêt de la démarche.
Les utilisateurs des chemins cliniques sont essentiellement les IDE et les AS, et dans une moindre mesure les
praticiens (chirurgiens, anesthésistes) pour lesquels des protocoles ont été créés. L'IDE prescrit le chemin clinique
à l'arrivée du patient.
Clinique des Cèdres Toulouse
Les chemins cliniques sont écrits en fonction des besoins décrits par les praticiens, puis paramétrés après
quelques échanges entre l'équipe projet, l'équipe médicale et paramédicale. Les médecins et les IDE sont les
principaux utilisateurs des chemins cliniques (tous informatisés), mais ils peuvent être utilisés par les fonctions
supports, mobilisées par le biais des prescriptions médicales contextualisées/mises en oeuvre dans le chemin
clinique. Parmi les médecins, les prescripteurs incontournables sont les anesthésistes, au coeur du processus de
prise en charge chirurgicale (pour l'activité programmée et dans le cas des diagnostics réalisés). On note toutefois
l'intérêt de l'équipe des Urgences pour les chemins cliniques séquentiels comme complets.
La diffusion encore récente de la culture du chemin clinique fait que dans les établissements de santé, le dossier
patient informatisé (DPI) s’est le plus souvent déployé avec le paramétrage des outils utilisés dans le dossier papierVous pouvez aussi lire