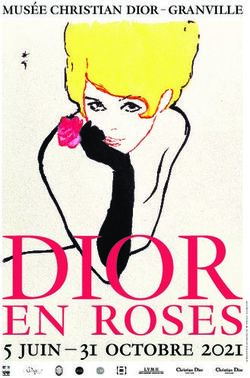JOURNAL LITTÉRAIRE Bernard Quiriny - Revue Des Deux Mondes
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
JOURNAL LITTÉRAIRE
› Bernard Quiriny
L’auteur de L’Affaire Mayerling a tenu un journal en évacuant tout ce qui
n’est pas de la littérature.
22 mai. Philip Roth et Tom Wolfe
Morts coup sur coup, à huit jours d’intervalle. Du second, je n’ai pas
lu Le Bûcher des vanités (mettons que je me rattraperai d’ici la fin de ce
journal) mais Moi, Charlotte Simmons, excellent roman de campus, et
Bloody Miami, qui m’a laissé un souvenir de crépitement typographique
incompréhensible, mélangé d’injures en espagnol. Question de généra-
tion, sûrement : on ne se comprend jamais,
Bernard Quiriny est écrivain et
avec les jeunes gens comme Wolfe. Roth, critique littéraire. Derniers ouvrages
lui, s’en va sans le Nobel. Beaucoup y voient publiés : Histoires assassines
une terrible erreur du jury, et une injustice (Rivages, 2015) et L’Affaire Mayerling
pour Roth. Personnellement, je trouve plu- (Rivages, 2018).
tôt qu’il l’a échappé belle : avec ses lauréats aberrants (Bob Dylan), son
esprit de sérieux terrifiant et son côté politiquement correct exaspérant,
le Nobel est devenu embarrassant. Pour ne rien arranger, le jury est
enlisé dans un scandale à la Weinstein ; la crise est telle, dit-on, qu’il
n’y aura pas de prix en 2018 – à la place, on en remettra deux en 2019,
116 NOVEMBRE 2018littérature
un peu comme le Comité international olympique a sélectionné deux
villes l’an dernier, trop content d’avoir deux clients pour fourguer sa
camelote. Dans dix ans, le CIO payera les villes pour qu’elles reçoivent
les Jeux. Le Nobel, prévoyant, paye depuis toujours.
4 juin. Lucien d’Azay
Réédition de son livre sur Fragonard, La Volupté sans recours, qui
m’intéresse moins pour son sujet (Le Verrou) que pour sa forme : une
collection d’études de trois pages, qui prennent Le Verrou sous tous les
angles, sans esprit de système. L’auteur aurait pu, comme B.S. John-
son, l’avant-gardiste cher à Jonathan Coe, les publier en brochures dans
une boîte, à mélanger avant lecture. Pourquoi cette forme désinvolte
me séduit-elle ? Mon Monsieur Spleen, à l’époque, était déjà dans cette
veine : idéal du livre-promenade, souple, composé d’instinct, sans réflé-
chir. La chose étrange, c’est que je suis en même temps un admirateur
des dispositifs contraignants, type Perec-Oulipo. Allez comprendre.
Au sujet du Verrou, je m’émerveille que ce tableau n’ait pas encore
été décroché par les censeurs, comme ces nus de la Manchester Art
Gallery, évacués l’hiver dernier pour alerter le public sur le sexisme
révoltant de la peinture victorienne. Beaucoup de commentateurs
militants jugent que Fragonard a peint un viol, et suggèrent de don-
ner ce titre au tableau. D’Azay, inconscient du danger (il écrivait en
1996), suggère avec malice que l’héroïne aime peut-être que son amant
la brusque : « Se montrerait-elle encline au vertige de la pente ? » En
2018, ce propos frise la correctionnelle. Sous les verrous !
7 juin. Édouard Louis
L’Opinion nous informe que son dernier livre, Qui a tué mon père
(Seuil, 2018), fait un tabac chez les conseillers de l’Élysée.
On part d’un président qui pose avec les « Pléiade » de Gide et de
Stendhal sur la photo officielle, on se retrouve au bout d’un an avec
des conseillers qui lisent Édouard Louis.
En politique, je ne sais pas, mais en littérature, le macronisme est
une débâcle.
NOVEMBRE 2018 117bernard quiriny
8 juin. Patrick Reumaux
On parle toujours de nos écrivains préférés, jamais de nos traduc-
teurs favoris. Non pas au sens où l’on aimerait leur façon de traduire
(il faudrait être bilingue, ou traducteur), mais au sens où l’on goûte
ce qu’ils traduisent. Plutôt que traducteur, c’est passeur qu’il faudrait
dire. (Ou importateur, mais ça fait commercial.) Quel est votre passeur
favori ? Je veux dire, celui qui vous a fait découvrir tel univers étranger,
telle galaxie d’écrivains lointaine ? Les amateurs de littérature étrangère
ont tous un passeur préféré ; quand ils voient son nom sur une cou-
verture, ils bondissent. Ils n’achètent pas un livre parce que le nom de
l’auteur leur dit quelque chose, mais parce que cet auteur est adoubé
par le passeur. Prenez Patrick Reumaux, éminent connaisseur de la lit-
térature anglo-saxonne : je lui dois d’avoir découvert Theodore Francis
Powys et Flann O’Brien ; ainsi, grâce à lui, ma vie a un peu changé. Du
coup, je surveille tout ce qu’il traduit – plutôt j’essaye, car il traduit
beaucoup. Je le retrouve ces jours-ci dans la réédition de Gormenghast
de Mervyn Peake, ainsi que dans Les vieux soldats ne meurent jamais,
recueil de textes courts irlandais par Lord Dunsany, Mary Lavin et Sean
O’Faolain. Celui de Dunsany (1878-1957), pionnier de la fantasy, est
délectable : le narrateur raconte ses conversations avec Dean Spanley, un
honorable clergyman qui, si on l’imbibe convenablement de tokay, entre
en transe et se rappelle sa vie antérieure, où il était un chien. Alan Sharp
en a tiré un scénario, porté à l’écran en 2008. Pas vu le film. Content
d’avoir lu le livre, grâce à mon passeur favori.
9 juin. George Orwell
Orwell, partout, ces temps-ci : le Comité Orwell, les titres des gazettes
qui l’invoquent pour dénoncer – à juste titre ! – la délirante proposition
de loi sur les fake news en discussion à l’Assemblée (1), la retraduction
de 1984 par Josée Kamoun. Je n’ai pas lu cette dernière mais j’apprends
que Thought Police, « police de la pensée », y devient « mentopolice »,
et newspeak, novlangue, « néoparler ». Bon. « Mentopolice » ne veut
rien dire ; on dirait le nom d’un bonbon mentholé pour CRS. Quant à
« néoparler », ça fait petit-nègre. « Novlangue » charriait tout un imagi-
naire que je ne vois pas de raison d’avoir évacué. Il faudra lire les expli-
118 NOVEMBRE 2018journal littéraire
cations de Josée Kamoun, et sa version. Voilà qui montre comme il
est délicat de changer les traductions anciennes. Prenez Bartleby : je n’ai
jamais pu me faire aux variantes imaginées après Pierre Leyris pour I
would prefer not to, « je préférerais pas » – avec cette faute délicieuse qui
donne à la réplique son charme négatif et buté, si approprié au person-
nage (2). Jean-Yves Lacroix écrit : « Je préférerais ne pas » ; Jérôme Vidal
« J’aimerais mieux pas. » Variantes possibles, mais j’en reviens à « je pré-
férerais pas », charmant, net, définitif. « Néoparler », je préférerais pas.
26 juin. Albert Camus, Antonio Gramsci, etc.
Article du Monde sur la nouvelle manie des intellectuels conser-
vateurs d’accaparer des intellectuels progressistes, Orwell, Camus,
Gramsci, Weil, etc. C’est intéressant, mais révélateur d’une certaine
conception de la vie intellectuelle. Alain, je crois, repérait quelqu’un
qui n’est pas de gauche au fait qu’il récuse le clivage droite-gauche.
J’en déduis qu’on repère un homme qui n’est pas de droite au fait qu’il
classe tout en gauche-droite. S’interroger sur le pourquoi de l’appétit
de la droite pour les auteurs de gauche, c’est une question de gauche :
« Comment se fait-il que vous aimiez Gramsci, qui était de gauche ?
– Vous, vous êtes de gauche.
– Oui, comment l’avez-vous deviné ?
– C’est écrit dans votre question. »
27 juin. Jean Guéhenno, Marcel Jouhandeau
Aujourd’hui j’ai 40 ans. Ce serait le moment de lire le Journal d’un
homme de 40 ans de Jean Guéhenno, surtout que je n’avais pas lu il y a
dix ans le Journal d’un homme de 30 ans de Mauriac. (Je suis allé voir
s’il existe un « Journal d’un homme de 50 ans », pour prévoir, mais
non). Je me suis offert pour l’occasion une visite à la Communauté
Emmaüs du coin, caverne d’Ali Baba du livre d’occasion où je m’ap-
provisionne souvent. Dans la récolte du jour, pas de Guéhenno (c’eût
été trop beau) mais Du pur amour de Marcel J ouhandeau, exemplaire
acheté le 24 mai 1982 par un certain Jérôme Blin à la Fnac des Halles
(griffonnage au bic, en première page). Qu’est devenu ce M. Blin ?
À quoi jouais-je, âgé de 3 ans et demi, ce lundi-là sous Mitterrand ?
NOVEMBRE 2018 119bernard quiriny
Et comment ce volume, parti des Halles en 1982, est-il arrivé chez
Emmaüs à D***, en 2018 ? Il faudrait glisser des puces électroniques
extrafines dans les couvertures des livres, comme les « boîtes noires »
des poids-lourds, pour retracer leur vie, de l’imprimeur à leur dernier
propriétaire, en l’occurrence moi.
2 juillet. Remy de Gourmont
Le Mercure réédite Le Désarroi, petit roman des années 1890,
découvert dans les années deux mille par les fanatiques du Cargo (le
Cercle des amateurs de Remy de Gourmont). J’en profite pour rouvrir
ses Promenades littéraires, achetées chez un bouquiniste pour le cha-
pitre sur Henri de Régnier, et que je n’avais jamais lues en entier. Quel
livre superbe, quel festival de choses justes ! Sur la critique, notam-
ment, dans le chapitre consacré à Ernest Renan. Gourmont explique
très simplement pourquoi la critique est un genre à part entière, pas
moins noble que les autres. Simplement, un critique a besoin pour
exister de prendre appui sur un auteur ; mais celui-ci n’est qu’un pré-
texte. Moyennant quoi, ce qui compte sur la couverture d’un ouvrage
de critique sur X ou Y, c’est le nom du critique, pas celui de X ou Y.
Bref, le critique est un écrivain, qui ne parle jamais que de lui.
6 juillet. Christiane Taubira
Tribune passionnée de l’ancienne garde des Sceaux, après l’abrogation
du délit de solidarité par le Conseil constitutionnel. « Les sages du Conseil
constitutionnel ont considéré qu’il était temps pour nous d’entrer dans
le XXIe siècle, de prendre au sérieux les idées et les combats ayant tissé
la cohésion d’un peuple qui cultive un tel tropisme prométhéen. » C’est
beau. Vraiment beau. Mais qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
8 juillet. Mark Greene
Je plonge dans les livres de la rentrée. C’est à peine une image, plon-
ger : il y a tant de romans qu’on a l’impression d’un océan. Je sélectionne
sans méthode, me fiant à des souvenirs de lectures, aux quatrièmes de
couverture, à l’éditeur, au hasard. Mais il n’y a pas de hasard en littéra-
ture : un livre, s’il est fait pour vous, vous parvient toujours. Donc j’ai
120 NOVEMBRE 2018journal littéraire
ouvert, au flair, Federica Ber de Mark Greene. Bonne pioche : superbe
roman modianesque, inattendu, atmosphérique, plein de notations
bien vues sur le sentiment du passé, l’impression d’irréalité du présent,
les irruptions du passé dans le présent. Dans ce livre flotte un mystère
que l’auteur, par la voix de son héroïne, explique ainsi : il ne faut pas
chercher à fixer les choses, mais « laisser de l’air ». Les bons romans,
évocatoires et magiques, sont comme la glace industrielle, pleins d’air.
16 juillet. Édouard Louis (bis)
Outrées que le prix Nobel de littérature ne soit pas décerné en 2018,
des personnalités du monde de la culture suédois ont monté une acadé-
mie bis. « La New Academy, expliquent-elles, a été fondée pour garantir
qu’un prix littéraire international sera décerné en 2018, mais aussi pour
rappeler que la littérature doit être associée à la démocratie, l’ouverture,
l’empathie et le respect ». Comme on voit, ça part mal. Une liste de 47
lauréats possibles a été établie, où figurent trois Français : Nina Bouraoui,
Maryse Condé et… Édouard Louis ! Même pas né, ce prix alternatif est
déjà plus ridicule que l’autre. Les Suédois devraient arrêter de s’occuper
de prix.
20 juillet. Marcel Aymé
Invité à Dives-sur-Mer, je profite d’être interrogé sur mes lectures
fantastiques pour faire l’éloge de Marcel Aymé, fidèle à mon principe de
ne jamais manquer l’occasion de placer son nom. Il vient d’autant plus
à propos qu’on projette le soir même une adaptation du Passe-muraille
en présence du réalisateur, Dante Desarthe. Je ne trouve pas le temps
de dire à ce dernier combien je trouve son film réussi, à la fois fidèle à
l’esprit désinvolte et léger d’Aymé et tout à fait personnel. Je me rattrape
ici, comptant qu’il lit cette revue.
31 juillet. Papini, Hardellet, Balzac
Je prépare mes lectures de vacances. Deux livres que je veux relire : Gog,
merveilleux musée d’inventions de Giovanni Papini, Italien très oublié
car vaguement sulfureux (il a tourné fasciste), qui mériterait qu’on le réé-
NOVEMBRE 2018 121bernard quiriny
dite (Borges l’avait sélectionné dans sa « Bibliothèque de Babel », et je ne
désespère pas de mettre un jour la main sur la traduction de son Crépus-
cule des philosophes, hors de prix chez les libraires) ; puis Le Seuil du jardin,
d’André Hardellet, discret maître à moustaches, chansonnier, poète, fan-
tastiqueur et pornographe, dont l’œuvre m’intrigue et m’attire. Je viens de
relire son Parc des Archers, étrange dystopie à la Boris Vian, un peu froide,
mal finie mais collante, au sens où l’on reste collé à l’ambiance. J’emporte
aussi du Balzac, à cause de l’affaire Benalla qui bat son plein : les officines,
la police secrète, le petit gars d’Évreux monté à l’Élysée, les mensonges
sous serment, c’est du Rastignac-Vautrin, avec une pointe de ridicule.
9 août. Émilie Frèche
Séverine Servat, épouse de François de Rugy, accuse Émilie Frèche,
compagne de son ex-mari Jérôme Guedj, d’avoir pillé sa vie dans un
roman à paraître. L’affaire, d’abord mise dans les mains de la justice,
semble en voie d’être résolue à l’amiable. Issue décevante : j’aurais pré-
féré les voir se battre sous l’œil d’un smartphone, façon Booba-Kaaris
à Orly. En attendant, les protagonistes s’insultent par voie de presse,
et le roman est lancé. L’ennui, c’est qu’il est impossible à présent de
l’ouvrir pour y chercher de la littérature : seulement des potins. En
même temps, on ne se faisait pas trop d’illusions.
15 août. Jacques Drillon
Sur un marché aux livres à G***, j’achète le Traité de la ponctua-
tion française de Jacques Drillon (collection « Tel », 1991), dont je ne
manque jamais les « Papiers découpés » du vendredi sur le site de l’Obs.
Ses pages sur la virgule me rappellent un menu de restaurant à la cam-
pagne, du côté de Blois : « Menu : entrée, plat, fromage, ou dessert ».
J’avais cru la ponctuation fautive, mais non : c’était soit entrée-plat-fro-
mage, soit dessert.
19 août. Divagation
Au moment de relire ces pages, je vois que je me suis tenu à peu
près au parti pris du début : ne parler que d’écrivains (presque), éva-
cuer ce qui n’est pas de la littérature. Cela pourrait fournir le principe
122 NOVEMBRE 2018journal littéraire
d’un journal intime, écrit sur une vie entière : un homme qui ne par-
lerait jamais directement de lui, ni du monde, seulement des livres
qu’il a lus, ne se révélant qu’à travers eux, en creux, en reflet. Façon
de suggérer que rien ne compte au fond que les livres, et qu’à chauffer
une vie de lecteur au bec Bunsen, on obtient comme seul résidu sec
les livres qui l’ont jalonnée. Il faudrait s’entraîner en fait à penser le
monde non pas comme un lieu habité par des hommes qui lisent des
livres mais comme un lieu habité par les livres que lisent les hommes.
Ce ne sont pas les livres qui sont là pour divertir, instruire et scanda-
liser les hommes, mais les hommes qui sont là pour les écrire, donner
des modèles à leurs personnages et les lire.
20 août. Henri de Régnier
Je cherche une citation un peu ronflante pour finir pompeusement
ce journal. J’en aurais peut-être trouvé une dans Le Bûcher des vanités si
j’avais eu le courage de l’ouvrir, comme je me l’étais promis. À défaut, je
me rabats sur mon cher vieux Henri de Régnier, dont j’ai relu cet été Le
Bon Plaisir en vue d’un texte à écrire pour Tel qu’en songe, petite revue
annuelle d’études régnériennes. (Publicité.) On cite souvent de Régnier
son mot terrible : « Vivre avilit. » Mais il en a donné un autre, plus ter-
rible encore : « Chaque heure qui passe, dis-toi bien que c’est une heure
de ta vie. » Je me demande toujours quelle tête il avait en écrivant cela :
la tête blême d’un homme terrifié ou celle, narquoise, d’un homme
résigné. Un homme qui sait qu’on n’a qu’une vie, et qu’il ne faut pas la
gâcher à moitié.
1. Proposition dont j’ignore à cette heure si elle aboutira – à Dieu ne plaise (note du 20 août : le Sénat,
impérial, l’a rejetée sans examen ; mais les pions de l’Assemblée passeront en force) – mais dont la simple
existence constitue déjà la tache fatale de la mandature, comme la déchéance de nationalité lors du quin-
quennat précédent. La désinvolture, le manque de recul, l’entêtement des députés de La République en
marche sur ce sujet si sensible de la liberté d’expression sont ahurissants. Je rappelle au passage que cette
majorité n’avait rien trouvé de mieux pour inaugurer sa carrière en 2017 que d’attenter d’emblée à la liberté
d’expression, en inventant la peine d’inéligibilité quasi automatique pour les personnes condamnées à cer-
tains délits de presse. Heureusement, le Conseil constitutionnel l’avait censurée. On aurait dû comprendre
dès cette époque que ces gens sont des fous dangereux.
2. Leyris, paraît-il, avait penché d’abord pour cette formulation lourdaude : « Je préférerais ne pas le
faire. »
NOVEMBRE 2018 123Vous pouvez aussi lire