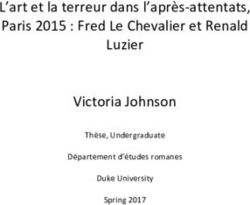L'Aïd El-Fitr marque la fin du ramadan - Reforme.net
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
L’Aïd El-Fitr marque la fin du ramadan L’Aïd El-Fitr est également appelé « Aïd El-Séghir », la fête de la rupture. Elle correspond chaque année au premier jour du mois Chawwal du calendrier hégirien (islamique). Cette fête, synonyme de partage, de paix et d’amour, est l’occasion pour toute la communauté islamique de se souhaiter mutuellement « Aïd Moubarak ». Cette expression signifie bonne fête de l’Aïd ou “Que Dieu vous bénisse”. C’est l’un des jours les plus importants pour les millions de fidèles dans le monde. Bien plus qu’une rupture du jeûne, c’est un moment chaleureux. Après la prière matinale et collective, les croyants vêtus de leurs plus beaux habits se rendent visite et se réunissent autour d’un repas. Ils se souhaitent les vœux et se félicitent du jeûne accompli et des bonnes actions effectuées. Une grande fête Les personnes non-musulmanes peuvent aussi participer à cette fête. Certains sont conviés chez leur ami pour déguster les mets, boire du thé, échanger sur les bienfaits de la vie et faire un bilan sur ce mois d’abstinence. D’ailleurs, dans les villes françaises certaines mosquées ouvrent leurs portes après la prière matinale pour laisser place aux visiteurs et personnes désireuses de connaître la tradition islamique. Cette fête religieuse clôture un mois de piété intense. Le ramadan qui a débuté le 5 mai dernier était une aubaine pour chaque musulman de faire une introspection sur sa foi. L’occasion aussi de faire une auto-évaluation dans le but de purifier son âme et son esprit. Il se traduit par une privation alimentaire, d’ascèse physique et
morale. C’est un moyen de se repentir, et faire son mea-culpa pour les péchés commis tout au long de l’année. Le ramadan, une période considérée parfois comme contraignante, l’est moins pour certains. C’est le cas de Yaya Diallo, jeune étudiant de Strasbourg, « cette année, le climat a été plutôt clément. J’ai bien vécu le ramadan donc moins ressenti l’impact du jeûne » explique-t-il modestement. Avant la fin du ramadan, tous les musulmans doivent aussi s’acquitter de la Zakat Al-Fitr (aumône légale), troisième pilier de l’islam et sorte d’offrande sans contrepartie. La Zakat, sujet de polémique Chaque croyant a l’obligation de venir en aide à une personne dans le besoin, c’est un acte symbolique. Elle est qualifiée de « taxe sociale purificatrice », car elle permet de partager non seulement avec les plus démunis, mais aussi de purifier son âme contre toutes formes d’avarice. En revanche, la question liée à sa revalorisation allant de 5 euros à 7 euros sous l’impulsion du Conseil théologique musulman de France (CTMF) a suscité le débat cette année. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) quant à lui ne s’est pas prononcé là-dessus. En effet, cette différence se traduit par le fait que le mode d’évaluation prend en compte la variation des prix des denrées alimentaires selon les régions. Un écart qui peut exister entre Paris et les autres régions de France par exemple. Le CFCM « tient à rassurer les musulmans que les différents avis sont probants, légitimes et qu’il n’y a pas lieu d’en faire une polémique puisque depuis le début de l’islam, les gens sortaient la zakat sous forme de denrées alimentaires différents représentant le même volume, mais pas la même valeur monétaire ». Il faut tout de même rappeler que c’est la somme de 7 euros qui est communiquée à tous les fidèles musulmans de France. Mais cette valeur versée a peu d’importance, car seul l’acte compte pour le fidèle désireux d’accomplir sa foi, comme nous le précise Abdelhafid, jeune agriculteur de 27 ans, près de Marseille : « à défaut de ne pas pouvoir verser de l’argent aux pauvres, il est possible de leur donner de la nourriture, le plus important est d’aider les gens qui sont dans le besoin ».
Elections européennes : une liste confessionnelle parmi les 34 listes À l’origine de cette initiative se trouve Nagib Azergui, ingénieur télécom qui a créé un mouvement politique confessionnel. « J’ai fondé le parti parce que j’en avais marre de voir que l’on parle matin, midi et soir du “musulman”, a-t-il déclaré à nos confrères de la chaîne LCI. Sur le terrain politique, c’est devenu l’argument électoral numéro 1. Au début, c’était limité à l’extrême droite mais cela s’est généralisé. L’islamophobie, la détestation du musulman, est devenue quelque chose d’acceptable dans la société. En l’espace de 10 ans, on observe une radicalisation des esprits. C’est cela qui m’a poussé à tirer la sonnette d’alarme. » Une telle démarche est inédite en France. « Dans d’autres pays d’Europe occidentale d’autres tentatives ont eu lieu, fait observer Ismaïl Ferhat, maître de conférences à l’université Paris-Jules Verne. En Grande-Bretagne, un député travailliste dissident, George Galloway, avait créé un parti appelé Respect, qui voulait attirer les musulmans britanniques en reprenant certaines de leurs revendications. En Belgique, il y a quatre-cinq ans, un parti appelle explicitement à la question de l’islam. » Cette formation, très inspirée d’une conception conservatrice de la religion, a surtout rallié à lui des électeurs en Wallonie. Bien entendu, la loi de 1905 n’interdit pas la création de partis politiques à coloration confessionnelle. Mais elle en dissuade l’affirmation trop voyante. C’est ainsi que le Mouvement Républicain Populaire (MRP), parti politique fondé en 1944 par d’anciens résistants dont la plupart étaient catholiques pratiquants, ne s’est jamais présenté comme démocrate-chrétien – différence essentielle avec ses homologues italien et allemand. « L’UDMF adopte une stratégie comparable à
celle, on l’oublie souvent, de Recep Erdogan avant son durcissement idéologique et politique, estime Ismaïl Ferhat. L’idée consiste à tenir un discours libéral sur le plan économique, modéré sur un plan politique et très conservateur sur le terrain des mœurs. » Il est difficile d’évaluer les chances électorales de cette liste. « Elle renforcera peut-être sa présence dans quelques bastions, ajoute Ismaïl Ferhat. Mais les Français musulmans se déterminent en fonction de critères politiques et non pas sur des considérations confessionnelles. » La liste Une Europe au service des peuples restera donc, selon toute probabilité, marginale. Au Maroc, reportage à l’institut de théologie Al Mowafaqa Samedi 30 mars, 15 h 30. Les ruelles de la médina de Rabat sont presque désertes. Les rares Occidentaux à déambuler sont chaleureusement invités par les propriétaires des boutiques à regarder à la télévision les discours du roi du Maroc et celui du pape François. Dans les cafés, les Marocains offrent des places au premier rang aux touristes. Rare moment de communion interculturelle et interreligieuse. Sur les écrans, le roi explique que la lutte contre le fanatisme religieux et le terrorisme passe par l’éducation ; il faut « se parler », se côtoyer les uns les autres. Il existe au Maroc un lieu particulier pour cette rencontre : l’institut de théologie Al Mowafaqa, créé en 2012 conjointement avec les Églises catholique et protestantes du pays, par le pasteur Samuel Amédro, qui a travaillé quatre années
à sa fondation. Si le pape ne s’y est pas rendu physiquement, il l’a mentionné dans son discours au roi comme un « signe prophétique de dialogue ». Une formation adaptée Cet institut a pour vocation première de former les cadres des Églises installées sur place et délivre une licence de théologie reconnue en France. Les étudiants ainsi que les professeurs sont à la fois catholiques et protestants. Y sont formés les assistants de paroisses catholiques ainsi que les pasteurs de l’Église évangélique au Maroc (EEAM), qui regroupe toutes les confessions protestantes, des luthériens aux pentecôtistes. Aujourd’hui, l’EEAM compte 11 paroisses et 3 000 membres – pour 35 millions de Marocains. Dans ce contexte, Al Mowafaqa souhaite « offrir aux jeunes de nos Églises une formation adaptée spécifiquement à notre contexte marocain pour qu’ils servent nos communautés dans un esprit d’ouverture vers l’autre – l’autre chrétien et l’autre musulman », explique la pasteure américaine Karen Smith, présidente de l’EEAM. C’est pourquoi, en parallèle de la licence, un cycle court de cinq mois délivre un « certificat de dialogue interculturel et interreligieux ». Des conférences parsèment la vie culturelle de l’institut tout au long de l’année. Un séminaire de dix jours en islamologie est également organisé tous les étés. S’est aussi ajouté, sous l’impulsion de l’ancien directeur Bernard Coyault, un accompagnement théologique spécifique pour les responsables d’Églises de maison, non membres de l’EEAM. Aujourd’hui, l’institut est dirigé par le pasteur Jean Koulagna, de l’Église évangélique luthérienne du Cameroun, qui assure aussi les cours d’Ancien Testament. « Je viens du nord du Cameroun où l’islam est très présent », témoigne-t-il. Il était donc déjà habitué au dialogue interreligieux. Mais c’est à Al Mowafaqa qu’il a vraiment découvert le dialogue œcuménique. « Les divisions entre chrétiens sont un scandale, surtout dans un pays où nous sommes minoritaires. Cela n’a pas de sens de nous disputer, même si c’est important d’être différents. » D’après lui, « toute personne qui passe par Al Mowafaqa se convertit d’une façon ou d’une autre, dans sa façon de voir l’autre ».
Lui même affirme vivre actuellement une conversion : « Moi qui suis un luthérien classique, je m’habitue aux façons pentecôtistes de faire un culte… » C’est à la fois riche, et en même temps un grand défi. Karen Smith renchérit : « Au Maroc, nous, les chrétiens, sommes minoritaires, une position qui encourage en nous, j’espère, l’humilité. Ainsi, le “croyant-autre” que je rencontre, que j’écoute, pour qui j’ai du respect, devient pour moi un “point d’interrogation” spirituel et me force à réfléchir, à me questionner. Ça me pousse vers plus d’honnêteté, plus d’authenticité dans ma propre foi. » Keren, 25 ans, originaire du Congo-Kinshasa, en a fait l’expérience. Devenue athée à la suite du décès brutal de son père quand elle avait 14 ans, elle est revenue à la foi en arrivant au Maroc trois ans plus tard. Aujourd’hui, elle est étudiante en licence à Al Mowafaqa et assistante pastorale de l’Église catholique de la région de Marrakech. « Il a d’abord fallu déconstruire ma foi pour la reconstruire. Le faire avec des protestants permet une ouverture plus grande », témoigne-t-elle. Elle étudie, entre autres, avec Michelle, 33 ans, originaire de Côte d’Ivoire, pentecôtiste. Étudier avec des catholiques ? « Je ne suis pas d’accord avec eux sur certaines choses, et réciproquement. Alors on apprend de nos différences. On les met sur la table, on débat, en étant motivé par une seule chose : l’amour de Jésus. » Aujourd’hui, Michelle travaille comme bibliothécaire à l’institut et cherche un sponsor pour financer la suite de ses études, l’année prochaine. Parmi les autres étudiants en licence, on compte plusieurs responsables d’Églises de maison, comme Pamphyl, Jean ou Alexandre. Jean, surnommé Jimel, 49 ans, congolais, insiste : « Il faut mettre l’accent sur la formation car elle nous unit. » Aujourd’hui, il est en charge du FOREM d’Al Mowafaqa (Formation des Responsables d’Églises de Maison), et pasteur stagiaire de l’Église de migrants qui vient de se créer au sein de l’EEAM. Ses études à Al Mowafaqa lui apportent « beaucoup d’ouverture dans l’accompagnement de l’autre ». Alexandre, 45 ans, camerounais, ancien footballeur, apprécie ses études de théologie car il découvre « l’histoire, l’archéologie, la pensée des autres, etc. ». Pour lui, qui a aussi étudié dans un collège adventiste et fréquenté des messes catholiques, « s’il y a plusieurs confessions, c’est qu’il y a une histoire derrière. Si chaque confession ne dit du bien que d’elle-même, ça nous bloque dans des
cloîtres. Il faut faire comprendre aux gens que nous n’avons qu’un seul Christ ! ». Comme les étudiants en licence ont aussi des activités professionnelles en parallèle, ils ne suivent des cours qu’une semaine sur deux et font leur licence en quatre ans. La semaine avant la venue du pape, ils n’étaient pas en cours. Par contre, l’institut hébergeait deux sessions distinctes et simultanées : le FOREM et le certificat de dialogue interreligieux. Les étudiants du FOREM suivaient un cours sur la justice sociale, dispensé par un couple de théologiens presbytériens américains, Bob et Gracie Ekblad. Les étudiants du certificat pour le dialogue interreligieux, quant à eux, étaient initiés aux grands débats de l’islam contemporain par l’islamologue soufi Rachid Saâdi, après avoir été formés aux pédagogies interculturelles. Rachid Saâdi tient ses étudiants à Al Mowafaqa en haute estime. Empathie révolutionnaire « Ils sont très réceptifs et ont développé de manière réjouissante des compétences : ils sont dans des démarches de décentrement et d’empathie, qui correspondent au véritable dialogue interreligieux. Ils cherchent à entrer dans le cadre de référence de l’autre, d’une façon sereine et rationnelle, c’est révolutionnaire. » Parmi les étudiants du certificat se trouve sœur Odile, 39 ans, religieuse burkinabée. « Le dialogue va nous aider à nous comprendre et à dédramatiser, estime-t-elle. Il est très important de nous découvrir mutuellement et de mettre en avant nos valeurs communes pour œuvrer à une paix durable. Le Christ est venu s’incarner, étant lui-même dialogue entre l’homme et Dieu. Il nous a appelés à dialoguer entre nous. » Pour elle, la venue du pape au Maroc était une façon de « favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans, et d’encourager les chrétiens entre eux ». Theresa, quant à elle, catholique, 27 ans, est étudiante en théologie et ethnologie à Tübingen en Allemagne. Elle participe au certificat d’Al Mowafaqa car « il n’était pas suffisant d’étudier ma propre religion. L’interreligieux est un sujet actuel en Allemagne. Avec les migrants, on a peur de l’autre, de l’étranger. Or, nous ne savons rien sur lui ! Il
nous faut être bien éduqués, pour diminuer les préjugés, et nous enrichir nous- mêmes. Le Maroc est un pays prédestiné pour cela : il est au carrefour de l’Europe, du monde arabe et de l’Afrique. » À noter Les inscriptions pour le séminaire d’islamologie du 15 au 25 juillet 2019 sont ouvertes. almowafaqa.com Comment la rhétorique chrétienne nourrit-elle le populisme ? Le populisme emprunte au christianisme des schèmes structurants, une sorte d’eschatologie, l’attente d’un miracle accompli par un homme providentiel. Mais c’est un christianisme fruste, réduit à l’état de marqueur identitaire. » Christian Delahaye, journaliste et théologien, ne mâche pas ses mots lorsqu’il tente de décrypter les liens que nourrissent réciproquement populisme et christianisme. Les jeunes pousses – mais pas seulement – qui se plaisent à invoquer les racines chrétiennes de la France se repaissent de cette rhétorique. Culture nationale Depuis que Marine Le Pen a pris la tête du Front national, devenu depuis le
Rassemblement national, le langage est moins agressif, plus subtil, mais la grande idée selon laquelle c’est d’abord une culture partagée qui fait la Nation demeure. Cette culture dépasserait les individus qui s’agrègeraient autour d’elle. Aux côtés de cette identité ethno-culturelle, Philippe Portier, politologue, convoque également dans la définition qu’il donne du populisme un mécanisme d’opposition et donc d’exclusion de l’autre différent. « Ainsi, dans la plupart des populismes européens, ceux qui ne s’intègrent pas à la culture nationale, ce sont les musulmans, précise-t-il, avant les Roms et les juifs. » La conviction de rassembler derrière soi le « vrai » peuple contre des élites mondialisées complète le tableau. Il existe donc bien un populisme, dont le christianisme est le noyau dur pour la plupart des pays européens. Rien de plus logique, dans la mesure où il s’inscrit dans le cadre d’une culture nationale qui dépasse l’autonomie des sujets. Cette connivence possible entre un message politique démagogique et l’Évangile se justifie-t-elle dans le fond ? Deux courants très différents, selon le professeur de théologie pratique (faculté d’Heidelderg en Allemagne) Fritz Lienhard, sont à l’œuvre dans le christianisme. Le premier découle d’un nationalisme fort, tel que le livre du Deutéronome (dans la Bible) le présente, avec toutefois une distinction entre l’étranger comme ennemi potentiel d’Israël et l’étranger habitant au milieu du peuple, qui doit être protégé. À l’opposé, on trouve une véritable tradition d’accueil de l’étranger. Elle tire ses arguments de la libération des juifs d’Égypte. « Lorsque deux traditions se dégagent, il va falloir établir une hiérarchie des vérités, en quelque sorte, en observant quels arguments christologiques les soutiennent », estime le professeur. En l’occurrence, la sortie d’Égypte manifeste un Dieu libérateur, protecteur des faibles, et renvoie Israël à sa propre condition d’émigré. Puis dans le Nouveau Testament, et en particulier avec l’apôtre Paul, dans la continuité de l’attitude de Jésus vis-à-vis de la Samaritaine, par exemple, l’enjeu sera de rompre avec certaines distinctions : entre juifs et non-juifs, hommes libres et esclaves, femmes et hommes, comme Paul l’écrit explicitement dans l’épître aux Galates. Laïcité à géométrie variable En France – comme en Italie, à ceci près que la péninsule a vu l’alliance d’un populisme de gauche et d’un populisme de droite pour parvenir au pouvoir –, le populisme chrétien est catholique, et de droite. « Avec le mouvement de la Manif pour tous, on assiste au surgissement d’une contre-civilisation aux valeurs de
tolérance et d’acceptation de l’autre. On est dans la reconstruction d’un populisme identitaire, barricadé dans ses options », affirme Christian Delahaye. Étrangement, cela n’empêche pas les tenants de ces partis de militer en faveur de la laïcité. Un paradoxe qui se résout dans la définition particulière qu’ils en donnent. « L’idée est d’empêcher les religions de pénétrer et de s’affirmer dans l’espace public, tout en considérant que la religion consubstantielle à la Nation, c’est-à-dire le christianisme, peut se le permettre », souligne Philippe Portier. Laurent Wauquiez en est l’exemple lorsqu’il défend le maintien des crèches de Noël dans certaines municipalités ou conseils régionaux, tout en tenant un discours favorable à la laïcité. « Ce qui renvoie à l’idée que la Nation se confond avec la religion », estime le politologue. Et de renchérir : « C’est un trait typique du populisme chrétien français, qui fait référence aux racines chrétiennes de la France tout en l’associant à la laïcité. » En parallèle d’un populisme chrétien au Nord se développe, selon Christian Delahaye, un populisme islamiste au Sud. « Une dialectique épouvantable et mortifère est en train de se mettre en place, qui ne peut amener qu’à un affrontement des blocs identitaires, rangés derrière leurs étendards », alerte-t-il. Si l’idée d’un sauveur incarné par l’homme providentiel ou l’image des croisades parlent aux peuples, c’est là « une rhétorique qui réduit le religieux à sa plus pauvre et à sa pire expression ». Car il n’y aurait, selon le journaliste et théologien, que des arguments bibliques superficiels et mal interprétés pour rapprocher populisme et christianisme. Encore faut-il être en mesure de le détecter et de contre-argumenter… Le populisme et les fake news (fausses informations) auraient donc ceci de commun qu’ils s’appuient sur une vision simpliste de la réalité, en même temps qu’un manque d’éducation ou de culture. « On écrête le religieux à des événements de surface, épiphénoménaux, et on ne fait aucun effort pour entrer dans l’intelligence du sujet. C’est dans la même tonalité que le succès des fake news », estime Christian Delahaye. Populisme et fake news Un terreau identique nourrirait donc une hydre à deux têtes, mêlant rejet des médias, des élites mondialisées et des apatrides, l’ensemble de ces acteurs étant en situation de « connivence » et de « complicité ». « Non seulement le populisme
dénonce les élites mais il s’inscrit dans un système de défiance à l’égard de tout ce qu’elles peuvent dire, parce qu’elles mentent », détaille Philippe Portier. On retrouve là un thème cher aux populistes : l’authenticité. Selon eux, « les élites et les fake news relèvent d’un même système qui produit des fausses nouvelles pour mieux nous subordonner, nous subjuguer », explique le politologue. Il rappelle d’ailleurs combien les sondages d’opinion mettent en lumière le fait que les catégories sociales les moins éduquées sont celles qui donnent le plus de voix à l’extrême droite, donnent foi aux fake news et estiment que les élites dissimulent la réalité. « Tout un système de croyance, de classe sociale et de classe d’âge forme une configuration sur le fondement de laquelle le populisme peut faire son lit », déclare-t-il. Un danger supplémentaire consisterait à penser que la France est à l’abri des formes les plus extrêmes que pourrait prendre le mouvement. À lire Le protestantisme en Amérique latine : une approche socio-historique Jean-Pierre Bastian Labor et Fides, 1994. L’Alliance contre-nature Christian Delahaye Empreinte temps présent, 2018.
Antisémitisme : le désarroi des Français juifs Nombre de Français juifs ont aujourd’hui plus que peur : ils perdent l’espoir. Voici quelques jours, le journaliste Yves Azeroual a publié sur sa page Facebook une déclaration symptomatique : « Je ne veux plus être un baromètre, je ne veux plus être un canari dans la mine, je ne veux plus être une manifestation de soutien ni un rassemblement en hommage à…, ni une pétition, je ne veux plus voir ce long cortège de politiques, sincèrement émus, pleurer devant le trou qui deviendrait mon cercueil… Je veux simplement que les antisémites me fichent la paix ! » Lorsque, le 19 février au soir, des milliers de Français sont descendus dans les rues pour manifester contre l’antisémitisme, on aurait pu parler d’un sursaut. Mais cette mobilisation, plus faible qu’attendue, malgré la présence, dans le défilé parisien, de deux anciens présidents de la République et d’un ancien Premier ministre, a laissé une impression mitigée. Depuis trente ans, les actes antisémites n’ont cessé de croître en France. Au début du mois de février, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu qu’en 2018 les actes antisémites avaient augmenté de 74 %. Dans un tel contexte, nos concitoyens juifs se sentent découragés. Entre colère et dégoût Difficile de mesurer l’angoisse d’une communauté d’êtres humains. Mais ceux que l’on n’entend pas dans les médias d’information, ceux qui n’ont d’autre désir que de vivre en paix chez eux, tous ces anonymes qui veulent pratiquer leur religion ou même dire leur fidélité culturelle sans crainte d’être agressés, que pensent- ils ? « Je reconnais que j’ai peur, chaque matin de trouver ma boîte à lettres vandalisée, déclare Charles (1) , un comédien qui porte un patronyme hébraïque. Aujourd’hui, je pense que tout signe d’appartenance à la religion juive peut devenir une source de problèmes. Quand je sors de chez moi, je masque mon étoile de David. La plupart de mes amis se comportent de cette manière et considèrent comme un acte de courage le fait de porter la kippa dans la rue, alors
que les musulmans arborent, tranquilles, un voile ou une longue barbe typée. » Sandra (1), jeune artiste peintre, estime faire preuve d’abnégation en vivant toujours en France, alors qu’une grande partie de sa famille a déjà quitté le territoire pour s’installer en Israël. « On ne peut plus s’étonner de pareilles réactions, souligne Jérémie Haddad, président des Éclaireuses et Éclaireurs israélites de France. Quand on vit dans un milieu protégé, on ne rencontre pas de difficultés majeures. En revanche, l’insécurité concerne désormais des communes qui étaient jusqu’alors réputées calmes. Une jeune scoute de seize ans a vu récemment la porte de son appartement taguée d’une croix gammée, a reçu des lettres d’injures, alors qu’elle habite à La Garenne-Colombes. » Cela explique que l’angoisse gagne du terrain. Mais ce qui surprend le plus, c’est l’indifférence polie avec laquelle nos concitoyens juifs accueillent les mouvements de solidarité. Jadis, ils prenaient ces élans comme des signes forts. Aujourd’hui, quand ils voient les responsables politiques ou associatifs organiser des manifestations, ils n’y croient plus ou presque. Alain Villain fut caché pendant la guerre dans les Cévennes. Il témoigne avec précaution, considérant qu’il n’a pas les réflexes de quelqu’un qui appartiendrait de longue date à une famille française, mais aussi parce qu’il ne se reconnaît pas dans les déclarations officielles communautaires. Pourtant, il déclare avec force : « Je n’adhère pas à cet enthousiasme collectif fondé sur l’émotion. On a bien vu que la mobilisation gigantesque de janvier 2015 n’a pas empêché les attentats du mois de novembre suivant. » Si beaucoup se sentent indignés par les actes qu’eux-mêmes ou leur proches subissent, ils ne se font plus d’illusions. «Bien entendu, les grandes manifestations peuvent nous réconforter, reconnaît Claude Allouche, un gynécologue de la région normande. Mais quand on regarde de près de quelle façon se déroulent ces défilés, on s’aperçoit bien vite que soit ce sont les organisations juives qui fournissent le gros des troupes, soit les gens se mobilisent pour les juifs et en même temps pour des policiers, des dessinateurs de presse, etc. Au mois de janvier 2015, c’est le slogan “Je suis Charlie” qui a été retenu. Je ne conteste pas le caractère épouvantable du crime, cependant, la différence de traitement avec les juifs nous a sauté aux yeux. » Un point de vue partagé par Jérémie Haddad, pour qui l’épuisement des juifs de
France est aujourd’hui palpable : « Quand Ilan Halimi a été tué en 2006, quand des enfants juifs ont été tués en 2012, l’indignation verbale n’a pas été suivie d’une vraie vague de mobilisation du corps social. » Est-ce à dire que ces manifestations ne sont pas utiles ? « Je crois que cela ne sert à rien en terme de remède, je crois même que cela agace les antisémites », a déclaré la semaine dernière Géraldine Muhlmann, professeure en sciences politiques à l’université Panthéon-Assas sur l’antenne de France Culture. « Il ne faut pas se leurrer. Mais cela permet aux juifs qu’ils sachent qu’ils ne sont pas abandonnés par le pouvoir politique, l’opinion publique, les médias. Cela crée un frein. C’est nécessaire, mais pas suffisant. » Quand on leur demande ce qui pourrait les rassurer, nos interlocuteurs se montrent prudents. « Je ne vois pas comment nous pourrons nous en sortir, observe Charles. On dit souvent que l’islamisme ne concerne qu’une minorité de musulmans. Je veux bien le croire, mais pourquoi les musulmans “ordinaires” ne défilent-ils pas de façon plus spectaculaire ? Il arrive que des minorités fassent l’histoire… Il suffit de se rappeler que les nazis sont parvenus au pouvoir sans jamais avoir obtenu 50 % des suffrages. » L’appui des politiques Heureusement, les responsables politiques de premier plan n’ont jamais manqué au rendez-vous. Les chefs d’État successifs ont toujours condamné avec la plus extrême fermeté les actes antisémites. « Oui, c’est vrai, mais pour quel résultat ?, interroge Claude Allouch. Je crois que nous avons affaire à un éternel recommencement. Les juifs eux-mêmes n’osaient pas penser l’impensable et même cette attitude s’apparentait à une forme d’aveuglement. Les gouvernements nous disent qu’ils vont nous défendre, et malgré cela, rien ne change vraiment. » Alain Villain va même plus loin, déplorant une instrumentalisation de la cause des juifs : « Les uns et les autres se donnent bonne conscience, espèrent, en faisant des déclarations martiales, redorer leur blason, mais c’est tout. » Bien entendu, l’histoire est là pour nous rappeler que durant les années Trente ces manifestations eussent été bienvenues. L’appui constant des politiques demeure fondamental. « Quelles que soient leurs sensibilités, nous devons
reconnaître que les élus, les représentants des pouvoirs publics ont agi de manière impeccable, admet Jérémie Haddad. Jusqu’en 2002, le déni de réalité pouvait nous alarmer, mais de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron en passant par François Hollande et Manuel Valls, les responsables politiques de premier plan nous ont toujours défendus avec énergie. Le jour où la digue sautera… » Cette hypothèse aurait stupéfait les habitants des shtetls qui, au siècle dernier, murmuraient face aux pogroms : « Heureux comme Dieu en France ». (1). Le prénom a été changé. La démocratie et après ? – L’édito de Samuel Amédro Avons-nous autre chose à proposer que la démocratie ? Ne devrions-nous pas nous mobiliser pour défendre ce qui nous permet de vivre en paix ? La menace n’est pas uniquement extérieure, venue d’Italie, de Hongrie ou du Brésil mais aussi et surtout à l’intérieur. La liste est longue et, en soi, elle fait sens. Que ce soient les multiples tags antisémites, les violences contre les élus pour déstabiliser les institutions, les attaques contre les journalistes comme les méthodes plus que contestables utilisées par certains d’entre eux pour faire le buzz, quelque chose d’insidieux est en train de s’infiltrer et de gangrener notre société, ce qui nous laisse démunis. Il est tout aussi difficile de lutter contre l’islamisme radical qui contrôle de nombreux quartiers sans mettre en cause les musulmans victimes de cette idéologie mortifère que de lutter contre ce populisme tortueux qui gagne le
mouvement des gilets jaunes, tout en défendant la revendication légitime de justice et de partage équitable qui essaie de prendre corps. Il ne s’agit pas d’un manque de limites (les lois suffisent à réprimer les délits constitués) mais bien plutôt d’un manque de… boussole. Quel regard chrétien pouvons-nous porter sur cette situation ? D’abord nous nous devons de préserver cette tension féconde entre la légitimité de la loi qui fait barrière au chaos et cette attention au plus vulnérable qui porte la marque de l’Évangile. L’histoire de Caïn et Abel permet de faire un pas de plus : sentiment d’injustice, jalousie, colère et pulsion de mort, tous ces ingrédients explosifs font écho aujourd’hui. Et, dans cette histoire, une parole vient avertir d’un danger imminent bien plus grave : le péché est un animal tapi à notre porte, prêt à nous dévorer. Il dépend de nous de ne pas laisser entrer le désespoir, cette malédiction de l’homme sans Dieu. Cette question demeure, boussole en ces temps troublés : « Où est ton frère ? » En Allemagne, l’effroyable retour de l’antisémitisme Le panneau d’une synagogue détruit à Magdebourg, un entraîneur de football qui se fait traiter de « sale juif » sur Facebook, des graffitis antisémites à Leipzig… Voici quelques exemples extraits de la « chronique des incidents antisémites » de 2018 de la fondation allemande Amadeu-Antonio. Deux cas ont particulièrement défrayé la chronique de ce côté du Rhin. En avril 2018, deux hommes portant une kippa se font agresser dans un quartier bourgeois de Berlin. Leur attaquant les
frappe à coups de ceinture en scandant « yahudi », soit « juif » en arabe. Deux mois plus tard, les médias révèlent qu’un écolier d’une prestigieuse école internationale de Berlin s’est fait harceler pendant des mois à cause de sa confession juive. Pour certains commentateurs, l’explication est vite trouvée : l’Allemagne ferait face à un nouvel antisémitisme, importé par les réfugiés musulmans. Le concept est particulièrement populaire au sein du parti populiste Alternative pour l’Allemagne (AfD). Il est vrai que l’attaquant à la ceinture était un jeune Syrien arrivé en République fédérale deux ans plus tôt. « Évidemment, des personnes qui ont grandi dans des pays où l’antisémitisme fait quasiment partie de la raison d’État ont des tendances antisémites », concède la psychologue sociale Beate Küpper. Cette chercheuse a participé à un grand rapport sur l’antisémitisme commandé par le gouvernement allemand et paru en 2017. « Il est important de reconnaître ce problème afin de l’aborder au mieux lors de l’intégration des réfugiés, continue Beate Küpper. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l’antisémitisme est également bien ancré dans la population allemande. » Une certaine indifférence « Si on regarde les statistiques, l’arrivée massive de demandeurs d’asile en Allemagne depuis 2015 n’a pas fait exploser le nombre d’agressions antisémites enregistrées par la police », insiste Felix Klein, émissaire spécial du gouvernement fédéral pour la lutte contre l’antisémitisme. Certes, le nombre de délits à caractère antisémite a légèrement augmenté, avec 1 504 cas en 2017 contre 1 468 l’année précédente. Mais on en dénombrait 1 809 en 2006. Sans compter que 95 % des infractions de 2017 ont été attribuées à l’extrême droite, et non à des musulmans. « Les préjugés antisémites se retrouvent dans toutes les couches de la société, confirme Sigmount Königsberg, chargé de la lutte contre l’antisémitisme au sein de la Communauté juive de Berlin. En tant que juif, on me catalogue souvent comme représentant d’Israël par exemple, ce qui est une manière de me dire que je ne suis pas allemand. » Il regrette également que les attaques contre les juifs ne provoquent pas plus l’indignation au sein de la population. « Une manifestation
de soutien a été organisée deux semaines après l’agression en avril dernier. Seules 3 000 personnes sont venues. Nous aurions dû être dix fois plus ! » Des stéréotypes tenaces Ses observations sont confirmées par plusieurs études, comme celle publiée l’automne dernier par l’université de Leipzig. On y apprend notamment que 30 % des Allemands sont convaincus que « les politiciens et les dirigeants ne sont que les marionnettes de puissances cachées ». Cette image des marionnettistes agissant en secret fait partie des stéréotypes antisémites classiques. D’ailleurs, toujours selon cette étude, 10 % des Allemands approuvent l’affirmation selon laquelle « les juifs sont particuliers » et ne leur « correspondent pas vraiment ». 20 % de plus se disent partiellement d’accord avec cette affirmation. « Ce rapport dénote une légère augmentation des préjugés antisémites dans la population allemande par rapport à 2016, mais c’est normal d’avoir des fluctuations sur ce genre de question », assure Beate Küpper. Selon elle, rien n’indique une hausse importante de l’antisémitisme de ce côté du Rhin au cours des dernières années. Pourtant, quelque chose a changé au sein de la communauté juive. « Nous sommes davantage sur nos gardes que par le passé », reconnaît Sigmount Königsberg. Si les opinions antisémites n’ont pas vraiment évolué, leur articulation dans l’espace public est devenue plus audible. « L’antisémitisme a toujours été là, mais maintenant il s’exprime à voix haute, et de manière très agressive », constate Beate Küpper. Des propos comme ceux de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz étant un détail de l’histoire ont longtemps été complètement tabous en Allemagne. Mais aujourd’hui les barrières tombent. « Ce qu’on disait avant au café du coin à son copain, on le dit maintenant sur Internet, en public, et sans se cacher », ajoute Sigmount Königsberg. La libération du discours antisémite est particulièrement visible sur la toile. Selon une étude de l’université technique de Berlin parue l’été dernier, les commentaires haineux à l’égard des juifs se sont multipliés par trois depuis 2007
sur les grands sites d’information allemands. Mais la parole antisémite s’entend aussi dans la rue, notamment lors des manifestations de Pegida. « Sur les podiums, certains orateurs n’hésitent pas à reprendre les mythes du complot juif », souligne Beate Küpper. L’AfD, clairement antisémite « La Shoah s’est déroulé il y a 70 ans, et presque tous ceux qui l’ont vécu, que ce soit du côté des bourreaux ou des victimes, sont désormais décédés, explique la chercheuse. Il est donc plus facile de réactiver les vieux préjugés antisémites. » Sigmount Königsberg, quant à lui, blâme l’AfD. « C’est un parti clairement antisémite car ils relativisent l’importance de la Shoah. Quand leur codirigeant, Alexander Gauland, qualifie l’époque nazie de “pipi de chat” dans l’histoire allemande, c’est une violente gifle pour les survivants. » Le parti populiste veut notamment en finir avec le « culte de la culpabilité », et l’un de ses leaders, Björn Höcke, a même qualifié le mémorial de l’Holocauste à Berlin de « mémorial de la honte ». Certes, le parti se défend de toute opinion antisémite. En octobre dernier, 19 personnes ont même fondé le groupe des « juifs de l’AfD ». Les populistes entendent ainsi s’opposer à l’antisémitisme qui serait importé par les musulmans. De quoi provoquer un tollé au sein de la communauté juive allemande. Lutter plus efficacement « L’antisémitisme n’a jamais disparu, mais le sujet était négligé par les politiques. On n’en parlait que pendant les périodes de crise, lorsqu’il y avait un incident grave », assure Beate Küpper. Le rapport, auquel elle a participé, préconisait donc la création d’un émissaire spécial du gouvernement fédéral pour la lutte contre l’antisémitisme. C’est chose faite en mai 2018 et Felix Klein est le premier à assurer cette fonction. « Ma mission est de rendre l’antisémitisme visible et de provoquer une prise de conscience au sein de la population et des politiques », précise le diplomate de carrière. Lutter contre un problème commence cependant par l’appréhender correctement. Or les statistiques sur les délits antisémites sont loin de refléter le quotidien des juifs en Allemagne, car beaucoup de victimes
d’agression ne portent jamais plainte. Afin de mieux collecter les données, une nouvelle plate-forme en ligne va être lancée en février 2019. Victimes et témoins d’actes antisémites pourront s’y inscrire et recevoir une assistance. Prochain chantier : l’éducation. « Nous devons notamment adapter les livres d’histoire afin que les juifs ne soient pas uniquement présentés comme des victimes, mais aussi comme des acteurs de l’histoire allemande », précise Felix Klein. Il souhaite également réformer la formation des professeurs en y ajoutant des cours sur l’antisémitisme et le racisme. « La plupart des enseignants ne savent pas comment réagir face à des cas de harcèlement ou des insultes antisémites », explique-t-il. Une réunion avec les ministres de l’Éducation de tous les Länder est prévue en février pour discuter de ces mesures. Sigmount Königsberg se réjouit de ces avancées, même si le chemin à parcourir est encore long : « Se battre contre l’antisémitisme, ce n’est pas se battre uniquement pour les juifs. C’est avant tout lutter pour une société démocratique et libérale. » “Islam de France” : une réforme très délicate La République n’a aucune raison d’être en difficulté avec l’islam, pas plus qu’avec d’autres religions », a affirmé le chef de l’État devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles, le 9 juillet 2018. Il annonçait « un cadre » pour l’automne afin que « l’islam s’exerce dans le respect de la République ». Jusqu’au 15 septembre, des assises territoriales réunissant des universitaires, des responsables de culte et des acteurs associatifs ont été organisées dans chaque département. Depuis, on attend le discours d’Emmanuel Macron et ses annonces.
Depuis la fin des années 1980, ses prédécesseurs de droite comme de gauche ont déjà tenté d’organiser par le haut la communauté musulmane et ont, en grande partie, échoué. L’histoire de « l’islam de France » commence avec Pierre Joxe, alors ministre de l’Intérieur. Nous sommes en 1989, l’année de « l’affaire du voile » à Creil et de la fatwa de mort lancée par l’ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie et ses Versets sataniques. Auparavant, l’État déléguait aux pays d’origine la gestion du culte musulman. Pierre Joxe fonde le Conseil de réflexion sur l’islam de France (Corif), un organe consultatif chargé de faire des propositions au gouvernement (carrés musulmans dans les cimetières, nourriture halal, etc.). Des sujets casse-tête En 1993, tout s’arrête : cette instance est supprimée par Charles Pasqua, arrivé place Beauvau, qui décide de s’appuyer exclusivement sur la Grande Mosquée de Paris, enracinée dans la culture algérienne. En 2003, Nicolas Sarkozy donne naissance au Conseil français du culte musulman (CFCM). Cette organisation, qui a pour vocation de représenter les musulmans de France auprès des pouvoirs publics, est aujourd’hui sous le feu des critiques. « Même l’islamologue et animateur télé Ghaleb Bencheikh, qui ne cherche pas la polémique, parle du CFCM comme “d’un machin”», pointe Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences-Po Lyon, spécialiste de l’islamisme en France et au Maroc. Lors des « Assises territoriales de l’islam », lancées par l’ex-ministre de l’Intérieur Gérard Collomb durant l’été, les participants ont planché sur trois thématiques : la gouvernance et le financement des lieux de culte et la formation des acteurs cultuels. En France, aujourd’hui, on recense 2 500 lieux de culte, salles de prière et mosquées. Les imams, pour la plupart, sont bénévoles et issus du même pays que la communauté d’origine de la mosquée à laquelle ils sont rattachés. Seuls 20 ou 30 % d’entre eux auraient la nationalité française. Depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, le dossier de la formation des imams est devenu le leitmotiv des gouvernements de gauche et de droite et a connu une réelle avancée, d’après Ali Mostfa, maître de conférences sur le monde arabo-musulman à l’université catholique de Lyon. Depuis 2008, en effet, les diplômes universitaires « laïcité » se multiplient dans les universités et permettent aux imams de se familiariser avec le cadre juridique français et son régime républicain et laïc.
Néanmoins, dans certains lieux de prières, « des imams continuent de prêcher en arabe. Or, nous savons que la langue influe sur la façon de penser une religion. Ainsi, un prêche tenu en arabe peut être plus rigoriste et idéologique », nuance Ali Mostfa. Autre grande thématique ? Les financements des pays étrangers. Selon un rapport sénatorial de 2016, la construction et l’entretien des lieux de culte sont assurés en grande partie par les communautés elles-mêmes, à travers les dons des fidèles. La part des financements étrangers (Turquie, Maroc, Algérie et Arabie saoudite principalement) est donc marginale mais suscite toujours des interrogations. « Dans certaines circonstances, le pays financeur peut, en effet, exiger un imam importé d’un pays du Golfe, propageant un islam identitaire aux accents wahhabites », affirme Ali Mostfa. « Ne pas avoir réussi à réellement représenter les musulmans », « Être coupé des fidèles, parfois incapables de citer le nom du président, depuis 2017, Ahmet Ogras »… Le Conseil français du culte musulman (CFCM) est vivement critiqué. Le gouvernement va se heurter à un problème de taille : la difficile mission de représentation des musulmans en France. En cause, un islam pluriel et des musulmans qui se sécularisent. Difficile aussi de dresser un panorama exhaustif des organisations musulmanes en France. Elles sont nombreuses : Rassemblement des musulmans de France (RMF), Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), Musulmans de France (MF), anciennement Union des organisations islamiques en France (UOIF), etc. Le gouvernement Macron est-il capable de mettre en place une instance légitime aux yeux de l’ensemble des musulmans ? Le spécialiste Haoues Seniguer n’y croit pas. « Il y aura toujours un sentiment d’illégitimité, de suspicion dès lors que c’est l’État qui organise. Pour une part des fidèles, il s’agira de colonisation par d’autres moyens. De plus, ce nouveau chantier arrive dans un contexte marqué par différentes polémiques autour de la question de la visibilité de l’islam, de la responsable voilée de l’UNEF à la candidate du télé-crochet The Voice. Ce qui n’aide pas à créer un climat de confiance susceptible d’instaurer un réel dialogue. »
Vous pouvez aussi lire