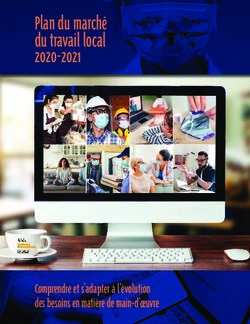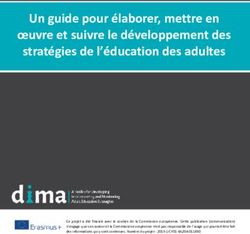L'Économie Sociale Flamande - Werk.be
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE
Département de l’Emploi et de l’Economie sociale
L’économie sociale en Flandre est le thème de la
2010 Baromêtre politique
deuxième édition du baromètre politique, une série dans
laquelle le département Emploi et Economie Sociale de
l’administration flamand annuellement élabore un thème
politique en détail. Dans cette édition du baromètre
politique nous donnons un aperçu de la politique flamand
L’Économie Sociale
relative à l’économie sociale de manière succincte en
nous montrons les efforts continus et renforcés pour
les personnes qui sont le plus éloigné du marché du
travail. L’aperçu chiffré des programmes au sein de
l’économie d’insertion sociale offre une vision claire sur
Flamande
les bénéficiaires, le développement, la diversité et la
dispersion subrégionale de ces programmes. L’économie
sociale est d’autant plus que l’insertion des groupes à
risques. Ainsi les plus-values pour l’écologie, l’économie,
l’homme et la société passent la revue. Avec cette
publication nous espérons de vous offrir un panorama
complet de la réalité de l’économie sociale en Flandre
aujourd’hui.
«Le baromètre politique 2010: L’économie sociale
flamande» est disponible sur le site web: www.werk.be.
Vous y trouvez une édition en néerlandais, en anglais
et en français.
DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE
verruimt je blik op werkC o lo p h o n
Autorité flamande Composition
Domaine politique de l’Emploi et de l’Economie sociale
Département de l’Emploi et de l’Economie sociale
Avenue Roi Albert II 35 boîte 20
1030 Bruxelles
+32 (0)2 553 42 56
monitoring@vlaanderen.be
www.werk.be
Dirk Vanderpoorten Editeur
Secrétaire général responsable
D/2010/3241/396 Depotnummer
Perplex | Aalst Lay-out
Vlaamse overheid Imprimés par
Agentschap voor Facilitair Management
Digitale drukkerij
Octobre 2010 EditionAvant-propos Contenu Partenaires Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
Avant-propos
Cette publication est la deuxième édition du Baromètre politique, une série dans laquelle
le Département de l’Emploi et de l’Economie sociale expose annuellement un thème
politique en détail. Sur la base d’analyses chiffrées et d’autres analyses, nous présenterons
les évolutions et les tendances sur le marché de l’emploi flamand ainsi que les défis pour la
politique flamande du marché de l’emploi. Cette année, la politique de l’économie sociale
fait l’objet de cette publication.
Les coups que le marché de l’emploi flamand a dû encaisser lors de la période de crise
passée, se sont manifestés de manière pénible dans le taux de chômage du «Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding» (VDAB – l’Office flamand de l’emploi et de
la Formation professionnelle). En plus, le nombre de demandeurs d’emploi provenant de
groupes à risque a fortement augmenté. Aujourd’hui, les trois quarts d’à peu près 200.000
demandeurs d’emploi inoccupés appartiennent à au moins un des groupes à risque
suivants: les personnes qui ont plus de cinquante ans, les allochtones, les personnes peu
scolarisées et les personnes handicapées. La moitié de ces personnes, 70.000 demandeurs
d’emploi, appartiennent à plus d’un groupe à potentiel. L’économie sociale crée des
possibilités pour ces personnes qui, autrement, ne trouveraient que très difficilement un
emploi, voire pas du tout.
Par le biais de cette publication, nous voulons porter l’attention sur les efforts continués
et aiguisés visant ceux qui se trouvent le plus éloigné du marché de l’emploi, bref, sur la
politique flamande de l’économie sociale. Le développement de ce secteur ainsi que les
réformes en préparation fournissent matière à un état d’avancement clair et un regard sur
l’avenir.
Lors de la lecture de cette publication, vous comprendrez que l’économie sociale comprend
plus que l’insertion des groupes à risque sur le marché de l’emploi. Il s’agit d’une forme
spécifique d’entrepreneuriat, où ce ne sont pas les bénéfices économiques qui constituent
l’objectif le plus important, mais la réalisation d’une multitude de plus-values sociales.
La politique actuelle vise à rendre ces plus-values sociales plus visibles, à harmoniser
davantage les mesures d’emploi existantes et à continuer à développer et à optimiser
l’appui de l’entrepreneuriat socialement responsable en concertation avec les personnes
concernées. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans l’objectif principal de cette législature de
la politique de l’économie sociale: s’engager à renforcer et à réformer l’économie sociale.
Dans cette publication, l’élaboration et l’exécution concrètes de cette politique, aujourd’hui
et au cours des années suivantes, par le Département de l’Emploi et de l’Economie sociale
seront expliquées de manière succincte. De plus, l’aperçu chiffré des programmes au
sein de l’économie sociale d’insertion permettra de voir clair dans le développement,
l’ampleur, la diversité et la répartition subrégionale du secteur. Dans un dernier chapitre,
nous donnerons un avant-goût des autres résultats de l’économie sociale, outre l’insertion.
Ils mettent l’accent sur des plus-values relatives à l’écologie et l’économie, à l’homme et la
société.
Baromêtre politique 2010 3Grâce à cette brochure, nous espérons que toutes les personnes concernées et intéressées concevront de manière claire en quoi consiste la réalité de l’économie sociale flamande aujourd’hui. Nous tenons également à remercier l’Agence flamande de Subventionnement de l’Emploi et de l’Economie sociale et le VDAB de leur contribution lors de la collecte des données chiffrées présentées. Dirk VANDERPOORTEN Secrétaire général Département de l’Emploi et de l’Economie sociale 4 Baromêtre politique 2010
Avant-propos Contenu Partenaires Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
Contenu
Avant-propos 3
Partenaires de la politique de l’Economie sociale au sein du
domaine de l’Emploi et de l’Economie sociale 7
Chapitre 1 La politique flamande de l’économie sociale en quelques mots 9
1.1 L’économie sociale définie 9
1.2 Insertion au sein de l’économie sociale 10
1.3 Appui de l’économie sociale 12
1.4 Rendre les plus-values sociales visibles 13
Chapitre 2 L’économie sociale d’insertion en flandre aujourd’hui:
les chiffres 17
2.1 Demandeurs d’emploi faisant partie des groupes à risque 17
2.2 L’ampleur du groupe-cible des programmes de l’économie sociale 19
2.3 Aperçu des formes de travail dans l’économie sociale 22
2.4 Atelier protégés 23
2.5 Atelier sociaux 25
2.6 Entreprises d’insertion 27
2.7 Economie de services locaux 31
2.8 Assistance par le travail 33
2.9 Sortie des programmes d’économie sociale d’insertion vers l’emploi 36
Chapitre 3 Vers une économie tournée vers l’avenir ayant plus de valeur 39
3.1 L’économie sociale:plus que l’insertion 39
3.2 Le pilier «Profit»: des plus-values pour une économie durable 39
3.2.1 L’investissement durable 39
3.2.2 Rendre possible l’entrepreneuriat social pour les groupes à risque 41
3.3 Le pilier «People»: des plus-values pour l’homme et la société 41
3.3.1 Répondre aux nouveaux besoins dans l’accueil d’enfants 41
3.3.2 Encadrer le vieillissement sur deux fronts 42
3.4 Le pilier «Planet»: des plus-values écologiques 42
3.4.1 Réduire la montagne de déchets 42
3.4.2 Une consommation énergétique réduite et plus efficace 42
3.4.3 Une meilleure mobilité 43
3.4.4 Promouvoir la biodiversité 43
Baromêtre politique 2010 5Tableaux
Tableau 1: Aperçu des formes de travail au sein de l’économie sociale 11
Tableau 2: Aperçu de l’offre d’appui au sein de l’économie sociale 12
Tableau 3: Evolution du nombre de demandeurs d’emploi (demandeurs d’emploi
inoccupés) faisant partie des groupes à risque depuis le début de la crise
(Région flamande) 17
Tableau 4: Combinaison des caractéristiques de groupes à risque
(demandeurs d’emploi inoccupés – juin 2010) 18
Tableau 5: Les chances des groupes à risque de trouver un emploi (2009) 19
Tableau 6: Nombre, entrées et sorties, croissance et rotation dans
les programmes de l’économie sociale 22
Tableau 7: Travailleurs de groupes-cibles de l’économie sociale, population totale
et nombre total de travailleurs dans les RESOC/régions flamandes 27
Tableau 8: Travailleurs de groupes-cibles dans des entreprises d’insertion
(avec et sans titres-services), population totale et nombre total
de travailleurs dans les RESOC/régions flamandes 30
Tableau 9: Travailleurs de groupes-cibles dans l’économie de services locaux,
population totale et nombre total de travailleurs dans
les RESOC/régions flamandes 33
Tableau 10: Travailleurs de groupes-cibles dans l’assistance par le travail,
population totale et nombre total de travailleurs dans
les RESOC/régions flamands 35
Tableau 11: Sortie vers l’emploi (2006-2009) 36
Figures
Figure 1: Programmes d’emploi classés en fonction de la distance par rapport
au marché de l’emploi des travailleurs de groupes-cibles 20
Figure 2: Travailleurs de groupes-cibles dans des ateliers protégés et
subventions de la VSA accordées 23
Figure 3: Pourcentage des groupes à risque dans les ateliers protégés et dans
le total des travailleurs en Flandre 24
Figure 4: Nombre de travailleurs de groupes-cibles dans des ateliers sociaux
et subventions de la VSA accordées 25
Figure 5: Pourcentage des groupes à risque dans les ateliers sociaux et
dans le total des travailleurs en Flandre 26
Figure 6: Répartition du nombre de travailleurs de groupes-cibles des
ateliers sociaux par province, selon le domicile du travailleur 26
Figure 7: Nombre de travailleurs de groupes-cibles dans des entreprises
d’insertion et subventions de la VSA accordées 28
Figure 8: Nombre de travailleurs de groupes-cibles dans les entreprises
d’insertion par type 28
Figure 9: Pourcentage des groupes à risque dans les entreprises d’insertion
et dans le total des travailleurs en Flandre 29
Figure 10: Pourcentage des groupes à risque dans les entreprises d’insertion
par type 29
Figure 11: Répartition du nombre de travailleurs de groupes-cibles dans
les entreprises d’insertion (avec et sans titres-services) par province,
selon le domicile du travailleur 30
Figure 12: Nombre de travailleurs de groupes-cibles dans l’économie de
services locaux et subventions de la VSA accordées 31
Figure 13: Pourcentage des groupes à risque dans l’économie de services
locaux et dans le total des travailleurs en Flandre 32
Figure 14: Répartition du nombre de travailleurs de groupes-cibles dans l’économie
de services locaux par province, selon le domicile du travailleur 32
Figure 15: Nombre de travailleurs de groupes-cibles dans l’assistance par le travail
et subventions de la VSA accordées 34
Figure 16: Pourcentage des groupes à risque dans l’assistance par le travail et
dans le total des travailleurs en Flandre 34
Figure 17: Répartition du nombre de travailleurs de groupes-cibles dans l’assistance par
le travail par province, selon le domicile du travailleur 35
Figure 18: La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 40
Figure 19: Clients selon point principal (2009) 40
6 Baromêtre politique 2010Avant-propos Contenu Partenaires Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
Partenaires Partenaires de la politique
de l’Economie sociale au sein
du domaine de l’Emploi et
de l’Economie sociale
Le domaine de l’Emploi et de l’Economie sociale se compose de cinq entités:
• un département principal: le Département de l’Emploi et de l’Economie sociale
• quatre agences:
– «Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie» (VSAWSE –
Agence flamande de Subventionnement de l’Emploi et de l’Economie sociale)
– «Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding» (VDAB –
Office flamand de l’Emploi et de la Formation professionnelle)
– «Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen»
(Agence flamande pour la Formation d’Entrepreneurs «SYNTRA Vlaanderen»)
– «Europees Sociaal Fonds (ESF) – Agentschap Vlaanderen vzw» (Fonds social
européen (FSE) – l’a.s.b.l.)
Le département principal et l’Agence flamande de Subventionnement de l’Emploi et
de l’Economie sociale constituent ensemble le Ministère flamand de l’Emploi et de
l’Economie sociale. Toutes les entités jouent un rôle dans la politique de l’économie
sociale.
Le Département de l’Emploi et de l’Economie sociale assure le développement et
la coordination politique, le monitoring et le maintien (inspection) de la politique de
l’Economie sociale. Le département se compose d’un service d’encadrement, d’une
division Politique de l’Emploi et d’une division Inspection de l’Emploi et de l’Eco-
nomie sociale. La coordination de fond de la politique est effectuée par l’équipe de
l’Economie sociale, RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et création d’em-
plois au sein de la division Politique de l’Emploi.
L’Agence flamande de Subventionnement de l’Emploi et de l’Economie sociale
assure l’appui et le renforcement de l’économie sociale. Par le biais de l’agrément
d’organisations et l’octroi de subventions dans le cadre des différents programmes
d’emploi, elle contribue à l’exécution de la politique de l’économie sociale.
En général, l’Office flamand de l’Emploi et de la Formation professionnelle a
uniquement pour mission de mettre en contact les employeurs et les demandeurs
d’emploi et d’assister chaque demandeur d’emploi de manière optimale dans la
recherche d’un emploi approprié. A cet effet, le VDAB a un large éventail de services
à offrir: placement, accompagnement de parcours, entraînement & formation et
accompagnement de carrière. Dans ce cadre, le VDAB remplit le rôle de porte d’en-
trée pour les demandeurs d’emploi souhaitant faire appel à une mesure de l’éco-
nomie sociale.
L’Agence flamande pour la Formation d’Entrepreneurs – «SYNTRA Vlaanderen»
soutient l’entrepreneuriat dans l’économie sociale, entre autres via un accord de
coopération avec les coopérations d’activités.
>
Baromêtre politique 2010 7L’Agence FSE assure la gestion du Fonds social européen en Flandre. Elle veut
augmenter l’employabilité, l’adaptabilité, l’entrepreneuriat et l’égalité des chances en
Flandre et souhaite, à cet effet, encourager, soutenir et accompagner les initiateurs
au maximum. Au sein de différentes priorités, des projets innovateurs de l’économie
sociale sont appuyés.
Aujourd’hui, le Ministre fonctionnellement compétent de la politique de l’Economie
sociale au sein du Gouvernement flamand est la Ministre Freya Van den Bossche.
Le «Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen» (SERV – Conseil socio-économique
de la Flandre) constitue le conseil consultatif stratégique du domaine politique de
l’Emploi et de l’Economie sociale.
8 Baromêtre politique 2010Avant-propos Contenu Partenaires Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
Chapitre 1 La politique flamande
de l’économie sociale en
quelques mots
Ce premier chapitre est une première rencontre avec l’ampleur de la politique flamande
de l’économie sociale. Après la définition de l’économie sociale au sens large, nous aborde-
rons au présent chapitre consécutivement les mesures d’insertion et l’appui de l’économie
sociale en tant que forme d’entrepreneuriat. Dans la dernière partie, nous traiterons plus à
fond la manière dont la politique tente de rendre plus visibles les plus-values sociales.
1.1 L’économie sociale définie
La politique flamande de l’économie sociale est parfois purement réduite à une collection
de mesures d’emploi. Mais l’économie sociale comprend bien plus. Afin de saisir pleinement
ce qui suit, il s’avère judicieux de commencer par une définition de «l’économie sociale».
Comme point de départ, la politique flamande a choisie la définition de la Plateforme
flamande de Concertation de l’Economie sociale:
«L’économie sociale se compose d’une diversité d’entreprises et d’initiatives posant
comme principe dans leurs objectifs la réalisation de certaines plus-values sociales et
respectant à cet effet les principes de base suivants:
• priorité à l’emploi et non au capital;
• prise de décision démocratique;
• intégration sociale;
• transparence;
• qualité;
• durabilité.
Une attention particulière est également prêtée à la qualité des relations internes
et externes. Elles mettent des biens et des services sur le marché et engagent leurs
moyens de manière efficace sur le plan économique, visant à assurer la continuité
et la rentabilité.»
L’économie sociale comprend donc bien plus qu’uniquement l’insertion de groupes à
risque. Il s’agit d’une forme spécifique d’entrepreneuriat tâchant de réaliser de diverses plus-
values sociales, là où le système purement économique laisse un vide.
La politique flamande de l’économie sociale a son origine dans la constatation que les
secteurs public et régulier ne réussissaient pas à répondre de manière adéquate à un certain
nombre de grands problèmes sociaux, tels que le taux de chômage élevé des années 80. A
la suite d’une phase expérimentale, les initiatives du secteur socioculturel et du secteur de
l’aide social visant à offrir un emploi utile à des demandeurs d’emploi de longue durée ont
fait l’objet d’un cadre structurel dans le décret relatif aux ateliers sociaux de 1998. De cette
Baromêtre politique 2010 9manière, le premier ancrage d’un sous-secteur de l’économie sociale a été réalisé à partir de la politique de l’emploi. Plus tard, la mesure d’insertion, les initiatives de l’économie de services locaux et le transfert, du domaine politique du Bien-être, des ateliers protégés (qui existaient déjà dans les années 50 du siècle précédent) ont suivis. L’objectif d’insérer des groupes à risque et l’entrepreneuriat social en tant que moyen ont permis de traduire la plus-value de la politique en chiffres réels. De ce fait, les Ministres compétents pouvaient communiquer sur des résultats concrets. Les initiatives politiques visant l’appui de l’économie sociale en tant que forme d’entrepreneuriat n’ont été créées que par après. 1.2 Insertion au sein de l’économie sociale La politique de l’Economie sociale agrée de différentes initiatives visant à réaliser l’insertion professionnelle de personnes qui sont fort éloignées du marché de l’emploi et visant simul- tanément à respecter les principes de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans la gestion de l’entreprise. Ces formes de travail ont souvent été créées à partir de la base et ont, après une période expérimentale ou non, été ancrées dans leur propre réglementa- tion. La conséquence de cette évolution de bas en haut est que chacune de ces mesures a développé une propre histoire, un propre groupe-cible et une propre culture d’organisation. Lors de la législation précédente, les premiers pas ont été faits vers la simplification et l’an- crage de ces initiatives. Quatre formes de travail en sont le résultat: les ateliers protégés, les ateliers sociaux, les entreprises d’insertion et les initiatives d’économie de services locaux. Pour être complet, nous remarquons que l’économie sociale offre également un appui dans le cadre de la méthodique de l’assistance par le travail. A la fin de l’année 2009, 1.238 personnes, ne pouvant (plus ou pas encore) fonctionner dans un régime de travail régulier, ont participé à une activité professionnelle accompagnée non rémunérée. Les formes de travail diffèrent fortement pour ce qui concerne les conditions d’agrément, les formes organisationnelles, la nature et le niveau de financement et le groupe-cible visé. Elles sont également différentes parce que certaines formes sont de nature temporaire par définition (insertion), alors que d’autres visent bien la transition, mais offrent également un emploi permanent. L’Agence flamande de Subventionnement de l’Emploi et de l’Economie sociale définit les programmes au sein de l’économie sociale d’insertion comme suit: • L’assistance par le travail comprend l’emploi accompagné non rémunéré sur mesure pour des personnes ne pouvant plus ou ne pouvant pas encore s’adresser au marché de l’emploi rémunéré régulier ou adapté. • Un atelier protégé offre un cadre de travail adapté aux besoins de personnes ayant un handicap qui ne sont pas (encore) capables de travailler dans le circuit économique régu- lier. Le travail accompagné sur mesure dans un atelier permet à ces personnes d’exercer une activité professionnelle correspondant à leurs désirs, besoins et possibilités. • Un atelier social est une initiative agréée développant une activité professionnelle et des emplois sur mesure dans un environnement professionnel protégé pour des deman- deurs d’emploi dont le placement est très difficile. • Les entreprises d’insertion sont des entreprises qui sont prêts à garantir un emploi durable à des groupes à risque, tout en prêtant de l’attention à la formation et à l’ac- compagnement dans un environnement professionnel où l’entrepreneuriat socialement responsable occupe une position centrale. • L’économie de services locaux tente de réaliser l’insertion de groupes à risque via une offre de services complémentaire de la part des autorités, à l’encontre de besoins sociaux et où les principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises sont ancrés dans le fonc- tionnement. 10 Baromêtre politique 2010
Avant-propos Contenu Partenaires Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
Tableau 1: Aperçu des formes de travail au sein de l’économie sociale
Forme de travail Personne Groupe-cible Nombre Activités
(ancré morale groupe-cible
structurellement travailleurs
depuis) fin 2009*
Ateliers sociaux a.s.b.l. Les demandeurs de 3.990 Entre autres des centres de récupération, des emplois verts
(14 juillet 1998) travail de très longue durables, des restaurant sociaux, etc.
durée ayant des
problèmes de nature Chaque activité requiert l’autorisation des autorités, après l’avis du
sociale, psychique ou comité de consultation et du RESOC.
psychologique
Ateliers protégés a.s.b.l. Les personnes 15.439 Entre autres des emballages, des activités graphiques, le
(28 avril 1958) handicapées ne montage, l’assemblage, des emplois verts durables, etc.
(Joint au domaine pouvant (pas encore)
politique de travailler de manière Il n’existe aucune limitation des activités.
l’Economie sociale régulière
depuis le 1er avril
2006)
Les entreprises Sociétés Les demandeurs 2.042 Les secteurs principaux dans lesquels ils sont actifs sont:
d’insertion commerciales d’emploi de longue l’industrie, la construction, l’entrepôt, la communication, les
(8 septembre 2000) durée de courte commerces de gros, les services, les commerces de détail,
scolarisation, la réparation, le secteur des hôtels, restaurants et cafés,
les personnes l’agriculture, la location, etc.
handicapées et
les personnes Il n’existe aucune limitation des activités, mais les secteurs du
bénéficiant du revenu charbon, de la construction navale et du transport sont exclus et
d’intégration** la combinaison avec des activités dans le cadre de titres-services
d’aide ménagère sont extinctifs.
Initiatives dans le a.s.b.l. et Les demandeurs 1.447 La réalisation d’une offre de services complémentaire de la part
cadre de l’économie autorités d’emploi de longue des autorités, offrant une plus-value sociale.
de services locaux locales et durée de courte
(21 décembre 2006) provinciales scolarisation et Lors de la législature précédente, des trèfles flamands ont été
les personnes établis relatifs aux services d’accueil d’enfants de voisinage, à
bénéficiant du revenu l’accueil d’enfants flexible et occasionnel, aux soins à domicile
d’intégration logistiques et complémentaires, aux emplois verts durables,
aux concierges dans le cadre du logement social et aux sports
de quartier. Il existe également un certain nombre de projets
spécifiques dans le cadre du tourisme, des projets peu énergivores,
des points vélo et des agents de prévention pour De Lijn. En outre, il
existe également des trèfles locaux, répondant à des besoins locaux
tels que des services de transport et de livraison, des restaurants
sociaux, l’entretien de terrains de jeux, le désherbage manuel, etc.
*Source: VSAWSE
**Dans le cadre de leur engagement à temps plein, les élèves de l’enseignement secondaire professionnel peuvent
également être engagés comme travailleur d’insertion.
Dans l’accord gouvernemental 2009-2014, le Gouvernement flamand s’engage à réaliser
une meilleure harmonisation des différentes mesures d’emploi. Le domaine politique de
l’Emploi et de l’Economie sociale élabore en ce moment un seul cadre flamand transpa-
rent pour les mesures d’emploi dans toutes les entreprises, y compris celles de l’économie
sociale. Une harmonisation avec la réglementation fédérale et européenne y est cruciale.
Compte tenu de la distance par rapport au marché de l’emploi, une matrice de 4 modules
visant à soutenir les travailleurs et/ou les employeurs (potentiels) visés, sera prévue. Ces
modules sont:
[1] la formation sur le lieu de travail;
[2] l’accompagnement sur le lieu de travail (encadrement);
[3] une prime salariale (sur la base de la distance par rapport au marché de l’emploi);
[4] l’adaptation du lieu de travail/de l’environnement professionnel.
Les modules peuvent se combiner mutuellement en fonction des besoins du travailleur
concerné.
Les mesures de l’économie sociale au sein de la matrice sont groupées en deux piliers. Le
premier pilier est celui du travail sur mesure. A partir des besoins du demandeur d’emploi
Baromêtre politique 2010 11et du travailleur, l’appui aux ateliers protégés, aux ateliers sociaux et à la mesure d’insertion
y sera incorporé. L’accord de principe sur le travail sur mesure, conclu en début de l’année
2009 entre les partenaires sociaux et le Gouvernement flamand, est réalisé dans ce pilier
conformément à l’accord gouvernemental. Ainsi, la porte vers une économie plus sociale est
ouverte.
L’Accord gouvernemental flamand prévoit l’économie des services locaux comme
deuxième pilier de l’économie sociale. Cette économie a pour objectif de développer une
offre de services complémentaire de la part des autorités, s’alignant étroitement sur les
tendances et besoins sociaux tels que le vieillissement de la population, la durabilisation
et l’équilibre entre le travail et la vie privée. Lors du développement de ces services, une
double plus-value sociale est créée par la promotion de l’insertion de groupes à risque et
par l’ancrage des principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises dans des services.
Afin de permettre à l’économie des services locaux de jouer son rôle pleinement, la régle-
mentation existante sera adaptée sur la base d’une évaluation à fond, visant l’harmonisa-
tion, la simplification, la complémentarité, la transition et la qualité.
1.3 Appui de l’économie sociale
En efet, l’insertion dans la vie professionnelle constituait initialement l’objectif principal
pour obtenir une réglementation de l’économie sociale, mais l’alliance entre objectif et
moyen offrait également la possibilité de développer une offre d’accompagnement à
l’appui de l’entrepreneuriat socialement responsable.
Tableau 2: Aperçu de l’offre d’appui au sein de l’économie sociale
13 centres de démarrage aident des entrepreneurs débutants à concrétiser leurs idées
régionaux professionnelles, les encouragent à créer des emplois durables pour
des groupes à risque et les accompagnent afin de mettre en œuvre, par
étapes, les idées de l’Entrepreneuriat socialement responsable au sein
de la gestion professionnelle. L’accent est mis sur l’appui de la mesure
d’insertion.
5 bureaux-conseil agréés offrent la possibilité pour des entreprises socialement responsables de
bénéficier d’une intervention dans les frais pour:
• une étude de faisabilité;
• un service de conseil ad hoc;
• une analyse des points forts et faibles;
• la consultation en gestion obligatoire en cas de déficit.
5 coopérations d’activités promeuvent l’entrepreneuriat auprès des demandeurs d’emploi des
groupes à risque dans le cadre des principes de l’économie sociale et de
l’entrepreneuriat socialement responsable. Les coopérations d’activités
offrent un accompagnement individuel et collectif.
VOSEC est la plateforme de concertation pour les entreprises, les organisations
la Plateforme flamande de et les experts du secteur de l’économie sociale en Flandre. VOSEC est
Concertation de l’Economie une organisation de coordination, composée sur base confédérale,
sociale conformément aux sous-secteurs au sein de l’économie sociale.
Trividend a été créé comme fonds de capital-risque via une collaboration unique
le Fonds flamand de entre des acteurs de l’économie sociale, des entreprises privées et
Participation de l’Economie l’autorité flamande. Grâce à ce fonds, Trividend peut soutenir des
sociale entreprises par des participations temporaires ou en octroyant des
prêts subordonnés.
Le Fonds répond à la demande du secteur de l’économie sociale de disposer
d’Investissement social – de moyens financiers à des tarifs avantageux. Le Fonds offre des
SIFO crédits d’investissement, des crédits de capital d’exploitation, des
prêts subordonnés et des crédits de soudure. Le SIFO est un fonds de
cofinancement et agit de concert avec ses institutions agréées.
Les villes-centres coordinateurs offrent un appui à leur administration locale en vue du développement
du rôle de régisseur dans le cadre de l’économie de services locaux.
12 Baromêtre politique 2010Avant-propos Contenu Partenaires Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
Dans l’arrêté sur les plus-values du 8 septembre 2000, les centres de démarrage, les
bureaux-conseil, Trividend, l’équipe d’audit et la Plateforme de Concertation pour l’Eco-
nomie plurielle ont été ancrés structurellement. En outre, un certain nombre d’initiatives
ont été réalisées dans le cadre de l’Accord de coopération Economie sociale entre l’autorité
fédérale et les Régions; l’appui des coopératives d’activités en est un exemple.
Entre-temps, la conscience que des emplois de qualité méritent une vision et une approche
de management stratégique durable n’a cessé d’augmenter. En préparation du décret sur
le travail sur mesure, les parties prenantes concernées ont développé le modèle de qualité
«De Kwaliteitswijzer» (le Guide de Qualité). Il constituera le point de départ pour l’intégra-
tion de la qualité et de la durabilité dans les différentes réglementations et nouveaux cadres
politiques.
Par le biais de ce système de qualité, le domaine de l’Emploi et de l’Economie sociale vise à
réaliser un cadre univoque de dispositions et d’accords relatifs à la qualité et aux attentes
minimales de qualité de l’autorité flamande vis-à-vis de toutes les organisations qui sont
appuyées (financièrement) au sein de son domaine politique.
Outre l’offre régularisée, il existe également de nombreuses initiatives expérimentales et
temporaires actuellement, à l’appui de la politique de l’économie sociale et des entreprises.
Ces projets visent souvent à conclure des accords de coopération et à établir des partena-
riats avec des initiatives en dehors du domaine politique.
Quelques exemples:
• le groupe de réflexion sur l’entrepreneuriat social au sein de la politique stratégique d’in-
novation
• le projet à l’appui du rôle régisseur de la politique locale de l’emploi dans les villes qui ne
sont pas des villes-centres
• une offre spécifique de formation en vue du développement des compétences dans le
secteur et la professionnalisation du secteur
• une offre de formation visant la diffusion de connaissances et de la compréhension du
thème de l’économie sociale
• des recherches à long et à court terme dans le cadre du centre d’assistance de l’Emploi et
de l’Economie sociale et du VIONA
• un suivi systématique de la politique de l’économie sociale (entre autres via le moniteur
de l’économie sociale)
Tant les initiatives structurelles que les initiatives ad hoc se sont souvent développées en
vue d’un objectif spécifique, mais elles n’ont pas toujours suivi les évolutions de la politique.
Suivant la simplification des mesures d’emploi, l’offre d’appui actuelle sera réformée sur
la base des besoins des entrepreneurs sociaux et en vue du soutien de l’innovation dans
l’économie sociale. La proposition qui est développée actuellement, se base sur une seule
structure d’appui avec des points d’ancrage. La complémentarité et les plus-values sociales
occuperont une place centrale dans le développement de l’offre.
De ce point de vue, un appui spécifique sur le plan du développement organisationnel,
de la gestion des ressources humaines, de la RSE, de la formation et de l’éducation, de la
communication, de la qualité et de l’innovation peut être doté d’une place au sein de cette
structure. En outre, la grande offre existante de l’autorité flamande sur le plan de l’appui aux
PME (marchand ainsi que non marchand), du financement, de l’innovation, du subvention-
nement et du suivi continue à exister.
1.4 Rendre les plus-values sociales visibles
La réalisation de plus-values sociales constitue l’essence de l’entrepreneuriat social. Au
sein de l’économie sociale, des entreprises visent à atteindre un équilibre dynamique entre
les intérêts des différentes parties prenantes. Elles poursuivent à cet effet la réalisation de
succès économique, d’enrichissement social et de bénéfices écologiques. Les décideurs
politiques ne souhaitent pas uniquement réaliser une «économie sociale» plus forte, à la
mesure des personnes, mais également diffuser la vision sous-jacente de la Responsabi-
Baromêtre politique 2010 13lité sociétale des entreprises (RSE) en vue d’une «économie plus sociale, plus socialement responsable» pour tous. Ce revirement d’opinion demande du temps et ne se réalisera pas du jour au lendemain. Mais il est déjà perceptible que les bénéfices économiques ne constituent plus le seul critère. Les aspects sociaux et surtout écologiques se font de plus en plus valoir. Nous voulons, nous inspirant de la réalisation de plus-values sociales, chercher de manière proac- tive des réponses aux défis qui se présentent demain, tant aux entreprises qu’au gouver- nement. Vu la complexité de ces défis, une approche coordonnée et multidisciplinaire en partenariat avec les parties prenantes s’impose. Concrètement, cela implique que nous veillerons à ce que la durabilité sociale et l’entre- preneuriat socialement responsable reçoivent une place au sein des cadres politiques pertinents. Ainsi la nouvelle Stratégie flamande en matière de Développement durable a été développée, la fonction exemplaire de l’autorité y a également reçu une place. De plus, nous appuyons d’autres domaines politiques afin d’augmenter la visibilité des aspects sociaux de leurs initiatives. En liant des critères de durabilité à des achats, un marché public peut devenir un levier important pour la création de plus-values de manière indirecte. L’élaboration de direc- tives sur le plan de critères sociaux pour les marchés publics dans le cadre du Plan d’Action flamand relatif aux Marchés publics durables et la réalisation d’un certain nombre de projets pilotes ne sont donc pas sans importance, vu le volume considérable des marchés publics mis en adjudication par l’autorité annuellement. Le Pacte 2020[1] ambitionne la responsabilisation sociale des organisations et des entreprises, ainsi que la diffusion générale de l’Entrepreneuriat socialement responsable pour 2020. Cela requiert des objectifs intelligents et concrets, des indicateurs et un dialogue ouvert avec les partenaires sociaux. Le développement continué du «Digitaal Kennis centrum MVO Vlaanderen» (Centre de Connaissance numérique RSE Flandre – www.mvovlaanderen.be) au sein d’un partenariat largement supporté, contribuera à une plus grande assise sociale de la RSE. En outre, dans le cadre du projet transnational du FSE «Encourager l’entrepreneuriat durable et transparent en Flandre», le département de l’Emploi et de l’Economie sociale et les orga- nisations patronales flamandes cherchent en Europe des méthodiques et des outils capa- bles de combler l’écart entre la théorie et la pratique de la durabilité. Souvent, les entre- prises et les organisations ne savent pas de quelle manière elles peuvent concrétiser leur responsabilité sociale. Ces dernières années, de très gros efforts ont été faits au niveau inter- national afin de réaliser des outils tels que la norme ISO 26000 et le GRI («Global Reporting Initiative» – le reporting sur le développement durable) afin de transposer les objectifs à la base de l’entreprise. Ce projet doit nous donner les poignées afin de réaliser la transposition au contexte flamand. Des défis sociaux requièrent souvent des réponses innovatrices. Du point de vue de la poli- tique, nous trouvons qu’il est important d’inspirer des entreprises et des organisations et, au besoin, de les soutenir afin de réaliser l’innovation sociale. Cela s’effectuera entre autres par la structure d’appui, mais il existe également deux projets politiques spécifiques méritant une attention particulière. Un premier projet vise de manière générale à faire connaître et à renforcer l’entrepreneuriat coopératif. La coopération est une forme spécifique d’entrepre- neuriat où un groupe autonome de personnes se réunit à titre volontaire afin de répondre à des besoins et des attentes communs sur le plan économique, social ou culturel. Elles concrétisent cette ambition par le biais d’une entreprise qu’elles possèdent ensemble et qu’elles gèrent de manière démocratique. La coopération n’est pas très bien connue en Flandre. Lors de l’élaboration du «Plan d’Action stratégique de l’Entrepreneuriat coopératif», nous voulons de nouveau porter l’attention sur cette forme d’entrepreneuriat et fournir des 1 Le Pacte 2020 a été lancé dans le cadre de «Vlaanderen in Actie» (la Flandre en Action) afin de garantir la réalisation des percées. Le Pacte de la Flandre contient des objectifs chiffrés concrets. Le Pacte veut entre autres réaliser que plus de personnes trouvent un emploi, créer une meilleure qualité de vie et assurer une administration efficace et efficiente. (www.vlaandereninactie.be) 14 Baromêtre politique 2010
Avant-propos Contenu Partenaires Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
informations à ce sujet. De plus, nous voulons examiner si l’entrepreneuriat coopératif offre
des possibilités pour répondre à certains besoins sociaux (p.ex. l’accueil d’enfants, des rési-
dences-services, l’énergie, la mobilité) et soutenir le développement de ces niches.
Un deuxième projet veut continuer à examiner les possibilités de systèmes monétaires
complémentaires. De tels systèmes existent déjà à l’étranger et y font partie d’une poli-
tique d’encouragement afin de rendre possible des transactions et des échanges qui ne
doivent pas être payés en euros. Cette stratégie facilite la prise d’initiatives qui encouragent
et récompensent un comportement socialement et écologiquement responsable. Cela est
possible contre un coût marginal, par exemple en liant l’accès gratuit à des services publics,
tels que la piscine publique ou le transport en commun, à la récompense du comportement
durable. Ainsi, les expériences relatives à la protection du quartier, du voisinage et de l’en-
vironnement dans des quartiers défavorisés peuvent être agrandis grâce à l’engagement et
la participation des habitants. Un autre exemple est de réduire le retard scolaire et le décro-
chage scolaire y lié, en encourageant des élèves à aider d’autres élèves à comprendre des
matières difficiles. Moyennant un petit effort, un effet social important peut être créé de
cette manière.
Rendre les plus-values visibles ne constitue peut-être pas le dernier volet de la politique de
l’économie sociale, mais il s’agit bien de la cerise sur le gâteau. Au moyen de tous ces enga-
gements et actions, la politique flamande de l’économie sociale ambitionne en effet une
économie innovatrice, plus sociale et durable pour tous.
Baromêtre politique 2010 1516 Baromêtre politique 2010
Avant-propos Contenu Partenaires Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
Chapitre 2 L’économie sociale d’insertion
en flandre aujourd’hui:
les chiffres
Le présent chapitre donne un aperçu des évolutions récentes dans l’économie sociale d’in-
sertion. Avant d’évaluer l’importance des groupes-cibles des différents programmes, regar-
dons d’abord l’ampleur du groupe des demandeurs d’emploi faisant partie des groupes
à risque sur le marché de l’emploi flamand. En effet, les critères des groupes-cibles sont
souvent décrits de façon qu’il faille répondre à un ou plusieurs caractéristiques de groupes
à risque avant de pouvoir accéder à un programme. Ensuite, nous donnerons un aperçu du
nombre de travailleurs ainsi que des entrées et des sorties des programmes de l’économie
sociale de l’année écoulée. Nous examinerons également les programmes séparément, pour
ce qui concerne les développements à long terme au niveau d’occupation et de dépenses,
la représentation des groupes à risque et la répartition subrégionale. Enfin nous donnerons
quelques chiffres quant à la sortie des programmes d’insertion sociale vers l’emploi.
Les données proviennent de l’Agence flamande de Subventionnement de l’Emploi et de
l’Economie sociale (VSAWSE) et de l’Office flamand de l’Emploi et de la Formation profes-
sionnelle (VDAB). Les chiffres présentés ici sur les programmes de l’économie sociale (et
d’autres chiffres actualisés) peuvent d’ailleurs être consultés sur le site web néerlandais
www.werk.be/c-en-o/cijfers/beleidsopvolging/. Via ce site web, vous pouvez également
accéder au Moniteur interactif de l’Economie sociale, ou vous pouvez télécharger des
tableaux sur mesure. Jusqu’à présent, le moniteur interactif contient des données sur les
ateliers sociaux, les entreprises d’insertion, l’économie de services locaux, l’assistance par le
travail et les ateliers protégés. Les tableaux donnent un aperçu du nombre de participants
au début de l’année, des entrées et des sorties au cours de l’année et de la situation à la fin
de l’année. Les données peuvent être demandées pour tous les participants, ou pour des
sous-groupes sur la base de leur sexe, âge, niveau de scolarité, ethnicité et handicap.
2.1 Demandeurs d’emploi faisant partie
des groupes à risque
Depuis le début de la crise économique dans la deuxième moitié de l’année 2008, le
nombre de demandeurs d’emploi faisant partie des groupes à risque a fortement augmenté.
Relativement, le nombre de demandeurs d’emploi allochtones a augmenté le plus, suivi
par les personnes peu scolarisées et les personnes de plus de cinquante ans. Le nombre de
personnes handicapées a également augmenté, quoi que beaucoup moins prononcé. L’éco-
nomie sociale d’insertion crée des possibilités pour une partie de ces personnes qui, autre-
ment, ne trouveraient que très difficilement un emploi, voire pas du tout.
Tableau 3: Evolution du nombre de demandeurs d’emploi (demandeurs d’emploi inoccupés)
faisant partie des groupes à risque depuis le début de la crise (Région flamande)
Allochtones Personnes Personnes Personnes
handicapées plus de 50 ans peu scolarisées
Juin 2008 32.871 27.747 44.405 84.535
Juin 2010 46.436 29.376 51.907 102.280
Evolution (N) +13.565 +1.629 +7.502 +17.745
Evolution (%) +41,3 +5,9 +16,9 +21,0
Source: VDAB (Adapté par le Département de l’Emploi et de l’Economie sociale)
Baromêtre politique 2010 17Les quatre caractéristiques (d’origine allochtone, handicapé du travail, plus âgé, peu scola-
risé) apparaissent souvent en combinaison. De tous les demandeurs d’emploi (juin 2010)
appartenant à au moins un des groupes à risque, c’est-à-dire 146.509 personnes soit 74%
des 198.563 demandeurs d’emploi inoccupés, à peu près la moitié (69.990 = 48%) appar-
tiennent à plus d’un groupe à potentiel.
Tableau 4: Combinaison des caractéristiques de groupes à risque
(demandeurs d’emploi inoccupés – juin 2010)
Allochtones Personnes Plus de De courte Nombre
handicapées cinquante ans scolarisation
Oui Oui Oui – 175
Oui Oui Oui Oui 458
Oui Oui – – 608
Oui – Oui – 1.964
- Oui Oui – 1.993
Oui Oui – Oui 2.076
Oui – Oui Oui 2.631
- Oui – – 4.101
- Oui Oui Oui 7.702
- Oui – Oui 12.263
- – Oui – 16.978
Oui – – – 18.410
- – Oui Oui 20.006
Oui – – Oui 20.114
- – – Oui 37.030
- – – – 52.054
Nombre total des demandeurs d’emploi inoccupés 198.563
Source: VDAB (Adapté par le Département de l’Emploi et de l’Economie sociale)
Au sein du groupe des personnes handicapées, 86% appartient à au moins un autre groupe;
au sein des plus de cinquante ans il s’agit de 67%, au sein des personnes peu scolarisées de
64% et au sein des allochtones de 60%.
Outre les quatre caractéristiques de groupe à potentiel mentionnées – annonçant tous une
intégration problématique dans le marché de l’emploi – il faut également tenir compte de la
durée de la période de chômage, puisqu’il a déjà souvent été démontré que les chances de
s’intégrer diminuent fortement lorsque la durée de cette période s’élève. Cela vaut autant
de plus lorsque la durée de la période de chômage est à son tour combinée avec une carac-
téristique de groupe à potentiel.
En juin 2010, 45% (88.523 personnes) de tous les demandeurs d’emploi sont au chômage
depuis plus d’un an. Pour ceux qui appartiennent à au moins un groupe à potentiel, ce
pourcentage s’élève à 52% (75.838 personnes), alors que pour les autres il ne s’élève qu’à
24% (12.685 personnes). Les chiffres concernant les chômeurs de longue durée par groupe
à potentiel sont composés comme suit: 41% (19.054 personnes) des demandeurs d’em-
ploi allochtones, 51% (52.441 personnes) des personnes peu scolarisées, 70% (20.684
personnes) des personnes handicapées et 72% (37.408 personnes) des personnes de plus
de cinquante ans.
En outre, il existe encore d’autres caractéristiques limitant les chances des demandeurs
d’emploi sur le marché de l’emploi, telles que l’illettrisme (à peu près 45% de tous les
demandeurs d’emploi inoccupés), les parents isolés (à peu près 4,5%) et vivre dans une
situation de pauvreté (à peu près 20%).
La distinction entre les profils des demandeurs d’emploi se manifeste également dans le
tableau suivant représentant «les chances de trouver un emploi», mesuré comme le pour-
18 Baromêtre politique 2010Vous pouvez aussi lire