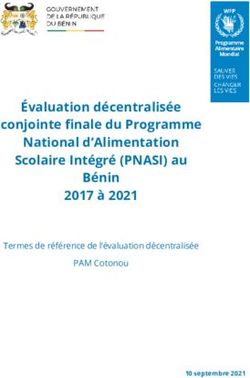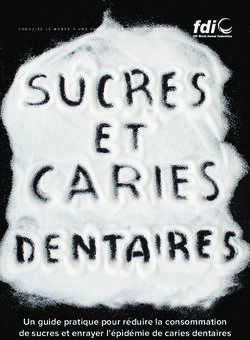L'Âme de la forêt La visite - Musée d'arts de Nantes
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
CYCLES 2 ET 3
VISITE EN AUTONOMIE
Accrochage temporaire
L'Âme de la forêt
La visite > 1 heure
Cette visite en autonomie donne l'occasion
aux élèves d'observer des œuvres des > 4 œuvres (à choirsir parmi 5)
collections du musée ayant pour thème la
forêt. Plus généralement, elle permet de > Classe entière (possibilité de
montrer comment se manifeste l'intérêt des diviser la classe en sous-groupes)
artistes pour la nature. La visite se déroule au
> Enseignant + 3 ou 4 adultes
sein de l'accrochage temporaire L'Âme de la
accompagnateurs
forêt. Elle permet d'aborder une variété
d'œuvres, de techniques et élargit les
périodes d'histoire de l'art étudiées, allant du
1 7 e au 21 e siècle.
Avant votre visite au musée, il est
impératif de prendre connaissance des
modalités de visite et de transmettre ces
Objectifs
informations aux adultes > Définir un paysage en peinture
accompagnateurs.
> Prendre conscience de la variété de
Ce document contient : représentations d'un même thème
- Le propos de l'accrochage
- Des fiches sur 5 œuvres abordées au > Observer et identifier différentes
cours de la visite. techniques
- Un glossaire
> Observer et décrire collectivement des
Ces éléments vous permettront d'organiser œuvres de périodes différentes
votre propos et de questionner vos élèves lors
de votre venue au musée.
CYCLES 2 & 3 > VISITE EN AUTONOMIE /1Comment venir
avec sa classe
Réservation obligatoire
Le formulaire de pré-réservation est à remplir exclusivement en ligne sur le site internet du Musée d’arts
de Nantes .
Avant la visite
La venue au musée doit être préparée avec vos élèves comme avec les personnes qui les accompagnent.
Prenez connaissance du réglement intérieur sur le site internet du musée .
En raison des normes sanitaires mises en place dans le cadre de la Covid 1 9, le port du masque est
obligatoire pour tous à l’intérieur du musée à partir de 1 1 ans, et est recommandé pour les élèves
venant en groupes scolaires à partir du CP. Veillez à ce que les adultes ainsi que les élèves
apportent leurs masques personnels.
Pour respecter les jauges et les distanciations physiques, les groupes ne doivent pas dépasser 20
personnes, accompagnateurs compris. Tous les groupes dépassant ce nombre seront donc
systématiquement divisés en 2 sous-groupes.
Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'ensemble des espaces du musée pour tous les
visiteurs ayant plus de 1 2 ans depuis le 30 septembre (élèves et accompagnateurs compris).
Merci de sensibiliser vos élèves à ce qu'est un musée avant le jour de la visite. Il s'agit d'un lieu
d'émerveillement et de découverte dans lequel un certain nombre de règles doivent être respectées pour
protéger les œuvres et respecter les autres visiteurs :
• Ce que vos élèves peuvent faire à tout moment : observer, s'asseoir par terre (mais pas contre les
murs), lever le doigt pour poser une question, aimer ou ne pas aimer, écrire et dessiner au crayon de
bois ...
• Ce qui est interdit : toucher ou frôler les œuvres, parler fort, courir, se bousculer...
Le musée est un lieu de conservation, nous avons tous un rôle à jouer pour transmettre ce patrimoine aux
générations futures.
• Une réelle implication des adultes accompagnateurs est nécessaire pour ce parcours (ils devront
prendre en charge la moitié de la classe). Il est donc important de les sensibiliser aux règles qui doivent
êtres observées dans un musée.
N'hésitez pas à leur transmettre un exemplaire de ce dossier pédagogique en amont de la visite. Merci de
vous assurer avant la venue au musée qu'ils ont bien compris le rôle qu'ils devront jouer.
• En cas de retard , prévenir le musée dès que possible au 02 51 1 7 45 00. La visite est assurée jusqu'à 1 5
minutes après l'heure prévue et la durée sera écourtée en fonction de votre retard.
Au musée
• Merci d'arriver 1 5 minutes avant le début de votre visite afin de déposer les affaires (sacs et manteaux)
au vestiaire. Vous serez ainsi plus à l’aise et éviterez de heurter les œuvres sans le vouloir.
• Vous serez accueillis par nos agents d'accueil qui vérifieront votre réservation, vous remettront le
matériel nécessaire à votre visite et rappelleront les règles de visite du musée.
• Entre 9h et 1 1 h, vous serez accompagnés par nos agents tout au long de votre visite. Ils vous aideront
dans votre orientation au sein du musée, assureront votre sécurité et celle des œuvres.
• Les salles dans lesquelles se trouvent les œuvres de ce parcours vous sont réservées pour la durée de la
visite. Merci de suivre le parcours proposé , d'en respecter la durée et de ne pas vous installer avec vos
élèves dans d'autres espaces du musée au risque de gêner d'autres groupes.
• Merci de n’utiliser que des crayons de bois car un geste malheureux peut toujours arriver.
• Une attention toute particulière vous sera demandée quant au respect des œuvres (ne pas les toucher
pour les préserver), des autres visiteurs et du personnel du musée.
CYCLES 2 & 3 > VISITE EN AUTONOMIE /2Localisation
des œuvre s
Palais
Niveau +1
Salle 25
L'Âme de la Forêt
CYCLES 2 & 3 > VISITE EN AUTONOMIE /3Propos
L'Âme de la Forêt
Salle 25
1 8 décembre 2020 - juillet 2022
Considérée pendant longtemps comme vierge de toute civilisation, la forêt est toutefois loin
d'être vide de toute présence humaine et occupe notre imaginaire depuis les origines.
Dès l’époque médiévale c’est un espace régulé, et l’exploitation de ses ressources (chasse, bois
de chauffage et de construction) reste contrôlée. Pourtant les Lumières (Jean-Baptiste Oudry)
et le romantisme* feront de la forêt l’espace sauvage par excellence, où l’homme peut
échapper à l’influence malsaine de la civilisation. Cette image de nature sauvage attire les
artistes, comme à Fontainebleau à partir du 1 9 e siècle, alors même que la forêt commence à
être protégée par des lois, et entretenue par l’homme dans un état « naturel ».
Fascinant et mystérieux, l’espace de la forêt est par essence ambivalent. Des mythes à la
littérature fantasy, en passant par les contes, comme Le Petit Chaperon rouge, il est
omniprésent. Zone de danger (domaine de la peur ancestrale du loup), la forêt peut être le lieu
de refuge et de rencontre, avec soi-même ou avec le surnaturel (Edgard Maxence ). Dans les
contes, la traversée des bois, où le héros rencontre de multiples dangers et en ressort
victorieux, évoque le passage de l’enfance à l’âge adulte et la construction de soi.
Lieu de pratique artistique, de délassement, de promenade, ou milieu à protéger des attaques
d’une civilisation industrielle, les multiples symboles se rattachant à la forêt en font un sujet et
un motif récurrent dans l’histoire de l’art.
Les œuvres sélectionnées à partir des collections du Musée d’arts, du 1 7 e au 21 e siècle donnent
à voir cette richesse symbolique ainsi que la source d'inspiration sans cesse renouvelée qu'elle
représente pour les artistes, en peinture, en sculpture, comme pour Giuseppe Penone qui
travaille directement l’arbre, ou même en vidéo (David Claerbout).
L’Âme de la forêt vous
invite à explorer, à votre tour, cette « forêt de symboles » qu’évoque
Charles Baudelaire dans son poème Correspondances, au cœur d'une scénographie évocatrice,
vidéographique et sonore de Bastien Capela et Christophe Sartori.
CYCLES 2 & 3 > VISITE EN AUTONOMIE /4Fiche
d'œuvre 1 7e
Gysbrecht LEYTENS
Anvers, 1 586-1 656
Paysage d'hiver avec gitans et patineurs
Vers 1 640
Huile sur bois
L'œuvre 80 x 1 23 cm
Collection Cacault, achat, 1 81 0
Inv. 502
Un paysage animé
Ce paysage d'hiver est animé par des profondeur au tableau. Cette partie du paysage
personnages se livrant à diverses activités. est le domaine des patineurs et des demeures
Certains patinent sur la rivière glacée sous le paysannes, un univers connu et rassurant.
regard de quelques spectateurs et d'un chien. À gauche, les arbres dessinent des formes
À l'orée du bois, au premier plan, une diseuse inquiétantes, animées par les silhouettes noires
de bonne aventure lit les lignes de la main d'un des oiseaux. La diseuse de bonne aventure
passant. Un homme portant un lourd fardeau ainsi que le personnage et son âne s'enfonçant
est assis au bord du chemin tandis que plus dans la profondeur de la forêt évoquent un
loin, un autre ramasse du bois, accompagné univers plus mystérieux voire inquiétant.
d'un âne bâté. L'artiste oppose deux mondes différents, unis
cependant par un même manteau neigeux qui
Gitans et patineurs recouvre tout et rend imperceptibles les limites
Les bohémiens ou gitans, aux origines entre le ciel et la terre. Il joue des tonalités de
incertaines (la Bohême ou l'Égypte) sont des blanc, délicatement rehaussées par le noir des
personnages prisés par la littérature et le ombres et des branches.
théâtre. Les artistes donnent d'eux une image
fantasmée. La diseuse de bonne aventure, libre Un paysage fidèle à la tradition flamande
et nomade, brave les interdits de la religion Le 1 7 e siècle voit l’émancipation du genre* du
catholique en se livrant à la divination. Le paysage en Europe. Autrefois arrière-plan d'une
personnage est très prisé dans la peinture du scène religieuse, il devient un sujet en soi. Si les
début du 1 7 e siècle (Le Caravage, La diseuse de peintres français et italiens préfèrent les
bonne aventure, 1 593 ; Georges de la Tour, La paysages idéalisés dont l'espace est construit
diseuse de bonne aventure, vers 1 630). par une perspective linéaire*, les artistes
Dans le tableau de Leytens, la bohémienne flamands sont célèbres pour une profondeur
introduit un sentiment de mystère qui contraste obtenue par les jeux et les nuances de
avec les patineurs s'adonnant à l'activité couleurs. Cette perspective dite
hivernale par excellence au 1 7 e siècle dans les atmosphérique* est possible grâce aux
Pays-Bas. subtilités de la peinture à l'huile.
Un paysage familier et inquiétant à la fois Dans ce paysage d'hiver, l'atmosphère du
Une forte diagonale longeant le bord du chemin premier plan se teinte d'ocre et de brun pour
au premier plan structure le paysage. mieux se rapprocher de nous, alors que la ligne
Dans la moitié droite du tableau, l'horizon d'horizon bleutée s'enfonce dans l'espace
s'ouvre sur la rivière gelée bordée d'un pictural. Les détails des éléments naturels et
alignement d'arbres. Les lignes obliques qui des personnages se perdent au fur et à mesure
délimitent le cours d'eau donnent une grande que l’œil avance dans la profondeur du tableau.L'artiste Un peintre très peu documenté Le paysage d'hiver comme spécialité Nous savons très peu de choses concernant la Le succès des paysages et la tendance des vie de Gysbrecht Leytens . peintres à se spécialiser dans un même sujet Peintre paysagiste de l’école flamande, il est fait naître des sous-genres comme les paysages dans un premier temps l’élève de Jacques ruraux, les marines, les paysages de neige, etc. Vrolyck à Anvers en 1 598 et entre dans la Guilde Avant un article paru en 1 942 qui identifie des peintres d'Anvers en 1 61 1 . Il a quelques Leytens, ce dernier était surnommé le « Maître élèves documentés entre 1 61 7 et 1 627 et des paysages d'hiver ». Dans cette spécialité comme bien d'autres peintres néerlandais, il thématique, il suit la tradition flamande (Pieter s'intéresse aussi à la poésie. Il est membre de Brueghel l'ancien, Paysage d'hiver avec patineurs l'importante chambre de rhétorique anversoise et trappe aux oiseaux, 1 565 ; Joos II de Momper, "De Olijftak" et occupe un poste de capitaine de Paysage d'hiver, 1 61 5). la garde civile.
Fiche
d'œuvre 20 e
Max ERNST
Brühl (Allemagne), 1 891 - Paris, 1 976
La Forêt
1 925
Huile sur toile, 87 x 65 cm
Technique du grattage
Achat avec la participation du Fram, 1 986
Inv. 986.5.1 .P
L'œuvre
La Forêt de Max Ernst entre au Musée d'arts de considéré par les surréalistes comme très
Nantes en 1 986, se rapprochant ainsi de proche de l'écriture automatique. Ernst part du
Pornic, lieu de sa création. L'artiste aurait en parquet pour retrouver la forêt : il inverse le
effet réalisé ses premiers frottages dans un processus qui a conduit de la nature au
hôtel de Pornic le 1 0 août 1 925 : « par un plancher.
temps de pluie dans une auberge au bord de la
mer ». La Forêt est probablement la première La forêt : un souvenir d'enfance
d'une quinzaine de peintures portant ce titre, Ernst raconte volontiers son enfance et la décrit
exécutées en 1 925. comme une période de sa vie où regarder et
dessiner étaient ses seuls plaisirs. Il se souvient
Technique du grattage de ses sentiments mitigés, entre ravissement et
La technique du grattage est une adaptation du oppression, lorsque pour la première fois il
frottage sur papier pour la peinture sur toile. pénètre dans une forêt. Il se remémore ses
C'est cette technique que Max Ernst utilise hallucinations fiévreuses devant une armoire
pour livrer cette évocation -plus qu'une en faux acajou dont les nervures semblaient
représentation-, d'une forêt. À l'exception de prendre les traits grossiers de représentations
quelques touches blanches faites au pinceau organiques. Ces souvenirs resurgissent bien
dans la partie gauche, il n'y a plus aucune
survivance du métier traditionnel du peintre des années plus tard dans son travail : la forêt
dans ce tableau. L'artiste superpose plusieurs devient le thème d'une longue série de
couches de peintures sur la toile, puis pose en peintures et la poésie des matières et textures
dessous des objets divers. En grattant la des objets du réel réapparaît au cœur de ses
surface de la toile, il enregistre la texture des recherches grâce aux techniques du frottage
matériaux placés dessous : le bois pour les sur papier et du grattage sur toile. En 1 934,
arbres et le ciel, et un morceau de grillage pour Ernst signe un texte sur Les mystères de la forêt.
le sol.
La forêt comme paysage
Ernst surréaliste Dans ce tableau, Ernst se place et place le
Le grattage est un moyen ludique et indirect spectateur à la lisière du bois. Ses forêts,
d'expression (recouvrir, gratter, découvrir) qui souvent impénétrables, frontales, se dressent
permet, selon l'artiste, « d'assister en comme des barrières qui semblent protéger
spectateur à la naissance de l’œuvre ». l'entrée de mondes secrets.
Ce procédé, libéré du contrôle de la raison, estL'artiste
Entre Allemagne et France De l'exil aux États-Unis au retour en France
Max Ernst est né en 1 891 à Brühl près de Ressortissant allemand, Ernst est arrêté et
Cologne. Son goût pour la peinture lui vient de emprisonné au début de la Deuxième Guerre
son père, instituteur et peintre amateur. mondiale. En 1 941 , il parvient à s'enfuir aux
À 1 9 ans, à la faculté de lettres de Bonn, il États-Unis où il épouse Peggy Guggenheim.
s'intéresse à la philosophie et se consacre Ses techniques expérimentales ont un impact
bientôt à l'art.
En 1 91 3, il s'installe à Paris où il côtoie les important sur l'avant-garde new-yorkaise.
artistes d'avant-garde comme Guillaume Jackson Pollock s'intéresse particulièrement au
Apollinaire et Robert Delaunay. Un an plus tard, tableau d'Ernst Tête d'homme intriguée par le vol
il est mobilisé par l'armée allemande. d'une mouche non-euclidienne, réalisé en 1 942
En 1 91 7, Ernst rejoint le groupe Dada formé selon la technique du dripping (gouttes de
pendant la guerre. Ce mouvement international peinture qui tombent aléatoirement sur une
revendique la remise en cause totale de toutes toile posée au sol).
conventions et contraintes idéologiques, En 1 953, Ernst revient à Paris avant de se fixer à
esthétiques et politiques . Huismes, près de Chinon, avec sa nouvelle
femme, l'artiste Dorothea Tanning.
Un artiste expérimentateur Il meurt à Paris en 1 976.
Ernst développe des techniques variées qu'il
invente ou adapte avec virtuosité dans de
nombreux domaines. En 1 921 , il expose pour la
première fois à Paris des collages accompagnés
d'un texte d'André Breton. Il est ensuite
naturellement associé au surréalisme* dès
1 924. Puis en 1 925, alors qu'il passe l'été à
Pornic à l'hôtel de France, il redécouvre la
richesse du frottage. 34 dessins réalisés à l'aide
de ce procédé sont publiés en 1 926 par la
galerie Jeanne Bucher, dans un album intitulé
Histoire Naturelle, dont le Musée d'arts de
Nantes conserve un exemplaire.
Autres œuvres
Voir l'album Histoire naturelle, 1 926, de Max Ernst, réunissant des estampes réalisées à partir de la technique
du frottage et conservées dans les collections du Musée d'arts de Nantes. Consultez la base de données des
collections en ligne :https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/#/Fiche
d'œuvre 20 e
Joan MITCHELL
Chicago, 1 926 – Paris, 1 992
Tilleul
1 978
Huile sur toile
AM 1 995-1 6 8
Dépôt du Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle,
Centre Pompidou, 1 996
Inv. D.996.3.3.PI
L'œuvre
Abstraction ? Figuration ? Elle transmet la verticalité de l'arbre et la masse
Le titre renvoie au monde réel, au figuratif. du feuillage par de larges traits dynamiques.
Pourtant Joan Mitchell ne cherche pas à le L'artiste doit s'éloigner pour regarder la toile en
représenter ou le décrire, mais à retranscrire les entier et revenir vers elle pour poursuivre.
sensations éprouvées face à la nature. Elle Cette peinture gestuelle rapproche le travail de
donne de cet arbre évoqué par le titre, Joan Mitchell de celui des peintres
certainement le tilleul de son jardin à Vétheuil , expressionnistes abstraits tels que Willem de
une transposition sensible. Kooning.
L'artiste peint ses souvenirs visuels et
sensoriels : « Je peins d'après des paysages La puissance des couleurs
remémorés que j'emporte avec moi et le La palette fortement contrastée mêle un noir
souvenir des sentiments qu'ils m'ont inspirés et profond à un bleu froid, que des traits orangés
qui, bien évidemment sont transformés ». viennent illuminer. Les couleurs sont
appliquées par des coups de brosse vigoureux,
Un format loin de la tradition du paysage énergiques et rapides. Les traces laissées par
En choisissant de peindre sur une toile de très l'outil - coulures, épaisseurs, empâtements -
grand format et posée à la verticale, Mitchell témoignent du dynamisme du geste et de
montre sa volonté de s'éloigner de la tradition l'implication du corps tout entier de l'artiste
du paysage et de son format horizontal. La toile dans l'exécution de la peinture. La composition
n'est plus une surface où l'on représente le semble ainsi palpiter et vibrer sous nos yeux. À
monde, elle devient « une arène dans laquelle partir de cette série, l'artiste commence à
agir », comme l'avait écrit le critique Rosenberg peindre principalement la nuit, vérifiant
au sujet des œuvres de l'expressionnisme l'exactitude des couleurs seulement le
abstrait* américain. Le spectateur à son tour lendemain à la lumière du jour.
peut s'immerger dans ce tableau de grande
échelle. Observation incessante de la nature
Mitchell perçoit chaque chose de la vie à travers
L'expressivité du geste une couleur liée à la nature. Elle s’immerge au
L'intensité, la puissance et le dynamisme du cœur de la toile et livre des champs colorés
geste transparaîssent dans cette œuvre. Devant qu’elle multiplie en polyptyques. Au cours des
cette toile de grand format, l'artiste exécute des années 1 980-1 990, la peinture évoque plus que
gestes énergiques et rapides qui engagent son jamais le paysage : La Grande Vallée, Rivière,
corps tout entier. Champs, Bleuets, Tilleuls…L'artiste
Formation et débuts Seconde génération
Née à Chicago en 1 925, Joan Mitchell vit dès son Joan Mitchell fait partie de la seconde
enfance dans un milieu très stimulant. Après un génération de l'expressionnisme abstrait*,
cursus littéraire, elle s'inscrit à l'« Art Institute» avant tout héritière de de Kooning, c'est à dire
de Chicago. Elle s'installe à New-York et débute d'une pratique de la peinture gestuelle comme
sa carrière, où elle fréquente le groupe des expression libre.
expressionnistes abstraits. Elle y rencontre La peinture abstraite et gestuelle de Joan
Franz Kline et Willem De Kooning qui l'initient Mitchell est avant tout liée à l'émotion ressentie
aux variantes de la peinture abstraite, et prend devant la nature.
part à l'effervescence de la vie artistique new-
yorkaise. Une bourse d'étude lui permet de Inclassable
venir en France en 1 948. À partir de ce moment Joan Mitchell, dans son travail singulier, sensible
là, elle partage sa vie entre les États-Unis et la et poétique, échappe aux étiquettes. Elle se
France avant de s'installer définitivement dans veut hors normes, refusant toute règle,
le village de Vétheuil en 1 967. méthode ou tout système en général, restant
exclusivement à l'écoute de sa sensibilité et de
Vétheuil et l'influence de Monet ses émotions.
L'installation de Mitchell en 1 967 dans le village Elle fait le choix difficile de s'isoler en France au
de Vétheuil marque profondément son travail.
Dans ce lieu autrefois fréquenté par Claude moment même du triomphe de l'école
Monet, sa peinture synthétise deux courants américaine.
picturaux qui l'ont profondément influencée :
l'impressionnisme* et l’expressionnisme
abstrait*. L'observation de la nature, l'intérêt
pour la couleur et la lumière, la touche
apparente et le travail en série sont de
nombreux points communs avec l'œuvre de
Monet.
Ressources
- Pour découvrir les autres oeuvres de l'artiste conservées dans les collections du Musée d'arts de Nantes,
consultez la base de données des collections en ligne: https://www.navigart.fr/museedartsdenantes/#/Fiche
d'œuvre 20 e
Giuseppe PENONE
Garessio (Italie), 1 947
Arbre de 7 mètres
1 986
Bois
350 x 34 x 68 cm
Inv. : 988040303
© Adagp, Paris
Crédit photographique : Gérard Blot/Agence photographique de la
Réunion des Musées NationauxHindustrielle, Centre Pompidou, 1 996
L'œuvre
De la poutre à l'arbre Socle ou pas socle ? La relation au
Giuseppe Penone remonte le temps dans cette spectateur
œuvre en retrouvant dans une poutre, objet Cette œuvre se compose de deux parties bien
manufacturé, l'origine de l'arbre. Il taille distinctes, toutes deux issues de la même
progressivement et minutieusement le bois afin matière première : l'arbre. En haut, et en
de faire réapparaître le cœur de l'arbre et la dessous, la poutre laissée intacte rappelle le
naissance des branches. piédestal qui mettait en valeur les sculptures
traditionnelles en ronde bosse . Mais malgré ce
Une hauteur imposante "socle intégré", l'œuvre de Penone s'appuie
L'arbre de 7 mètres est présenté divisé en deux directement sur le sol, à l'égal du spectateur qui
parties de 3,5 mètres de haut. D'un côté, la peut ressentir une certaine proximité avec elle.
circonférence plus importante du tronc indique
qu'il s'agit de la partie de l'arbre proche de sa Une œuvre de l'Arte Povera *
base. De l'autre, s'observe la partie près de la En 1 967, le critique d'art Germano Celant
cime de l'arbre, plus fine. Penone confronte regroupe sous le terme d’ « Arte Povera »* les
ainsi, au même niveau, les deux extrémités du œuvres d'artistes italiens réalisées pour la
tronc. Cette œuvre fait partie d'une série plupart avec des matériaux « pauvres »,
commencée par l'artiste en 1 969. quotidiens (cordes, ciment, terre, végétaux...)
contrastant avec les matériaux traditionnels de
la sculpture tels que le marbre et le bronze.
Tradition de la sculpture : la taille directe Certaines œuvres de l’Arte Povera sont pour
Penone s'inscrit avec cette œuvre dans la cette raison éphémères ou presque
tradition de la sculpture. Il utilise la technique impossibles à conserver.
de la taille directe. Il enlève de la matière en Ce groupe, dans lequel Penone est le dernier
suivant les lignes de l'arbre (les cernes) pour arrivé, rassemble une douzaine d'artistes dont
retrouver la forme initiale de l'arbre. Alighiero e Boetti, Luciano Fabro, Pino Pascali,
Michelangelo Pistoletto, artistes présents dans
les collections de Nantes.L'artiste
Un ancrage dans la nature Revenir à l'essence de l'arbre
Giuseppe Penone est né en 1 947 à Garessio, Dès 1 969, il débute un travail de sculpture à
province du Piémont italien. Il étudie la partir de poutres ou de planches de traverse. Il
comptabilité avant de suivre une formation à cherche à retrouver l'origine de l'arbre dans
l’École des Beaux Arts de Turin. C'est à partir de cette matière transformée.
cette période qu'il développe une approche « C’est extraordinaire de retrouver la forme que
artistique singulière qui le différencie de ses quelque chose pouvait avoir à un instant précis
autres camarades. de sa croissance. J’ai fait ça au moment de l’art
Il décide de retourner dans son village natal, un minimal : prendre une poutre industrielle, un
endroit familier, dans lequel il a grandi, joué et morceau de bois travaillé par l’homme et
construit une mythologie personnelle. devenu planche, et retrouver quelque chose de
l’ordre de l’organique ».
La forêt, espace de l'œuvre et source Après la tempête de 1 999 en France, Penone
d'inspiration achète aux enchères deux très grands cèdres
Penone place dans la nature ses premières de Versailles qui avaient été déracinés. Il
actions. En 1 968, il questionne le rapport entre continue alors cette série sur une échelle
l'homme et l'arbre avec la sculpture L'arbre beaucoup plus grande.
poursuivra sa croissance sauf en ce point. L'artiste
serre le tronc d'un jeune arbre dans sa main. Ce La nature et le corps de l'artiste
point de départ de l'œuvre nous est connu par Dans sa recherche d'un nouveau rapport entre
une photographie. Il place ensuite un moulage l'homme et la nature, Penone utilise des
de sa main, en bronze, à l'emplacement même matières premières inattendues comme des
de son geste initial sur le tronc de l'arbre. pommes de terre, des citrouilles, qu'il oblige à
L'arbre, dans une temporalité qui lui est propre, grandir dans des moulages de ses organes
continue sa croissance en s'adaptant à cet
élément extérieur, à ce corps étranger. sensoriels : son nez, sa bouche, ses oreilles.
Avec cette œuvre, connue du public par des (Patate, 1 977, Citrouille,1 978). Là encore,
photographies, Penone instaure un dialogue l'élément vivant s'adapte et prend ici la forme
entre la nature, l'homme et le temps et pose les du moule proposé.
jalons de sa production. Dans Retourner ses propres yeux, en 1 970, il
questionne son regard en portant des lentilles
de contact miroir qui empêchent la vue mais
dans lesquelles se reflète le monde.
Dans la série Souffles, débutée en 1 978, il laisse
l'empreinte de son corps dans une masse
importante d'argile, laissant la terre entrer dans
sa bouche pour garder la trace de son souffle
vital.
Autres œuvres
Dans Pages de terre II, 1 987, appartenant aux collections de Nantes et présentée dans le Cube niveau 0, il
recueille sur trois outils de jardinage une fine couche d'argile. En se pliant, les lames de terre forment des
courbes évoquant le corps. Elles contrastent avec les lignes droites et affirmées des outils sur lesquels elles
sont présentées.
Consultez la base de données des collections : https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/collectionsFiche
d'œuvre 21 e
David CLAERBOUT
Courtrai (Belgique), 1 969
Le Moment
2003
Production New Museum (New York) et Bick Productions
vidéo
Achat, 2004
Inv. 04.3.2.V
L'œuvre
Commandée pour une anthologie de l'art faussement négligée. Cependant toute œuvre
vidéo de l'artiste fait l'objet d'un travail digital
En 2003, David Claerbout fait partie des onze important.
artistes sollicités par le New Museum of
Contemporary Art de New York pour participer Une bande-son angoissante
à une anthologie DVD de l’art vidéo, filmique et La bande-son de The Moment mêle « Police », un
digital contemporain : Point of View : An morceau composé par Angelo Badalamenti
Anthology of the Moving Image. pour le film de David Lynch, The Lost Highway
L’anthologie est conçue comme une façon de (1 997) à des bruits d'insectes. Ce fond sonore
rendre plus accessible l'art vidéo aux musées, oppressant renforce le suspense suscité par
aux universités et aux écoles d’art à travers le l’espace peu éclairé. Les masses des arbres
monde. À cette occasion, il travaille aux côtés défilent, uniquement perturbées par le vol
des vidéastes les plus reconnus : Francis Alÿs d'insectes.
ou Anri Sala. Dans le cadre de ce projet, David
Claerbout produit une œuvre, The Moment, Des imaginaires de la forêt renversés par le
accompagnée d’une interview. contre-pied final
Le spectateur attend, angoissé, une rencontre
Une déambulation inquiétante pressentie comme dangereuse. Lorsque la
Durant 2 minutes 44 secondes, la vidéo en
caméra s’arrête en un plan fixe, un profond
couleur nous fait pénétrer à l’intérieur d’une
revirement émotionnel s'opère. Des bruits de
forêt de nuit. Via une caméra subjective, la
pas amplifiés se font entendre puis les
déambulation alterne les plans à hauteur
miaulements d’un chat. L’animal tigré, gris, noir
d'homme et ceux où la caméra est orientée
et blanc surgit des bois. Inoffensif, il traverse le
vers le sol. Elle semble ainsi mimer l'affolement
plan avant de disparaître derrière un arbre. Ce
du promeneur nocturne.
contre-pied final peut se lire comme un
clin d’œil amusé aux imaginaires traditionnels
Une réalisation inspirée du cinéma de la forêt en lieu inquiétant voire dangereux.
d'horreur
La réalisation fait écho au célèbre film
d'horreur, Le projet Blair Witch , réalisé en 1 999 Un artiste, plusieurs visions de la forêt
par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Le film a L'artiste propose une version tout à fait opposée
popularisé le found-footage [enregistrement de la forêt dans Travel (1 996-201 3). La
trouvé] consistant à présenter une partie ou la promenade onirique dans les bois surgit dans
totalité d'un film comme un enregistrement l'esprit de Claerbout après avoir écouté une
vidéo authentique. Ici la réalisation semble musique de relaxation. La forêt incite cette fois
vériste en proposant une qualité visuelle à l'apaisement et au sommeil.L'artiste
Formation et débuts
Né à Courtrai en 1 969, David Claerbout se forme La matière visuelle est ensuite retravaillée ou
au National Hoger Instituut voor Schone littéralement recréée lors d'un processus de
Kunsten d’Anvers. Il y bénéficie d'un postproduction numérique et plastique. La
apprentissage classique du dessin, de la transformation peut se circonscrire à de
peinture et de la lithographie. Il intègre ensuite simples incrustations numériques (Rurulo
ces disciplines au processus créatif de son Bocurlosheweg, 1 91 0 ; 1 997) ou provenir
œuvre vidéo. d'ajouts graphiques ou picturaux réalisés par
Depuis le milieu des années 1 990, son l'artiste sur une impression papier. Mais la
esthétique et ses préoccupations théoriques recréation d'une image peut aussi être totale
majeures se cristallisent. Ses créations mêlent (Travel ; 1 996-201 3). Les captations réelles font
les images fixes et vidéos, réelles et virtuelles. Le place à une pure image de synthèse.
temps et sa perception devient un
questionnement majeur. Claerbout interroge le Du bref coup d'œil à l'école du regard
spectateur sur le temps représenté dans ses David Claerbout souligne qu'il s'efforce de
créations en jouant des phénomènes de toujours présenter deux situations opposées
ralentissement, d'accélération et de dans ses créations. Dans un premier temps, ses
superposition de durées contradictoires. Mais il œuvres invitent à une analyse univoque
amène aussi son public à réfléchir à l'usage qu'il reposant sur une atmosphère, un temps et un
fait de son propre temps. espace donnés. Mais une contemplation plus
Créant seul et dépourvu de moyens approfondie permet au public de déceler une
technologiques à ses débuts, l'artiste effectue seconde lecture à travers le repérage
désormais son travail en studio entouré d'une d'éléments contradictoires. Ces indices sont
équipe. semés afin que le spectateur puisse décoder
l'image et en saisir la complexité. Tout en
De la photo à la vidéo, du réel au virtuel éprouvant un sentiment de contrôle, le public
Une des principales caractéristiques de l'œuvre prend conscience du leurre que peut impliquer
de Claerbout semble être l'introduction du toute image. En mêlant, la photographie et la
mouvement dans une image fixe. Ses créations vidéo, l'image réelle et l'image virtuelle,
naissent le plus souvent d'images célèbres ou Claerbout convertit son œuvre en école du
peu connues, trouvées en bibliothèque, sur regard.
internet ou enregistrées par l'artiste lui-même.
Ressources
- Pour visionner l'œuvre, consultez le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=3gnjAEJqY3U
- Pour découvrir d'autres œuvres de l'artiste, consultez son site internet : https://davidclaerbout.com/Glossaire
Arte Povera Impressionnisme
En 1 967, le critique d'art Germano Celant regroupe sous À la fin du 1 9 e siècle, certains artistes comme Claude
le terme d’ « Arte Povera » les œuvres de jeunes artistes Monet, Auguste Renoir ou Gustave Caillebotte
italiens réalisées avec des matériaux « pauvres », expérimentent la peinture en extérieur. En 1 874,
quotidiens (cordes, ciment, terre, végétaux...) Monet présente lors d'une exposition organisée par
contrastant avec les matériaux traditionnels de la Nadar l’œuvre Impression Soleil Levant. La critique alors
sculpture. Les œuvres de l’Arte Povera sont pour la publiée par Louis Leroy dans le Charivari est à l'origine
plupart éphémères ou irrécupérables. Elles privilégient du terme « impressionnisme ». Les artistes
le processus plutôt que l’objet réalisé et remettent en impressionnistes sont en rupture avec la peinture
cause l'idée même de culture, de progrès, dans une académique officielle et souvent influencés par l’art
attitude de défi face à la société de consommation. japonais et la photographie. Ils cherchent à
Ce groupe rassemble une douzaine d'artistes dont retranscrire la réalité et la modernité de leur époque.
Alighiero e Boetti, Luciano Fabro, Pino Pascali, Le paysage urbain ou rural est au cœur de leur
Michelangelo Pistoletto, artistes présents dans les production. Ils sortent des ateliers pour travailler
collections du Musée d'arts de Nantes. directement en plein-air, peignant à présent leurs
impressions en captant les vibrations de la lumière et
Expressionnisme abstrait les nuances de couleurs sur des toiles de petit format.
Après la Seconde Guerre mondiale, en Europe comme
en Amérique du nord, apparaît une nouvelle forme de Perspective atmosphérique
peinture abstraite qui privilégie l'expression spontanée Alors que la perspective linéaire est définie en Italie,
de l’artiste sur la toile. Cette abstraction gestuelle est les artistes Flamands mettent au point un autre
appelée « Abstraction lyrique » à Paris et système de représentation de l’espace. Ils cherchent à
« Expressionnisme abstrait » ou « Action Painting » en rendre sur la toile le caractère illimité de l’espace en
Amérique du nord. Les plus célèbres représentants sont restituant ce qu'ils observent des phénomènes
Jean-Paul Riopelle, Joan Mitchell ou Jackson Pollock. climatiques. La perspective dite « atmosphérique ».
Les artistes qui pratiquent cette abstraction accordent restitue l'aspect vaporeux de l'horizon. Elle se
plus d'importance à l'acte physique de peindre qu'au décompose en plans successifs, allant des bruns et
résultat produit. Ils transforment la toile, souvent de des ocres du sol au premier plan, aux verts et aux
grand format, en un espace d’expérimentation. Avec une bruns orangés du second plan, jusqu’aux bleus des
grande liberté de techniques, d'outils et de matières, ils lointains brumeux.
réalisent une œuvre qui est le témoin de cette
expérimentation, la trace matérielle des gestes, des
Perspective linéaire
En 1 435, l’architecte et humaniste italien Leon Battista
mouvements du corps vivant, en action, de l'artiste. Alberti définit les règles de la perspective dite
« linéaire » dans son traité De Pictura. Le tableau doit
Genres être une fenêtre ouverte sur le monde et donner
Mot qui désigne les grandes catégories de sujets traités l’illusion du réel, d’un espace en trois dimensions
en peinture : peinture d'histoire (sujets mythologiques, (hauteur, largeur et profondeur). Il s’agit de
chrétiens ou historiques, allégorie), portrait, scène de représenter sur la surface plane du tableau l’image
genre, paysage, nature morte. Cette hiérarchisation des perçue par l’œil et notamment l'illusion de la
genres définie au 1 7 e siècle par l'Académie royale de profondeur par l'usage géométrique de lignes qui
peinture et de sculpture reconnaît la peinture d'histoire convergent toutes vers un même point de fuite,
comme le genre majeur ou le « grand genre » tandis généralement situé sur la ligne d’horizon.
que les autres catégories appartiennent aux genres
mineurs.
Le 1 9 e siècle puis le 20 e siècle mettent un terme à cette
hiérarchisation des genres.
CYCLES 2 & 3 > VISITE EN AUTONOMIE /1 5Romantisme Surréalisme
Le groupe des surréalistes se forme dans les années
Courant artistique qui domine la première moitié du
1 920, animé d'un esprit de révolte qui caractérise les
1 9 e siècle en France. Cette tendance apparue en
avant-gardes de l'entre-deux-guerres. Le mouvement
Grande-Bretagne au 1 8 e siècle touche divers domaines
est d'abord littéraire puis s'étend aux arts plastiques,
artistiques : littérature, musique peinture, avec des
à la photographie et au cinéma. Guillaume Apollinaire
artistes aussi emblématiques que Victor Hugo, Frédéric
utilise le premier ce mot en 1 91 7, en qualifiant de
Chopin ou Eugène Delacroix. Comme l'explique
« drame surréaliste » sa pièce Les mamelles de Tirésias.
Baudelaire en 1 846 : « Le romantisme n'est
Le terme désigne selon lui une invention qui ne
précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la
cherche pas à imiter le réel.
vérité exacte, mais dans la manière de sentir ». Ces
Le théoricien du mouvement, l'écrivain André Breton,
artistes partagent des thématiques et des sensibilités
en donne une définition dans le premier texte-
communes. Ils s'opposent à la tradition académique
manifeste publié en 1 924 : « Automatisme psychique
qui défend la beauté idéale pour proposer une œuvre
pur par lequel on se propose d’exprimer, soit
basée sur les sentiments. Les états d'âme des artistes
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre
se retrouvent dans les toiles. Les compositions
manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée
deviennent plus mouvementées et la couleur
de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par
transcende le sujet.
la raison, en dehors de toute préoccupation
esthétique ou morale. »
S’inspirant de la peinture de Giorgio de Chirico,
fondatrice de l’esthétique surréaliste, les artistes du
groupe réduisent le rôle de la conscience et
l’intervention de la volonté par le recours à des
techniques comme le frottage, le collage, ou le dessin
automatique.
Leur première exposition collective a lieu à Paris en
1 925 à la Galerie Pierre. Puis le mouvement se diffuse
largement à l’étranger.Liens avec les progammes de 6e Pour vous accompagner à préparer votre visite de l'exposition, l'équipe enseignante rattachée au musée propose des pistes d'éducation artistique et culturelle, disciplinaires ainsi que des ressources à exploiter avec vos élèves. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec les coordinatrices territoriales, Géraldine Baillarguet (lettres) geraldine.baillarguet@ac-nantes.fr, Anne Herrier (lettres-histoire) anne.herrier@ac- nantes.fr et Christel Culos (arts plastiques) christel.culos@ac-nantes.fr. ARTS PLASTIQUES Collège En classe de 6 e : 1 . La représentation plastique et les dispositifs de présentation - Ressemblance et écart dans la représentation (Joan Mitchell) - Autonomie du geste : incidences sur la représentation et l’unicité de l’œuvre (Joan Mitchell) - Multiplicité d’images : les différentes catégories et leurs procédés de fabrication - Narration visuelle : compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage ; organisation des images fixes et animées pour raconter (David Claerbout, Gysbrecht Leytens, Edgard Maxence) - Mise en regard et en espace : la scénographie, une mise en abîme de la forêt ? - Prise en compte du spectateur : modalités de présentation et de réception des œuvres. Caractéristiques de la scénographie de Bastien Capela et Christophe Sartori (espace, son, lumière, couleur) 2. Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace - Espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume (Giuseppe Penone) 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre - Réalité concrète de production ou d’une œuvre : rôle de la matérialité dans les effets sensibles que produit une œuvre (Max Ernst) - Caractéristiques physique des matériaux (porosité, rugosité, liquidité, malléabilitéW) : leur incidence sur la pratique plastique en deux dimensions (Joan Mitchell) - Effets du geste et de l’instrument : qualités plastiques et effets visuels obtenus par la mise en œuvre d’outils, de médiums et de supports variés ; par l’élargissement de la notion d’outil ; par les dialogues entre instruments et matière (touche, trace, texture, facture, traînée, coulureW) ; par l’amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité. - Matérialité et qualité de la couleur : découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée, des effets induits par les usages (jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, W), les supports, les mélanges avec d’autres médiums ; la compréhension des dimensions sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre quantité et qualité (Joan Mitchell, Gysbrecht Leytens).
GÉOGRAPHIE
Collège
En classe de 6 e :
« Mon espace proche : paysages et territoires »
« Habiter le monde rural »
Pistes EAC
A-LA FORÊT ET L’IMAGINAIRE
1 - Une forêt inquiétante, qui suscite des sentiments négatifs (peur, angoisse, crainte, effroi, W)
Avant la visite : Définir et distinguer sentiments, émotions, sensations.
Pendant la visite: Après avoir observé les œuvres, construire un court récit en vous appuyant sur deux ou
trois œuvres de votre choix et en faisant ressortir un ou plusieurs sentiments, sensations et émotions.
Après la visite: Exploiter la scénographie pour construire une nouvelle à chute.
2- Une forêt apaisante, qui suscite des sentiments positifs (joie, sérénité, plénitude, calme, protection, W)
Avant ou après la visite, au jardin des plantes
Balade sensorielle : observer, méditer, sentir, se ressourcer, écouter, toucher. À exploiter, par exemple, en
lien avec une réflexion sur les compétences psycho-sociales
B- UN LIEU INITIATIQUE
1 - Lieu mystérieux, espace de découverte et d'aventures, de liberté, de rituels magiques
Après la visite: À partir de l’œuvre vidéo de D. Claerbout, construire un synopsis cinématographique (court-
métrage, film, ou série), qu'on pourra compléter par une image-clé du récit, un story-board, W
2-Lieu intime, secret, propice à l'éveil
Avant ou après la visite
« Classe en plein air » : une expérience sensible de la forêt
« À l'écoute de la forêt, à l'écoute de soi » :
- Mettre en voix un texte dans un lieu
- Écouter le lieu, donner à entendre les voix de la forêt, le « murmure » de la forêt
C- LA FORÊT VIVANTE
1 - Les métiers de la forêt
Avant ou après la visite :
- Interviews sur les métiers du bois (rencontres ; utilisation des 35 fiches métiers sur le site de l'ONISEP)
- Portraits de travailleurs de la forêt (description de gestes, métiers d'hier et d'aujourd'hui, W)
- Élaborer une fresque / une galerie des métiers de la forêt
- Réaliser une exposition sur ces métiers, à partir de capsules vidéos
- Exploiter les archives pour découvrir des métiers anciens2- Un écosystème fragile (fragilisé par l'homme?) Pour les classes de 6 e, en arts plastiques, Lettres, SVT La diversité faisant un tout : sensibiliser à la variété des végétaux de la forêt (diversité des essences, des formes, des couleurs, des noms de plantes et termes les qualifiant) Pour les classes de 6 e, en arts plastiques, Lettres, Histoire-Géographie Art engagé en lien avec l'environnement, argumenté en français et documenté en Histoire-Géographie. Dispositif « classe en plein air » : décrypter le paysage 3- Lieu d'inspiration et de création artistique (matière et atmosphère) Pendant la visite : cueillir des mots, des phrases, des impressions, des sentiments, des fragments d'images qui seront le point de départ d'une pratique artistique argumentée. Après la visite : - Une production mêlant texte et image - Une page de BD dont le décor est la forêt - Créer in situ en adoptant une démarche écoresponsable D- LA FORÊT ET LA VILLE 1 - L'arbre, œuvre d'art dans la ville (la gare de Nantes de Rudy Riccioti, Lunar tree de MRZYK & MORICEAU) - An 2999 : À l'aube du 3 e millénaire, la forêt prend le dessus sur la ville. (Arts-Plastiques / Français) - Un parcours : l'arbre dans Nantes - Reportage photographique faisant ressortir un point de vue sur l'arbre dans la ville. Présenter ensuite ce reportage en argumentant - Projet éco-citoyen : une mini-forêt dans mon établissement 2- La forêt dans la ville (la petite Amazonie...) - De la forêt à la ville en dix cases (bande dessinée sans parole), puis faire ajouter un texte à chaque case par un autre élève (description, récit, dialogue, monologue intérieur, W)
Vous pouvez aussi lire